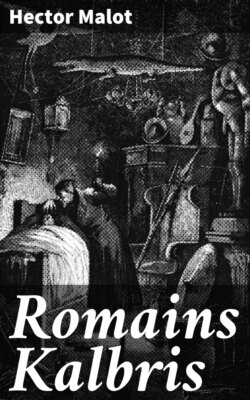Читать книгу Romains Kalbris - Hector Malot - Страница 7
V
ОглавлениеMa réception chez M. de Bihorel justifia pour moi sa réputation d’originalité, dont j’avais tant entendu parler.
En arrivant, je le trouvai devant la porte de la maison, car, m’ayant vu de loin, il était venu au-devant de moi.
— Arrive ici, dit-il sans me laisser le temps de me reconnaître. As-tu jamais écrit une lettre? Non. Eh bien! tu vas en écrire une à ta mère pour lui dire que tu es arrivé et que Samedi ira demain chercher ton linge. Par cette lettre je verrai ce que tu sais. Entre, et mets-toi là.
Il me fit entrer dans une grande salle pleine de livres, me montra une table sur laquelle étaient du papier, des plumes, de l’encre, et me laissa.
J’avais plus envie de pleurer que d’écrire, car cette brusquerie, me tombant sur le cœur après l’émotion de la séparation, me suffoquait; cependant je tâchai d’obéir. Mais je salis mon papier de plus de larmes que d’encre, car, bien que ce fût ma première lettre, je sentais que: «Je suis arrivé et Samedi ira demain chercher mon linge,» c’était un peu court, mais il m’était impossible de trouver autre chose.
J’étais depuis un quart d’heure écrasé sous cette malheureuse phrase qui ne voulait pas s’allonger, lorsque mon attention fut distraite par une conversation qui s’engagea dans la pièce voisine entre M. de Bihorel et Samedi.
— Pour lors, disait Samedi, l’enfant est arrivé.
— Pensais-tu qu’il ne viendrait pas?
— Je pensais que ça va changer tout ici.
— En quoi?
— Monsieur déjeune vers midi; moi, je prends ma goutte le matin: l’enfant attendra-t-il midi pour manger, ou bien boira-t-il la goutte avec moi?
— Tu es fou avec ta goutte.
— Dame! je n’ai jamais pris d’enfants en nourrice.
— Tu as été enfant, n’est-ce pas? Eh bien! souviens-toi de ce temps-là et traite-le comme on te traitait toi-même.
— Ah! mais non, pas de ça dans votre maison; moi, j’ai été élevé à la dure; si vous voulez l’élever comme ça, mieux vaut le renvoyer chez lui. N’oubliez pas que vous lui devez quelque chose, a ce petit.
— Ne l’oublie jamais toi-même et agis en conséquence.
— Alors faut lui donner la goutte avec du sucre.
— Tu lui donneras ce que tu aimais à son âge; ou plutôt tu lui demanderas ce qu’il veut.
— Si vous le mettez sur ce pied-là, ça ira bien.
— Samedi, sais-tu à quoi servent les enfants?
— Ça ne sert à rien qu’à dévaster tout et à faire damner le monde.
— Cela sert encore à autre chose: cela sert à recommencer notre vie quand elle a dévoyé ; cela sert à réussir ce que nous avons manqué.
Presque aussitôt il rentra.
— Tu ne sais rien, dit-il en lisant ma lettre, tant mieux; il n’y aura pas à arracher avant de planter. Maintenant, va te promener.
C’était vraiment une singulière habitation que cette île, qu’on nommait la Pierre-Gante, et telle que jamais je n’ai rien vu qui lui ressemblât.
Du rivage, l’île se présente en amphithéâtre sous la forme d’un triangle allongé dont la pointe la plus longue et la plus basse n’est séparé de la terre ferme que par un petit bras d’eau large à peine de quatre cents mètres. Tout ce qui est incliné vers la côte est couvert de verdure, herbe et arbustes que crèvent seulement çà et là quelques aiguilles grises de granit; tout ce qui regarde la mer est dénudé, pelé, brûlé par les vents et le sel.
La maison est située au sommet de l’île, à l’endroit même où les pentes se réunissent pour former un petit plateau, et si, par le fait de sa position, elle jouit d’une vue circulaire qui embrasse l’horizon aussi bien sur terre que sur mer, elle est, par contre, exposée à toute la violence des vents, de quelque côté qu’ils soufflent. Mais les vents ne peuvent rien contre elle, car, bâtie sous lé ministère de Choiseul pour s’opposer aux débarquements des Anglais et se relier aux nombreux corps de garde de la côte, elle a des murailles en granit de plusieurs pieds d’épaisseur, et un toit à l’épreuve de la bombe. Quand M. de Bihorel avait acheté cette vieille bicoque, il l’avait, à l’extérieur, entourée d’une galerie qui l’égayait en l’agrandissant, et, à l’intérieur, transformée en maison habitable, au moyen de cloisons et de portes. Il ne l’avait rendue ainsi ni commode ni élégante, mais il ne lui avait rien enlevé de sa qualité indispensable, qui était d’être aussi solide sous le vent que le rocher lui-même dont elle faisait partie.
Ces vents terribles, qui sont l’ennemi contre lequel il faut sans cesse se défendre, sont cependant en même temps un bienfait pour l’île. Ils lui donnent en hiver une température plus douce que dans l’intérieur des terres, si bien que, dans les creux du terrain, à l’abri des rochers ou des éboulements, on rencontre des plantes et des arbustes qui, sous des climats moins rudes, ont besoin de la protection d’une serre: des lauriers-roses, des fuchsias, des figuiers.
Le plus grand nombre des accidents de terrain étaient dus à la nature; mais quelques-uns avaient été créés par M. de Bihorel, qui, aidé de Samedi, avait transformé l’île en un grand jardin sauvage; seule, la partie exposée à l’ouest avait échappé à leur travail; continuellement tondue par les vents et arrosée de l’écume des vagues, elle servait de pâturage à deux petites vaches bretonnes et à des brebis noires.
Ce qu’il y avait de curieux dans ces travaux de transformation et d’appropriation en réalité considérables, c’est qu’ils avaient été accomplis par ces deux hommes seuls, sans le secours d’aucun ouvrier.
J’avais souvent entendu dire dans le pays que c’était par avarice que M. de Bihorel agissait ainsi; lorsque je le connus, je vis que c’était, au contraire, en vertu d’un principe. «L’homme doit se suffire à lui-même, répétait-il souvent, et je suis un exemple vivant que cela est possible. »
Il poussait si loin cette idée dans son application, que, même pour les choses ordinaires et journalières de la vie, il n’avait recours à aucun étranger. On se nourrissait du lait des vaches, des légumes et des fruits du jardin, du poisson pêché par Samedi, du pain cuit à la maison avec de la farine moulue dans un petit moulin à vent qui était assurément le chef-d’œuvre de M. de Bihorel: l’île eût été assez grande qu’on lui eût fait produire le blé nécessaire à la provision de l’année et les pommes pour presser le cidre.
Pour être juste, il faut dire que la part de Samedi était considérable; il avait été mousse, matelot, domestique d’un officier de marine, cuisinier à bord d’un baleinier, et il avait ainsi fait l’apprentissage de tous les métiers.
Les rapports entre ces deux hommes n’étaient pas ceux d’un maître et d’un domestique, mais de deux associés; ils mangeaient à la même table, et la seule distinction entre eux était que M. de Bihorel occupait le haut bout. Ainsi organisée, cette existence avait quelque chose de simple et de digne qui ne m’étonna pas quand je m’y trouvai mêlé, mais qui maintenant me touche et m’émeut encore.
— Mon garçon, me dit M. de Bihorel dès le jour de mon arrivée, je n’ai pas l’intention de faire de toi un monsieur, c’est-à-dire un notaire ou un médecin, mais tout simplement un marin qui soit un homme. Il y a plus d’une façon de s’instruire: on peut s’instruire en jouant et se promenant. Ce système est-il de ton goût?
Ce discours était un peu bizarre pour un enfant tel que moi. La pratique m’expliqua ce que je n’avais pas tout d’abord bien compris.
J’avais été un peu surpris d’apprendre que l’éducation pouvait se faire même en jouant, car ce n’était pas ainsi que j’avais été habitué à travailler à l’école. Je le fus bien plus quand il me mit à l’œuvre, c’est-à-dire dans l’après-midi même.
Je l’accompagnais dans sa promenade sur la côte, et, tout en marchant, il me faisait causer; nous étions entrés dans un petit bois de chênes.
— Qu’est-ce que c’est que ça? dit-il en me montrant des fourmis qui traversaient le chemin.
— Des fourmis.
— Oui, mais que font-elles?
— Elles en portent, d’autres.
— Bon, tu vas les suivre jusqu’à leur fourmilière; tu les regarderas et tu me diras ce que tu as vu; si tu ne remarques rien qui t’étonne, tu reviendras demain, après-demain, jusqu’à ce que tu aies observé quelque chose.
Après deux journées passées autour de la fourmilière, je vis qu’il y avait des fourmis qui ne faisaient absolument rien, tandis qu’il y en avait d’autres qui travaillaient sans cesse et qui même donnaient à manger aux paresseuses.
— C’est bien, me dit-il quand je lui communiquai le résultat de mes observations; tu as vu le principal, cela suffit. Ces fourmis qui ne font rien ne sont pas des malades ou des invalides, comme tu crois; ce sont les maîtres de celles qui travaillent et qui sont des esclaves. Sans le secours de ces esclaves, elles seraient incapables d’aller chercher leur nourriture. Cela te surprend; il en est pourtant de même dans notre monde; il est encore quelques pays où il y a des hommes ne faisant rien qui sont nourris par ceux qui travaillent. Si cette oisiveté avait pour cause l’infirmité chez les maîtres, rien ne serait plus explicable que le travail des uns et le repos des autres: il faut bien s’entr’aider; mais il n’en est pas ainsi. Les maîtres, chez les fourmis, sont précisément ceux qui sont les plus aptes aux choses qui demandent la force et le courage, — à la guerre. Nous retournerons observer ensemble ces fourmis, et nous les verrons sans doute se livrer entre elles quelque grande bataille. Ce sont les maîtres seuls qui y prennent part, et leur but est de conquérir des esclaves. En attendant que tu sois témoin de ces luttes, je vais te donner à lire, dans le livre d’un savant qui se nomme Huber, le récit d’un de ces combats qui eut lieu précisément au moment même où une autre grande bataille, bien plus terrible, se livrait à cinq cents lieues de là entre les hommes. Les hommes avaient-ils, ce jour-là, de meilleures raisons pour s’entretuer, je ne le sais pas, mais je sais que le massacre fut épouvantable. Moi-même, si je ne suis pas resté sur ce champ de mort, il s’en est fallu de bien peu. Nous marchions le long d’une rivière qu’on nomme l’Elbe, et de l’autre côté, sur la rive droite, les Russes avaient en batterie une formidable artillerie dont nous entendions les détonations, mais dont nous ne voyions pas les ravages, parce que nous étions abrités par un coude de la rivière et par un mouvement de terrain. Tout en marchant je n’avais qu’une idée, c’est que ce jour, qui pouvait être le jour de ma mort, car il fallait passer sous le feu de cette artillerie, était aussi celui de la fête de ma femme. Je pensais combien j’aurais été heureux de la lui souhaiter. Tout à coup, j’aperçois à mes pieds, dans le fossé humide où je marchais, toute une traînée de myosotis en pleine fleur. Il ne faut pas croire que dans les batailles les choses se passent comme le représentent les tableaux, avec une parfaite régularité d’alignement. Nous étions déployés en tirailleurs, c’est-à-dire libres de nos mouvements. En dépit du sérieux de la position, les petites fleurs bleues m’attiraient. Je me baissai pour cueillir quelques brins de myosotis, et au même moment je sentis au-dessus de moi un vent terrible qui me passait à quelques pouces de la tête, puis j’entendis une détonation épouvantable et je reçus sur le dos une bourrée de branches de saule. Nous étions arrivés en face de la batterie, et c’était elle qui venait de faucher autour de moi tous mes camarades. Si j’étais resté debout, sans mon petit bouquet par conséquent, j’étais mort comme eux. Avoue que j’avais bien fait de penser à ma femme. Quand je parvins à sortir de dessous les saules, le maréchal Ney avait fait taire les canons russes.
Tout pénétré encore de ce récit de la bataille de Friedland, le soir même, je lisais celui du combat des fourmis dans Huber. Huber était aveugle, il regardait par les yeux du plus dévoué et du plus intelligent des domestiques, et lui dictait ensuite le plus charmant livre qu’on ait écrit sur les abeilles et les fourmis. Si M. de Bihorel n’eût point ainsi amené cette lecture, et s’il me l’eût imposée comme un devoir au lieu de me la donner comme une récompense, quel effet eût-elle produit sur un enfant de mon âge, ignorant de tout comme je l’étais? Grâce à la façon dont il me la présenta, elle entra si pleinement dans mon esprit préparé qu’aujourd’hui encore, malgré les années écoulées, j’en retrouve le souvenir plus sensible et plus net que pour le livre que je lisais hier.
Il n’aimait pas beaucoup les livres. Il y en eut un pourtant qu’il me mit tout de suite entre les mains, mais celui-là était à ses yeux ce qu’est la Bible pour les protestants, l’Imitation pour un catholique; c’était sur ce livre qu’il avait modelé sa vie, c’était lui qui avait créé la Pierre-Gante et les merveilles de travail qu’on y voyait; c’était lui qui avait donné l’idée du grand parapluie, lui qui avait baptisé Samedi que, par respect pour Robinson, il n’avait pas voulu nommer Vendredi, — c’était le Robinson Crusoé.
— Tu apprendras là-dedans, me dit-il en me le remettant, ce que peut chez un homme la force morale; tu apprendras aussi que si l’homme peut à lui seul, par la volonté, recommencer toutes les inventions humaines, il ne doit pas trop s’enorgueillir de sa puissance, car au-dessus de lui il y a Dieu. Tu ne sens peut-être pas en ce moment ce que je te dis là, mais ça te reviendra plus tard, et il était nécessaire que cela te fût dit: Au reste, si tu n’es pas frappé par ce grand enseignement, tu feras comme tous les lecteurs, tu prendras dans le livre ce qui te plaira.
Je ne sais pas s’il est des enfants qui peuvent lire Robinson de sang-froid; pour moi je fus transporté.
Il faut avouer pourtant que ce qui me toucha, ce ne fut pas le côté philosophique qui m’avait été indiqué, mais bien le côté romanesque, — les aventures sur mer, le naufrage, l’île déserte, les sauvages, l’effroi, l’inconnu. Mon oncle l’Indien eut un rival.
Je trouvai là comme une justification de mes désirs. Qui de nous ne s’est pas mis à la place du héros de de Foë, et ne s’est pas demandé :
— Pourquoi ne m’en arriverait-il pas autant? Pourquoi n’en ferais-je pas autant?
Ce ne sont pas seulement les enfants de six mois qui croient qu’il n’y a qu’à étendre la main pour prendre la lune.
Samedi, qui savait tant de choses, ne savait pas lire. En voyant mon enthousiasme, il eut envie de connaître ces aventures et me demanda de les lui lire.
— Il te les contera, dit M. de Bihorel, et ça vaudra mieux; tu es assez primitif pour préférer le récit à la lecture.
Dix années de voyages avaient donné à Samedi une certaine expérience, et il n’acceptait pas toutes mes histoires sans y faire des objections. Mais j’avais une réponse qui ne permettait pas la discussion.
— C’est écrit.
— En es-tu sûr, mon petit Romain?
Je prenais le livre et je lisais.
Samedi écoutait en se grattant le nez, puis, avec la résignation d’une foi aveugle:
— Puisque c’est écrit, disait-il, je veux bien; mais c’est égal, j’y ai été, à la côte d’Afrique, et je n’ai jamais vu de lions venir à la nage attaquer les navires. Enfin!
Il avait surtout été dans les mers du Nord, et il avait gardé de ces voyages des souvenirs avec lesquels il payait mes récits.
Une année, surpris par les glaces, ils avaient été obligés d’hiverner: pendant six mois ils avaient vécu sous la neige, plus de la moitié de l’équipage était restée ensevelie sous cette neige; les chiens eux-mêmes étaient morts, non de froid ou de privation de nourriture, mais de privation de lumière; si on avait eu assez d’huile pour tenir toujours les lampes allumées, ils auraient vécu. C’était presque aussi beau que Robinson, quelquefois cependant c’était trop beau pour ma crédulité.
— Est-ce écrit?
Samedi était bien alors obligé de convenir qu’il ne l’avait pas lu; mais il l’avait vu.
— Qu’est-ce que cela fait, puisque ce n’est pas écrit?
De pareils entretiens n’étaient pas de nature, il faut en convenir, à me donner l’idée de vivre tranquillement à terre; aussi ma mère, tourmentée de voir mes dispositions naturelles si malheureusement encouragées, voulut-elle faire une tentative auprès de M. de Bihorel.
— Ma chère dame, répondit-il, je vous rendrai l’enfant si vous trouvez que je le pousse dans une voie que vous ne voudriez pas lui voir suivre; mais vous ne le changerez jamais tout à fait, il est de la race de ceux qui cherchent l’impossible; je conviens avec vous que cela mène rarement à la fortune, mais cela mène quelquefois aux grandes choses.
Telle est l’ingratitude des enfants qu’à ce moment j’aurais presque volontiers quitté la Pierre-Gante. M. de Bihorel avait étudié les cris des oiseaux, et dans ces cris il avait cru, à tort ou à raison, trouver un langage dont il avait composé le lexique; il voulait me l’apprendre: je n’y comprenais absolument rien. Delà étaient nées des occasions continuelles, pour lui de colère, pour moi de pleurs.
C’était cependant chose curieuse que ce langage, et je regrette bien aujourd’hui de n’en avoir retenu que quelques mots. Tout ce qu’un oiseau peut exprimer, M. de Bihorel affirmait qu’il était arrivé à le traduire, selon lui, couramment: «J’ai faim... manger là-bas... sauvons-nous vite... faisons un nid... kia ouah tsioui, voilà la tempête.» Mais alors j’étais encore trop enfant et trop paysan pour admettre, même à l’état d’hypothèse, que les bêtes puissent parler. Nous sentons la musique, qui n’est pas notre langue, et nous ne voulons pas que les oiseaux la comprennent, eux qui nous en ont donné les premiers modèles! Nos chiens, nos chevaux, nos animaux domestiques entendent notre langage; était-il donc tout à fait impossible que M. de Bihorel entendît celui des oiseaux?
Ma mère, troublée par cette réponse de M. de Bihorel, ne persista pas dans sa demande, et je dus continuer à étudier le dictionnaire des Guillemot et des Pierre Garin.
— Tu verras plus tard, me dit M. de Bihorel, l’utilité de ce qui te paraît aujourd’hui ridicule. Ta mère a peur que tu sois marin, je ne le souhaite pas non plus; car aujourd’hui, si on entre avec enthousiasme dans la marine à quinze ans, on en sort souvent à quarante, avec dégoût. Mais tu as la passion des voyages, c’est chez toi une vocation de famille, et il faut s’arranger pour donner satisfaction à ta vocation et aux désirs de ta mère. Je voudrais donc que tu fusses un homme comme André Michaux dont tu lisais l’autre jour la vie, comme Siebold, un médecin hollandais qui nous a fait connaître le Japon; comme l’Anglais Robert Fortune; je voudrais te préparer à voyager dans des pays peu connus, au profit de ta patrie que tu enrichirais de plantes nouvelles et d’animaux utiles, au profit de la science dont tu serais un soldat. Voilà qui vaut mieux que d’être marin pour transporter toute ta vie, comme un entrepreneur de roulage maritime, du café de Rio-Janeiro au Havre, et des articles-Paris du Havre à Rio-Janeiro; et si cela se réalise, tu verras que ce que je veux t’apprendre aujourd’hui te rendra de réels services.
C’était là un beau rêve. Par malheur, ce ne fut qu’un rêve. Cette direction prévoyante et élevée eût-elle fait de moi l’homme que M. de Bihorel voulait? Je ne sais; car elle cessa de s’exercer sur moi précisément au moment où elle m’était le plus nécessaire et où je commençais à profiter des leçons de cet excellent homme. Voici comment arriva cette brusque catastrophe:
Habituellement j’accompagnais M. de Bihorel dans toutes ses courses; quelquefois cependant il s’embarquait seul dans la chaloupe pour aller étudier tout à son aise les cris des oiseaux à l’île des Grunes, qui est à trois lieues au large du Port-Dieu.
Un jour qu’il était ainsi parti avant que je fusse levé, nous fûmes très-surpris de ne pas le voir revenir à l’heure du dîner.
— Il aura manqué la marée, dit Samedi, ce sera pour celle de ce soir.
Le temps était calme, la mer tranquille; il n’y avait en apparence aucun danger. Cependant Samedi paraissait assez inquiet.
Le soir, M. de Bihorel n’arriva pas, et Samedi, au lieu de se coucher, alluma un grand feu de fagots sur le point le plus élevé de l’île. Je voulus rester auprès de lui, il m’envoya à mon lit assez durement. Vers le matin avant le jour, je me levai et l’allai rejoindre. Il marchait en long et en large devant le feu qui jetait de grandes flammes rouges, et de temps en temps il s’arrêtait pour écouter: on n’entendait que le murmure de la mer; quelquefois il se faisait une sourde rumeur, un bruit d’ailes, et des oiseaux, que la lumière avait été troubler dans leurs cavernes, s’abattaient affolés sur notre feu.
Une lueur blanche entr’ouvrit le ciel du côté de l’Orient.
— Bien sûr il lui sera arrivé quelque chose, dit Samedi; il faut emprunter le bateau à Gosseaume et aller à l’île des Grunes.
L’île des Grunes est un amas de rochers granitiques qui n’est habité que par les oiseaux de mer; nous l’eûmes bientôt explorée; nulle part nous ne trouvâmes traces de M. de Bihorel ni de la chaloupe.
Au Port-Dieu tout le monde fut bientôt en émoi, car malgré son originalité on aimait le vieux M. Dimanche. Cette disparition était inexplicable.
— Il aura chaviré, disaient les uns.
— On retrouverait la chaloupe.
— Et les courants?
Samedi ne disait rien, mais de toute la journée il ne quittait pas la grève; quand la marée baissait, il suivait le flot, et les uns après les autres il visitait tous les rochers; il y avait des soirs où nous nous trouvions ainsi éloignés de cinq à six lieues du Port-Dieu. Il ne parlait pas, jamais il ne prononçait le nom de M. de Bihorel; seulement, quand il rencontrait un pêcheur, il lui disait d’une voix dolente:
— Rien de nouveau?
Et le pêcheur, qui comprenait cette brève interrogation, répondait:
— Rien de nouveau.
Et alors, s’il voyait une larme dans mes yeux, il me donnait une petite tape sur la tête en disant:
— Tu es un bon garçon; oui, tu es un bon gars.
Quinze jours après cette inexplicable absence arriva à la Pierre-Gante un M. de La Berryais, qui habitait la basse Normandie. C’était un petit-neveu de M. de Bihorel et son seul parent.
Après nous avoir fait longuement raconter ce qui s’était passé, il embaucha douze hommes au Port-Dieu avec l’ordre d’explorer le rivage. Les recherches continuèrent pendant trois jours, puis, le soir du troisième jour, il les arrêta, déclarant qu’elles étaient désormais inutiles et que bien certainement M. de Bihorel avait péri; les courants avaient entraîné le corps et la chaloupe.
— Qu’en savez-vous? s’écria Samedi; pourquoi voulez-vous qu’il soit mort? Les courants peuvent bien avoir entraîné la chaloupé sans qu’elle ait chaviré ; peut-être que le maître a été débarquer en Angleterre. Pourquoi ne reviendrait-il pas demain?
C’était devant les gens qui avaient fait les recherches qu’il avait répondu ces paroles. Personne ne répliqua par respect pour son chagrin, mais personne n’était de son avis.
Le lendemain, M. de La Berryais nous fit comparaître devant lui, Samedi et moi, et il nous annonça qu’il n’y avait plus besoin de personne à la Pierre-Gante: on allait fermer les portes, et le notaire ferait soigner les bêtes en attendant qu’on les vendît.
Samedi fut tellement suffoqué qu’il ne put que balbutier des paroles inintelligibles; puis tout à coup, se tournant vers moi:
— Fais ton sac, me dit-il, nous allons sortir d’ici tout de suite.
En quittant l’île, nous rencontrâmes M. de La Berryais sur la chaussée; Samedi marcha droit à lui:
— Monsieur, dit-il, vous êtes peut-être bien son neveu pour la loi, mais pour moi vous ne l’êtes pas; non, vous ne l’êtes pas, et c’est un vrai matelot qui vous le dit.
Il avait été convenu que Samedi accepterait l’hospitalité chez ma mère jusqu’à ce qu’il eût trouvé à se loger dans le village, mais il ne resta pas longtemps avec nous.
Tous les matins il s’en allait sur la plage et il continuait ses recherches. Cela dura à peu près trois semaines, puis un soir il nous annonça qu’il nous quitterait le lendemain pour passer aux îles anglaises et peut-être en Angleterre.
— Parce que, voyez-vous, dit-il, la mer ne garde rien, ça c’est sûr; donc si elle ne rend rien, c’est peut-être qu’elle n’a rien pris.
Ma mère voulut le faire parler, il n’en dit pas davantage.
Je le conduisis jusque sur le sloop, où il s’embarqua.
Comme je l’embrassais:
— Tu es un bon garçon, dit-il; tu iras quelquefois à la Pierre- Gante, et tu porteras une poignée de sel à la vache noire, elle t’aimait bien aussi.