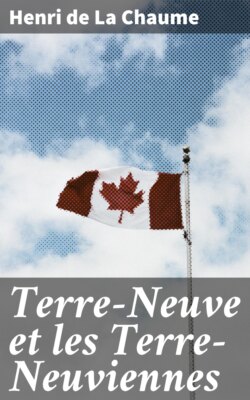Читать книгу Terre-Neuve et les Terre-Neuviennes - Henri de La Chaume - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE II
ОглавлениеTable des matières
Je viens de vous faire passer une année entière avec moi. C'est beaucoup abuser de votre temps et de votre amitié, n'est-ce pas? Mais voyez la petite trahison: je vous sais fort curieux; aussi ai-je réservé pour la fin le plus intéressant. Il faut donc bien que vous m'écoutiez jusqu'au bout pour être satisfait. Jusqu'au bout?... Cher ami, vous avez beaucoup de chance pour que je reste en route!
Parlons un peu de Saint-Jean. Figurez-vous que j'habite une ville toute bâtie de bois.—Et pourtant c'est la capitale de l'île de Terre-Neuve, celle qui s'intitule, avec un orgueil tout britannique, «la plus ancienne des colonies anglaises».
C'était le 24 juin 1497. Les brouillards sont presque constants à cette époque de l'année autour de Terre-Neuve. Mais parfois un rayon de soleil y ouvre une brusque et profonde blessure, et c'est ainsi que ce jour-là, au lever de l'aurore, l'île vierge, dépouillée de son voile de gaze, fut surprise pour la première fois par des regards européens.
D'une voix triomphante, la vigie qui veillait dans le mât de misaine du Mathieu, petite barque de Bristol, poussa ce cri: «Terre! terre!»
Le capitaine était John Cabot, et son fils, Sébastien, avait rang de premier officier. Des cris d'enthousiasme s'élevèrent du pont, et dans les rochers de la côte, l'écho étonné répétait sans comprendre les sons qu'il n'avait encore jamais entendus.
L'histoire dit pourtant que les morues ne s'en émurent point, ne pouvant s'imaginer de quels malheurs pour leur race la venue de ces hommes était le signal.
Elles partageaient alors avec les phoques la souveraineté absolue de l'île et de ses dépendances, mais l'Angleterre ne tardera pas à les en déposséder à son profit, sous prétexte que Sébastien Cabot qui commandait le Mathieu était né à Bristol.
Au mois de février de l'année suivante, le roi Henri VII accorda à John Cabot une nouvelle patente l'autorisant à renouveler son expédition à la tête de six navires. Mais, cette fois, le vieil Italien n'y alla pas et confia sa mission à son fils Sébastien, alors âgé de vingt-trois ans.
Néanmoins, malgré sa perfide joie à harponner toute proie nouvelle, ce ne fut que quatre-vingt-six ans plus tard qu'Albion songea à établir officiellement sa domination sur Newfoundland. En effet, nulle tentative de colonisation n'avait été faite durant ce laps de temps, presque un siècle.
Les phoques, déjà renommés pour leur habileté diplomatique, s'étaient constitués en congrès avec les marins. Des plénipotentiaires avaient été nommés, et une conférence s'était réunie sur les bancs, qui avait décidé qu'il fallait employer la plus extrême prudence à ne pas éveiller la dévorante ambition des Anglais; que pour cela il était nécessaire d'observer le plus grand silence et de ne point former d'attroupements sur la voie publique.
Mais, quatre-vingt-six ans plus tard, le congrès s'étant assemblé de nouveau pour voter des félicitations à ses peuples, les Anglais le surprirent pendant qu'il délibérait, et une extermination générale fut résolue.
Ce jour-là, quatre vaisseaux de guerre anglais et trente-six navires de pêche de toutes nationalités se trouvaient réunis dans le port de Saint-Jean.
Sir Humphrey Gilbert descendit à terre. Des otages pris parmi les phoques et les morues furent traînés devant lui chargés de chaînes. Tout autour, des officiers et un assez grand nombre d'autres personnes formèrent le cercle. Sir Humphrey donna alors lecture d'une patente royale l'autorisant à prendre possession de Terre-Neuve au nom de la reine Élisabeth, et à exercer sa juridiction sur l'île et sur tous les autres domaines de la couronne dans la même région.
Puis, se tournant vers les otages, il leur déclara que leur autopsie allait être ordonnée. Deux chirurgiens de la marine royale s'avancèrent alors, scalpel en main, et ce fut à cette occasion que la vivisection fut pratiquée pour la première fois. De l'économie anatomique de la morue il fut déduit que sa chair fournirait un aliment à la fois substantiel et délicat. Quant au phoque, sa peau rembourrée de graisse fit penser qu'il serait un produit précieux pour l'industrie nécessaire au développement du pays.
En conséquence, guerre ouverte fut déclarée aux peuples sous-marins, et tous moyens proclamés bons et loyaux pour les mettre en conserves.
La juridiction de sir Humphrey Gilbert, selon qu'elle était délimitée par la patente, s'étendait à deux cents lieues à la ronde. Aussi comprenait-elle, avec Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, une partie du Labrador, le Cap-Breton et l'île du Prince Édouard.
C'était presque un royaume, et sir H. Gilbert avait amené avec lui du Devonshire environ deux cent cinquante colons, pour commencer à le peupler. Il fut soutenu dans son entreprise par son célèbre demi-frère, sir Walter Raleigh. Celui-ci avait d'abord fait partie de l'expédition dirigée par sir Humphrey. Mais une maladie contagieuse éclata à son bord, et il dut regagner l'Angleterre.
C'est ainsi que furent jetés les premiers fondements de l'empire colonial que l'Angleterre s'est conservé dans l'Amérique du Nord.
Mais Terre-Neuve seule nous occupe, pour l'instant, et comme son histoire est peu intéressante, je ne ferai que vous l'esquisser à grands traits.
Il n'est cependant peut-être pas inutile de rappeler que les Français furent les véritables colonisateurs de Terre-Neuve.
Après la découverte des Cabot, ce sont des navigateurs français, Cartier, puis Champlain, qui viennent débarquer sur ses côtes. En 1525, François Ier envoie Verazini déployer la Salamandre sur la «terre nouvellement trouvée» et déclarer aux phoques et aux morues qu'ils passent sous sa royale domination. En 1604, le premier établissement français est fondé, et Terre-Neuve et l'Acadie, aujourd'hui Nouvelle-Écosse, sont à nous pendant tout le cours du dix-septième siècle et jusqu'au traité d'Utrecht.
Une coalition nous les enlève pour les donner alors à l'Angleterre. Durant cette période, toutes les places fortes de Terre-Neuve, et surtout Saint-Jean, changent vingt fois d'occupants.
Enfin 1713 nous chasse définitivement de nos anciennes possessions, ne nous laissant que les îles Saint-Pierre et Miquelon, et des droits de pêche sur une partie des côtes de Terre-Neuve. Ces droits, qui nous seront renouvelés dans la suite par plusieurs traités, méritent une étude toute particulière, et que je renvoie à plus tard.
Quels traits me reste-t-il donc encore à marquer pour achever ce rapide crayon de l'histoire terre-neuvienne?
Depuis cette époque troublée de guerres, rien n'a été plus paisible que l'établissement et le développement des colons anglais. En 1855, Terre-Neuve devint colonie indépendante. Il n'y eut plus de garnison dans l'île, et à Saint-Jean (Saint-John's), la capitale, les seuls agents à la disposition du pouvoir exécutif sont cinquante «policemen» tant à pied qu'à cheval.
Tel est l'état actuel du pays dans lequel je vous ai conduit et dont je m'efforce de vous bien faire les honneurs.
Quant à la résistance que les Indiens ont pu opposer à l'invasion de leur île, on n'en a jamais entendu parler.
Tout ce qui reste aujourd'hui des premiers maîtres de Terre-Neuve se réduit à une dizaine de familles d'aborigènes de la tribu des Micmacs. Elles se sont groupées et forment un village sur un certain point de la côte nord.
Du reste, fort inoffensifs et de caractère paisible, ils pêchent pendant l'été et poursuivent en hiver les animaux à fourrures qui habitent le long des rivières et l'intérieur des forêts si peu connues de l'île.
N'est-il pas étonnant que la «race née du sol» ait si rapidement disparu dans un pays presque inexploré et sur lequel on en est encore réduit à se faire une opinion basée sur l'hypothèse?
Car, ainsi que je vous l'ai dit, les côtes seules sont parfaitement connues, et tous les établissements des Européens ont été fondés sur le bord de la mer. Du reste, quoi de moins surprenant? Quelle est l'«attraction» qui a amené et fixé ici ceux qui constituent désormais le peuple de Terre-Neuve? La pêche, uniquement la pêche. C'est au phoque et à la morue que ce pays doit sa colonisation. Sans la présence de ces mines de richesses à exploiter pour l'industrie, ce serait encore un désert que cette pauvre île au sol déshérité.
Toutes les villes, tous les villages ont la même origine, sinon les mêmes fondateurs. Des marins sont venus, français d'abord et plus tard anglais, qui ont cherché sur les côtes une baie, un havre offrant à la fois un abri sûr à leurs navires et du bois pour la construction de leurs cabanes et des échafauds nécessaires au séchage de la morue. Les côtes devinrent mieux connues; on sut quels endroits le poisson avait coutume de fréquenter le plus. Il se fit alors sur ces divers points des agglomérations de pêcheurs. Quelques-uns hivernèrent et se mirent à faire le commerce pour leur propre compte. Mais ils consommaient, et le pays ne produisant rien, l'importation dut faire croisière avec l'exportation entre Terre-Neuve et l'Europe. À côté des établissements de pêche s'en élevèrent d'autres plus considérables, des habitations, des magasins: le fondement d'une nouvelle nation était jeté.
À l'heure qu'il est, la population de toute l'île s'élève à environ cent quatre-vingt mille habitants, la plupart Irlandais et Écossais d'origine. Sur ce nombre, trente mille sont agglomérés à Saint-Jean. On en compte de six à sept mille au Havre de Grâce et à Twilingate, qui sont, après la capitale, les deux centres commerciaux les plus importants.
Je me bornerai à vous parler de Saint-Jean. Aussi bien est-ce la ville la plus intéressante, et puis, c'est la seule que je connaisse.