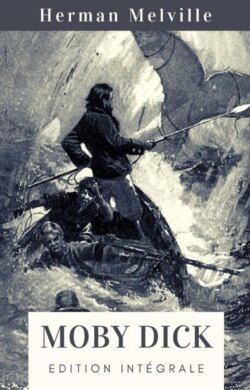Читать книгу Herman Melville : Moby Dick (Édition intégrale) - Herman Melville, Herman Melville - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE XIV
Nantucket
ОглавлениеLe reste de la traversée se passa sans incident, de sorte qu’après un excellent voyage nous arrivâmes sains et saufs à Nantucket.
Nantucket ! Sortez votre carte et regardez-la. Regardez quel vrai coin du monde elle occupe. Comme elle se tient là, au large, plus solitaire que le phare d’Eddystone. Regardez-la, un simple tertre, un bras de sable tout en plage, sans toile de fond. Il y a là plus de sable que le monde n’en utiliserait, vingt ans durant, en guise de buvard. Les plaisantins vous diront qu’ils doivent y semer la mauvaise herbe qui n’y pousse pas toute seule, qu’ils importent les chardons du Canada, qu’ils doivent faire venir d’outre-mer un fausset pour boucher un trou dans un baril d’huile, et que tout bout de bois est solennellement porté à travers Nantucket, comme à Rome les morceaux de la vraie croix. Pour se procurer un peu d’ombre en été, les habitants plantent des faux agarics dans leurs jardins ; un brin d’herbe est une oasis, trois brins d’herbe découverts au cours d’une journée de promenade sont une prairie. Ils y portent des chaussures pour les sables mouvants assez semblables à celles que mettent les Lapons sur la neige. Ils y sont si bien enfermés, ceinturés, séquestrés de toute manière, entourés, l’Océan en fait si bien une île, que des grappes de coquillages adhèrent parfois jusqu’à leurs chaises et leurs tables comme aux carapaces de tortues de mer. Toutes ces divagations signifient seulement que Nantucket n’est pas l’Illinois !
Considérez à présent l’étonnante légende racontant comment les Peaux-Rouges vinrent à s’établir sur l’île. Ainsi va l’histoire : au temps jadis, un aigle s’abattit sur la côte de la Nouvelle-Angleterre et enleva dans ses serres un petit enfant indien. En se lamentant bien haut, les parents virent leur enfant emporté hors de vue au-dessus de la vaste mer. Ils décidèrent de suivre cette direction à sa recherche. Ayant mis à l’eau leurs pirogues, ils accomplirent une traversée périlleuse, découvrirent enfin l’île et y trouvèrent, coffret d’ivoire vide, le squelette du pauvre petit Indien.
Quoi d’étonnant dès lors à ce que ces Nantuckais nés sur la grève prennent la mer pour gagner leur vie ! Ils commencèrent par chercher dans le sable des crabes et des vénus ; s’enhardissant, ils pataugèrent avec des filets pour prendre les maquereaux ; leur expérience croissant, ils s’éloignèrent en bateau pour pêcher la morue ; enfin ils lancèrent une flotte de grands navires sur l’Océan afin d’explorer l’univers liquide ; ils le cernèrent d’incessantes circumnavigations, jetèrent un coup d’œil dans le détroit de Behring, et, en toutes saisons et sur toutes les mers, déclarèrent une guerre éternelle à l’être le plus puissant qui ait survécu au déluge, au plus monstrueux, au plus montagneux ! À cet Himalaya, à ce Mastodonte salé, de mauvais augure et dont la force brute rend ses paniques plus redoutables que la téméraire malveillance de son assaut.
C’est ainsi que ces Nantuckais nus, ces ermites de la mer, sortant de leur fourmilière océanique, parcoururent le monde liquide et le conquirent comme autant d’Alexandres, se partageant les océans Atlantique, Pacifique et Indien, comme les trois nations flibustières firent de la Pologne. Que l’Amérique ajoute le Mexique au Texas, empile Cuba sur le Canada, que les Anglais essaiment dans toute l’Inde et plantent leur drapeau resplendissant sur le soleil même, il n’en reste pas moins que les deux tiers du monde aqueux sont aux Nantuckais. Car la mer est à eux, elle leur appartient comme un empire à son empereur, les autres marins n’y ont qu’un droit de transit. Les navires marchands ne sont qu’un prolongement des ponts ; les bâtiments de guerre rien de plus que des forteresses flottantes ; les pirates et les corsaires, bien que sillonnant les mers, comme des voleurs de grand chemin parcourent les routes, ne font rien de plus que piller d’autres navires, fragments de terre comme eux, qui ne quêtent pas leur subsistance dans l’abîme sans fond. Seul le Nantuckais réside et pullule sur la mer ; lui seul vogue sur la mer, dans des navires – pour parler en termes bibliques – labourant, ici et là, sa plantation personnelle. C’est là son foyer. Là il mène ses affaires, à l’abri d’un nouveau déluge, quand bien même toute la population de la Chine en serait submergée. Il vit sur la mer comme le coq des landes sur la lande, se cache dans la vague, et l’escalade comme les Alpes le chasseur de chamois. Pendant des années il ne sait plus rien de la terre, et lorsqu’il y revient enfin, elle a pour lui un parfum d’autre monde, plus étrange que celui de la lune n’en aurait pour un terrien. Comme le goéland sans patrie replie ses ailes au coucher du soleil et s’abandonne à la berceuse des flots, ainsi à la tombée du soir le Nantuckais, loin de toute terre, ferle ses voiles et s’étend cependant que sous son oreiller même défilent des troupes de morses et de baleines.
CHAPITRE XV Soupes de poissons
Il était bien tard dans la soirée quand le petit Varech mouilla confortablement l’ancre et que Queequeg et moi débarquâmes. Aussi nous ne pouvions vaquer à aucune affaire le soir même, du moins à aucune autre que de trouver à souper et à dormir. Le patron de l’Auberge du Souffleur nous avait recommandé d’aller chez son cousin Osée Hussey, propriétaire des Tâte-Pots, l’hôtel le mieux tenu de tout Nantucket, nous affirma-t-il ; de plus, nous avait-il assurés, ce cousin Osée – comme il l’appelait – était célèbre pour ses soupes de poissons. En somme, il déclarait carrément que nous ne pouvions faire mieux que de tâter la chance au Tâte-Pots. Mais le chemin à suivre qu’il nous avait indiqué, nous engageant à suivre, par tribord, un entrepôt jaune jusqu’à ce qu’on aperçoive une église blanche à bâbord, de rester alors à bâbord jusqu’à un carrefour à trois points de tribord, et ceci fait de demander où se trouvait l’auberge au premier homme que nous croiserions. Ces indications retorses nous déconcertèrent d’abord grandement, d’autant plus que Queequeg soutenait que l’entrepôt jaune, notre point de départ, devait se trouver à bâbord, tandis que j’avais compris que Peter Coffin parlait de tribord. Toutefois, à force de louvoyer dans l’obscurité et de frapper aux portes de paisibles habitants pour demander notre chemin, nous arrivâmes enfin à quelque chose ne permettant aucune méprise.
Deux énormes chaudières de bois, peintes en noir, étaient suspendues par leurs oreilles d’âne de part et d’autre des élongis d’un vieux mât de hune fiché en terre devant un antique portail, sciés d’un côté, ils donnaient à ce vieux mât l’allure d’un gibet. Peut-être étais-je, à ce moment-là, rendu trop vulnérable à certaines impressions, mais je ne pus m’empêcher de contempler cette potence avec de sombres pressentiments. J’attrapai le torticolis à lever la tête vers ces deux cornes restantes ; oui, deux ; l’une pour Queequeg, l’autre pour moi. C’est un mauvais présage, me dis-je. En arrivant dans le premier port baleinier, je trouvai un aubergiste du nom de Coffin[2], puis le regard, posé sur moi, des plaques funéraires dans la chapelle, ici enfin un gibet et une paire de prodigieuses chaudières noires par-dessus le marché ! Serait-ce une allusion insidieuse à Topheth ?
Je fus tiré de mes réflexions par la vue d’une femme couverte de taches de rousseur, assortissant une robe jaune à des cheveux jaunes, debout sous le porche de l’auberge où se balançait une lampe rouge sans éclat évoquant singulièrement un œil injecté de sang. Elle tançait vivement un homme en chemise de laine pourpre.
– Filez de par là, disait-elle à l’homme, ou vous allez recevoir une peignée !
– Venez, Queequeg, tout va bien, voilà Mme Hussey. Il s’avéra que c’était elle en effet. M. Osée Hussey était absent, mais il avait laissé à Mme Hussey les pleins pouvoirs sur la conduite de ses affaires. Lorsque nous eûmes exprimé le désir d’un souper et d’un lit, Mme Hussey, renvoyant à plus tard ses semonces, nous précéda dans une petite pièce, nous fit asseoir à une table jonchée des reliefs d’un repas qui venait d’être terminé et, se tournant vers nous, questionna :
– Clovisses ou morue ?
– Comment se présente la morue, madame ? demandai-je avec une politesse extrême.
– Clovisses ou morue ? répéta-t-elle.
– Des clovisses pour le souper ? une froide clovisse. Est-ce bien là ce que vous voulez dire, madame Hussey ? C’est une coquille plutôt humide et glaciale où se retirer en hiver, ne trouvez-vous pas, madame Hussey ?
Mais impatiente de poursuivre ses criailleries attendues sous le porche par l’homme en chemise rouge et n’ayant paru saisir que le mot clovisse, Mme Hussey se précipita vers une porte donnant sur la cuisine et brailla : « Deux clovisses, deux ! » et disparut.
– Queequeg, dis-je, pensez-vous que nous pouvons souper à deux sur une clovisse ?
Pourtant, le parfum appétissant de la chaude vapeur, qui s’échappait de la cuisine, infligeait un démenti à un programme apparemment peu réjouissant. Lorsque la soupe fumante apparut, la clef du mystère nous fut délicieusement donnée. Ah ! mes bons amis, écoutez bien. De petites clovisses juteuses, à peine plus grosses qu’une noisette, mélangées à des biscuits de mer émiettés et à du porc salé finement émincé, composaient cette soupe enrichie de beurre et généreusement assaisonnée de sel et de poivre. Un voyage hivernal nous avait aiguisé l’appétit. Queequeg se trouvait devant son plat favori, la soupe était une réussite parfaite, aussi l’eûmes-nous expédiée promptement. Je m’appuyai au dossier de ma chaise et, songeant à la proposition de Mme Hussey : clovisses ou morue ? j’envisageai de tenter une petite expérience. Me dirigeant vers la porte de la cuisine, je prononçai le mot : morue avec grandiloquence et regagnai mon siège. Au bout d’un instant la vapeur appétissante renaissait, apportant un parfum différent, et, en temps voulu, on nous servit une magnifique soupe à la morue.
Nous nous y attaquâmes, et tandis que nous plongions nos cuillères dans nos écuelles, je me demandai si cela avait un effet sur la tête ? Une locution populaire ne veut-elle pas qu’on ait des têtes de poissons frits ? Mais, regardez, Queequeg, n’y a-t-il pas une anguille vivante dans votre écuelle ? Où est votre harpon ?
Ce Tâte-Pots était plus poissonneux que tous les endroits poissonneux, et il méritait bien son nom ! Dans toutes ses chaudières bouillaient des soupes de poissons, on vous servait de la soupe de poissons au petit déjeuner, de la soupe de poissons au repas de midi, de la soupe de poissons au souper, jusqu’à ce que les arêtes vous sortent de la peau et que vous en veniez à les chercher dans vos vêtements. L’entrée, devant la maison, était pavée de coquilles de clovisses. Mme Hussey portait un collier de vertèbres de morue polies et Osée Hussey avait des livres de comptes reliés en peau de chagrin, ancienne et de qualité. Le lait avait un arrière-goût de poisson, lui aussi. La raison m’en échappait tout à fait. Mais un matin, tandis que je me promenais le long de la plage parmi les barques de pêcheurs, je vis la vache bringée d’Osée, pâturant des restes de poissons, avançant sur le sable, ses quatre sabots chaussés d’une tête de morue ; croyez-moi, elle avait l’air d’une traîne-savates.
Le souper terminé, nous reçûmes une lampe et des renseignements de Mme Hussey sur le plus court chemin menant au lit, mais tandis que Queequeg s’apprêtait à me précéder dans l’escalier, la dame tendit le bras et réclama son harpon. Elle ne tolérait aucun harpon dans les chambres. « Pourquoi ? demandai-je, tout vrai harponneur dort avec son harpon… alors pourquoi non ? » – « Parce que c’est dangereux, dit-elle, depuis que le jeune Stiggs de retour de c’mal’reux voage, après quatre ans et demi d’absence, avec seulement trois barils d’haïle, depuis qu’il a été trouvé mort au premier dans la chambre de derrière, le harpon dans le cœur ; depuis, alors, je n’autorise aucun pensionnaire à emporter des armes aussi dangereuses dans leurs chambres la nuit. Auchi, monsieur Queequeg (car elle avait appris son nom) je vais juste prendre ce fer-ci et vous le garder jusqu’à demain matin. Mais à propos de la soupe, clovisses ou morue pour le petit déjeuner, les gars ? »
– Les deux, répondis-je, et donnez-nous aussi une paire de harengs fumés pour varier le menu.