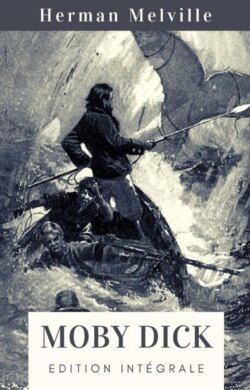Читать книгу Herman Melville : Moby Dick (Édition intégrale) - Herman Melville, Herman Melville - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE XIX
Le prophète
Оглавление« Matelots, vous êtes-vous enrôlés sur ce navire ? »
Queequeg et moi venions tout juste de quitter le Péquod, nous éloignant nonchalamment du quai, absorbés chacun dans nos propres pensées, lorsqu’un étranger nous adressa en ces mots la parole en montrant d’un index massif le bateau en question. Il était misérablement vêtu d’un veston passé, de pantalons rapiécés, et d’un lambeau de mouchoir noir autour du cou. Une petite vérole confluente avait inondé son visage et l’avait abandonné, tel le lit d’un torrent d’où les eaux ruisselantes se sont retirées, couturé de nervures compliquées.
– Êtes-vous enrôlés à ce bord ? répéta-t-il.
– Vous entendez le Péquod, je présume ? dis-je en essayant de gagner du temps pour scruter sa physionomie.
– Oui, le Péquod, ce navire-là, dit-il, ramenant son bras en arrière et le détendant brusquement devant lui, armé de la baïonnette de son index pointée au cœur dudit objet.
– Oui, dis-je, nous venons de signer le rôle.
– Pas de clause concernant vos âmes ?
– Concernant quoi ?
– Oh ! peut-être que vous n’en avez pas, ajouta-t-il vivement. Aucune importance, je connais beaucoup de gars qui n’en ont pas… grand bien leur fasse et ils s’en sentent d’autant mieux. Une âme, c’est quelque chose comme la cinquième roue d’un char.
– Que radotez-vous, camarade ? dis-je.
– Lui, du moins, il en a assez pour suppléer à toutes les déficiences de cet ordre des autres gars, dit brusquement l’étranger, soulignant avec émotion le mot « lui ».
– Queequeg, dis-je, allons-y, ce personnage est un échappé de quelque part, il parle de quelque chose et de quelqu’un que nous ne connaissons pas.
– Un moment ! s’écria l’étranger. Vous dites vrai, vous n’avez pas encore vu le vieux Tonnerre, n’est-ce pas ?
– Qui est le vieux Tonnerre ? demandai-je subjugué encore par la conviction et la démence de ses manières.
– Le capitaine Achab.
– Comment ! le capitaine de notre navire, du Péquod ?
– Oui, quelques vieux marins d’entre nous l’appellent ainsi. Vous ne l’avez pas encore vu ?
– Non. Il est malade, à ce qu’ils disent, mais il se remet et sera tout à fait bien sous peu.
– Tout à fait bien sous peu ! s’esclaffa l’étranger avec un rire à la fois ironique et solennel. Écoutez-moi bien ! lorsque le capitaine Achab ira bien, alors mon bras gauche aussi. Pas avant.
– Que savez-vous de lui ?
– Que vous ont-ils raconté à son sujet ? Dites…
– Ils ne m’ont pas dit grand-chose sous aucun rapport à son sujet, j’ai seulement entendu dire qu’il était un excellent chasseur de baleines et un bon capitaine pour son équipage.
– C’est vrai, c’est vrai – oui, ces deux choses sont également vraies. Mais il s’agit de bondir lorsqu’il donne un ordre. Marche et grogne, grogne et marche, telle est la formule du capitaine Achab. Mais on ne vous a rien dit de ce qui lui était arrivé au large du cap Horn, voici longtemps, et comment il resta comme mort pendant trois jours et trois nuits ; rien non plus de cette lutte à mort menée devant l’autel avec l’Espagnol à Santa ? Vous n’avez rien entendu de tout cela, n’est-ce pas ? Rien non plus au sujet de la calebasse d’argent dans laquelle il a craché ? Rien encore de la perte de sa jambe conformément à la prophétie ? Avez-vous entendu dire quoi que ce soit de ces choses et de bien d’autres encore ? Non, je le pensais bien, comment les auriez-vous apprises ? Qui le sait ? Pas une âme à Nantucket, j’imagine. Peut-être pourtant avez-vous entendu parler de sa jambe et de la manière dont il l’a perdue ? Oui, vous en avez entendu parler, j’oserais l’affirmer. Oh ! oui, ça, tout le monde le sait – je veux dire que tout le monde sait qu’il n’a qu’une jambe et qu’un cachalot lui a arraché l’autre.
– Mon ami, dis-je, je ne sais pas à quoi rime tout votre charabia et je m’en soucie peu du reste, car il me semble que vous devez avoir le cerveau légèrement atteint. Mais si vous parlez du capitaine Achab, de ce navire-là, le Péquod, alors laissez-moi vous dire que je sais tout au sujet de la perte de sa jambe.
– Tout, hein ? Êtes-vous sûr de tout savoir ? Vraiment tout ?
– Joliment sûr.
L’index toujours pointé, les yeux levés vers le Péquod, l’étranger loqueteux sombra un moment dans une inquiète rêverie ; puis il se tourna en tressaillant et ajouta : « Vous vous êtes enrôlés, alors c’est vrai ? Vos noms figurent sur le rôle ? Eh bien ! Eh bien ! ce qui est signé est signé. Ce qui doit être sera. Et encore cela ne sera peut-être pas après tout… De toute façon tout est écrit, prévu et j’imagine qu’il faut bien qu’il y ait des marins pour partir avec lui, autant vous que d’autres, que Dieu les ait en pitié ! Bien le bonjour à vous, camarades, bien le bonjour. Que l’Ineffable vous bénisse ; je m’excuse de vous avoir retardés.
– Écoutez un peu, ami, dis-je, si vous avez quoi que ce soit d’important à nous dire, sortez-le ! Mais si vous essayez de nous embobiner, alors vous perdez votre temps, je n’ai rien à ajouter !
– Et c’est très bien dit, j’aime entendre des gars s’exprimer de cette manière-là ; vous êtes exactement les hommes qu’il lui faut… vous et vos pareils. Bien le bonjour, camarades, bien le bonjour ! Oh ! quand vous y serez, dites-leur bien que j’ai décidé de ne pas être des leurs…
– Ah ! mon vieux, vous ne pouvez pas nous berner de la sorte… vous ne pouvez pas nous duper ! Il n’y a rien au monde de plus facile à un homme que de faire croire qu’il détient un grand secret.
– Bien le bonjour, camarades, bonjour…
– Et c’est le jour en effet, dis-je, venez Queequeg, quittons cet homme fou à lier. Mais un instant, dites-moi comment vous vous appelez, voulez-vous ?
– Élie.
– Élie ! pensai-je. Et nous partîmes, commentant, chacun à notre façon, les propos de ce vieux marin en haillons, nous tombâmes d’accord pour trouver que c’était un donneur d’eau bénite jouant au loup-garou. Mais nous n’avions pas fait cent mètres que, venant à passer l’angle de rue et à me retourner, je vis Élie nous suivant, bien qu’à une certaine distance. Pour je ne sais quelle raison cela me frappa à tel point que je n’en informai pas Queequeg, mais allai de l’avant avec lui, soucieux de savoir si l’étranger allait prendre la même rue que nous. C’est ce qu’il fit. Il me sembla alors qu’il nous surveillait mais, sur ma vie, je ne pus deviner son intention. Ce fait, venant se greffer sur son discours voilé, ambigu, à demi allusif, à demi révélateur, engendrait à présent en moi toutes sortes de vagues points d’interrogation, de demi-appréhensions, tout cela lié avec le Péquod, le capitaine Achab, cette jambe qu’il avait perdue, cet accès qu’il avait eu au cap Horn, la calebasse d’argent, et ce que le capitaine Peleg m’en avait dit, lorsque j’avais quitté le navire la veille, et les prédictions de Tistig, la squaw, et ce voyage pour lequel nous nous étions liés, et cent autres choses sous le signe de l’ombre.
Que cet Élie déguenillé nous épiât ou non, j’étais décidé à en avoir le cœur net, et dans cette intention je traversai la rue avec Queequeg et rebroussai chemin. Mais Élie passa sans paraître nous voir, je me sentis soulagé. Et une fois de plus, et définitivement, du moins je le crus, je le taxai, en mon âme, de charlatan.
CHAPITRE XX Grande animation
Un jour ou deux passèrent et une activité débordante régnait sur le Péquod. Non seulement on réparait les vieilles voiles, mais on en embarquait des neuves, ainsi que des pièces de toiles et des glènes de filin. Bref, tout disait que l’armement du navire tirait à sa fin. Le capitaine Peleg ne descendait pour ainsi dire jamais à terre, mais restait assis dans son wigwam, surveillant étroitement les hommes ; Bildad s’employait à tous les achats et à la fourniture du matériel ; les hommes occupés dans la cale ou au gréement travaillaient très avant dans la nuit.
Le lendemain du jour où Queequeg eut signé son engagement, toutes les auberges où étaient descendus les membres de l’équipage reçurent le mot d’ordre d’amener les coffres à bord avant la nuit car on ne pouvait prévoir quand le navire lèverait l’ancre. De sorte que Queequeg et moi embarquâmes nos atours, résolus toutefois à dormir à terre jusqu’à la dernière minute. Mais il semble que les avertissements soient donnés très longtemps à l’avance, en pareil cas, car le navire n’appareilla pas de plusieurs jours. Il n’y a rien là d’étonnant, il y avait beaucoup à faire et le nombre de choses auquel il convenait de penser pour que l’armement du Péquod fût complet est incalculable.
Tout un chacun sait quelle multitude d’objets s’avèrent indispensables à la tenue d’une maison : lits, casseroles, couteaux et fourchettes, pelles et pincettes, serviettes, casse-noix, que sais-je encore ? Il en va de même sur un baleinier qui réclame pendant trois ans la tenue d’un ménage au milieu du vaste Océan, loin des épiciers, des marchands des quatre saisons, des médecins, des boulangers et des banquiers. Et si cela est vrai pour l’équipement d’un navire marchand, il n’y a pas de commune mesure avec l’armement réclamé par un baleinier. Car indépendamment de la durée prolongée du voyage, le matériel de pêche à lui seul se compose de nombreux objets introuvables dans les ports lointains ordinairement fréquentés. De plus, il faut s’en souvenir, de tous les navires, les baleiniers sont les plus exposés aux accidents de toute nature, plus particulièrement à la destruction et à la perte des engins dont dépend le succès du voyage, c’est pourquoi il y faut des pirogues de rechange, des avirons de rechange, des lignes et des harpons de rechange et de tout de rechange ou presque, hormis un capitaine de rechange et un navire de rechange.
Au moment de notre arrivée dans l’île, le Péquod avait déjà embarqué le plus gros de son chargement, y compris son bœuf salé, son pain, son eau, ses feuillards en fer et ses futailles en botte. Mais, comme je l’ai déjà dit, un va-et-vient perpétuel se prolongea longuement entre la terre et le navire pour l’embarquement de choses et d’autres, tant grandes que petites.
La personne la plus affairée à ces transports était la sœur du capitaine Bildad, une vieille dame maigre, à l’esprit on ne peut plus résolu et infatigable, de bon cœur en outre, qui paraissait décidée, si c’était en son pouvoir, à ce que rien ne manquât à bord, une fois que le Péquod serait engagé en haute mer. Une fois, elle arrivait avec un pot de légumes marinés pour l’office du cambusier ; une autre, avec un bouquet de plumes pour le bureau où le second tenait son journal de bord ; une autre encore, avec une pièce de flanelle destinée au creux d’un dos rhumatisant. Jamais femme ne mérita si bien son nom de Charité, tante Charité comme chacun disait. Et telle une sœur de charité, cette charitable tante Charité allait et venait de-ci de-là, prête à se mettre à l’œuvre, corps et âme, pour tout ce qui pourrait assurer la sécurité, le confort et la consolation de tous sur un navire où son bien-aimé frère Bildad avait ses intérêts, et sur lequel elle-même possédait une ou deux vingtaines de dollars d’économies.
Il était saisissant de voir cette quakeresse au grand cœur monter à bord, comme elle le fit le dernier jour, avec une longue cuillère pour les pots dans une main et une lance plus longue encore dans l’autre. Bildad et le capitaine Peleg ne restaient pas à la traîne. Bildad se promenait avec une interminable liste des objets nécessaires et à chaque arrivage nouveau il mettait une coche face à l’objet désigné sur son papier. De temps à autre, Peleg se dégageait de son antre de fanons, rugissant contre les hommes dans les écoutilles, rugissant vers les gréeurs à la tête du mât, et terminant ses rugissements à l’intérieur de son wigwam.
Au cours de ces jours de préparatifs, Queequeg et moi montâmes souvent sur le navire, et chaque fois je demandais des nouvelles du capitaine Achab, et quand il rejoindrait le bord. À ces questions, il était répondu qu’il allait de mieux en mieux et qu’on l’attendait d’un jour à l’autre ; entre-temps, les deux capitaines Peleg et Bildad pouvaient s’occuper de tout ce qui était nécessaire au bateau pour prendre la mer. Si j’avais été parfaitement sincère avec moi-même, j’aurais vu très clairement dans mon cœur que cela ne me plaisait qu’à moitié d’être engagé de cette manière pour accomplir un aussi long voyage, sans avoir une seule fois aperçu l’homme qui serait maître absolu du navire dès que celui-ci aurait gagné la haute mer. Mais lorsqu’un homme pressent qu’il s’est embarqué dans une mauvaise affaire, il lui arrive de lutter inconsciemment pour se cacher à lui-même ses soupçons. C’était bien à peu près ce que je faisais. Je ne disais rien et j’essayais de ne penser à rien.
Enfin, on annonça que le navire appareillerait probablement le lendemain. Aussi Queequeg et moi nous nous levâmes de bonne heure ce jour-là.
CHAPITRE XXI Nous embarquons
Il était près de six heures lorsque nous approchâmes du quai, mais l’aube grise était incertaine et brumeuse.
– Il y a des marins qui courent devant nous, si je vois bien, dis-je à Queequeg, ce ne peuvent pas être des ombres, je pense que nous allons lever l’ancre avec le soleil. Dépêchez-vous !
– Arrière ! s’écria une voix, et celui à qui elle appartenait fut en même temps dans notre dos et posa une main sur nos épaules respectives puis, se glissant entre nous, il s’arrêta, légèrement penché en avant et, dans cette lumière trouble, il nous regarda tour à tour d’étrange manière. C’était Élie.
– Vous embarquez ?
– Bas les pattes je vous prie, dis-je.
– Écoutez, vous, dit Queequeg en se secouant, vous, allez !
– Alors vous n’embarquez pas ?
– Oui, nous embarquons, mais en quoi cela vous regarde-t-il ? dis-je. Savez-vous, monsieur Élie, que je vous considère comme légèrement indiscret.
– Non, non, non, je ne m’en rendais pas compte, dit Élie, nous regardant alternativement Queequeg et moi d’un regard inexprimable, lent, étonné.
– Élie, dis-je, vous nous obligeriez, mon ami et moi, en vous retirant. Nous partons pour l’océan Indien et l’océan Pacifique et nous préférerions n’être pas retenus.
– Vous y allez vraiment ? Et vous revenez avant le petit déjeuner ?
– Il est toqué, Queequeg, dis-je, venez !
– Holà ! cria Élie, immobile, nous interpellant alors que nous avions fait quelques pas.
– Ne nous occupons pas de lui, lui dis-je, venez Queequeg.
Mais il nous rattrapa à nouveau et, me tapant soudain sur l’épaule, il dit : « N’avez-vous pas vu quelque chose qui ressemblait à des hommes se dirigeant vers le bateau il y a un moment ? »
Frappé par cette question simple et terre à terre, je répondis : « Oui, j’ai cru voir quatre ou cinq hommes, mais il faisait trop sombre pour que j’en sois sûr. »
– Très sombre, très sombre, dit Élie. Bien le bonjour à vous !
Une fois de plus, nous le quittâmes, mais une fois de plus il vint en tapinois derrière nous, et me touchant une fois de plus à l’épaule, il dit :
– Vous tâcherez d’essayer de les retrouver à présent, n’est-ce pas ?
– Retrouvez qui ?
– Bien le bonjour à vous, bien le bonjour ! entonna-t-il une fois de plus, puis s’éloignant, il ajouta : Oh ! j’allais vous mettre en garde contre… mais peu importe, peu importe… c’est tout un, tout en famille aussi. Il gèle dur ce matin, n’est-ce pas ? Adieu à vous ! Je ne vous reverrai pas de sitôt, m’est idée, à moins que ce ne soit devant le Grand Tribunal. Sur ces divagations, il partit enfin, me laissant, sur l’instant, stupéfait d’une impudence aussi éhontée.
À bord du Péquod, régnait un profond silence, pas une âme ne bougeait. La porte de la chambre était fermée de l’intérieur, les panneaux d’écoutilles étaient tous en place et encombrés de glènes de filins. Nous dirigeant vers le gaillard d’avant, nous trouvâmes le panneau de l’écoutillon ouvert. Voyant une lumière, nous descendîmes et ne découvrîmes qu’un vieux gréeur, enveloppé dans une vareuse d’ordonnance en lambeaux. Couché de tout son long sur deux coffres, à plat ventre, le visage enfoui entre ses bras croisés, il dormait du plus profond sommeil.
– Ces marins que nous avons vus, Queequeg, où peuvent-ils avoir passé ? demandai-je en regardant ce dormeur d’un air soupçonneux. Mais il apparut que, lorsque nous étions sur le quai, Queequeg n’avait rien remarqué de ce à quoi je faisais allusion à présent, aussi j’aurais cru à une illusion d’optique, n’eût été la question, inexplicable alors, posée par Élie. Mais je chassai cette pensée et, jetant un regard sur le dormeur, je suggérai facétieusement à Queequeg de veiller le corps, l’invitant à s’installer à cette fin. Il posa la main sur l’arrière-train de l’homme, comme pour tâter s’il était assez moelleux, puis, sans autre forme de procès, il s’y assit tranquillement.
– Miséricorde ! Queequeg ne vous asseyez pas là, lui dis-je.
– Oh ! joli bon siège, dit Queequeg, mon pays coutume. Fera pas mal figure lui.
– Sa figure ! dis-je, vous appelez ça sa figure ? Elle a une mine fort bienveillante alors ; mais comme il a de la peine à respirer ; levez-vous, Queequeg, vous êtes lourd, vous lui écrasez la figure, à ce pauvre. Debout, Queequeg ! Il va vous secouer de là, bientôt. Je m’étonne qu’il ne se réveille pas.
Queequeg s’installa alors juste derrière la tête du dormeur et alluma son tomahawk-pipe. Je m’assis aux pieds. Nous nous passions la pipe par-dessus le dormeur. Tout en fumant, répondant à sa manière incohérente aux questions que je lui avais posées, Queequeg me laissa entendre que, dans son pays, en l’absence de causeuses et de sofas d’aucune espèce, les rois, les chefs et tous les grands en général avaient coutume d’engraisser quelques individus des basses classes en guise de divans, et de meubler ainsi une maison très confortablement, vous n’aviez qu’à acheter huit ou dix paresseux et à les disposer dans les trumeaux et les alcôves. D’autre part, ils présentaient de gros avantages lors d’une promenade, ils étaient de beaucoup supérieurs à ces chaises de jardin qu’on peut replier afin qu’elles servent de cannes car, lorsque l’occasion s’en présente, le chef peut transformer son escorte en canapé s’il désire s’asseoir sous un arbre croissant peut-être dans un sol humide ou marécageux.
Tout en racontant son histoire, chaque fois que je lui repassais la pipe, Queequeg en brandissait le côté hache sur la tête du dormeur.
– Pourquoi faites-vous cela, Queequeg ?
– Joli facile touer lui, oh ! joli facile…
Il évoquait de sauvages souvenirs au sujet de sa pipe-tomahawk qui semblait avoir eu la double fonction de défoncer le crâne de ses ennemis et d’apaiser son âme, lorsque le gréeur endormi attira notre attention. La fumée acre avait complètement rempli ce trou resserré et commençait à agir sur lui ; il respirait comme s’il avait été bâillonné, puis il présenta des troubles nasaux, se tourna enfin une ou deux fois, puis s’assit et se frotta les yeux.
– Holà ! souffla-t-il finalement, qui êtes-vous, fumeurs ?
– Des enrôlés, répondis-je, quand est-ce qu’il part ?
– Oui, oui, vous partez avec, hé ? Il part aujourd’hui. Le capitaine a rejoint le bord la nuit dernière.
– Quel capitaine ? Achab ?
– Qui sinon lui ?
J’allais lui poser d’autres questions au sujet d’Achab lorsque nous entendîmes un bruit sur le pont.
– Holà ! Starbuck est debout, dit le gréeur. C’est un second actif, celui-là, bon diable et pieux, mais tout à fait actif à présent, faut que j’aille. Sur ce, il monta sur le pont où nous le suivîmes.
Le soleil se levait. Les hommes arrivaient par groupes de deux ou de trois, les gréeurs se démenaient, les seconds s’affairaient et plusieurs hommes à quai s’empressaient à embarquer encore les derniers colis. Pendant ce temps, le capitaine Achab demeurait invisible, enchâssé dans sa cabine.