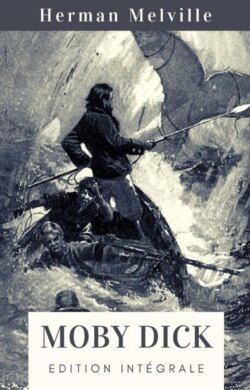Читать книгу Herman Melville : Moby Dick (Édition intégrale) - Herman Melville, Herman Melville - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE VI
La rue
ОглавлениеSi je m’étais étonné tout d’abord, après le premier regard jeté sur un être aussi incongru que Queequeg, en l’imaginant côtoyant le beau monde d’une ville civilisée, mon étonnement disparut incontinent dès que je parcourus de jour les rues de New Bedford.
Tout grand port maritime offre, aux alentours de ses quais, le spectacle d’étrangers des plus bizarres et des plus hétéroclites. Même dans Broadway et Chesnut Streets, il arrivera que des marins venus de la Méditerranée bousculent des dames effarouchées. Regent Street n’est pas inconnue des lascars et des Malais et, sur l’Apollo Green de Bombay, d’entreprenants Yankees ont souvent effrayé les natifs. Mais New Bedford bat le record de toutes les Water Street et Wapping, où vous ne rencontrerez guère que des marins, tandis qu’à New Bedford d’authentiques cannibales taillent une bavette au coin des rues, parfaits sauvages, dont beaucoup ont sur les os une chair non sanctifiée. Insolite spectacle !
Mais en plus des insulaires des Fidji, de Tongatabou, de Panjang, d’Erromango Bright et en plus des échantillons farouches produits par les équipages des baleiniers qui déambulent inaperçus, la rue vous proposera des spectacles encore plus singuliers et certainement plus comiques. Chaque semaine, on voit arriver des citadins de Vermont et du New Hampshire dévorés par l’appât du gain et de la gloire des grandes pêches. Ce sont pour la plupart des gars jeunes et robustes qui, après avoir abattu des forêts entières, cherchent à troquer la hache contre le harpon. Ils sont aussi verts que les montagnes dont ils descendent. À bien des égards, on les croirait tout frais sortis de la coquille. Voyez-moi ce gars qui fait la roue, là-bas au coin ! Il porte un chapeau de castor, un manteau en queue d’hirondelle, une ceinture de marin serrée à la taille et un couteau dans sa gaine. Et cet autre qui arrive en suroît et cape d’alépine.
Il n’est pas de dandy citadin capable de rivaliser avec un gandin sorti de la campagne – j’entends un vrai rustre du dandysme – un gars qui, en pleine canicule, fauchera ses deux acres les mains gantées de daim de crainte qu’elles ne se tannent. Eh bien, quand un dandy de cette trempe s’est mis dans l’idée de se tailler une réputation à sa hauteur, et cherche à s’embarquer pour la pêche à la baleine, vous devriez voir à quelles cocasseries il s’adonne en arrivant au port. En commandant l’habit qu’il portera en mer, il réclame des boutons d’uniforme d’apparat pour sa vareuse, des bretelles pour ses pantalons de toile. Ah ! pauvre rustaud ! combien cruellement, au premier hurlement de la tempête, vont s’envoler ces ornements tandis que vous serez précipités, bretelles, boutons et tout, droit au fond du gosier de la tempête. Mais n’allez pas croire que cette ville fameuse ne peut montrer à ses hôtes que des harponneurs, des cannibales et des blancs-becs. Pas du tout. Pourtant, New Bedford est un lieu insolite. Mais sans nous autres baleiniers, cette région serait peut-être encore maintenant, telles les côtes du Labrador, le seul domaine du vent. Son arrière-pays est assez rocailleux pour effrayer encore son monde. Mais la ville est peut-être l’endroit où la vie est la plus chère de toute la Nouvelle-Angleterre. C’est bien une terre grasse, certes, mais non à la façon de Canaan, une terre de blé et de vin. Le lait ne ruisselle pas dans les rues, et le printemps ne les pave pas d’œufs frais. Pourtant, malgré cela, nulle part ailleurs en Amérique, vous ne trouverez autant de maisons patriciennes, des parcs et des jardins plus somptueux qu’à New Bedford. D’où viennent-ils et comment poussèrent-ils sur la scorie de cette terre maigre ?
Allez faire un tour et regardez bien, autour de ces hautaines demeures, se dresser l’emblème des harpons de fer, c’est la réponse à votre question. Ces jardins en fleurs et ces pimpantes maisons sortent tout droit des océans Atlantique, Pacifique et Indien. Toutes ces demeures ont été prises au harpon et arrachées au fond des mers. Herr Alexandre lui-même aurait-il pu accomplir pareil tour de prestidigitation ?
À New Bedford, dit-on, les pères dotent leurs filles avec des baleines et pourvoient leurs nièces grâce à quelques marsouins. Si vous voulez voir un beau mariage, c’est à New Bedford qu’il faut aller, car on raconte que les maisons ont des réserves d’huile inépuisables et que chaque nuit on y brûle avec insouciance des bougies de blanc de baleine tout entières.
L’été, la ville est exquise à voir, des érables sans nombre bordent de vert et d’or les longues avenues. Et en août, les beaux marronniers altiers et munificents, tels des candélabres, offrent au passant les cierges dressés de leurs bouquets en touffes. La toute-puissance de l’art est telle qu’en plus d’un quartier de New Bedford il a transformé en éclatantes terrasses fleuries les rochers nus, déchets inutiles rejetés au dernier jour de la création.
Les femmes de New Bedford, elles, fleurissent à l’égal de leurs propres roses rouges. Mais tandis que les roses ne s’épanouissent qu’en été, le délicat incarnat de leurs joues est éternel comme la lumière du septième ciel. Vous ne trouveriez nulle part ailleurs pareille splendeur, sauf peut-être à Salem, où les jeunes filles, dit-on, répandent un parfum si musqué que leurs amoureux marins le reconnaissent à des milles de la côte, comme s’ils approchaient des odorantes Moluques bien plutôt que des sables puritains.