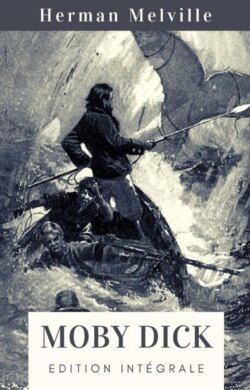Читать книгу Herman Melville : Moby Dick (Édition intégrale) - Herman Melville, Herman Melville - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE XVI
Le navire
ОглавлениеAu lit, nous combinâmes un plan pour le lendemain, mais à ma surprise et pour ma plus grande inquiétude, Queequeg me donna alors à entendre qu’il avait sérieusement consulté Yoyo – ainsi s’appelait son petit dieu noir – que Yoyo lui avait répondu par deux ou trois fois, et fortement insisté de toutes les manières possibles, pour qu’au lieu d’aller ensemble au port et choisir d’un commun accord parmi la flottille des baleiniers le navire sur lequel nous embarquerions, au lieu de cela, dis-je, Yoyo ordonnait instamment que j’assumasse l’entière responsabilité de ce choix, attendu que Yoyo se proposait de nous protéger et qu’à cette fin il avait d’ores et déjà choisi lui-même ce navire que, livré à moi-même, moi Ismaël, je trouverai comme par hasard mais infailliblement, comme si la chance l’avait amené là exprès ; je devais m’engager aussitôt sur ce navire, indépendamment de Queequeg pour le moment.
J’ai oublié de dire que, en bien des cas, Queequeg accordait une grande confiance à la valeur des jugements de Yoyo et à l’étonnante sûreté de ses prédictions. Il tenait Yoyo en considérable estime, comme un dieu plutôt bon de nature aux intentions généralement amicales, mais dont les bienveillants desseins ne réussissaient pas toujours.
Cette décision de Queequeg, ou plutôt de Yoyo, je ne l’appréciai à aucun degré. Je m’en étais presque absolument remis à la perspicacité de Queequeg pour élire le mieux qualifié pour nous transporter sûrement, nous et notre sort. Mais toutes mes protestations restant sans effet, je fus contraint de céder et, en conséquence, je me préparai à prendre l’affaire en main avec une hâte décidée, une énergie vigoureuse, propre à bâcler promptement cette question futile. Le lendemain matin de bonne heure, je quittai Queequeg enfermé avec Yoyo dans notre petite chambre, car il semblait que ce fût le jour d’une espèce de carême ou de ramadan, ou un jour de jeûne, de mortification et de prières entre Queequeg et Yoyo. Ce qu’il en était précisément, je ne pus jamais le découvrir car bien que je me sois appliqué maintes fois à méditer sa liturgie et ses XXXIX Articles, je ne pus jamais en venir à bout ; dès lors, abandonnant Queequeg jeûnant avec son tomahawk, et Yoyo se chauffant au feu sacrificatoire des copeaux, je me mis en route parmi les bateaux. Après des déambulations interminables, des renseignements demandés à tort et à travers, j’appris que trois navires étaient en partance pour des voyages de trois ans : le Diable-et-sa-mère, la Bonne-Bouche et le Péquod. J’ignore l’origine du nom du Diable-et-sa-mère, celle de Bonne Bouche est évidente, quant à Péquod, vous vous souvenez sans doute que c’était le nom d’une célèbre tribu d’Indiens du Massachussetts aussi éteinte à présent que les anciens Mèdes. Je jetai un regard inquisiteur et fureteur sur le Diable-et-sa-mère ; de là, je sautai dans la Bonne-Bouche et enfin, montant à bord du Péquod, je l’examinai un moment et décidai que c’était là le navire idéal pour nous.
Autant que je sache, vous avez sans doute vu, au cours de votre vie, bien des embarcations pittoresques : des lougres à bouts carrés, des jonques japonaises hautes comme des montagnes, des galiotes-caisses à beurre, je ne sais quoi encore mais, croyez-moi sur parole, vous n’avez jamais vu un vieux bâtiment aussi extraordinaire que cet extraordinaire vieux Péquod. C’était un navire de la vieille école, plutôt petit, qui avait la façon surannée des meubles à pieds de griffon. Longuement amarinée, colorée par tous les temps, des typhons aux calmes plats des quatre océans, sa vieille coque avait pris le teint basané d’un grenadier français qui aurait combattu en Égypte comme en Sibérie. Son étrave vénérable semblait barbue. Ses mâts – taillés quelque part sur la côte japonaise là où la tempête emporta ceux qu’il avait à l’origine – ses mâts avaient la raideur de l’épine dorsale des trois vieux rois de Cologne. Ses ponts antiques étaient usés et ridés comme la dalle vénérée des pèlerins où fut versé le sang de Becket dans la cathédrale de Cantorbéry. À ces pièces de musée, étaient venues s’ajouter des caractéristiques nouvelles et étonnantes qui racontaient les aventures sauvages qui furent les siennes pendant plus d’un demi-siècle. Le vieux capitaine Peleg, second à son bord pendant plusieurs années avant de commander son propre navire, qui était maintenant à la retraite et l’un des principaux propriétaires du Péquod, ce vieux Peleg avait, durant son règne de second, ajouté à son caractère grotesque primitif et l’avait pénétré de part en part d’une étrangeté, due à la fois au matériau et à son esprit inventif, qui n’avait sa pareille nulle part sauf peut-être sur le bouclier ou le châlit de Thorkill Hake. Il portait parures comme un barbare empereur d’Éthiopie au cou alourdi de pendentifs d’ivoire poli. C’était un reliquaire de trophées. Un cannibale de navire, se pavanant dans les ossements ciselés de ses ennemis. Ses pavois à découvert, sans jambettes, étaient ornés sur tout leur pourtour, sans interruption, telle une seule mâchoire, avec les longues dents aiguës du cachalot tenant lieu de cabillots pour amarrer ses muscles de chanvre et ses tendons. Ces filins ne couraient pas dans des poulies de vulgaire bois des forêts mais filaient prestement dans des réas creusés dans du morfil. Méprisant un gouvernail à tourniquet, il arborait une barre digne de respect, taillée d’une seule pièce dans la longue et étroite mâchoire inférieure de son ennemi héréditaire. L’homme de barre lorsqu’il gouvernait dans la tempête se sentait, cette barre en main, pareil au Tartare lorsqu’il retient par le mors son ardente monture. Un navire d’une vraie noblesse, mais aussi d’une certaine manière, d’une grande mélancolie ! Toute chose noble en est empreinte.
Lorsque j’en vins à chercher sur le gaillard d’arrière quelqu’un nanti d’autorité, afin de me porter candidat au voyage, je ne vis personne de prime abord mais ce que je ne pus manquer de voir c’était une singulière sorte de tente, ou plutôt de wigwam, dressée un peu en retrait du grand-mât. Elle semblait être une installation de fortune pour le temps passé au port, conique, de quelque dix pieds de haut, elle était construite avec les longs et immenses fanons noirs et souples, découpés en lanières et pris dans le centre et la partie la plus haute des mâchoires de la baleine franche. Leurs extrémités les plus larges s’appuyaient sur le pont ; lacées ensemble, ces lanières formaient un cercle décroissant qui se terminait en touffe serrée au sommet où ces crins flottants s’agitaient de-ci de-là telle une mèche de scalp mêlée de plumes sur la tête de quelque vieux sachem des Pottowottamie. Face à l’étrave, une ouverture triangulaire permettait à son hôte d’avoir une vue totale sur l’avant.
À demi dissimulé dans cette curieuse habitation, je trouvai enfin quelqu’un dont l’aspect semblait indiquer qu’il détenait un pouvoir et qui, tout travail étant interrompu à bord parce qu’il était midi, ayant déposé le fardeau du commandement, jouissait de son répit. Il était assis sur une chaise de chêne démodée, contorsionnée de toutes parts d’insolites sculptures et dont le siège était fait d’un puissant entrelacs de cette même matière élastique dont était construit le wigwam.
Peut-être l’aspect du vieil homme que je vis n’avait-il rien de si particulier ; il était tanné et musclé comme la plupart des vieux marins, lourdement enveloppé dans un manteau de pilote en drap brun, coupé à la mode quaker ; mais autour de ses yeux un fin et presque microscopique réseau de rides minuscules avait dû être tissé par un regard plissé sans cesse, fixé au vent, au cours d’incessantes navigations dans plus d’une rude tempête. De telles rides sont très utiles pour prendre un air menaçant.
– Ai-je l’honneur de parler au capitaine du Péquod ? demandai-je en m’approchant de l’entrée de la tente.
– En supposant que ce soit le capitaine du Péquod, que lui veux-tu ?
– Je pensais à embarquer.
– Tu y pensais, n’est-ce pas ? Je vois que tu n’es pas de Nantucket – déjà été dans un bateau défoncé ?
– Non, monsieur, jamais.
– Tu ne connais rien de rien en fait de pêche à la baleine, j’en jurerais, hein ?
– Rien, monsieur, mais je suis sûr que j’apprendrai vite. J’ai fait plusieurs voyages dans la marine marchande et je crois que…
– Le diable emporte la marine marchande. Pas de jargon avec moi. Vois-tu ce pied ? – Je te le flanquerai au cul si jamais tu reparles devant moi de la marine marchande. La marine marchande, sans blague ! Et je présume que tu en es même fier, d’avoir servi sur ces navires marchands. Mais bon sang, homme ! qu’est-ce qui te pousse à vouloir pêcher la baleine, hein ? – ça m’a l’air un peu suspect, non ? – Tu n’as pas été pirate des fois, non ? Tu n’as pas volé ton dernier capitaine, non ? Tu n’as pas pensé à assassiner les officiers une fois au large ?
Je protestai de mon innocence devant ces soupçons. Je comprenais que ce vieux marin, en tant que quaker de l’île de Nantucket, dissimulait, sous le masque de la facétie, ses préjugés d’insulaire, méfiant envers tout étranger à moins qu’il ne vienne du cap Cod ou de Vineyard.
– Mais qu’est-ce qu’il te prend de vouloir pêcher la baleine ? Je veux en connaître la vraie raison avant d’envisager de t’embarquer.
– Eh bien ! monsieur, je veux savoir ce que pêcher la baleine veut dire. Je veux voir le monde.
– Tu veux tâter de la pêche à la baleine, hein ? As-tu aperçu le capitaine Achab ?
– Qui est le capitaine Achab, monsieur ?
– Oui, oui, c’est bien ce que je me disais ! Le capitaine Achab est le capitaine de ce navire.
– Alors, je me trompe. Je croyais que je parlais au capitaine en personne.
– Tu parles au capitaine Peleg – voilà à qui tu parles, jeune homme. C’est à moi et au capitaine Bildad qu’il appartient de veiller à ce que le Péquod soit armé pour le voyage, approvisionné de tout le nécessaire, les hommes y compris. Nous avons des parts de propriété et nous sommes également armateurs. Mais j’étais en train de dire que si tu veux savoir ce que pêcher la baleine signifie, comme tu me dis le vouloir, je peux te donner le moyen de l’apprendre avant que tu ne sois engagé sans possibilité de te dédire. Va voir un peu le capitaine Achab, et tu te rendras compte qu’il n’a qu’une jambe.
– Que voulez-vous dire, monsieur ? Qu’il a perdu l’autre à cause d’une baleine ?
– À cause d’une baleine ! Jeune homme, viens plus près de moi : elle a été dévorée, mâchée, broyée par le plus monstrueux cachalot qui ait jamais fait voler en éclats un bateau !… ah ! ah !…
Je fus un peu effrayé par sa violence, peut-être un peu ému aussi par tout ce que sa dernière exclamation exprimait de sincère douleur, mais je répondis aussi calmement que je pus :
– Ce que vous dites n’est certainement que trop vrai, monsieur, mais comment aurais-je pu savoir que ce cachalot particulier était d’une si particulière férocité, encore qu’en vérité j’eusse bien pu en tirer cette déduction du simple fait de l’accident.
– Écoute à présent, jeune homme, tu as le poumon mou, tu comprends ? tu n’as pas le langage marin. Tu es bien sûr que tu as déjà pris la mer, tu es sûr de ça ?
– Monsieur, j’ai cru vous avoir dit que j’avais fait quatre voyages dans la marine…
– Ne la ramène pas avec ça ! Prends garde à ce que j’ai dit au sujet de la marine marchande, ne m’exaspère pas, je ne le permettrai pas. Mais essayons de nous comprendre. Je t’ai laissé entendre ce que pêcher la baleine signifiait, t’y sens-tu toujours disposé ?
– Oui, monsieur.
– Bon. Maintenant es-tu homme à jeter un harpon au fond de la gueule d’une baleine vivante et à filer à sa suite ? Réponds, vite !
– Je le suis, monsieur, s’il se trouve qu’il soit absolument nécessaire de le faire ; mais pas pour qu’on se débarrasse ainsi de moi, bien sûr, ce dont je ne parle pas comme d’une chose devant se produire.
– Bon, encore une fois. Alors, tu ne veux pas seulement partir pêcher la baleine pour savoir par expérience ce que c’est, mais encore tu souhaites voir le monde ? N’était-ce pas ce que tu disais ? C’est ce que j’ai cru comprendre. Eh bien ! avance seulement jusque-là, jette un coup d’œil du côté du vent, et reviens me dire ce que tu y auras vu.
Je restai quelque temps légèrement abasourdi par cette intimation curieuse, ne sachant pas très bien comment l’interpréter, que ce fût une plaisanterie ou un ordre sérieux. Mais ramenant toutes ses pattes d’oie en un froncement renfrogné, le capitaine Peleg m’invita à aller.
Je me rendis à l’avant, je regardai du côté du vent et je m’aperçus que le navire à l’ancre, balancé par la marée, pointait maintenant obliquement vers le large. La vue s’étendait à l’infini, un infini monotone et hostile à l’excès, je ne pus y discerner quoi que ce soit qui en rompît l’uniformité.
– Eh bien ! quel est le compte rendu ? me demanda Peleg lorsque je revins. Qu’as-tu vu ?
– Pas grand-chose… rien que de l’eau, un horizon immense toutefois et peut-être un grain qui se prépare…
– Alors, qu’est-ce que tu en penses maintenant de voir le monde ? As-tu envie de doubler le cap Horn pour ne rien voir de plus, hein ? Ne peux-tu voir le monde depuis là où tu es ?
J’étais un peu ébranlé, mais pêcher la baleine, je le devais, et j’irai ; et le Péquod était un bateau aussi bon qu’un autre – meilleur, pensais-je – pour embarquer. Tout cela, je l’exprimai à Peleg. Me voyant si décidé, il consentit à m’engager.
– Tu peux aussi bien signer les papiers tout de suite, ajouta-t-il, suis-moi. Ce disant, il me précéda jusqu’à la descente de la cabine.
Sur la barre d’arcasse était assis un personnage qui me parut extraordinaire et surprenant. Il se trouva que c’était le capitaine Bildad qui, avec le capitaine Peleg, possédait le plus grand nombre de parts du navire, les autres actions, comme c’est parfois le cas dans ces ports, appartenant à une foule de vieux rentiers, à des veuves et des orphelins, à des pupilles sous tutelle judiciaire ; chacun d’entre eux se trouvant propriétaire de la valeur d’une tête d’allonge, d’un pied de planche ou d’un ou deux clous à bord. Les gens de Nantucket placent leur argent sur les baleiniers, tout comme vous l’engagez en fonds d’État sûrs et d’un bon rapport.
Bildad, comme Peleg, et bien d’autres Nantuckais, était quaker, cette secte ayant fondé le premier établissement de l’île ; et ses habitants conservent en général et jusqu’à ce jour, dans une mesure très exceptionnelle, les particularités des quakers, nuancées seulement de façon variable et irrégulière par des éléments parfaitement étrangers et disparates. Car quelques-uns de ces mêmes quakers sont parmi les plus sanguinaires des marins et des chasseurs de baleines. Ce sont des quakers combattants, des quakers en furie.
De sorte qu’il y a parmi eux des exemples d’hommes portant des noms tirés des Écritures – une coutume très répandue sur l’île – et qui, assimilant avec le lait de l’enfance le tutoiement théâtral et majestueux du langage quaker, mêlent étrangement à ces particularités indéracinables, au cours de leurs vies d’aventures sans bornes, audacieuses et téméraires, mille traits de caractère d’effronterie, que ne renieraient pas un roi viking ou un conquérant romain. Lorsque ces contraires fusionnent dans un homme d’une force naturelle vraiment supérieure, au cerveau bien fait et au cœur grave, que tant de longues nuits de quart aussi, sur les plus lointaines eaux, sous les constellations que le Nord ne révèle jamais, amènent, par leur paix et leur solitude, à penser avec indépendance en marge des traditions, qui reçoit toutes les empreintes douces ou violentes à la source même du sein vierge, généreux et confiant de la nature, et qui se rend maître, dès lors, c’est l’un de ses profits accidentels, d’un langage hardi, énergique et hautain – cet homme – le recensement d’une nation n’en donnera qu’un – vous offre le spectacle de la grandeur de qui est promis aux nobles tragédies. Et il ne sera amoindri en rien, quant au pathétique, si de naissance ou à cause de quelque circonstance, une tristesse maladive domine le fond de sa nature, dans laquelle il semble se complaire à demi. Car c’est un certain goût morbide qui façonne tous les hommes d’une tragique grandeur. Ô jeune ambition, sache-le bien, toute grandeur humaine n’est que maladie. Mais pour le moment nous ne nous trouvons pas devant une nature de ce genre mais devant une autre, fort différente, avec un homme qui, pour singulier qu’il soit, n’exprime qu’un aspect du quakerisme modifié par sa personnalité.
Comme le capitaine Peleg, le capitaine Bildad était un baleinier à la retraite, fortune faite. Mais au contraire du capitaine Peleg, qui lui se moquait complètement de ce qu’on appelle les choses sérieuses et qui, à vrai dire, considérait ces mêmes choses sérieuses comme des broutilles, le capitaine Bildad non seulement avait été élevé selon les règles les plus strictes du quakerisme de la secte de Nantucket mais ni toute sa vie passée sur l’Océan, ni la vue, aux environs du cap Horn, de superbes créatures nues, ni rien de tout cela n’avait changé d’un iota ce quaker né comme cela, n’avait en rien adouci les angles de sa veste. En dépit de ces données inaltérables, l’honorable capitaine Bildad manquait passablement de simple logique. Bien que refusant, par scrupules de conscience, de porter les armes contre de terrestres envahisseurs, lui-même avait envahi sans que rien puisse le retenir, l’Atlantique et le Pacifique et, bien qu’ennemi juré du sang versé, il avait pourtant, dans son manteau étroit, répandu à flots celui du léviathan. Comment le pieux Bildad, au soir contemplatif de sa vie, réconciliait-il ces faits dans son souvenir, je ne sais ; mais cela ne semblait pas l’inquiéter outre mesure, et il en était très probablement venu à la conclusion sage et raisonnable que la religion d’un homme est une chose et que ce monde positif en est une autre. Ce monde paie des dividendes. Passant de mousse de carré, vêtu de court et de gris, au rang de harponneur habillé d’un large gilet en ventre d’alose, puis à celui de chef de pirogue, de second, de capitaine pour devenir enfin commanditaire, Bildad, je l’ai déjà dit, avait mis un terme à sa carrière aventureuse en abandonnant toute activité au bel âge de soixante ans, vouant le restant de ses jours à la douceur d’encaisser un revenu bien gagné.
Maintenant, j’ai le regret de le dire, Bildad avait la réputation d’être un vieil avare incorrigible et passait pour avoir été, du temps où il naviguait, un tyran implacable. On m’a raconté à Nantucket, bien que cela paraisse sans aucun doute une curieuse histoire, que lorsqu’il était maître à bord du vieux navire-baleinier Catgut, son équipage, en débarquant, avait été emmené presque au complet à l’hôpital, cruellement épuisé et usé. Pour un homme pieux, qui plus est pour un quaker, il avait plutôt le cœur dur, c’est le moins qu’on en puisse dire. Jamais il n’injuriait ses hommes, mais il avait une façon à lui de les soumettre aux travaux forcés, avec une cruelle démesure. Lorsque Bildad était second, sentir son œil terne vous fixer intensément vous rendait fou de nervosité jusqu’à ce que vous puissiez faire main basse sur n’importe quoi : un marteau ou un épissoir, et vous mettre au travail, comme un forcené, à une chose ou à une autre, peu importe quoi. L’indolence et la paresse tombaient mortes devant lui. Sa propre personne était l’incarnation parfaite de la parcimonie. Son long corps étique ne comportait aucune chair superflue, aucune barbe superflue, son menton s’ornant d’un poil doux ratissé à l’économie, semblable au velours élimé de son chapeau à larges bords.
Telle était la personne que je trouvai assise sur la barre d’arcasse après avoir suivi le capitaine Peleg dans la cabine. L’espace entre les ponts était étroit, et le vieux Bildad se tenait assis là, droit comme un i, car il s’asseyait toujours ainsi sans s’appuyer jamais comme s’il eût voulu ménager les basques de son vêtement. Son chapeau était posé à côté de lui, il tenait ses jambes croisées avec raideur, sa veste de drap était boutonnée jusqu’au cou et, les lunettes sur le nez, il paraissait absorbé dans la lecture d’un volume imposant.
– Bildad, s’écria le capitaine Peleg, je t’y reprends, Bildad, hein ? Voilà maintenant trente ans, à ma connaissance certaine, que tu étudies ces Écritures. Où en es-tu, Bildad ?
Comme s’il était habitué depuis longtemps à un langage aussi profane de la part de son vieux compagnon de bord, Bildad, sans relever son manque de respect, leva tranquillement les yeux et, me voyant, les reporta interrogativement sur Peleg.
– Il dit qu’il est notre homme, Bildad, dit Peleg. Il veut embarquer.
– Le veux-tu ? me demanda Bildad d’une voix caverneuse en se tournant vers moi.
– Si tu le veux bien, répondis-je, le tutoyant sans m’en rendre compte, tant il était quaker jusqu’au bout des ongles.
– Que penses-tu de lui, Bildad ? demanda Peleg.
– Il fera l’affaire, répondit Bildad, en m’examinant, et il se remit à déchiffrer son livre en marmottant de manière presque audible.
Je trouvais qu’il était bien le plus bizarre vieux quaker que j’aie jamais vu, d’autant plus que Peleg, son ami et compagnon de longue date, accusait le contraste, avec son genre de casseur d’assiettes. Mais je ne dis rien, me contentant de porter un regard perçant sur ce qui m’entourait. Peleg ouvrit un coffre et, sortant le rôle d’équipage, plaça devant lui une plume et de l’encre, en s’asseyant lui-même à une petite table. Je commençai à penser qu’il était grand temps que je me décide à connaître les conditions que j’accepterais pour mon engagement. Je savais déjà qu’il n’était pas question de salaire sur les baleiniers ; mais l’équipage, y compris le capitaine, recevait des parts sur le bénéfice appelées quantièmes d’une part proportionnelle au degré d’importance des tâches respectives des hommes. Je me rendais compte également qu’étant novice, ma part ne saurait être bien grande, mais du fait que je connaissais la mer, que j’étais capable de gouverner un navire et d’épisser un cordage, je ne doutais pas que, d’après ce que j’avais entendu dire, l’on m’offrirait un 275e – c’est-à-dire le 275e d’une part des bénéfices nets du voyage à quelque taux qu’ils se montassent. Bien que ce 275e de part fût plutôt de ceux qu’ils appelaient à long terme, c’était toujours mieux que rien ; et si la chance favorisait notre voyage, cela paierait presque les vêtements que j’userais à bord, sans compter le lit et la table pour lesquels je ne débourserais pas un sou.
D’aucuns pourront trouver que c’est une piètre manière d’accumuler une fortune princière – et ce l’était, une bien piètre manière en vérité. Mais je ne suis pas de ceux qu’émeuvent les fortunes princières, et je suis bien content si le monde est disposé à me nourrir et à m’héberger lorsque je peux loger à l’enseigne menaçante du « Nuage d’orage ». Tout compte fait, je trouvai ce 275e à peu près équitable, mais je n’aurais pas été surpris qu’on m’offrît le 200e, vu la carrure de mes épaules.
Néanmoins, une chose me faisait douter de recevoir une part généreuse sur les bénéfices et c’était celle-ci : à terre, j’avais entendu parler du capitaine Peleg et de son inénarrable vieux compère Bildad et du fait qu’étant les plus gros propriétaires du Péquod, les autres actionnaires disséminés et de moindre importance laissaient la presque entière direction des affaires du navire à ces deux-là. Et je soupçonnai ce vieux pingre de Bildad d’avoir largement son mot à dire dans les engagements d’autant plus que je l’avais trouvé à bord, se sentant tout à fait chez lui dans cette cabine, et lisant sa Bible comme s’il se trouvait au coin de sa propre cheminée. Maintenant, tandis que Peleg essayait vainement de tailler une plume à l’aide de son couteau, le vieux Bildad, à ma grande surprise, étant donné qu’il était partie intéressée dans ces formalités, Bildad ne nous accorda aucune attention, mais continua à marmotter les phrases de son livre : « Ne vous amassez point de trésors sur la terre ou la mite… »
– Alors, capitaine Bildad, interrompit Peleg, qu’en dis-tu ? quelle part donnerons-nous à ce jeune homme ?
– Tu sais mieux… fut la sépulcrale réponse, la 777e ne serait pas trop, n’est-ce pas ?… « où la mite et le ver consument… mais amassez-vous… »
Amassez ! vraiment ! pensai-je avec une part pareille ! la 777e ! Eh bien ! vieux Bildad, vous avez résolu que moi le premier, je n’amasserai pas ici-bas, là où la mite et le ver consument. C’était une part à long terme, à un terme excessif en vérité, bien que l’amplitude du chiffre puisse, de prime abord, tromper un terrien, un peu de réflexion montrera que si 777 est un bien gros nombre, pourtant lorsqu’on lui ajoute la particule ème, force lui sera faite de constater que le 777e d’un centime cela fait beaucoup moins que 777 doublons d’or. C’est bien ce que je pensais à ce moment-là.
– Que le diable t’emporte, Bildad, s’écria Peleg, tu ne veux quand même pas filouter ce jeune homme ! il faut lui donner plus que cela.
– Sept cent soixante-dix-septième, répéta Bildad sans lever les yeux ; et il se remit à marmonner « car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. »
– Je vais l’inscrire pour une trois centième, dit Peleg. Tu m’as bien entendu, Bildad. J’ai dit la trois centième.
Bildad posa son livre et se tournant vers lui avec solennité dit :
– Capitaine Peleg, tu as un cœur généreux, mais tu dois prendre en considération ce devoir qui est le tien envers les autres propriétaires de ce navire : des veuves, des orphelins pour bon nombre d’entre eux, et admettre que si nous rétribuons trop largement les services de ce jeune homme, nous enlèverons peut-être le pain de la bouche à ces veuves et à ces orphelins. La 777e, capitaine Peleg.
– Toi, Bildad ! rugit Peleg en se levant et en s’agitant bruyamment dans la cabine. Maudit sois-tu, capitaine Bildad, si j’avais suivi ton avis dans ces domaines, j’aurais eu, avant ce jour, une conscience à traîner qui serait assez lourde pour envoyer par le fond le plus grand vaisseau qui ait jamais doublé le cap Horn.
– Capitaine Peleg, poursuivit Bildad fermement, ta conscience peut bien tirer dix pouces d’eau ou dix brasses, je n’en sais rien, mais étant donné que tu es toujours un pécheur impénitent, capitaine Peleg, je redoute beaucoup que ta conscience, elle, n’ait une voie d’eau, ne te coule et ne t’entraîne dans la fournaise de l’enfer, capitaine Peleg.
– La fournaise de l’enfer ! La fournaise de l’enfer ! tu m’insultes, homme, au-delà de ce qu’on peut humainement supporter, tu m’insultes. C’est un sacré outrage que de dire à n’importe quel être humain qu’il est voué à l’enfer. Par tous les tonnerres ! Bildad, dis-le moi encore une fois et fais-moi sortir de mes gonds, mais je… je… oui, j’avalerai une chèvre vivante, poils, cornes et tout. Hors d’ici, cafard décoloré, pistolet de bois… au large et plus vite que ça !
Tandis qu’il tempêtait de la sorte, il se précipita sur Bildad qui esquiva sur le côté avec une promptitude admirable et l’évita pour cette fois.
Alarmé par cette terrible algarade entre les deux principaux propriétaires et responsables du navire, me sentant à demi prêt à renoncer à toute idée d’embarquer sur un bateau en si discutable possession, et bien que l’autorité de ces capitaines ne fût que temporaire, je m’écartai de la porte pour laisser passer Bildad qui, je n’en doutai pas un instant, brûlait du désir de se soustraire à la colère éveillée en Peleg. Mais à mon étonnement, il se rassit tout à fait paisiblement et ne parut pas avoir la moindre intention de se retirer. Il paraissait fait au feu en ce qui concernait l’impénitent Peleg et ses habitudes. Quant à Peleg, après avoir donné libre cours à sa fureur, il semblait l’avoir totalement épuisée, et lui aussi, il s’assit comme un agneau, bien qu’il eût des crispations comme si ses nerfs vibraient encore.
– Pfuit ! siffla-t-il enfin… le grain a passé sous le vent, je crois. Bildad, autrefois tu étais adroit pour aiguiser les lances, taille-moi cette plume, veux-tu. Mon couteau a besoin de la meule. Je te reconnais là, merci, Bildad. À présent, mon garçon, Ismaël est ton nom, as-tu dit ? Eh bien, c’est en règle, Ismaël, pour la trois centième.
– Capitaine Peleg, dis-je, j’ai un ami avec moi qui voudrait embarquer aussi… puis-je l’amener demain ?
– Naturellement, dit Peleg, amène-le que nous le voyions.
– Quelle part veut-il ? gémit Bildad, levant les yeux de son livre dans lequel il s’était à nouveau absorbé.
– Oh ! Ne t’occupe pas de cela, Bildad, puis, se tournant vers moi, Peleg ajouta : A-t-il déjà chassé la baleine ?
– Tué plus de baleines que je ne saurais compter, capitaine Peleg.
– Bon, alors amène-le.
Les papiers signés, je partis, ne mettant pas en doute que j’avais fait du bon travail ce matin et que le Péquod était bel et bien le navire prévu par Yoyo pour nous transporter Queequeg et moi au-delà du cap Horn.
Mais je ne m’étais guère éloigné que je réalisai n’avoir pas encore vu le capitaine avec lequel nous devions partir, bien qu’à vrai dire, en maintes occasions, un baleinier puisse se trouver complètement armé, tout son équipage à bord, et que le capitaine fasse seulement son apparition à l’instant de prendre le commandement ; car les voyages se prolongent parfois si longuement, le temps passé à terre et à la maison est si éphémère que, si le capitaine a une famille, ou quelque attache de même nature, il ne se soucie guère de son navire à l’ancre, et l’abandonne aux propriétaires jusqu’à ce qu’il soit prêt à prendre la mer. Toutefois, il est toujours plus prudent d’avoir jeté un coup d’œil sur lui avant de se remettre irrévocablement entre ses mains. Retournant sur mes pas, j’abordai le capitaine Peleg pour lui demander où l’on pouvait trouver le capitaine Achab.
– Et qu’est-ce que tu lui veux, au capitaine Achab ? Tout est en ordre, tu es enrôlé.
– Oui, mais j’aimerais le voir.
– Je ne crois pas que tu le pourras pour l’instant. Je ne sais pas au juste ce qu’il a, mais il garde la chambre… une sorte de maladie, pourtant il n’a pas l’air malade. En fait il n’est pas malade, mais il n’est pas bien non plus. De toute façon, jeune homme, il n’est pas toujours d’accord de me voir moi, aussi je ne pense pas qu’il souhaite te voir, toi. C’est un homme étrange, le capitaine Achab – certains, du moins, le trouvent étrange – mais c’est un homme ! Oh ! tu l’aimeras, n’aie crainte, n’aie crainte. Il a de la grandeur, c’est un homme sans dieu, pareil à un dieu, le capitaine Achab, peu causant, mais quand il parle, alors il faut bien l’écouter. Prends note, je t’en avertis, le capitaine Achab est au-dessus du commun ; Achab a fréquenté tant les grandes écoles que les cannibales ; connu des prodiges plus profonds que la plus profonde vague ; plongé sa lance ardente dans des ennemis plus puissants et plus étranges que les baleines. Son harpon ! oui, le plus aigu et le plus sûr de toute notre île ! Oh ! ce n’est pas un capitaine Bildad, non, ni un capitaine Peleg ; il est Achab, mon fils ; et l’Achab de l’histoire, tu le sais, était un roi couronné !
– Et un roi très infâme. Lorsque ce roi pervers fut assassiné, les chiens ne léchèrent-ils pas son sang ?
– Viens près de moi, plus près, plus près, me dit Peleg et l’expression de son regard m’effraya presque. Écoute bien, mon gars, ne répète jamais cela à bord du Péquod. Ne le répète jamais nulle part. Le capitaine Achab n’a pas choisi son nom. C’est une lubie insensée de sa mère, une veuve folle et ignorante, qui mourut lorsqu’il n’avait que douze mois d’âge. Et pourtant la vieille squaw Tistig de Gayhead disait que, d’une façon ou d’une autre, ce nom se révélerait prophétique. Et peut-être que d’autres imbéciles de la même trempe viendront te dire la même chose. Je souhaite t’en avertir, c’est un mensonge. Je connais bien le capitaine Achab, j’ai été son second il y a bien des années ; je sais qui il est, c’est un homme intègre, non point un brave homme bigot comme Bildad, mais un brave homme qui jure – un peu comme moi – seulement il y a en lui bien d’autres richesses. Oui, oui, je sais qu’il n’a jamais été très gai ; et je sais qu’au retour il a eu l’esprit un peu dérangé par un maléfice, mais la douleur aiguë, lancinante que lui infligeait son moignon sanglant en était la cause ; n’importe qui le comprendrait. Je sais aussi que, depuis qu’il a perdu sa jambe au dernier voyage à cause de cette maudite baleine, il a été d’humeur changeante, parfois désespéré, parfois furieux, mais tout cela passera. Et une fois pour toutes, permets-moi de te dire et de t’affirmer : mieux vaut naviguer avec un bon capitaine ombrageux qu’avec un mauvais capitaine hilare. Au revoir à toi ! et ne condamne pas le capitaine Achab parce qu’il se trouve qu’il porte un nom mauvais. D’autre part, mon fils, il a une femme – il n’y a pas trois voyages qu’il est marié – une douce fille résignée. Pense à ceci : de cette gentille fille, ce vieil homme a un enfant, penses-tu alors qu’un mal total et sans espoir possède Achab ? Non, non, mon gars, si frappé, si dévasté qu’il soit, Achab est humain !
J’étais en m’éloignant profondément songeur. Ce qui venait de m’être incidemment révélé sur le capitaine Achab m’emplissait d’une souffrance à la fois vague et violente à son égard. Et d’une certaine manière, à ce moment-là, j’éprouvai envers lui une douloureuse compassion, dont j’ignorais la raison, à moins que ce ne fût à cause de sa jambe perdue de si cruelle façon. Et pourtant je ressentais aussi à son égard une terreur respectueuse, mais cette sorte de terreur, que je serais bien en peine de décrire, n’était pas vraiment de la terreur, je ne sais pas ce que c’était. Elle me pénétrait et ne me rebutait pas. Mais le mystère qui m’enveloppait, alors que je le connaissais si peu encore, engendrait en moi une impatience. Enfin mes pensées prirent un autre cours de sorte que le sombre Achab les quitta.