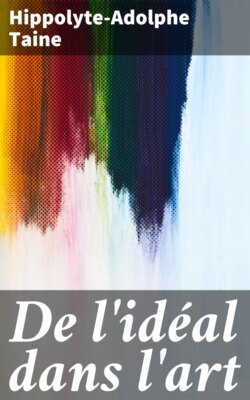Читать книгу De l'idéal dans l'art - Hippolyte-Adolphe Taine - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
ОглавлениеTable des matières
Parmi les idées que les artistes impriment dans leur modèle, y en a-t-il de supérieures? Peut-on indiquer un caractère qui vaille mieux que les autres? Y a-t-il pour chaque objet une forme idéale, hors de laquelle tout soit déviation ou erreur? Peut-on découvrir un principe de subordination qui assigne des rangs aux diverses œuvres d’art?
Au premier regard on est tenté de dire que non; la définition que nous avons trouvée semble barrer la voie à cette recherche; elle porte à croire que toutes les œuvres d’art sont de niveau et que le champ est ouvert à l’arbitraire. En effet, si l’objet devient idéal par cela seul qu’il est conforme à l’idée, peu importe l’idée; elle est au choix de l’artiste; il prendra celle-ci ou celle-là, à son goût; nous n’aurons point de réclamation à faire. Le même sujet pourra être traité de telle façon, de la façon opposée et de toutes les façons intermédiaires. Bien mieux, il semble qu’ici l’histoire soit du même parti que la logique et que la théorie soit confirmée par les faits. Considérez les divers siècles, les diverses nations et les diverses écoles. Les artistes, étant différents de race, d’esprit et d’éducation, sont frappés différemment par le même objet; chacun le voit à son point de vue; chacun y démêle un caractère distinct; chacun s’en forme une idée originale, et cette idée, manifestée dans l’œuvre nouvelle, dresse soudain dans la galerie des formes idéales un nouveau chef-d’œuvre, comme un nouveau dieu dans un olympe qu’on croyait complet. — Plaute avait mis en scène Euclion, l’avare pauvre; Molière reprend le même personnage et fait Harpagon, l’avare riche. Deux siècles après, l’avare, non pas sot et bafoué comme jadis, mais redoutable et triomphant, devient le père Grandet entre les mains de Balzac, et le même avare, tiré de sa province, devenu Parisien, cosmopolite et poëte en chambre, fournit au même Balzac l’usurier Gobseck. — Une seule situation, celle du père maltraité par ses enfants ingrats, a suggéré tour à tour l’Œdipe à Colonne de Sophocle, le Roi Lear de Shakspeare et le Père Goriot de Balzac. — Tous les romans et toutes les pièces de théâtre représentent un jeune homme et une jeune femme qui s’aiment et veulent s’épouser; sous combien de figures diverses a reparu ce même couple, de Shakspeare à Dickens et de madame de Lafayette à George Sand! — Les amants, le père, l’avare, tous les grands types, peuvent donc toujours être renouvelés; ils l’ont été incessamment, ils le seront encore, et c’est justement la marque propre, la gloire unique, l’obligation héréditaire des vrais génies que d’inventer en dehors de la convention et de la tradition.
Si, après les œuvres littéraires, on regarde les arts du dessin, le droit de choisir à volonté tel ou tel caractère paraît encore mieux établi. Une douzaine de personnages et de scènes évangéliques ou mythologiques ont défrayé toute la grande peinture; l’arbitraire de l’artiste y éclate par la diversité des œuvres comme par la plénitude des succès. Nous n’osons pas louer l’un plus que l’autre, mettre une œuvre parfaite au-dessus d’une œuvre parfaite, dire qu’il faut suivre Rembrandt plutôt que Véronèse, ou Véronèse plutôt que Rembrandt. Et cependant quel contraste! Dans le Repas d’Emmaüs, le Christ de Rembrandt est un ressuscité, figure cadavérique, jaunâtre et douloureuse, qui a connu le froid du tombeau, et dont le triste et miséricordieux regard s’arrête encore une fois sur les misères humaines; près de lui sont deux disciples, vieux ouvriers fatigués, à tête chauve et blanchie; ils sont assis à une table d’auberge; un petit garçon d’écurie regarde d’un air balourd; autour de la tête du crucifié qui revient, luit l’étrange clarté de l’autre monde. Dans le Christ aux cent florins, la même idée reparaît plus forte; c’est bien là le Christ du peuple, le sauveur des pauvres, debout dans une de ces caves flamandes où jadis priaient et tissaient les Lollards: des mendiants en loques, des gueux d’hôpital tendent vers lui leurs mains suppliantes; une lourde paysanne à genoux le regarde avec les yeux fixes et béants de la foi profonde; un paralytique arrive posé en travers sur une brouette: guenilles trouées, vieux manteaux graisseux et déteints aux intempéries, membres scrofuleux ou difformes, pâles visages usés ou abrutis, lamentable amas de laideurs et de maladies, sorte de bas-fonds humain que les heureux du siècle, un bourgmestre ventru, des citadins gras, regardent avec une insolente indifférence, mais sur lequel le bon Christ étend ses mains guérissantes, pendant que sa clarté surnaturelle perce l’ombre et rayonne jusque sur les murs suintants. — Si la pauvreté, la tristesse et l’air obscur rayé de lueurs vagues, ont fourni des chefs-d’œuvre, la richesse, la joie, la chaude et riante lumière du plein jour, fournissent un chef-d’œuvre égal. Considérez à Venise et au Louvre les trois repas du Christ par Véronèse. Le grand ciel s’étale au-dessus d’une architecture de balustres, de colonnades et de statues; la blancheur luisante et les bigarrures variées des marbres encadrent une assemblée de seigneurs et de dames qui font festin; c’est une fête d’apparat vénitienne, et du XVIe siècle; le Christ est au centre, et, en longues rangées autour de lui, des nobles en pourpoints de soie, des princesses en robes de brocart mangent et rient, pendant que des lévriers, des négrillons, des nains, des musiciens, occupent les yeux ou les oreilles des assistants. Les simarres chamarrées de noir et d’argent ondulent à côté des jupes de velours brodées d’or: les collerettes de dentelle enserrent la blancheur satinée des nuques; les perles luisent sur les tresses blondes; les florissantes carnations laissent deviner la force d’un sang jeune qui coule aisément et à pleines veines; les têtes spirituelles et vives ne sont pas loin d’un sourire, et sur le lustre argenté ou rosé de là teinte générale, les jaunes d’or, les bleus turquins, l’écarlate intense, les verts rayés, les tons rompus, reliés, achèvent par leur harmonie délicieuse et élégante la poésie de ce luxe aristocratique et voluptueux. — D’autre part, qu’y a-t-il de mieux déterminé que l’Olympe païen? La littérature et la statuaire grecques en ont arrêté tous les contours; il semble qu’à son endroit toute innovation soit interdite, toute forme précisée et toute invention bridée. Et cependant chaque peintre, en le transportant sur sa toile, y fait dominer un caractère jusqu’alors inaperçu. Le Parnasse de Raphaël présente aux yeux de belles jeunes femmes d’une douceur et d’une grâce tout humaines, un Apollon qui, les yeux au ciel, s’oublie en écoutant le son de sa cithare, une architecture mesurée de formes rhythmées et paisibles, des nudités chastes que le ton sobre et presque terne de la fresque rend plus chastes encore. Avec des caractères opposés, Rubens recommence la même œuvre. Rien de moins antique que ses mythologies. Entre ses mains les divinités grecques sont devenues des corps flamands, à pulpe lymphatique et sanguine, et ses fêtes célestes ressemblent aux mascarades que Ben-Jonson, au même moment, arrangeait pour la cour de Jacques Ier: audacieuses nudités encore rehaussées par la splendeur des draperies tombantes, Vénus grasses et blanches qui retiennent leurs amants avec un geste abandonné de courtisane, malignes Cérès qui rient, dos potelés et frémissants des sirènes tordues, molles et longues inflexions de la chair vivante et ployante, fureur de l’élan, impétuosité des convoitises, magnifique étalage de la sensualité débridée, triomphante, que nourrit le tempérament, que la conscience n’atteint pas, qui devient poétique en restant animale, et, par un accident unique, assemble dans ses jouissances toute la liberté de la nature et toutes les pompes de la civilisation. Ici encore un sommet a été atteint; la «colossale belle humeur» couvre et emporte tout; «le Titan néerlandais avait des ailes si puissantes qu’il s’est élevé jusqu’au soleil, quoique des quintaux de fromages de Hollande pendissent à ses jambes» . — Si enfin, au lieu de comparer deux artistes de race différente, vous vous enfermez dans la même nation, rappelez-vous les œuvres italiennes que je vous ai décrites: tant de Crucifiements, de Nativités, d’Annonciations, de Madones avec l’enfant, tant de Jupiters, d’Apollons, de Vénus et de Dianes, et, pour préciser vos souvenirs, la même scène traitée tour à tour par trois maîtres, Léonard de Vinci, Michel-Ange et Corrége. Il s’agit de leurs Lédas, vous connaissez au moins les trois estampes. — La Léda de Léonard est debout, pudique, les yeux baissés, et les lignes sinueuses, serpentines de son beau corps ondulent avec une élégance souveraine et raffinée; par un geste d’époux, le cygne presque humain l’enveloppe de son aile, et les petits jumeaux qui éclosent à côté de lui ont l’œil oblique de l’oiseau; nulle part le mystère des anciens jours, la profonde parenté de l’homme et de l’animal, le vague sentiment païen et philosophique de la vie une et universelle, ne s’est exprimé avec une recherche plus exquise et n’a montré les divinations d’un génie plus pénétrant et plus compréhensif. — Au contraire, la Léda de Michel-Ange est une reine de la race colossale et militante, une sœur de ces vierges sublimes qui dorment lassées dans la chapelle des Médicis, ou s’éveillent douloureusement pour recommencer le combat de la vie; son grand corps allongé a les mêmes muscles et la même structure: ses joues sont minces; il n’y a pas en elle la moindre trace de joie ni d’abandon; jusque dans un pareil moment elle est sérieuse, presque sombre. L’âme tragique de Michel-Ange soulève ces puissants membres, redresse ce torse héroïque, et roidit ce regard fixe sous le sourcil froncé. — Le siècle tourne, et les sentiments virils font place aux sentiments féminins. La scène dans Corrége devient un bain de jeunes filles, sous les doux reflets verts des arbres et parmi les mouvements agiles de l’eau qui bruit et ruisselle. Il n’y a rien qui ne soit séduction et attrait; le rêve heureux, la grâce suave, la volupté parfaite n’ont jamais épanoui ni troublé l’âme par un langage plus pénétrant et plus vif. La beauté des corps et des têtes n’est point noble, mais engageante et caressante. Rondes et rieuses, elles ont l’éclat satiné, printanier des fleurs illuminées par le soleil; la fraîcheur de la plus fraîche adolescence affermit la blancheur délicate de leur chair imprégnée de lumière. Une blonde, complaisante, avec un torse et une chevelure ambiguë de jeune garçon, écarte le cygne; une petite, mignonne, maligne, tient la chemise; sa compagne y entre et le tissu aérien qui l’effleure ne voilera pas les pleins contours de son beau corps; d’autres, folâtres, au front petit, aux lèvres et au menton amples, jouent dans l’eau avec un abandon mutin ou tendre; plus abandonnée encore, et contente de s’abandonner, Léda sourit, défaille; et la sensation délicieuse, enivrante, qui s’est exhalée de toute la scène arrive au comble dans son extase et dans sa pamoison.
Laquelle préférer? Et quel caractère est supérieur, la grâce charmante de la félicité débordante, la grandeur tragique de l’énergie hautaine, ou la profondeur de la sympathie intelligente et raffinée? Tous correspondent à quelque portion essentielle de la nature humaine, ou à quelque moment essentiel du développement humain. Le bonheur et la tristesse, la raison saine et le rêve mystique, la force active ou la sensibilité fine, les hautes visées de l’esprit inquiet et le large épanouissement de la joie animale, tous les grands partis-pris à l’endroit. de la vie ont une valeur. Des siècles et des peuples entiers se sont employés à les produire au jour; ce que l’histoire a manifesté, l’art le résume, et de même que les diverses créatures naturelles, quels que soient leur structure et leurs instincts, trouvent leur place dans le monde et leur explication dans la science, de même les diverses œuvres de l’imagination humaine, quel que soit le principe qui les anime et la direction qu’elles manifestent, trouvent leur justification dans la sympathie critique et leur place dans l’art.