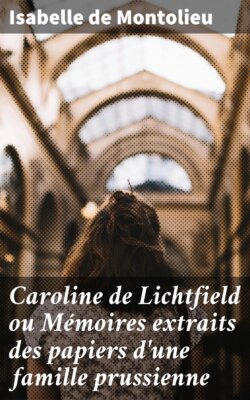Читать книгу Caroline de Lichtfield ou Mémoires extraits des papiers d'une famille prussienne - Isabelle de Montolieu - Страница 12
AU PUBLIC.
ОглавлениеJ'aime les champs; c'est là, pendant l'été,
Près d'un ruisseau, dans un bois écarté,
Que je me livre aux rêves d'un coeur tendre.
L'hiver, rendue à la société,
Quelques amis se plaisent à m'entendre.
Dans les loisirs du champêtre séjour,
Quand j'essayai de peindre Caroline,
Quand j'embellis des roses de l'amour
L'hymen forcé de ma jeune héroïne;
Quand, sous les noms de Lindorf, de Walstein,
A l'amitié j'élevais un trophée,
Mon cher lecteur, je n'eus d'autre dessein
Que d'amuser, l'hiver, à la veillée,
Le cercle étroit des indulgents amis
Qui veulent bien, près d'un feu réunis,
Me consacrer leur oisive soirée.
Mais je n'eus point l'orgueilleuse pensée
Qu'au rang d'auteur tout à coup élevée,
J'occuperais les presses de Paris.
Qui m'aurait dit que ce modeste ouvrage,
Sans mon aveu, me vaudrait cet honneur,
Et du public obtiendrait le suffrage?
Le bon Gresset, dans un accès d'humeur,
Du nom d'auteur déplorant l'étalage,
Dit quelque part que c'est un grand malheur (1) [(1) Epître à sa Muse, tome I.];
Mais si ce nom vous faisait tant de peur,
Eh! mon ami, qui vous forçait d'écrire?
J'aime bien mieux ici, mon cher lecteur,
A mon destin tout bonnement souscrire;
Car, après tout, un auteur a beau dire,
On n'est plus dupe, et l'on sait aujourd'hui
Qu'au fond du coeur le plus sage désire
Que dans le monde on parle un peu de lui.
Mais, dira-t-on, la mode, le caprice,
Ont au public extorqué maint arrêt
Dont nos neveux un jour feront justice.
Je le veux bien; mais le dépit secret,
Mais l'amour-propre ont-ils moins d'intérêt
A l'accuser d'erreur ou de malice?
Moi, je te juge avec plus d'équité,
Mon cher public, et, tout bas, je suppose
En ma faveur que mon sexe t'impose,
Et me soustrait à ta sévérité.
Ton indulgence est-elle méritée?
Je n'en sais rien, mais je veux en jouir.
D'un peu d'encens on peut être flattée,
Et son parfum nous fait toujours plaisir.
Dans ses ennuis, qu'un auteur misanthrope,
Qui de son siècle essuya les dédains
Mette sa gloire au bout d'un télescope,
Dans les brouillards et les siècles lointains;
Ah! laissons-lui cette flatteuse idée!
Moi, sans viser à tant de renommée,
J'aime bien mieux des succès plus certains.
Oui, du public, si ma plume estimée
Avec éloge est quelquefois citée;
Si je puis plaire à mes contemporains;
De mes amis si je suis regrettée
Quand du Léthé j'aurai franchi le bord,
Postérité tant de fois réclamée,
Je te tiens quitte, et je bénis mon sort.
Isabelle de MONTOLIEU.
Caroline de Lichtfield (1) [(1) Le nom de Lichtfield est plutôt anglais qu'allemand: en effet, la famille du chambellan, père de Caroline, était originaire d'Angleterre, quoique naturalisée depuis longtemps à Berlin.], à peine âgée de quinze ans, revenait un soir d'une noce de village. Ses seize quartiers, le rang de son père, ministre et grand chambellan du roi de Prusse, une fortune immense, n'empêchaient point Caroline de regarder les villageois comme des hommes, d'égayer sa retraite en se mêlant à leurs jeux, de les animer par sa présence, de partager leurs innocents plaisirs.
Le coeur encore ému du bonheur des époux, de leur bruyante joie, des danses sous l'ormeau, de la collation champêtre, Caroline en arrivant se jette dans les bras de la chanoinesse de Rindaw, et lui dit avec feu: — O maman, maman! comme c'est joli une noce! pourquoi donc ne vous êtes-vous jamais mariée?
Cette question et le titre de celle à qui elle était adressée disent assez que ce nom si doux de mère était donné par l'amitié et non par la nature. Caroline de Lichtfield n'était pas même parente de la baronne de Rindaw; mais si l'attachement le plus tendre, si les soins les plus assidus peuvent quelquefois remplacer ceux d'une mère, jamais on n'eut plus le droit d'être appelée maman. Caroline avait perdu la sienne en naissant, elle ne lui devait que la vie: combien elle devait plus à la bonne chanoinesse!
Depuis l'instant où celle-ci avait pris cet enfant chez elle, occupée d'elle seule, n'existant que pour sa chère Caroline, elle s'était consacrée entièrement à son éducation; mais elle en était bien récompensée par les grâces, les vertus, l'amour de sa fille adoptive. Chaque jour augmentait leur amitié mutuelle. A mesure que la raison et la sensibilité de Caroline de développaient, elle sentait tout ce qu'elle devait à son amie; et la reconnaissance et l'habitude serraient un lien plus fort peut-être que ceux de la nature. Mais l'âge et la légèreté de Caroline n'avaient pas encore permis d'y joindre la confiance: elle ignorait donc les motifs de la retraite, du célibat de sa vieille amie, et même de son séjour chez elle.
Un sourire équivoque redouble sa curiosité; elle répète plus vivement encore sa question. — Ma bonne maman, pourquoi ne vous êtes-vous mariée? Pourquoi ne suis-je pas tout de bon votre fille? Je ne vous aimerais pas mieux, mais il me semble que vous seriez plus heureuse.
La chanoinesse s'attendrit, embrassa son élève. — Ma chère fille!…. oui, tu devais l'être… oui, je méritais ce bonheur; et si ton père… Mais c'est une trop longue histoire… une autre fois.
Annoncer une histoire à une fille de quinze ans, et ne pas la lui raconter, c'est une chose impossible.
Voilà Caroline à genoux: elle prie; elle presse; elle joint ses petites mains avec ardeur, elle baise celles de la plus tendre amie; et cette amie, qui ne pouvait rien lui refuser, qui d'ailleurs aimait beaucoup à parler, et surtout d'elle-même, qui depuis longtemps n'a de confidents que les arbres de ses bosquets, cède enfin, et raconte très-longuement à Caroline, attentive, ce que nous allons dire le plus brièvement possible.
La baronne de Rindaw n'avait pas toujours vécu dans la retraite.
Première dame d'honneur de la reine, sa beauté a fait jadis grand bruit à la cour, et lui valut bien des hommages. Elle distingua bientôt, dans le nombre de ses adorateurs, le baron de Lichtfield, depuis père de Caroline, mais alors libre, jeune, et, au dire de la tendre baronne, le plus beau, le plus séduisant, mais le plus perfide de tous les hommes.
Pendant plusieurs années, ils filèrent ensemble la passion la plus vive, la plus pure, la plus désintéressée. Aimée comme elle aimait, contente de régner sur un coeur aussi fidèle, elle attendait sans impatience que de légers obstacles qui retardaient leur union fussent levés, et lui permissent enfin de pouvoir couronner l'amour et la constance de son cher baron.
Une amie intime, sa compagne et sa confidente, ajoutait encore à son bonheur. Elle jouissait de tous les plaisirs du sentiment; et en attendant l'instant d'être la plus heureuse des femme, elle était la plus heureuse des amantes et des amies.
Cette amie qu'elle chérissait si tendrement, acquit à cette époque un héritage immense et inattendu. La baronne partagea vivement sa joie, et le chambellan plus vivement encore; car, huit jours après cet événement, une belle lettre, signée par son fidèle amant et par sa tendre amie, lui apprit qu'ils étaient mariés.
A cet endroit du récit de la baronne, Caroline jeta un cri et se cacha le visage dans ses deux mains. La chanoinesse chercha au fond d'un tiroir cette fatale lettre moins effacée par le temps que par ses larmes. Elle la lut; et Caroline, la douleur dans l'âme, disait en gémissant: C'est mon père, c'est ma mère qui vous ont rendue si malheureuse!… ah! comment pouvez-vous m'aimer?
Chère enfant, je serais trop injuste si je te rendais responsable de leurs torts envers moi; je le serais même d'en vouloir encore à tes parents. Ta pauvre mère a bien expié ses torts par sa mort prématurée, ton père a voulu réparer la sienne; et toi, ma Caroline, ne fais-tu pas le bonheur de ma vie? Puis-je m'affliger d'une union que t'a donné la naissance? Crois plutôt que je la bénis tous les jours. T'aurais-je raconté cette histoire, si je n'avais pu justifier tes parents à tes yeux? Aime ton père, ma fille, respecte la mémoire de ta mère: écoute la fin de mon récit, et console-toi.
Un doux sourire effaça l'impression du chagrin sur le charmant visage de Caroline. Elle baisa la main de son amie, se rapprocha d'elle, et lui prêta de nouveau toute son attention.
La chanoinesse fit à son élève un détail circonstancié et tout à fait pathétique de sa profonde douleur à la réception de cette lettre; de la résolution qu'elle prit à l'instant même de quitter pour jamais le cour et le monde, de fuir tous les hommes, de renoncer au mariage, et d'ensevelir dans la plus profonde retraite et ses charmes et son désespoir. Cette résolution fut aussitôt suivie que formée. La baronne remit sa place à sa cour, entra dans un chapitre, y vécut quelque temps, puis obtint une permission d'habiter son château de Rindaw, qu'elle ne quitta plus.
Penser à son perfide amant, renouveler ses serments de constance éternelle, lire des romans du matin au soir, chercher des rapports de situation entre elle et l'héroïne du livre, rêver dans ses jardins, dans ses bosquets; voilà quelle fut sa triste existence pendant quelques années. Elle commençait enfin à s'accoutumer à cette vie, à oublier les ingrats dont elle se croyait oubliée, lorsqu'une lettre de l'infidèle chambellan vint le rappeler à son souvenir; et cette lettre, sortie encore du tiroir où elle les conservait toutes avec soin, fut lue à Caroline, qu'elle affecta beaucoup.
Le chambellan apprenait à son ancienne amie et la naissance de sa fille, et la mort prochaine de son épouse, à qui cette naissance devait coûter la vie; car il ne restait plus d'espoir de la sauver. Tourmentée du remords, son unique désir était d'obtenir, avant d'expirer, le pardon de la chanoinesse; elle osait la conjurer de venir recevoir son dernier soupir; le chambellan sollicitait instamment cette grâce; tous deux connaissaient trop bien son âme généreuse pour craindre un refus.
Ah! maman! maman!…. dit Caroline en sanglotant……. ô mon Dieu, quelle fut votre réponse? — Mon unique réponse, mon enfant, fut de partir au même instant et de faire une extrême diligence. Le moment de mon arrivée, de notre première entrevue auprès du lit de ta mère expirante, fut tout ce qu'on peut imaginer de plus touchant. Je n'ai lu dans aucun roman de scène plus intéressante; il faudrait un Richardson pour la décrire, et je ne l'essayerai pas: le souvenir d'ailleurs me donne trop d'émotion; mais tu peux te la représenter. — Ah! oui, oui, dit Caroline, je vous vois pardonner de bon coeur à ma pauvre mère, et vous charger d'élever son enfant. Ah! maman, ma bonne maman, que ne vous dois-je pas! Celle qui m'a donné le jour est morte en paix, et vous l'avez remplacée.
C'est cela même, mon enfant. Après avoir assuré à ta mère que tout était oublié, je la vis se tourmenter encore de l'idée que sa fille serait mal élevée et peut-être malheureuse. Ton père, tout occupé de ses emplois, du soin de faire sa cour au prince, t'aurait sans doute négligée. J'approuvai ses tendres craintes, et je les calmai en lui promettant de te prendre avec moi, de te garder jusqu'à ton mariage, de te servir de mère. Elle voulait plus encore….. Ah! soyez-la réellement, me disait-elle; remplacez-moi tout à fait; épousez son père; reprenez vos droits sur ce coeur que je vous ai si indignement enlevé…. que ma mort expie et répare ce crime! — Ah! oui, maman, interrompit Caroline, je pensais bien aussi cela. Pourquoi donc n'avez-vous pas épousé mon père?
L'amour outragé ne doit jamais pardonner, dit la chanoinesse avec un air de dignité et de noble fierté. Pour l'amitié, c'est autre chose. Elle peut être indulgente; mais l'amour….. l'amour a ses lois immuables; il y aurait de la lâcheté à s'en écarter. Un amant infidèle est un être contre nature, qui ne doit jamais rentrer en grâce. — Cependant vous avez pardonné à mon père. — Oui, mais seulement depuis qu'il se content d'être mon ami, et que l'amour est presque éteint dans mon coeur. Il m'a témoigné tant de respect, de soumission, de reconnaissance, quand il a vu que je t'adoptais également pour ma fille et mon héritière, que j'ai fini par en être touchée. Il a des qualités essentielles, le chambellan; il sent ce qu'on fait pour lui.
Elles en étaient là quand le bruit d'un carrosse interrompit leur entretien.
On regarde, c'était le grand chambellan lui-même.
Caroline courut au-devant de son père. La chanoinesse s'approche d'une glace, rajuste un peu sa coiffure, passe son grand cordon en écharpe pour recevoir son ancien amant avec toute la majesté convenable, et l'attend avec la tendre émotion qu'il lui inspirait toujours.
L'histoire de la baronne avait un peu prévenu la jeune Caroline contre son père. Elle courut moins vite et avec moins de joie qu'à l'ordinaire au-devant de lui; mais les tendres caresses du chambellan lui firent bientôt oublier ses torts passés; elle y fut d'autant plus sensible, qu'elle n'y était pas accoutumée.
Froid, égoïste, courtisan enfin s'il en fut jamais, il connaissait peu les doux sentiments de la nature. Séparé de sa fille dès sa naissance, ne la voyant qu'une ou deux fois par an, il la connaissait à peine, et l'aimait plutôt comme l'héritière de ses biens et de ceux de la chanoinesse, que comme la plus aimable des jeunes filles.
Il faut rendre justice à cette bonne chanoinesse, cet héritage qu'elle destinait à son élève était le moindre de ses bienfaits. Caroline lui devait l'éducation la plus soignée et pour le coeur et pour l'esprit, une raison souvent au-dessus de son âge, une innocence rare, même à cet âge, accompagnée cependant des grâces et de l'usage du monde, qui, jadis à la cour, distinguaient madame de Rindaw, et qu'elle avait conservés dans sa retraite. Elle avait développé chez son élève des talents qui n'attendaient que l'occasion de se perfectionner: on ne s'apercevait enfin que Caroline était élevée à la campagne que par une simplicité, une naïveté, une aimable franchise, une ignorance du mal, une gaieté douce, continuelle, que l'on conserve rarement à la ville, même jusqu'à l'âge de quinze ans.
Mais comment cette chanoinesse, qui n'a lu que des romans, qui ne s'est occupée que de sa belle passion, a-t-elle été capable d'élever cette fille charmante? On aurait tort de juger madame de Rindaw uniquement par son histoire, qui prouve au moins l'extrême bonté de son coeur et la simplicité de son caractère. Confiante à l'excès, jugeant tout le monde d'après elle-même, ne sachant pas garder un secret au delà d'une demi-heure, ignorant l'art de flatter aux dépens de la vérité, jamais on ne fut moins faite pour vivre dans le grand monde, et surtout à la cour.
L'événement qui la força à la retrait fut plutôt un bonheur qu'une infortune pour elle. Son excessive imprudence, son indiscrétion, sa bonté même, lui auraient sans doute attiré de plus grands chagrins encore dans le séjour de l'intrigue et de la fausseté. Elle eut du moins le bon esprit de le sentir; et ce motif contribua bien autant que son dépit à lui faire refuser la main du chambellan après la mort de sa femme. Mais satisfaite par son offre, elle lui promit une éternelle amitié, s'attacha à son enfant comme la mère la plus tendre, et se mit réellement en état, par de bonnes lectures, des études suivies, de remplir la tâche qu'elle s'était imposée. Il ne lui resta de son genre de vie précédent qu'une tournure sentimentale, romanesque, et quelques légers ridicules bien rachetés par les vertus les plus réelles, l'âme la plus sensible, le coeur le plus excellent.
Allons avec elle recevoir la visite du grand chambellan. Il fit à sa fille les caresses les plus tendres, il la trouva charmante, remercia beaucoup son amie de l'avoir rendue telle, et finit par dire qu'il l'emmènerait le lendemain; qu'il venait la chercher par l'ordre du roi pour qu'elle assistât à de brillantes fêtes qu'on devait donner à la cour.
Le commencement de ce discours avait d'abord effrayé Caroline. Quitter sa bonne maman, son cher Rindaw, sa basse-cour, sa volière, ses bons amis du village…… Elle rougit, et baissa des yeux qui se remplissaient de larmes; mais la suite vint les tarir.
Quelle est la fille de quinze ans que le mot de fêtes brillantes n'ait pas émue et consolée? Elle releva ses yeux animés par le plaisir. — Ce sera donc bien beau, papa? Je danserai; j'irai à la comédie; je….. Ah! je reviendrai bientôt, dit-elle tout à coup, en changeant de ton et se précipitant dans les bras de son amie……. ou, je n'irai pas… oui, j'aime mieux n'y pas aller, si papa le permet.
Un regard jeté sur la chanoinesse, qui pâlissait à l'idée de se séparer de sa chère élève, causa cette transition si subite et si touchante.
Son père ne répondit rien; mais, se levant avec solennité, il pria madame de Rindaw de vouloir bien lui accorder une audience particulière dans son cabinet. Elle y consentit: il lui présenta respectueusement la main; tous deux sortirent, et laissèrent Caroline hésiter sur ce qu'elle voulait, désirant les fêtes, regrettant sa bonne maman, mais très-décidée à ne point la chagriner et à sacrifier ses plaisirs à l'amitié.
La conférence fut longue. Le chambellan et la chanoinesse ne rentrèrent qu'après une demi-heure. La baronne paraissait avoir pleuré; cependant elle sourit à Caroline, lui dit qu'elle consentait avec plaisir à son petit voyage a Berlin, qu'elle le désirait même: et si cela ne suffit pas, dit-elle, je l'ordonnerai.
Caroline, forte content d'accorder le plaisir et le devoir, promit d'obéir, et courut se préparer à partir le lendemain matin. La soirée était déjà avancée; elle revit peu son amie; mais si elle eût fait attention à ce qui lui échappait, ce peu de temps aurait suffi pour l'éclairer sur les motifs de ce voyage. Elle n'entendit rien, ne comprit rien.
Pendant tout le souper elle ne songe qu'aux belles fêtes, trouve le roi bien bon de penser à elle, promet à sa maman de revenir bientôt lui conter tout ce qu'elle aura vu, puis la quitte baignée de ses larmes et de celles qu'elle verse elle-même, et qui sont bientôt essuyées par l'espérance du plaisir et par celle du retour.
La première ne fut point trompée. Caroline, présentée au roi par son père, fut reçue, non comme une petite fille de quinze ans, mais avec les distinctions les plus flatteuses. Parée avec l'élégance le plus recherchée, invitée tous les jours à une fête nouvelle, Caroline ne pensait à Rindaw que pour écrire à sa bonne maman, avec qui elle entretenait une exacte correspondance.
Dans les premières lettres qu'elle reçue d'elle, Caroline crut entrevoir qu'il était question de la marier, et que c'était dans ce but qu'on l'avait amenée à Berlin; mais cette idée glissa sur son esprit sans y faire aucune impression, d'autant plus que rien ne vint la confirmer. Aucun homme ne lui faisait la cour; aucun n'était admis chez son père, et lui-même paraissait plus occupé de la garder avec soin que de penser encore à l'établir.
Deux mois s'écoulèrent ainsi. Ils avaient paru bien courts à Caroline; et lorsque son père lui dit un jour en finissant de déjeuner: Eh bien! ma fille, voici deux mois que vous êtes à la Cour; comment trouvez-vous ce séjour? Charmant! Répondit-elle bien vite. Mais quoi! déjà deux mois? je ne l'aurais pas cru. Ah! comme je me suis amusée pendant ce temps-là! — Votre réponse me plaît et m'inquiète, ma chère enfant. Je suis charmé d'apprendre que vous aimez le lieu où vous êtes appelée à vivre; mais je ne voudrais pas qu'une préférence secrète…… Mon enfant, dit-il en écartant la table à thé, et avançant son fauteuil plus près d'elle, ouvre ton coeur à ton père; ce coeur est-il aussi libre que lorsque tu quittas Rindaw, et depuis que tu es à la cour n'as-tu distingué personne?
Cette question, faite par un père, embarrasse toujours plus ou moins celle à qui elle s'adresse.
Cependant Caroline aurait pu répondre hardiment. Son jeune coeur, aussi pur, aussi tranquille que dans les jours sereins de son enfance, n'avait encore palpité que pour des plaisirs innocents comme elle.
A Rindaw, une fleur nouvellement éclose, un oiseau qui chantait mieux que les autres, la lecture d'un conte des fées, une noce champêtre et l'histoire de son amie, avaient eu seuls le droit de l'intéresser et de l'émouvoir. Depuis qu'elle habitait la cour, un bal, un concert, un spectacle, une mode nouvelle, les avaient remplacés; mais Caroline n'imaginait pas même encore qu'un homme pût influer sur le bonheur ou le malheur de sa vie. Dans des instants de loisir ou d'insomnie (et ils étaient rares), il lui était arrivé de penser pendant deux minutes à l'histoire de sa bonne maman, à cette passion si tendre et si mal récompensée. Maman était bien bonne, disait-elle alors, de s'affliger ainsi; ne croirait-on pas qu'il n'y avait que mon père au monde? Il fallait l'oublier bien vite, et danser pour se distraire. Caroline n'imaginait aucun chagrin dont une valse ou une contre-danse ne dût la consoler; et les meilleurs, les plus infatigables danseurs étaient sans contredit ceux qu'elle préférait. Mais, le bal fini, Caroline dormait douze heures de suite, se réveillait en chantant, et se préparait à une nouvelle fête sans songer au danseur de la veille. La question de son père la surprit donc plutôt qu'elle ne l'embarrassa.
Caroline garda quelques minutes le silence; puis elle dit avec
un sourire ingénu: Je ne vous comprends pas bien, mon père.
Distinguer quelqu'un….., je n'entends pas ce mot…..
Serait-ce aimer, par hasard?
— Distinguer, c'est-à-dire préférer…., aimer, si tu le veux, désirer d'unir son sort à l'objet de cette préférence.
— Ah! j'y suis, dit-elle étourdiment….. C'est ce que ma bonne maman de Rindaw sentait pour vous autrefois. Ah! vraiment non, papa, je n'ai garde d'aimer quelqu'un ainsi; cela cause trop de chagrin…… Elle allait continuer, mais elle vit son père froncer le sourcil; elle craignit de lui avoir fait de la peine, et se tut baissant les yeux. — Je ne sais, reprit le chambellan en se levant, ce que madame de Rindaw a pu vous confier; mais vous avez dû voir, par son exemple, que les beaux sentiments ne servent à rien, et par le mien, que l'on peut, que l'on doit toujours les sacrifier aux convenances. Si, en suivant cette belle passion, je n'avais point épousé votre mère, Caroline de Lichtfield serait-elle actuellement héritière de vingt-cinq mille écus de rente? Pourrait-elle prétendre au premier parti du royaume? Plus heureuse que moi, ma fille, tu n'as point de sacrifices à faire, puisque ton coeur est libre. Cette fortune immense, que tu me dois, te dispense d'en chercher ailleurs, mais non de remplir tous les voeux d'un père qui ne désire que ta gloire et ton bonheur. Tu n'as qu'à dire un mot, ils sont assurés pour la vie. — Et quel est ce mot, mon père? reprend Caroline avec une émotion qui s'augmentait à chaque instant. Mille idées confuses se croisaient dans sa tête: il s'agissait d'un mariage; cela n'était pas douteux. Elle pensa rapidement aux hommes qu'elle avait vus, et ne s'arrêta sur aucun, parce qu'ils lui étaient tous également indifférents. Elle attendait cependant avec impatience la réponse de son père: il avait l'air de la préparer.
Vous ne connaissez encore, ma chère fille, lui dit-il d'un ton sentimental et pathétique, que les beaux côtés de votre situation; vous ignorez combien nos chaînes dorées sont quelquefois pesantes…… L'effroi se peignit dans les yeux de Caroline… Mais j'espère, ajouta-t-il, que celles qui doivent lier ma Caroline seront aussi douces, aussi légères qu'elle le mérite; elles seront du moins assez brillantes pour faire envier son sort à toutes les femmes. Dis-moi, mon enfant, ne seras-tu pas bien enchantée d'être dans quelques jours comtesse de Walstein, ambassadrice en Russie, et l'épouse du favori déclaré de ton roi? Ne crois pas, d'après cela, que je te destine à devenir la femme d'un vieillard. L'époux que je te propose doit ses honneurs à son nom, à son mérite, à la faveur dont il jouit; il n'a guère plus de trente ans. — Et je serai sa femme? dit Caroline en levant sur son père des yeux où brillait une modeste joie; je serai comtesse, ambassadrice? — Tu n'as qu'à dire un mot: Mon père, j'y consens, et je vous le promets. — Ah! de tout mon coeur, dit-elle en lui tendant la main et baisant les siennes avec transport. Oui, papa, je vous le promets, et j'obéirai avec plaisir… Mais…, mais, ajouta-t-elle après un instant de réflexion, où donc est-il ce comte? je ne l'ai jamais vu… Si j'allais ne pas l'aimer… ou ne pas lui plaire? — Vous l'épouseriez également, ma fille. Ce n'est pas votre coeur qu'on vous demande, c'est votre main; et c'est un monarque absolu qui vous fait l'honneur d'en disposer en faveur de l'homme qu'il aime le mieux. On se plaît toujours assez quand on réunit de part et d'autre toutes les convenances; cet établissement remplirait les voeux du père les plus ambitieux……
Cependant Caroline demandait toujours où se cachait M. de
Walstein, et pourquoi elle ne l'avait point vu.
Son père lui apprit alors que le comte était arrivé, seulement de la veille de son ambassade de Saint-Pétersbourg; que c'était par l'ordre du roi qu'il était allé chercher sa fille à Rindaw pour la marier. La chanoinesse en était instruite; elle approuvait cette alliance.
Le chambellan remit à Caroline une lettre de son amie, où celle-ci la pressait d'obéir à son père, et qui peut-être eût achevé de la décider quand elle aurait balancé; mais elle n'y songeait pas. Son père lui dit encore qu'elle serait déjà mariée, sans une maladie fâcheuse qui avait retenu le comte plus d'un mois à Dantzick: on avait même craint pour sa vie; et le chambellan n'avait pas cru devoir parler à sa fille d'un engagement qui peut-être allait se rompre de lui-même. J'en aurais été bien fâchée, dit la naïve Caroline. — Et moi peut-être plus encore, reprit le chambellan. On ne retrouve pas facilement un tel établissement; mais toutes mes craintes sont évanouies. Le comte arriva hier au soir très-bien portant. Le roi me fit appeler à l'instant, me présenta mon gendre futur, et m'ordonna de tout préparer pour qu'il le devînt au plus tôt. Je ne pouvais donc plus retarder de vous apprendre votre sort: il est fixé sans retour. Ma seule crainte était que votre coeur n'eût fait un choix parmi nos jeunes seigneurs, et que je ne fusse dans le cas d'exiger un sacrifice; mais je suis bien rassuré; je vois que vous sentez, comme vous le devez, les avantages de l'union que vous allez former. Je vais à la cour annoncer votre consentement, j'y dînerai, et ce soir je vous amènerai le comte. Allez vous habiller, ma fille, et vous préparer à le recevoir comme celui à qui vous appartiendrez dans quelques jours.
La docile Caroline lui renouvela sa promesse. Il l'embrassa tendrement, et sortit bien content d'elle, et plus encore de lui-même et de ses talents pour les négociations.
Il est certain que lorsque son intérêt était en jeu, il avait une certaine éloquence naturelle qui, dans l'occasion, lui tenait lieu d'esprit, de sensibilité, et le faisait parvenir à son but; mais cette fois il avait eu un peu de peine à réussir. Caroline n'aimait encore que le plaisir, et ne voyait dans ce brillant mariage qu'un moyen de le fixer: aussi ce fut la seule idée qui l'occupa lorsque son père l'eut laissée.
On s'attend peut-être qu'elle va réfléchir bien sérieusement sur tout ce qu'on vient de lui dire, sur l'engagement qu'elle a pris, sur le changement prochain de son sort. A vingt ans, il y aurait là de quoi rêver au moins toute la matinée; mais à quinze, on ne peut s'occuper si longtemps du même objet. Cependant Caroline resta bien dix minutes immobile à la place où son père l'avait laissée; et c'était beaucoup pour elle. Enfin, voyant qu'à force d'avoir à penser, elle ne pensait à rien, et que ses idées s'embrouillaient dans sa tête, elle se leva brusquement, courut à son piano, où, pendant une demi-heure, elle joua des contre-danses et des valses. Il lui vint tout à coup à l'esprit, en les jouant, que le comte les répéterait avec elle, et qu'il serait assez doux d'avoir toujours un danseur à ses ordres… Un danseur!…. son excellence! Eh! oui, sans doute, un danseur. On sait que le baron avait eu soin de prévenir sa fille que, malgré son rang, ses dignités, M. l'ambassadeur n'avait tout au plus que trente ans, et cette circonstance lui plaisait peut-être tout autant que les titres. Quoique ce fût le double de l'âge de Caroline, elle avait fort bien remarqué depuis qu'elle était à la cour, que les hommes de trente et les femmes de quinze pouvaient se convenir parfaitement.
Ce fut donc en formant un projet de danse continuelle dans son nouveau ménage, qu'elle courut au jardin cueillir son bouquet pour la soirée. Tout en le cueillant, elle vit voltiger autour des fleurs quelques beaux papillons, s'échauffa longtemps à les poursuivre, n'en prit pas un seul, et se consola en pensant que le comte serait peut-être plus leste qu'elle, et saurait mieux les attraper. Quand nos serons deux, dit-elle en sautant, ce serait avoir bien du malheur de les laisser échapper.
Elle alla ensuite se mettre à sa toilette, où bientôt l'idée des bijoux qu'elle allait avoir, des parures de toute espèce, des équipages, etc., effaça celle des papillons et de la danse, ou plutôt la promena de plaisirs en plaisirs.
Comme madame l'ambassadrice sera brillante, fêtée, enviée! comme de beaux diamants feront mieux dans mes cheveux que cette fleur! Enfin le bonheur conjugal de Caroline, fondé sur la danse, les papillons et la parure, lui parut la chose du monde la plus assurée. Elle se trouva d'avance la plus heureuse des femmes, employa tous ses soins pour être belle aux yeux du comte, et l'attendit avec une impatience mêlée tout au plus d'une sorte de crainte de ne pas lui plaire: quant à lui, elle était sûre qu'il lui plairait à l'excès.
Caroline réfléchissait quelquefois. Une réflexion profonde l'avait persuadée que le comte était tout ce qu'il y avait de plus charmant. Il est le favori du roi, lui avait dit son père: or ce mot de favori signifiait beaucoup de choses dans l'idée de Caroline. Elle se rappelait fort bien qu'à la campagne elle avait aussi sa petite cour, et ses petits favoris: l'oiseau favori, le chien favori, le mouton favori, toujours les plus jolis de leur espèce: donc le favori d'un roi devait nécessairement être le phénix de la sienne, et le plus beau et le plus aimable des êtres.
Elle en était si convaincue, et se réjouissait si fort de le voir, que, lorsqu'on vint l'avertir qu'il était là et que son père l'attendait, elle ne fit qu'un saut jusqu'à la porte du salon. Elle y trouva le chambellan, qui lui rappela sa promesse, lui prit une main qui tremblait peut-être autant de plaisir que d'émotion, et, l'exhortant à être bien raisonnable, la conduisit auprès de ce favori du roi.
Caroline leva les yeux, et fut si frappée de ce qu'elle vit, que, les couvrant à l'instant de ses deux mains, elle fit un cri perçant, et disparut comme un éclair.
Pendant que son père la suit, qu'il emploie toute l'éloquence paternelle pour la calmer et la ramener, esquissons le portrait du comte, et justifions l'effroi qu'il inspire à l'innocente et jeune Caroline.
Le comte de Walstein n'avait en effet guère plus de trente ans; mais une énorme cicatrice qui lui couvrit toute une joue, sa maigreur excessive, son teint jaune et plombé, sa taille voûtée, une perruque au lieu de cheveux, lui donnaient l'air d'en avoir au moins cinquante. Son grand oeil noir était assez beau; mais, hélas! il n'en avait qu'un: l'autre, caché sous un large ruban noir, était sans doute perdu par le coup de feu qu'il avait reçu. Il était né pour être grand et bien taillé; mais son attitude courbée lui ôtait cet avantage. Il avait le jambe belle; mais cet homme, qui devait danser du matin jusqu'au soir et courir après des papillons, marchait avec peine en boitant excessivement.
Tel était l'extérieur du comte: on verra dans la suite si le moral y répondait. En voilà bien assez sans doute pour excuser le premier mouvement de notre pauvre fugitive. Peut-être si elle se fût donné le temps de l'examiner, aurait-elle trouvé sous cette figure un air de noblesse et de bonté qui la caractérisait; mais elle n'avait vu que la cicatrice, que l'oeil qui lui manquait, que son dos voûté, sa perruque et sa jambe traînante.
La première impression était reçue; et la triste Caroline, presque évanouie dans son appartement, entendait à peine les sollicitations de son père pour l'engager à revenir. Elle n'y répondait que par des torrents de larmes; enfin elle se trouva si mal, qu'il fallut la délacer. Son père, voyant qu'il était impossible de la ramener, la quitta pour retourner auprès du comte; il réfléchit même qu'il valait mieux rentrer seul, et qu'un mal subit survenu à sa fille lui servirait d'excuse.
Il trouva son gendre futur très-inquiet de la réception qu'on lui avait faite, et n'en soupçonnant que trop le motif; mais le grand chambellan avait une éloquence si persuasive quand il voulait parvenir à ses fins, et l'employa avec tant de succès dans cette occasion, que le comte fut convaincu qu'une douleur de tête violente, suite de l'émotion de la journée, avait seule occasionné le cri et la fuite de Caroline. Peut-être aussi feignait-il de le croire; on ne sait trop sur quoi compter avec les courtisans; ils savent dérouter l'historien le plus exact. Quoi qu'il en soit, il se sépara du chambellan avec l'espoir de retrouver le lendemain mademoiselle de Lichtfield mieux disposée, et sortit très-affligé dans le fond de ce qui venait de se passer.
Il ne pouvait être amoureux de Caroline, qu'à peine il avait entrevue; mais ce mariage lui convenait à tant d'égards, qu'il y avait attaché l'idée du bonheur de sa vie; ensuite le roi le voulait, raison qui devait être aussi décisive pour son favori que pour son chambellan; elle était si forte pour celui-ci, qu'il n'avait pas même imaginé qu'on pût lui résister.
Il aurait mieux fait sans doute de prévenir sa fille sur la figure du comte. Il le sentit trop tard, et s'en repentit mortellement; mais il avait cru qu'il valait mieux d'abord extorquer sa promesse; que Caroline, intimidée, n'oserait y manquer; et il n'avait point prévu l'effet de son saisissement, rendu plus profond par l'idée qu'elle s'était formée du comte.
Dès qu'il fut libre, il revint auprès d'elle, et la trouva dans le même état où il l'avait laissée; elle eut cependant la force de se jeter à ses pieds, et de le conjurer de ne pas sacrifier sa fille. Il vit qu'elle était trop émue dans ce moment pour qu'il pût raisonner avec elle. Il fut touché lui-même de l'excès de sa douleur; et, la relevant avec tendresse, il lui dit de se calmer; qu'il lui parlerait le lendemain matin; qu'il ne voulait que son bonheur. Il la quitta en l'exhortant à prendre quelque repos.
Le malheureux qui se noie s'accroche à un brin de paille. Caroline saisit avec ardeur cette lueur d'espérance, et fut presque consolée. Mon père est bon, pensa-t-elle; il m'aime; il ne veut, dit-il, que mon bonheur. Ah! s'il veut le bonheur de Caroline, il ne l'unira pas à son monstre qui a une bosse, une perruque, et n'a qu'un oeil et qu'une jambe.
Elle était dans l'âge où l'on porte à l'extrême la douleur et la joie. D'abord elle s'était crue perdue sans ressource: à présent elle se croit pour jamais délivrée du comte, et reprend à peu près sa gaieté du matin; mais encore abattue, elle se couche, et s'endort en pensant au singulier goût des rois dans le choix de leurs favoris, protestant bien que, si elle était reine, le comte de Walstein ne serait pas le sien.
Son sommeil fut aussi doux, son réveil aussi tranquille que si rien ne l'avait agitée. A peine lui restait-il encore, le lendemain, cette légère impression d'effroi que laisse un songe fâcheux, et lorsque son père entra chez elle, il retrouva le même sourire, les mêmes grâces enfantines avec lesquels il était reçu tous les matins. Plus caressante, plus empressée même qu'à l'ordinaire, elle semblait le remercier à chaque instant de sa condescendance dont elle ne doutait pas; et, sans oser rien dire qui eût trait à ce qui s'était passé la veille, tout en elle exprimait la reconnaissance, la joie. Elle se livrait d'autant plus à l'espoir, que son père, au lieu de lui faire des reproches, l'accablait d'amitiés.
Aimable enfant! jouis de ta douce illusion; tu n'as vécu que deux mois à la cour; tu ne sais pas encore que l'âme d'un courtisan est fermée à tous les sentiments de la nature. Tu crois avoir un père, un tendre père; et tu vas bientôt apprendre combien ce titre lui est moins cher, moins précieux que ceux de ministre et de grand chambellan.
Cependant le baron chérissait sa fille. Après ses emplois, sa fortune, elle était certainement ce qu'il aimait le plus au monde; mais ces deux objets passaient avant tout. D'ailleurs il croyait de bonne foi assurer le parfait bonheur de Caroline par un mariage aussi brillant, fait sous les auspices du roi et par son ordre. Très-décidé à le terminer de gré ou de force, il voulut d'abord essayer d'y parvenir par la douceur. Il prit les deux mains de sa fille dans les siennes, et, les serrant tendrement: Caroline, lui dit-il, aimes-tu ton père? — Oh! si je l'aime! répondit-elle en embrassant ses genoux, qu'il me permette de passer ma vie auprès de lui, il verra jusqu'où peuvent aller l'amour, le respect de sa reconnaissante fille. — Je n'en doute pas, mais j'exige une autre preuve. — Tout, tout ce que vous voudrez, mon père, excepté… Elle allait dire d'épouser le comte; mais le baron, reprenant un instant la sévérité paternelle, lui ferma la bouche avec la main… Point d'exception, Caroline; la première preuve d'amour que je vous demande, c'est de m'écouter en silence.
Que feriez-vous, ma fille, si la vie de votre père était entre vos mains? — Votre vie? Je la sauverais aux dépens de la mienne; en pouvez-vous douter?…. Mais comment…., pourquoi… — Je n'en attendais pas moins de vous, ma chère enfant; vous venez de décider de votre sort et du mien. Oui, mon existence, ma vie dépendent de vous seule. N'espérez pas que je survive un jour à ma disgrâce; elle est assurée si votre union avec le comte de Walstein n'a pas lieu. Hier, en vous quittant, effrayé de votre répugnance pour ce mariage, j'allai me jeter aux pieds du roi; j'osai le conjurer de nous rendre notre promesse et notre liberté. — Caroline est un enfant, dit-il en fronçant le sourcil, qui ne sait ce qui lui convient, et dont on doit faire ce qu'on veut. Cependant vous êtes bien le maître de disposer d'elle à votre gré; mais si elle persiste dans son refus, nous pouvez la reconduire dans sa retraite et y rester avec elle: un père aussi faible ne peut être un bon ministre…. Il me tourna le dos, et ne m'a pas dit un mot de la soirée. Jugez de mon état! je n'ai que trop vu que l'on soupçonnait ma disgrâce prochaine, qu'on disposait déjà de mes emplois. O ma fille, ma fille! seras-tu donc la cause de malheur, que dis-je du malheur? de la mort certaine de celui qui t'a donné le jour?
La sensible et tremblante Caroline, plus effrayée cent fois de cette idée qu'elle ne l'avait été de l'aspect du comte, se précipita en frémissant dans les bras de son père: Oh! j'obéirai, j'obéirai, répétait-elle en sanglotant; j'épouserai le comte à l'instant même, s'il le faut. Causer votre mort! moi, grand Dieu! O mon père! courez vite; allez dire au roi que je ferai tout ce qu'il voudra, pour qu'il vous rende son amitié. Je vous promets, je vous jure d'être au comte, mais promettez-moi donc que vous ne mourrez pas.
Cette idée de mort l'avait tellement frappée, qu'elle craignait qu'un instant de retard ne coûtât la vie à son père. Elle aurait voulu aller dire elle-même au comte qu'elle était prête à l'épouser. Elle s'engagea de nouveau par les promesses les plus fortes, les plus positives, et ne laissa aucun repose au baron qu'il ne fût parti.
Laissée seule encore cette fois, elle ne pensa ni à danser, ni à courir après des papillons: tristement appuyée sur une main dont elle se couvrait les yeux, elle était agitée de mille sentiments contraires, et semblait craindre de faire un seul mouvement, comme s'il pouvait décider de son sort. Quelquefois son enthousiasme filial se ranimait; sa tête s'exaltait en pensant au sacrifice qu'elle allait faire à son père. Il me devra la vie, disait-elle avec une tendresse mêlée d'admiration pour elle-même, qui produisait une sensation assez douce. Oui, mais à quel prix, et avec qui vais-je passer la mienne? Alors l'image du comte se présentait, celle du père s'effaçait; Caroline frémissait, et ne comprenait pas qu'elle pût avoir la force de tenir ce qu'elle avait promis.
Elle était encore et dans la même attitude et dans le même trouble lorsque son père rentra avec précipitation, la joie peinte sur tous ses traits. Il put à peine lui dire, tant il était hors d'haleine, que le roi lui-même était en chemin pour venir chez elle, et lui amenait le comte. Oui, le roi en personne, répétait-il; cela fera du bruit, et ceux qui se réjouissaient hier de ma disgrâce pourront s'affliger ce matin. Voyez, Caroline, ce que c'est que d'être obéissante, et comme vous en êtes récompensée!
La pauvre Caroline, peu sensible à cette récompense, n'y vit qu'une conformation du cruel engagement qu'elle venait de prendre, et qu'une raison de plus de s'affliger. Son père la gronda de n'avoir pas employé à sa toilette le temps de son absence. Quelques jours auparavant, elle eût été bien fâchée elle-même d'être surprise par le roi dans son négligé du matin; mais tout lui devenait si indifférent, qu'elle attendit cette auguste visite dans le salon sans avoir même jeté un coup d'oeil sur son miroir.
Le baron lui répétait, pour la quatrième fois, comment elle devait recevoir le roi, quand le bruit des carrosses l'interrompit. Il courut au devant de son maître. La tremblante Caroline se leva, se rassit, respira des sels, et rassembla toutes ses forces pour cette pénible entrevue.
Le monarque entra, suivi seulement de son favori et de son chambellan, que tant d'honneur gonflait de joie.
Belle Caroline, dit-il en s'avançant près d'elle, et lui présentant le comte, soyez la récompense des services qu'il m'a rendus; et vous, mon cher comte, recevez de ma main celle de cette charmante épouse, et sentez bien tout le prix du présent que je vous fais.
Le comte alors s'approchant de Caroline, et prenant cette main qu'elle retirait à demi, la pria, d'une voix basse et timide, de vouloir bien confirmer son bonheur.
Pour le monde entier Caroline n'aurait pu articuler une seule parole. Si elle eût levé les yeux sur son futur époux, peut-être eût-elle trouvé la force de dire non; mais elle avait pris le sage parti de ne point le regarder. Elle se contenta d'une révérence respectueuse, et s'assit en silence par l'ordre du roi. Il en était temps; peu s'en fallut qu'elle ne réitérât la scène de la veille. Un tremblement général l'avait saisie. Elle fut encore obligée d'avoir recours à sa flacon, peut-être allait-elle se trahir par un évanouissement ou par un déluge de larmes; mais un regard jeté sur son père, près de se trouver mal lui-même d'inquiétude, lui rendit toute sa fermeté. Elle lui sourit à demi pour le rassurer, trouva la force de dire que ce n'était rien, et tout fut mis sur le compte de la timidité d'une jeune fille élevée à la campagne.
Elle espérait que la compagnie allait se retirer, ou tout au moins changer de sujet de conversation; mais elle se trompait. Ce que les rois entendent le moins, c'est de ménager la sensibilité de leurs sujets. Celui-ci, charmé du mariage qu'il venait de conclure, ne pouvait parler d'autre chose; et, sans s'apercevoir de tout ce qu'il faisait souffrir à la pauvre petite, il s'appesantissait cruellement sur les détails. Il fallait indiquer le jour, l'heure, le lieu de la cérémonie. Enfin Caroline, n'y pouvant plus tenir, retrouva la parole pour demander la permission de se retirer: elle lui fut accordée; et sa Majesté ne manqua point, lorsqu'elle sortit, de la saluer sous le nom de comtesse de Walstein.
La malheureuse petite comtesse, seule dans son appartement, s'affligea d'abord à l'excès. Enfin, après avoir beaucoup pleuré, elle comprit que cela ne changerait rien à son sort, qu'il était décidé sans retour, qu'il fallait bien s'y soumettre, et tâcher d'en tirer le meilleur parti possible.
Qu'on ne s'étonne point de voir une étourdie de quinze ans raisonner aussi sensément. Rien ne forme une jeune fille comme le malheur; et ces trois jours de trouble, d'inquiétude, de chagrins, avaient plus appris à Caroline à réfléchir, que n'auraient fait dix années d'une vie tranquille. Elle entendit enfin partir le carrosse du roi avec moins d'émotion qu'elle ne l'avait entendu arriver; et son père eut le plaisir de la trouver assez calme lorsqu'il vint lui faire part des arrangements.
Le mariage était fixé à huitaine. Le comte avait désiré qu'il fût tenu secret; aussi devait-il être célébré dans sa terre de Walstein, à six lieues de Berlin. Les fêtes, les présentations à cour, les visites, les présents, ne devaient avoir lieu qu'après la célébration.
Caroline approuva fort ce projet, et demanda à son père de passer dans la retraite les huit jours de liberté qui lui restaient. Il était si content de sa docilité, qu'à la rupture près de son mariage, elle aurait pu lui demander tout sans crainte d'être refusée. Il le lui promit, et tint parole. Sa solitude ne fut interrompue que par quelques visites de son futur époux. Le baron se chargeait de l'entretenir, et pendant qu'ils se perdaient dans la politique, Caroline se confirmait dans la résolution qu'elle avait prise.
Nous ne la suivrons point dans le détail des tristes idées qui l'occupèrent pendant ces huit jours. Il suffit de savoir qu'elle réfléchit plus qu'elle n'avait fait dans tout le cours de sa vie; nous verrons bientôt ce qui en résulta.
Le temps passe dans la douleur tout comme dans le plaisir. Voilà bientôt Caroline arrivée à ce jour redouté qui doit la lier irrévocablement. Elle avait eu le temps de s'y préparer, elle paraissait tout à fait résignée; son père était au comble de la joie et des honneurs.
Le monarque en personne voulait accompagner Caroline à l'autel. Il aurait bien désiré, le bon chambellan, que toute la terre en fût témoin; mais deux ou trois seigneurs et leurs épouses furent seuls nommés pour y assister. Il s'en consola, dans l'espoir d'avoir beaucoup de choses à raconter au retour.
On part pour la terre du comte. La jeune fiancée, plus occupée que triste, soutint assez bien le voyage et même la cérémonie, qui se fit en arrivant; et son père, s'applaudissant de l'habileté avec laquelle il l'avait amenée à obéir, eut enfin le bonheur de la présenter au roi sous le titre de comtesse de Walstein. Ce fut le seul moment où la fermeté de Caroline parut l'abandonner. Troublée par les caresses du chambellan, qui l'accablait d'éloges, elle s'en défendait, le suppliait de l'épargner; et plus le père paraissait content, plus la tristesse de sa fille augmentait.
On devait retourner le soir à Berlin, installer la jeune comtesse dans son nouvel hôtel, et l'on parlait déjà de repartir, lorsque, saisissant le moment où son époux était seul dans une embrasure de fenêtre, elle s'approcha de lui, lui présenta un papier, le suppliant de le lire avec indulgence, et passa dans un cabinet voisin, où elle lui dit qu'elle attendrait sa réponse et ses ordres. Surpris autant qu'on peut l'être, le comte ouvrit promptement le papier, et lut ce qui suit:
"J'ai obéi, monsieur le comte, aux ordres absolus de mon père et de mon roi. Ils ont voulu me donner à vous, je vous appartiens donc à présent. Je suis à vous, uniquement à vous; je ne reconnais plus d'autre maître. C'est à vous seul à disposer actuellement de mon sort, et c'est de vous que j'ose attendre de la bonté, de l'indulgence, de la générosité. Oui, c'est à celui qui vient de jurer de me rendre heureuse, que je veux demander sans crainte ce qui peut assurer mon bonheur, et sans doute le sien. O monsieur le comte! vous ne savez pas, vous ne pouvez imaginer combien la petite fille à qui vous venez de donner votre main et votre nom en est peu digne encore! combien elle est enfant, peu raisonnable! combien elle a besoin de passer quelques années de plus dans la retraite, auprès de l'amie respectable qui lui servit de mère! Consentez, oh! consentez, de grâce, que je retourne ce soir même à Rindaw, et que j'attende là que ma raison ait fait assez de progrès pour me soumettre sans mourir aux liens que j'ai formés. Votre consentement me pénétrera de la plus vive reconnaissance; il avancera peut-être cette époque. Un refus, au contraire…. soyez sûr qu'un refus vous priverait également, et pour jamais, de la malheureuse Caroline.
"Je sens fort bien tous les reproches que vous pouvez me faire. Cette lettre aurait dû vous parvenir plus tôt; mais en vous confiant ma résolution avant notre union, je risquais la vie de mon père: à présent je ne risque plus que la mienne. Il m'a juré qu'il n'aurait pas soutenu sa disgrâce; elle était sûre si je ne devenais pas votre épouse… Je vous appartiens; le roi doit être content. J'ose encore attendre de vous qu'il ne rendra pas mon père responsable de ma résolution, si elle lui déplaît. Ah! ce n'est pas au roi à se plaindre de son zèle, de son dévouement! Je ne m'en plaindrai pas non plus, si vous consentez à ce que je vous demande."
Cette lettre, écrite et déchirée plus de trente fois pendant les huit jours précédents, avait été finie telle qu'on vient de la lire le matin même avant le départ.
Si jamais un homme fut frappé d'étonnement, ce fut le comte de Walstein; il ne pouvait en croire ses yeux. Quoi! cette enfant si timide en apparence, et qui lui a paru si soumise, ose avoir une volonté, et l'annoncer avec cette fermeté, ce courage! Il relut ce billet une seconde fois, et la plus tendre pitié succéda bientôt à la surprise. Il vit alors qu'elle avait été sacrifiée au despotisme du roi, à l'ambition de son père, et il se reprocha mortellement d'en avoir été la cause et l'objet.
Quoiqu'on se fasse toujours un peu d'illusion sur sa figure, et que le comte n'en fût peut-être pas plus exempt qu'un autre, il se rendait cependant assez de justice pour n'avoir jamais imaginé qu'on pût l'épouser par goût: mais du moins il avait cru, sur les assurances les plus positives du chambellan, sur la résignation apparente de Caroline, que c'était sans répugnance, et surtout sans contrainte.
L'instant où il apprit qu'il s'était trompé, ou plutôt qu'on l'avait trompé, fut sans doute affreux pour lui; mais il ne balança pas une minute sur le parti qu'il avait à prendre; et voulant commencer par rassurer Caroline, il écrivit avec un crayon, dans l'enveloppe de son billet:
"Intéressante et malheureuse victime de l'obéissance, vous allez être obéie à votre tour. Je cours obtenir du roi ce que vous me demandez, et réparer, autant qu'il est possible, une tyrannie dont je suis la cause sans en être complice. Si j'étais refusé, fiez-vous alors à moi seul du soin de vous rendre cette liberté qu'on vous a si cruellement ravie. Je sens tout le prix de votre confiance en moi, je saurai la mériter, Caroline, en vous sacrifiant tout mon bonheur: heureux encore si ce sacrifice me rend moins odieux à celle qui en est l'objet!"
Il entr'ouvrit la porte du cabinet où Caroline s'était retirée, attendant la vie ou la mort. Il lui tendit son petit écrit, qu'elle reçut en tremblant, comme l'arrêt de son sort, et disparut à l'instant même.
Elle le lut avec saisissement; et pendant un moment elle en fut si touchée, si reconnaissante, qu'elle aurait presque voulu rappeler le comte; mais, malheureusement pour lui, en jetant les yeux sur la croisée, elle le vit se promener dans les jardins avec le roi. La promenade et le grand jour ne lui étaient pas aussi favorables que la lecture de ses billets, les bonnes dispositions de Caroline s'évanouirent à l'instant. Elle sentit plus que jamais le vif désir de retourner dans sa retraite; pensant d'ailleurs qu'il était trop tard, qu'elle en avait trop fait pour ne pas achever, qu'elle passerait pour capricieuse, inconséquente. Tout en réfléchissant et regardant le comte, son petit billet, roulé dans ses doigts, s'effaçait avec l'impression qu'il avait produite.
Pendant ce temps-là, son généreux époux usait de tout son ascendant sur l'esprit du roi pour l'engager à consentir aux volontés de Caroline. Il lui montra sa lettre: au lieu de l'irriter, le style et la fermeté de cette jeune femme intéressèrent le monarque.
— Il y a de l'énergie dans ce caractère, dit-il en la finissant; et regardant le comte en la lui rendant, il ne put s'empêcher de convenir en lui-même que son favori n'était véritablement pas fait pour être celui d'une beauté de quinze ans.
C'était s'en aviser un peu tard; mais ce moment fut si favorable à Caroline, qu'il ajouta tout de suite: Allons, mon ami, passons-lui cette fantaisie: c'est une enfant qu'il faut ménager, et que l'ennui nous ramènera bientôt. Sa fortune est à vous, c'est l'essentiel: on vit toujours assez avec sa femme.
En conséquence de cet arrêt, le grand chambellan fut appelé. Le nouveau projet lui fut communiqué; on lui montra la lettre de sa fille, qui, ainsi que son départ pour Rindaw, excita sa colère. Retenu cependant par la présence de son maître, il renferma son dépit avec soin, et se contenta de hasarder quelques objections. Le roi, qui l'avait toujours vu de son avis, ne trouva pas bon qu'il voulût même essayer d'en avoir un autre; il lui témoigna son mécontentement: le chambellan, effrayé, et s'inclinant profondément, le supplia de lui pardonner, et de disposer de sa fille à son gré.
Il fut donc décidé que, le soir même, Caroline retournerait à Rindaw auprès de sa bonne maman. On lui permit d'y rester autant qu'elle le voudrait, espérant bien qu'elle ne le voudrait pas longtemps.
On ajouta même une condition qui semblait rendre impossible une bien longue retraite, c'était le secret le plus profond sur le mariage. Le roi ne dit point ses motifs pour l'exiger. On a présumé qu'il avait craint que cette histoire ne répandît une sorte de ridicule sur son favori, et peut-être sur son autorité.
Quoi qu'il en soit, il prononça que, jusqu'au moment de la réunion des époux, Caroline portât le nom de Lichtfield, et qu'on laissât ignorer à tout le monde qu'elle fût comtesse de Walstein. Il déclara que du moment qu'il en transpirerait la moindre chose, Caroline rentrerait sous la puissance de son mari, et que l'indiscret perdrait sans retour sa confiance: il le dit en regardant le chambellan, qui se hâta de l'assurer qu'il observerait un profond silence.
Le roi le recommanda lui-même à tous ceux qui avaient été témoins de cette union. Tous le promirent, et en effet n'en firent confidence, sous le sceau du secret, qu'à une trentaine d'amis. Avant le fin de la semaine personne n'en doutait à Berlin; et pendant huit jours au moins on ne s'abordait qu'en se disant à l'oreille ou derrière l'éventail: Savez-vous que le comte de Walstein a épousé la petite Lichtfield? Le roi y était; c'est toute une histoire. Je la sais de la première main; n'en parlez pas; ne me nommez pas surtout.
Mais comme rien ne confirma ces bruits, qu'on ne revit point Caroline, que le comte retourna paisiblement à son ambassade, que le chambellan se taisait, et que bien d'autres secrets de cour succédèrent à celui-là, on finit par ne plus le croire, ou plutôt par n'y plus penser.
Voilà donc ce jour de noces terminé bien différemment qu'on ne l'avait imaginé. Le baron fut chargé d'apprendre à sa fille qu'on lui laissait la liberté de se confiner à Rindaw. Il devait aussi la conduire; mais le comte, craignant qu'il ne se vengeât sur elle de la contrainte que le roi mettait à sa colère, voulut encore épargner à sa jeune épouse ce désagréable voyage. Il persuada facilement à son beau-père qu'il lui était essentiel de ne pas s'éloigner de la cour dans ce moment critique; et comme celui-ci n'avait nulle envie de partager la retraite de sa fille, il se contenta de la confier à des domestiques sûrs, et de la charger d'une lettre qu'il écrivit à la baronne de Rindaw.
La réputation d'indiscrétion et d'imprudence de la bonne chanoinesse était si bien faite; elle était si bien connue, même à la cour, pour n'avoir jamais su garder un secret, qu'elle ne fut point exceptée de celui qu'on exigeait sur le mariage. On recommanda fortement au contraire au baron et à sa fille de le lui cacher avec soin.
Caroline, qui redoutait les remontrances, les persécutions journalières, ne demandait pas mieux; et l'obéissant baron, toujours soumis aux volontés de son maître, écrivit par ordre à son amie: "Que le mariage projeté pour sa fille étant retardé de quelque temps, il la lui confiait de nouveau."
Caroline, munie de cette lettre, prit congé de son père, en lui demandant à genoux son pardon et sa bénédiction. Le grand chambellan, satisfait de l'être toujours, lui accorda l'un et l'autre avec une tendresse encore un peu courroucée. Il la vit partir pour Rindaw, qui n'était qu'à sept ou huit lieues de là; et lui-même retourna bientôt à Berlin avec le roi et l'ambassadeur.
Caroline fut d'abord un peu surprise de se trouver seule dans une grande berline. Encore émue des adieux de son père et des événements de la journée, il lui eût été difficile de rendre raison de ce qui se passait dans sa tête, où tout était désordre et tumulte: elle ne savait si elle devait se réjouir ou s'affliger.
Certainement tout allait comme elle l'avait voulu, comme elle l'avait demandé; mais peut-être, sans trop se l'avouer à elle-même, avait-elle compté sur plus de résistance. Trop souvent la grande facilité d'obtenir ce qu'on désire en diminue bien le prix; d'ailleurs, sa petite vanité eût été du moins satisfaite si l'on eût eu beaucoup de peine à se séparer d'elle.
Quoi! disait-elle avec un mouvement qui tenait presque du dépit, je n'ai qu'à dire un mot, un seul mot, et l'on me laisse aller! mon père, le roi, le comte, sont à l'instant tous d'accord pour m'abandonner! Est-ce indifférence, colère, ou générosité?
Elle regardait son petit billet déchiré; elle cherchait à se rappeler les expressions. Il lui paraissait qu'au moins, de la part du comte, c'était pure bonté. Elle s'attendrissait, et disait en soupirant: Quel dommage qu'il soit si laid!
Son imagination, ses regrets s'arrêtèrent aussi sur son père, qu'elle quittait, qu'elle affligeait, puis sur les plaisirs qu'elle abandonnait, et sur les beaux titres qu'elle aurait pu porter. Madame le comtesse, madame l'ambassadrice, ne sera donc que la petite Caroline!
Il y eut des moments où sa tête fut à moitié hors de la portière pour dire au cocher de retourner à Berlin; mais ils furent courts, et l'image du comte encore présente à ses yeux la faisait rentrer bien vite au fond de la voiture, en se félicitant d'avoir su l'éviter. Non, non, c'était impossible, disait-elle alors; jamais je n'aurais pu m'accoutumer à lui; il me faisait mourir de peur; et le voir toujours là, le jour, la nuit, continuellement? non, c'était impossible. Alors elle s'applaudissait de son courage, et d'avoir su concilier ses devoirs et son antipathie, sauver la vie de son père, et conserver sa liberté.
Ces différentes idées l'occupèrent pendant les deux tiers de la route; mais plus elle se rapprochait de Rindaw, plus tout ce qui tenait aux regrets s'affaiblissait. Bientôt elle ne sentit que le plaisir de revoir sa bonne maman, cette amie si chérie qui lui avait tenu lieu de la mère la plus tendre, et qui semblait avoir transporté sur elle tous les tendres sentiments qu'elle avait eus pour son père. Lorsque celui-ci était venu prendre Caroline, et eut dit à la baronne que c'était pour la marier, son désespoir fut si grand, et l'effort qu'elle fit pour s'en séparer si violent, que sa santé en avait été altérée. Depuis, elle n'avait fait que languir. Gaieté, plaisir, bonheur, tout avait disparu de Rindaw avec Caroline. Les fermiers, les paysans, les domestiques, tout ce village, dont elle était l'âme et les délices, ne cessaient de parler d'elle, de la regretter, et de dire qu'ils avaient tout perdu.
Qu'on se figure donc la joie de ces bonnes gens lorsqu'un soir, par un beau clair de lune, un équipage s'arrête devant le château. C'était une chose si rare à Rindaw, qu'ils accoururent tous. Quelle fut leur surprise lorsqu'ils en virent descendre Caroline, leur chère Caroline, avec ces grâces qui lui gagnaient tous les coeurs!