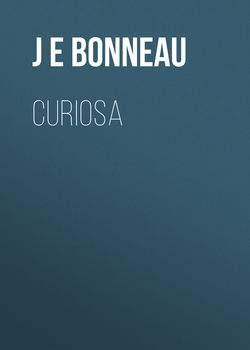Читать книгу Curiosa - J E Bonneau - Страница 12
XI
LES NOUVELLES
DE SACCHETTI40
ОглавлениеLes Trecento Novelle de Franco Sacchetti sont un des monuments de la littérature Italienne: comme style, de pur Toscan, elles font autorité et se classent parmi les testi di lingua; comme fond, elles ont l’inappréciable avantage d’être des tableaux de mœurs d’une vérité, d’une précision et d’une couleur on ne peut plus rares. Il y a lieu de s’étonner qu’elles soient restées manuscrites près de cinq siècles; presque contemporaines de Boccace, elles n’ont vu le jour que du temps de Voltaire. Les Italiens de la Renaissance les connaissaient pourtant à merveille; Strapparola, Bandello, le Lasca, Pogge surtout, en ont largement profité, mais l’idée de s’en faire l’éditeur n’est venue à personne de ceux qui les mettaient si bien à contribution. Peut-être était-ce par remords et pour ne pas dévoiler leurs larcins: croyons plutôt qu’ils les trouvaient d’un style trop rude, trop archaïque, et qu’ils préféraient de bonne foi à ces vieilleries leurs amplifications ou rajeunissements. Bottari les imprima le premier en 1724; Poggiali en donna une édition plus correcte et plus exacte (Livourne, sous la rubrique de Londres, 1795, 3 vol. in-8); à cette époque, le temps avait déjà produit dans l’œuvre de Sacchetti des ravages irréparables. Les copies en étaient encore nombreuses; il y en avait à Florence, à Rome, dans les bibliothèques publiques et dans les collections particulières; mais la plupart étaient de date récente, du XVIIe siècle ou de la fin du XVIe, et leurs auteurs ne semblaient avoir eu qu’une préoccupation: rajeunir le texte et lui enlever toute saveur, raccourcir ou délayer les Nouvelles, substituer leurs propres réflexions à celles de Sacchetti; ces copies ne pouvaient être d’aucune utilité. Un manuscrit ancien de la Bibliothèque Laurentienne, à Florence (on le croit du XVe siècle), servit de base aux travaux de Bottari, de Poggiali et de tous ceux qui vinrent après eux; malheureusement, il était mangé des vers, perdu d’humidité, des feuillets avaient été arrachés, le commencement et la fin manquaient. Le commencement fut retrouvé, cousu à une copie plus récente, dans la Bibliothèque Magliabecchi; la fin n’a jamais été découverte, et, même en rejoignant les deux parties, séparées l’une de l’autre, nous ne savons à quelle occasion, on ne réussit pas à combler toutes les lacunes. Dans l’état où elles sont actuellement, après cinq ou six éditions dont la meilleure est celle de M. Ottavio Gigli (Firenze, Le Monnier, 1868, 2 vol. grand in-18), les Trois cents Nouvelles se trouvent réduites à deux cent vingt-trois41.
Placé entre Boccace, qui le précède d’une vingtaine d’années, et Pogge, qui le suit à un demi-siècle de distance, Sacchetti tient à la fois de l’un et de l’autre; il refait à sa manière certains contes du Décaméron, par exemple le Diable en enfer, comme pour montrer ce que l’on peut tenter, même après un chef-d’œuvre; et par courtoises représailles, Pogge traite à son tour en Latin, avec l’originalité qui lui est propre, un grand nombre de sujets tirés des Trecento Novelle. Mais Pogge a une préférence marquée pour les brèves anecdotes, les reparties spirituelles, surtout pour les contes gras; il vise au trait et va droit au mot de la fin en une page ou deux. Boccace, conteur éloquent et fleuri, Cicéronien d’éducation et de style, affectionne les récits longuement accidentés, les aventures épiques. Peu lui importent le lieu de la scène et le temps de l’action; il choisit dans l’histoire ancienne, aussi bien que parmi les événements contemporains, le fait qu’il juge propre à captiver l’intérêt, il l’idéalise et le transforme en une peinture générale des travers, des vices et des passions: chacune de ses Nouvelles est un poème, une tragédie, une comédie. Sacchetti a de moins hautes visées; tandis que son prestigieux rival rehausse de tout l’éclat de son imagination les aventures déjà empreintes d’un caractère exceptionnel, lui se borne à nous raconter la vie au jour le jour, le fait divers de la semaine, l’aventure bourgeoise qui a défrayé les commérages du quartier. Les personnages de Boccace, même les plus vulgaires, deviennent des types, comme ceux de Molière et de Shakespeare: ils représentent l’humanité; ceux de Sacchetti restent des individus. Mais si l’auteur des Trecento Novelle n’a pas les hautes facultés d’idéalisation de son rival, il possède d’autres qualités à peine inférieures, et, en concentrant sur un seul foyer la peinture des mœurs Italiennes à son époque, toute l’intensité de son observation, il a réussi à nous laisser des tableaux pleins de l’animation de tout ce qui est vrai et sincère; on y sent la vie. L’un de ses mérites, très sensible même aux étrangers (combien doit-il l’être plus aux Italiens!), consiste dans le naturel et la justesse de l’expression, empruntée toute vive à la langue populaire, dans un style fourmillant d’idiotismes Florentins. Il a quelque chose de notre Villon, qui, lui aussi, nous a conservé tant de vieux proverbes et de locutions Parisiennes: l’absence de toute recherche littéraire et, sous cette négligence apparente, la précision du trait, du détail caractéristique, l’art d’esquisser une physionomie, de donner le croquis d’une scène, d’une manière ineffaçable, en deux ou trois coups de crayon; il ne compose pas un récit, il vous met la chose même sous les yeux.
Mieux que personne, Sacchetti était en position de bien connaître tous ces menus faits de la vie journalière, qu’il a recueillis pour son amusement et pour le nôtre; il remplit dans la dernière moitié de sa vie la charge de Podestat, magistrature qui, outre ses attributions administratives et politiques, conférait un pouvoir presque arbitraire, et dont la juridiction singulièrement étendue allait des cas de simple police aux causes emportant la peine capitale: dans la même séance, le Podestat décidait d’une contestation à propos d’un panier d’œufs et envoyait un mauvais drôle à la potence. Sacchetti ne dut assurément pas être pour les petites villes de Bibbiena et de San-Miniato, où l’envoya successivement la République de Florence, ce qu’est Angelo, tyran de Padoue, dans le sombre drame de Victor Hugo: la griffe du tigre sur la brebis, l’homme devant qui les fenêtres se ferment, les passants s’esquivent, le dedans des maisons tremble; mais s’il n’entendait point, la nuit, des pas dans son mur, il est bien permis de croire que son esprit observateur et curieux pénétrait assez facilement les murs et les secrets des autres. De là, dans ses Nouvelles, tant de renseignements puisés aux meilleures sources sur les principales familles Italiennes et les personnages en vue de son temps; il aimait ses délicates fonctions, tout en se dépitant de ne pas les exercer sur un plus vaste théâtre, il se plaît à les rehausser, à rapporter de beaux procès, jugés soit par lui-même, soit par divers de ses collègues, et, au milieu de ses récits généralement plus plaisants que tragiques, il tient souvent en réserve quelque terrible histoire, propre à effrayer quiconque voudrait se moquer des Podestats, Prévôts, Capitaines-grands et autres gens de justice.
Par sa naissance autant que par ses aptitudes, Franco Sacchetti était destiné aux charges publiques. La famille des Sacchetti est citée avec celle des Pulci, par Machiavel, comme une des plus anciennes et des plus importantes du parti Guelfe, chassées de Florence lors d’un triomphe éphémère des Gibelins à l’approche de l’Empereur Frédéric II, réduites à se réfugier dans les forteresses du Val-d’Arno et dont l’exil faisait la sécurité des vainqueurs. Elles furent rappelées peu de temps après et depuis lors conservèrent presque toujours le pouvoir. Dante aussi en parle comme d’une des premières familles de Florence:
Grande fut jadis la colonne du Vair,
Les Sacchetti, Giuochi, Fifanti, Barucci,
Galli, et ceux qui rougissent à cause du Boisseau42…
(Les Sacchetti appartenaient sans doute à la corporation des pelletiers); Dante les cite parmi les vieux Florentins dont le nom se perd dans la nuit des temps:
… Dirò degli alti Fiorentini,
Dei quai la fama nel tempo è nascosa…
(Paradiso, XVI, 86-87.)
Pourtant une vieille haine existait entre les Sacchetti et les Alighieri. Dans l’Enfer, Dante rencontre un de ses parents, Geri del Bello, tué par un Sacchetti, et l’Ombre, lui rappelant que sa mort est restée jusqu’à présent sans vengeance, le menace fortement du doigt (Inferno, XIX, 25-27). Ces inimitiés, que le temps finit par éteindre, n’altérèrent en rien le culte que voua plus tard Franco Sacchetti au grand poète Florentin; maints endroits de ses écrits témoignent de sa profonde admiration pour le chantre de la Divine Comédie, et l’une de ses Nouvelles (CXXI —Le Tombeau du Dante), renferme l’éloge le plus original, le plus audacieux qu’on puisse faire de son génie.
Il grandit et atteignit l’âge viril à l’une des périodes les plus troublées de l’histoire de Florence, celle où de terribles calamités vinrent se joindre aux luttes des partis qui divisaient continuellement cette turbulente République. Nobles et Plébéiens étaient arrivés à se faire la guerre, non plus pour obtenir, comme le remarque Machiavel, partage égal du pouvoir, mais pour s’annuler et se proscrire, dès que l’une des deux factions l’emportait. Le Duc d’Athènes, amené et soutenu par la faction des Nobles, venait d’être chassé, les Nobles tous tués ou proscrits. Le parti populaire, auquel appartenaient les Sacchetti, dominait; la ville n’en était pas plus calme, déchirée entre diverses familles qui se disputaient les armes à la main les principales magistratures. Des bandes de condottieri, appelées les unes par le Pape, les autres par l’Empereur, erraient à travers l’Italie, pillant les campagnes, prenant d’assaut les petites villes, prêtes à se mettre au service de n’importe quelle cité ou de quel prince, et forçant tout le monde à se renfermer chez soi, à s’armer pour se défendre d’attaques imprévues. La peste vint apporter un surcroît de désolation et de terreur. Né en 1335, Sacchetti avait treize ans lorsque éclata cette terrible peste noire, décrite par Boccace sous de si sombres couleurs dans le prologue du Décaméron, et qui lui laissa, à lui aussi, des souvenirs ineffaçables, car il en a également parlé dans la préface de ses Nouvelles43. On a peu de détails sur la première partie de son existence; on sait seulement qu’il voyagea, pour apprendre le négoce; qu’il était en 1350 en Slavonie, en 1353 à Gênes. Il s’adonnait en même temps à la poésie et dut à un certain nombre de Canzones, de Sonnets, de Madrigaux et de Ballades, qui le firent placer par ses contemporains immédiatement au-dessous de Pétrarque, son premier renom littéraire; très peu de ses vers ont été conservés et, quoiqu’ils soient fort estimables, ils ne légitiment pas tout à fait une si favorable appréciation.
Une de ses meilleures pièces est celle qu’il composa en 1375, à propos de la mort de Boccace; d’autres Canzones lui furent inspirés à diverses époques de sa vie par les événements auxquels il se trouva mêlé, et suivant l’usage du temps, par ses amours. Il dit avoir poursuivi de ses instances, pendant vingt-six ans, une dame dont le nom est resté ignoré, et qu’il accabla sans résultat de ses bouquets à Chloris. Sur la fin de sa vie, il s’en désolait encore et, contant dans l’une de ses Nouvelles (CXI —Le paquet d’orties), l’histoire d’un Religieux qui avait, en amour, des procédés un peu plus expéditifs, «un autre, et je suis de ceux-là,» dit-il avec quelque tristesse, «un autre aura beau adresser aux femmes mille madrigaux ou ballades, il n’en recevra pas un salut!» Il a en outre composé des Sermons dont nous dirons un mot; enfin on a quelques lettres Latines qui indiquent un esprit très-cultivé44.
Le point culminant de sa carrière politique fut la part qu’il prit, en 1376, à la ligue des États du nord et du centre de l’Italie contre l’Église, sous le Pontificat de Grégoire XI. L’Italie échappait au Pape qui, de son palais d’Avignon, prétendait la gouverner plus étroitement que jamais. Toutes les villes qu’il tenait sous sa domination se soulevaient; Bologne chassait ignominieusement son Légat, Rome même n’était pas sûre. Pour se consolider dans Faënza, l’Évêque d’Ostie, un des plus grands scélérats de l’époque, au dire de Muratori, prit à sa solde l’Anglais John Hawkwood (le Giovanni Acuto ou Gian Acut de Sacchetti et des chroniques Italiennes), qui guerroyait depuis longues années dans la Péninsule, à la tête de bandes indomptables. L’Anglais pénétra dans Faënza, puis réclama au Légat la solde de ses hommes; c’était une comédie convenue d’avance. «Payez-vous sur les habitants,» répondit le Cardinal. Hawkwood commença par bannir onze mille citoyens, toute la population valide, puis, sûr de ne plus rencontrer de résistance, mit la ville à sac; toutes les femmes furent livrées aux soldats, trois cents massacrées. «Voilà quels chiens,» dit Muratori, »prenaient à leur service en Italie les ministres de l’Église!» Le cardinal de Genève, depuis Anti-Pape sous le nom de Clément VII, émerveillé des hauts faits d’Hawkwood, l’envoya contre Cesena, qu’il traita aussi cruellement, puis contre Florence, qui ferma ses portes. L’Anglais ne put que ravager les territoires environnants, détruire les moissons et menacer la ville d’une épouvantable famine. En gens avisés, les Florentins achetèrent Hawkwood, qui, recevant de grosses sommes pour les réduire et le double pour ne rien faire, resta tranquillement dans ses quartiers; plus tard, ils le prirent à leur solde et l’employèrent avec succès contre le Pape, circonstance à laquelle cet illustre bandit doit d’avoir à Florence un magnifique mausolée, surmonté de sa statue équestre, dans l’église de Santa-Croce.
Malheur à qui est sous toi, et ne se révolte,
Car c’est juste raison de se soustraire
A qui de sang humain veut se nourrir,
s’écrie Sacchetti dans une furieuse invective adressée à Grégoire XI; il y rappelle les massacres ordonnés par le Cardinal de Genève:
… Le sang innocent de Cesena
Répandu par tes loups avec tant de rage:
Femmes grosses, vieilles, mortes en monceaux,
Les membres coupés, saignant par toutes veines;
Filles violées aux cris de: Qui en veut, la prenne!
D’autres réfugiées en nouveau servage;
Aucunes, avec leurs enfants, pour comble d’horreur,
Frappées à mort sur l’autel des églises.
O terre changée par elles en lac de sang rouge!
O Pontife!..45.
Mais il ne se contenta pas de faire des vers. Délégué comme ambassadeur de Florence près des seigneurs de la Romagne par le Conseil des Huit, magistrature dictatoriale créée en vue de la guerre, il se rendit à Bologne avec Matteo Velluti pour collègue, tandis que son frère, Giannozo Sacchetti, était envoyé au même titre à Sienne et à Chiusi; il acquit à la ligue Bologne et quelques autres villes, puis fut dépêché à Milan, y conclut l’alliance entre Barnabò Visconti et la République Florentine, et pendant cinq années ne cessa de réchauffer le zèle des adhérents, de susciter à l’Église de nouveaux ennemis. C’est à cette date que se rapportent ses relations avec les principaux chefs ou capitaines de la ligue: Malatesta de Rimini, Gambacorta de Pise, les Manfredi de Faënza, les Visconti, et surtout avec Ridolfo Varano de Camerino, qui eut le commandement en chef des forces alliées, et dont il rapporte tant de traits dans ses Nouvelles. Au retour de ses missions, en 1372, il fut surpris en mer par les Pisans et fait prisonnier; l’un de ses fils, qui l’accompagnait, Filippo, reçut une blessure grave pendant le combat. La République lui alloua soixante-dix florins d’or en dédommagement de ses pertes. Quelques années auparavant, il avait reçu de son pays une autre marque de faveur singulière. Son frère, Giannozo, se trouva compromis dans une obscure intrigue et convaincu de trahison: il affectait de grands principes religieux, couchait sur la dure, ne portait que des haillons, et n’avait pas laissé cependant d’accepter, en même temps que Franco, les fonctions d’ambassadeur; mais secrètement il travaillait pour le Pape et s’était abouché, à Padoue, avec les chefs des réfugiés Guelfes, que leur attachement au parti de l’Église avait fait bannir de Florence. De concert avec eux, il essaya de décider Carlo de Durazzo à s’emparer de Florence en se rendant à Naples, où il allait, sur la prière du Pape, chasser la reine Jeanne. Surpris avec quelques-uns des conjurés à Marignolle et mis à la torture, Giannozo avoua tout et fut condamné à mort; il eut la tête tranchée le 3 Octobre 1379. D’après une loi de Florence, nul des parents d’un condamné ne pouvait exercer de fonctions publiques: un décret de la Seigneurie, en date de 1380, releva expressément Franco Sacchetti de cette déchéance, manifestant ainsi la haute estime où le tenaient ses concitoyens. En 1383, Sacchetti fut élevé au Priorat; la date mérite d’être signalée: c’était au plus fort de la lutte entre Louis d’Anjou et Carlo de Durazzo, et la peste noire ayant fait de nouveau son apparition à Florence, les principaux habitants abandonnaient la ville, les magistrats désertaient leurs postes; il donna l’exemple du devoir. La même année, au sortir de sa charge, il entra au Conseil des Huit. Le reste de sa vie s’écoula dans des magistratures plus paisibles; on l’envoya successivement en qualité de Podestat à Bibbiena, à San-Miniato, puis à Portico (1398), avec le titre de Gouverneur de la province de Florence. Ses deux fils, Niccolo et Filippo Sacchetti, marchèrent sur ses traces; tous deux furent élevés au Priorat, comme leur père, et le second eut la charge de Gonfalonier de Justice en 1419.
41
Ginguené en compte par erreur deux cent cinquante-huit (Histoire littéraire d’Italie, tome III); il a été trompé par le chiffre de la dernière Nouvelle, qui est bien en effet CCLVIII, mais les éditeurs Italiens ont avec raison conservé à chacune d’elles, comme nous l’avons fait nous-même pour notre Choix, le numéro qu’elle porterait dans le recueil complet. En réalité, outre les quarante-deux dernières, dont il ne subsiste pas trace, il en manque trente-cinq dans le corps de l’ouvrage, et une trentaine des deux cent vingt-trois qui restent ne sont que des fragments réduits parfois à quelques lignes.
42
Grande fu già la colonna del Vaio,
Sacchetti, Giuochi, Fifanti, Barucci
E Galli, e quei ch’arrossan per lo Staio…
(Paradiso, XVI, 103-105.)
43
Ce n’est qu’un fragment assez informe, ce qui nous a empêché de la traduire.
44
Quelques-unes de ses poésies, entre autres douze Sonnets, des lettres, tant Italiennes que Latines, et les Sermons évangéliques, ont été recueillis par M. Ottavio Gigli et forment le premier volume des Opere di Franco Sacchetti (Florence, Le Monnier, 1857-1860, 3 vol. grand in-18).
45
Canzone cité par M. Ottavio Gigli.