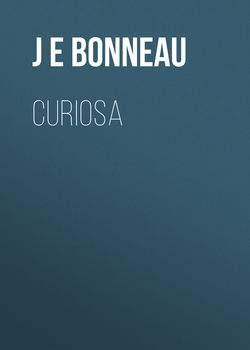Читать книгу Curiosa - J E Bonneau - Страница 4
III
UN VIEILLARD
DOIT-IL SE MARIER?
DIALOGUE DE POGGE3
ОглавлениеC’est au savant éditeur Anglais William Shepherd que l’on doit la connaissance de ce Dialogue. Auteur d’une excellente étude sur Pogge (Life of Poggio, Londres, 1802, in-8o), Shepherd regrettait vivement la perte de ce morceau littéraire, non inséré dans les Œuvres complètes ni imprimé à part, et qu’il restait peu de chances de retrouver. On savait que Pogge l’avait composé quelque temps après son mariage, comme pour se disculper vis-à-vis de ses amis de ses noces tardives; qu’il était primitivement dédié à Cosme de Médicis; que, des deux interlocuteurs, l’un y blâmait, l’autre approuvait le mariage d’un vieillard avec une jeune fille; qu’enfin Apostolo Zeno en avait eu en sa possession une copie; mais là se bornaient les renseignements. W. Shepherd en découvrit par hasard un manuscrit, en 1805, à Paris, dans le dépôt de la Bibliothèque Nationale, et se hâta de le publier sous ce titre: Poggii Bracciolini Florentini Dialogus, An seni sit uxor ducenda, circa an. 1435 conscriptus, nunc primum typis mandatus et publici juris factus, edente Gulielmo Shepherd (Liverpooliæ, typis Geo. F. Harris, 1807, in-8o). C’est cette édition, la seule qui ait été faite4, que nous avons suivie; comme elle est assez rare, et que d’ailleurs ce dialogue n’a jamais été traduit en Français, c’est pour ainsi dire un ouvrage inédit que nous offrons aux lecteurs.
Ce morceau valait la peine d’être tiré de l’oubli, tant en faveur de la nouveauté de la thèse, un paradoxe finement traité, que pour sa valeur littéraire; il est écrit avec cette bonne humeur, cet enjouement dont Pogge a marqué tous ses ouvrages, sans préjudice de ces qualités pittoresques qu’il recherchait parfois aux dépens de la pure Latinité. Son ordonnance rappelle, avec plus de laisser-aller (ce qui en double le charme), celle de ces beaux dialogues antiques qu’il arrachait aux catacombes des monastères, et dont il se nourrissait l’esprit en les recopiant avec amour. Il y a mis toute son ingéniosité, car c’était sa propre cause qu’il plaidait. Il s’agissait pour lui, non-seulement d’excuser le mariage d’un homme de cinquante-cinq ans, ce qui après tout n’est pas un crime, mais surtout de démontrer par vives raisons que c’est avec une jeune fille, non avec toute autre, qu’on doit se marier à cet âge. C’était là pour Pogge le point capital, car en épousant, dans son arrière-saison, une jeune fille d’une grande beauté, dans toute la fleur de ses dix-huit ans, il abandonnait une vieille maîtresse qui, quatorze fois de suite, l’avait rendu père de famille.
Le mariage de Pogge est un curieux épisode de sa vie. Ses amis l’adjuraient depuis longtemps de faire cesser l’irrégularité de sa conduite. Successivement secrétaire de sept ou huit papes, chargé de missions presque ecclésiastiques, sans être cependant engagé dans les ordres, il ne semblait pas se douter du discrédit que ses mœurs jetaient sur lui; il s’amusait même à rire aux dépens des autres. Mais, à mesure qu’il vieillissait, les reproches devenaient plus vifs, et il arriva même à l’un de ses protecteurs, le cardinal de Saint-Ange, de le tancer un jour vertement. Ce prélat avait été envoyé en Allemagne, le cierge d’une main, l’épée de l’autre, pour y détruire l’hérésie et convaincre spécialement les disciples de Jean Huss, qu’on venait de brûler à Constance. Sans s’amuser à prêcher longtemps ces rebelles, il leva une armée composée en grande partie de reîtres et de lansquenets Allemands, et envahit la Bohême, au grand effroi des populations paisibles; mais à peine ses soudards aperçurent-ils l’ennemi qu’ils s’enfuirent dans le plus grand désordre: le cardinal perdit sa bulle, sa crosse, et jusqu’à son chapeau rouge, dans la bagarre. Pogge se mit à railler sans pitié son ami: «Le triste et ridicule résultat de ton expédition en Bohême, d’une expédition préparée si longuement et si laborieusement, m’a consterné,» lui écrivit-il; «il est étonnant que tes soldats se soient sauvés, avant même d’avoir vu l’ennemi, comme des lièvres effrayés par un coup de vent. Ce qui me console, c’est que j’avais prévu la chose et que je ne t’ai pas caché mes craintes sur l’issue de cette funeste guerre; tu te mis à rire de mes alarmes, tu répondis que les prophéties de malheur étant plus souvent justifiées par l’événement, j’agissais avec prudence en formant de sinistres présages. Mes conjectures, cependant, n’étaient pas téméraires… Les Allemands étaient fameux jadis par leur bravoure; ils le sont maintenant par leur gloutonnerie à boire et à manger: ils sont braves en proportion du vin qu’ils ont avalé, et quand leurs tonneaux sont vides, leur courage est épuisé. Aussi suis-je tenté de croire que ce n’est pas la crainte d’un ennemi, qu’ils n’ont pas vu, qui les a fait fuir, mais bien le manque de vin. Jusqu’ici, tu croyais que la sobriété était nécessaire au soldat, mais si tu recommences ton expédition, il faudra changer de maxime et regarder le vin comme le nerf de la guerre.»
Le cardinal n’aimait pas la plaisanterie. Il répondit à Pogge qu’il en prenait bien à son aise pour un homme perdu de réputation, qui avait une maîtresse et des bâtards. C’était, du reste, le refrain que Pogge entendait continuellement autour de lui depuis quelque temps. Il essaya d’abord de s’en tirer par de nouveaux sarcasmes. «Tu me reproches» écrivit-il à l’irascible prélat, «d’avoir des enfants, ce qui ne convient pas à un ecclésiastique, et de les avoir eus d’une concubine, ce qui est un déshonneur même pour un laïque. Je pourrais te répondre que j’ai des enfants, ce qui n’est pas défendu à un laïque, et que je les ai eus d’une concubine, ce qui est la coutume des ecclésiastiques depuis le commencement du monde. Ne rencontre-t-on pas tous les jours, dans tous les pays, des prêtres, des moines, des abbés, des évêques et de plus hauts dignitaires encore qui ont eu des enfants de femmes mariées, de veuves et même de religieuses? Ces moines, qui font profession, à ce qu’ils disent, de fuir le monde et qui, couverts de bure, vont de ville en ville, les yeux baissés, montrent-ils plus de réserve et de retenue? Ils font semblant d’être pauvres, ils ont toujours à la bouche le nom de Jésus et ne songent qu’à s’emparer du bien d’autrui, pour en user comme d’un bien propre. De peur qu’on leur reproche, comme à un serviteur négligent, de tenir caché le seul talent qu’ils possèdent, ils s’efforcent de le rendre productif dans le terrain des autres. Souvent j’ai ri de la réponse hardie ou plutôt téméraire d’un certain abbé Italien qui se présenta un jour à la cour de Martin V avec son fils, grand gaillard sur lequel on le questionna: Je n’ai pas que celui-là, répondit-il, j’en ai quatre autres, tous en état de porter les armes, et que je mets au service de Sa Sainteté. Ce propos fit beaucoup rire le pape et toute sa cour… Quant à tes conseils sur le genre de vie que je dois suivre, je te déclare que je ne dévierai pas du chemin que j’ai suivi jusqu’à présent. Je ne veux pas être prêtre; je ne veux pas de bénéfices. J’ai vu une foule de gens, d’abord très estimables, et qui, après leur ordination, sont devenus avares, paresseux et débauchés. Dans la crainte de subir la même métamorphose, je finirai mon pèlerinage sur la terre avec l’habit laïque. Trop souvent j’ai remarqué que votre grande tonsure ne rase pas seulement les cheveux: le même coup de rasoir vous enlève la conscience et la vertu.» (Poggii Epistolæ, ep. 27.)
Pogge avait beau dire: il n’en était pas moins touché à l’endroit sensible. S’il était bien décidé à ne pas se faire prêtre, il n’avait pas la même horreur pour la vie de famille, et, peu de temps après l’échange de ces lettres, il épousa une jeune et noble Florentine, Vaggia de’ Buondelmonti. Il s’était arrangé, à Florence, une délicieuse retraite, encombrée de manuscrits précieux, de statues antiques et d’objets d’art, où c’eût été agir en égoïste que de vivre seul. Presque toutes ses lettres, à partir de cette époque, témoignent des satisfactions de tous genres qu’il rencontra dans son mariage; on dirait qu’il y fait déborder le trop plein de sa félicité conjugale. Voici, par exemple, ce qu’il écrit à un savant ecclésiastique de ses amis en lui apprenant son union récente: «Trop longtemps, mon cher père, j’ai interrompu par négligence nos entretiens épistolaires: veuillez cependant ne pas croire que le tort provienne d’un coupable oubli de mes nombreuses obligations envers vous; je conserverai éternellement la mémoire de vos bienfaits. Seulement, depuis ma dernière lettre, rien ne m’a paru assez important pour mériter que je vous en fisse part. Aujourd’hui qu’un grand changement s’est opéré dans ma situation, je m’empresse de vous l’apprendre pour vous faire participer à ma joie et à mon bonheur. J’ai mené jusqu’à présent, comme vous le savez, une existence intermédiaire, ni tout à fait laïque, ni tout à fait ecclésiastique. J’ai pour le sacerdoce une répugnance invincible et, parvenu maintenant à cette période de la vie où la régularité des habitudes devient indispensable, j’ai résolu de ne pas finir mes jours dans la solitude, à un foyer désert. Quoique au déclin des ans, j’ai pris pour femme une jeune fille d’une rare beauté et douée, en outre, de toutes les vertus et de toutes les qualités qui sont l’honneur de son sexe. Vous me direz peut-être que j’ai mis bien du temps à me décider. Je suis de votre avis; mais il y a là-dessus un vieux proverbe: Mieux vaut tard que jamais; et vous n’avez sans doute pas oublié cette maxime des Philosophes: Sera nunquam est ad bonos mores via. Certainement j’aurais dû me marier il y a longtemps, mais alors je ne posséderais pas la femme que j’ai choisie, un caractère si heureux qu’il se plie à mes goûts et à toutes mes habitudes, une compagne qui fait évanouir tous les tourments et tous les chagrins de ma vie. Je n’ai que faire de lui rien souhaiter, car la nature lui a prodigué tous ses dons. Aussi, du fond du cœur, ne cessé-je de remercier Dieu qui, après m’avoir toujours favorisé, m’a enfin comblé de sa grâce en m’accordant plus que je ne pouvais raisonnablement désirer. La sincère amitié que vous m’accordez et l’estime que j’ai pour vous m’ont engagé à vous écrire dans cette circonstance, et à vous faire part de mon bonheur. Adieu.»
Pogge manifeste les mêmes sentiments dans son dialogue: An seni sit uxor ducenda; mais il les reproduit cette fois sous la forme démonstrative. On voit qu’il veut se rendre compte de son bonheur, l’expliquer théoriquement, démontrer que ce ne fut pas un effet du hasard, mais que cela devait être, et du même coup pallier sa conduite et convier tous les célibataires endurcis à suivre son exemple. Les interlocuteurs sont au nombre de trois: Pogge, qui du reste joue un rôle assez effacé, son ami le savant Niccolo Niccoli, celui précisément auquel est adressée la charmante relation des Bains de Bade5, et Carlo Aretino, chancelier de Florence, beaucoup plus jeune alors que les deux autres. Niccolo, avec sa verve railleuse, expose que Pogge, en se mariant si tard avec une jeune fille de dix-huit ans, a peut-être fait par hasard une bonne affaire, mais qu’il en pourra cuire à ceux qui seraient tentés de l’imiter, et il énumère spirituellement toutes les tribulations d’un pareil ménage. C’est un tableau très réussi, et il offre cette particularité qu’il n’est pas chargé le moins du monde. Avec un art consommé, l’auteur se garde bien des exagérations que le sujet comportait naturellement, mais qui auraient rendu la réfutation trop facile. Niccolo paraît avoir tout à fait raison, jusqu’à ce qu’il cède la parole à Carlo Aretino, dont la réplique en faveur des mariages tardifs n’en est que plus piquante. Par une autre délicatesse, Pogge n’a pas voulu plaider pour lui-même, il a préféré placer ce qu’il avait à dire dans la bouche de son jeune ami. Carlo, après avoir démoli pièce à pièce toute l’argumentation de son adversaire, en fait une contrepartie si exacte qu’il semble qu’on voie clair pour la première fois dans une question embrouillée à plaisir; évidemment le vrai bonheur est de se marier aux environs de la soixantaine et de prendre sa femme la plus jeune possible. Le porte-parole de Pogge accumule avec tant d’esprit tant de bonnes raisons, qu’on arrive à se faire la réflexion formulée ironiquement à la fin par Niccolo: Hâtons-nous de vieillir, mettons les années doubles, pour arriver au plus tôt à cet état de parfaite béatitude.
Voilà qui est bien; mais l’ancienne maîtresse, la femme aux quatorze enfants? Le souvenir de son abandon et de celui des quatre enfants qui avaient survécu, dans le nombre, ne fait-il pas quelque ombre au tableau? Pogge ne semble pas s’être laissé importuner outre mesure par les remords; à partir de son mariage, son ancienne femme et ses enfants semblent avoir été pour lui comme s’ils n’existaient pas. Que devinrent cependant ces malheureux? Laurent Valla prétend que Pogge les laissa tranquillement mourir de faim, qu’il alla même jusqu’à déchirer une donation par laquelle il leur avait antérieurement assuré une petite aisance. Valla était un ennemi acharné de Pogge, et il a inventé contre lui de si odieuses et si absurdes calomnies, qu’il ne devait pas lui en coûter beaucoup de mentir une fois de plus; Tommaso Tonelli, le traducteur Italien de la Vie de Pogge, par Shepherd, met à découvert toute sa mauvaise foi. Il paraît que les enfants naturels de Pogge avaient acquis la légitimation par deux actes authentiques, dont le premier est une bulle pontificale, et le second un décret de la Seigneurie de Florence qui, en considération du retour de Pogge dans son pays natal, de son savoir et de ses occupations littéraires, l’exempta, lui et ses fils, de tout impôt. Ce décret fut rendu en 1532, trois ans avant son mariage. Ces fils légitimés conservaient donc tous leurs droits, même dans le cas où leur père aurait d’autres enfants. Quant à la donation soustraite et déchirée, c’est bien probablement une fable puisque Pogge, sans se donner tant de peine, pouvait la révoquer d’un trait de plume, en faisant d’autres dispositions testamentaires. Rien n’empêche donc de croire que Pogge assura, de façon ou d’autre, l’avenir de la femme qu’il quittait et des enfants qu’il avait eus d’elle; que s’il n’en a plus jamais parlé, cette absence de toute préoccupation et la sérénité de son esprit à leur égard témoignent précisément en faveur des dispositions qu’il avait dû prendre. Un homme tel que lui ne s’avilit pas de gaîté de cœur.
Quoi qu’il en soit, Pogge fut parfaitement heureux avec Vaggia de’ Buondelmonti; sa félicité conjugale résista au temps et dépassa de beaucoup les limites de la lune de miel, au cours de laquelle il écrivait ce dialogue. Pogge y prétend qu’il n’y a rien de tel que le fruit vert pour ragaillardir un vieillard et réveiller en lui le jeune homme: il le prouva bien6. Lui qui nous a conté tant de bons tours joués aux vieux maris, et qui peut-être leur en avait joué plus d’un, il eut la chance de démentir le mot de Plutarque: Qu’un barbon se marie autant pour ses voisins que pour soi. On prétend même qu’il mourut un peu prématurément, à soixante-dix-neuf ans sonnés, pour avoir été trop aimé par sa femme7. Son mariage, en somme, est d’un bon exemple pour les célibataires arrivés à la cinquantaine: à eux d’en faire leur profit.
Juin 1877.
4
Vincenzio Pecchioli l’a reproduite dans l’Appendice de sa traduction Italienne de la Vie de Laurent le Magnifique, de Roscoe.
5
Paris, Liseux, 1876, pet. in-18.
6
Pogge eut de Vaggia de’ Buondelmonti cinq fils: Pietro-Paolo, Giovan-Batista, Jacopo, Giovan-Francesco et Filippo. Pietro-Paolo naquit en 1438, prit l’habit de Dominicain et fut promu prieur de Santa-Maria-della-Minerva, à Rome, fonctions qu’il exerça jusqu’à sa mort arrivée en 1464.
Giovan-Batista naquit en 1439; il obtint le grade de docteur en droit civil et en droit canon, fut ensuite chanoine de Florence et d’Arezzo, recteur de l’église Saint-Jean-de-Latran, acolyte du souverain Pontife et clerc assistant de la Chambre. Il a composé en Latin les vies de Niccolo-Piccinnino, fameux condottière du temps, et de Domenico Capranica, cardinal de Fermo. Il mourut en 1470.
Jacopo fut le seul des fils de Pogge qui n’embrassa pas l’état ecclésiastique. Ce fut un littérateur distingué. Entré au service du cardinal Riario, ennemi acharné des Médicis, il était son secrétaire en 1478 et fut engagé par lui dans la conspiration des Pazzi. Le cardinal Riario parvint à s’échapper, mais le malheureux Jacopo subit le sort de la plupart des autres conjurés, qui furent pendus aux fenêtres du Palais de Justice de Florence.
Giovan-Francesco, né en 1447, fut, comme Giovan-Batista, chanoine de Florence et recteur de Saint-Jean-de-Latran. Appelé à Rome, il y devint camérier du pape et abréviateur des lettres apostoliques. Léon X, qui l’avait en grande estime, le prit pour secrétaire. Il mourut à Rome en 1522 et fut enseveli dans l’église de San-Gregorio.
Filippo naquit en 1450; c’est de sa naissance que Pogge se félicite dans une lettre à Carlo Aretino en lui annonçant que, quoique septuagénaire, il vient d’avoir un fils plus fort et plus beau que tous ses aînés. Filippo obtint à l’âge de vingt ans un canonicat à Florence, puis il abandonna l’état ecclésiastique pour épouser une jeune fille appartenant à une famille illustre, dont il eut trois filles.
Outre ses cinq fils, Pogge eut encore une fille, Lucrezia, qu’il maria de bonne heure à un Buondelmonti. On ne sait si cette fille provenait de son mariage, ou si c’était un des enfants qu’il avait eus de sa maîtresse.
7
En ce cas, il aurait ressemblé à l’un des plus célèbres médecins de son siècle, le Ferrarais Jean Manard, mort en 1537, à l’âge de 74 ans. Ce Manard, «s’étant marié fort vieux avec une jeune fille, fit des excès qui le tuèrent. Les poètes ne manquèrent pas de plaisanter là-dessus, et principalement ceux qui sçurent qu’un astrologue lui avoit prédit qu’il périroit dans un fossé. Ce fut le sujet de ce distique de Latomus:
In fovea qui te periturum dixit Aruspex
Non est mentitus: conjugis illa fuit.
«On a tant brodé la pensée de ce distique, que l’on est venu jusques à dire que Manard, pour éviter la prédiction, s’éloignoit de tous les fossez. Il ne songeoit qu’au sens litéral, et ne se défioit point de l’allégorique; mais il reconnut par expérience que ce n’est pas toujours la lettre qui tue, et que l’allégorie est quelquefois le coup mortel.» (Bayle, art. Manard.)