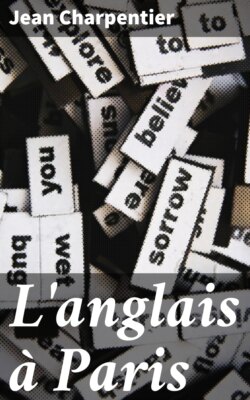Читать книгу L'anglais à Paris - Jean de Charpentier - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DE L’INFLUENCE DE LA TABLE SUR LES INSTITUTIONS ANGLAISES
ОглавлениеOn ne se fait pas une idée, disait Goldsmith, du nombre incalculable de bœufs, de moutons, d’oies, de canards, de poulets et de dindons qui, à l’époque de nos élections générales, meurent pour le bien de la patrie. Le tour «humoristique » de cette phrase du charmant auteur du Vicaire de Wakefield ne doit pas faire douter du fait qu’elle constate.
De tout temps les Anglais ont été grands mangeurs. En 1575, la reine Élisabeth alla visiter à son château de Cowdry, à Gorhambury, comté de Herts, sir Nicolas Bacon, chancelier d’Angleterre, et père du célèbre philosophe François Bacon, qui fut aussi chancelier. La royale visite dura cinq jours, du samedi 18 mai au mercredi suivant, et ce qu’elle coûta à sir Nicolas peut être évalué, d’après le détail du menu dressé par lui-même. «Sa Majesté, dit-il, a daigné passer plusieurs jours dans ma maison, et la proportion, pour chaque déjeuner, était de trois boeufs et cent quarante oies. On mangea, en outre, pendant ces cinq journées, trois cerfs et quinze chevreuils; plus une grande quantité de gibier, tels que hérons, butors, barges, pluviers, souchets, courlieux, au nombre de plusieurs centaines de têtes. La dépense en vins, bières, pâtisseries et autres objets de table, s’est élevée à 577 livres sterling 6 schellings, 7 pence et demi.» Cette somme représente aujourd’hui environ cent mille francs. Quatre ou cinq visites pareilles dans le cours d’une année eussent suffi pour ruiner le plus riche et le plus loyal sujet.
Ce fut en cette occasion qu’Élisabeth, qui savait être aimable quand elle le voulait, dit à sir Nicolas que sa maison était bien petite pour un homme tel que lui. A quoi le chancelier répondit: «Non, madame, c’est Votre Majesté qui m’a fait trop grand pour ma maison.» Se tournant ensuite vers François Bacon, le futur restaurateur des sciences, qui était alors un jeune garçon de douze à quinze ans, la reine lui demanda quel âge il avait: «Deux ans de moins que l’heureux règne de Votre Majesté,» répondit le courtisan précoce, qui devint garde des sceaux.
Aujourd’hui, comme il y a trois siècles, les repas homériques attestent à la fois la loyauté des Anglais pour leurs souverains et leur amour pour la liberté.
Pour se mettre en belle humeur et se donner les forces nécessaires dans une grande lutte civique, électeurs et candidats mangent avec un dévouement digne des Curtius et des Mucius Scœvola. Comme toute lutte, celle-ci implique deux partis antagonistes qui s’appellent ici, l’un whig, l’autre tory. (Nous dirons ailleurs l’origine et l’étymologie très-peu connues de ces deux mots, ainsi que leur prononciation.) Mais elle ne met en péril ni la sécurité du trône, ni la stabilité des institutions, du moins en ce qu’elles ont de bon, parce que les adversaires sont dans les dispositions pacifiques des gens qui ont bien déjeuné avant de se rendre sur le champ de bataille. Ils n’ont qu’un pas à faire de la salle à manger aux hustings, lieu où s’assemble le collége électoral; et le poll, élection, est suivi d’un lunch, collation copieuse, où chacun se rend à la hâte pour récomforter un estomac qu’ont creusé les cris et le tumulte des hustings. La bonne chère, ennemie des discordes politiques ou privées, joue, après comme avant le combat, son rôle conciliateur. Chez les vainqueurs elle tempère l’orgueil du succès, chez les vaincus, l’amertume de la défaite. Aussi les haines de partis ne couvent point sourdement dans les larges poitrines de ces heureux citoyens à figures épanouies et rubicondes. Poh! poh! «Bah! bah!» disent les torys défaits, en retournant chez eux; nous prendrons dans sept ans notre revanche sur ces damnés whigs. Et s’ils font bien les affaires du pays, nous leur donnerons même un coup d’épaule en attendant. Mais avant tout, qu’ils veillent avec soin à la régularité et à l’abondance des approvisionnements de bouche!
Les élections générales sont pour le pays tout entier une époque de réjouissance publique. Dans les hôtels, sous les toits domestiques, les foyers flambent, les broches tournent, les rôtis succulents fument et se dorent, les pots d’étain, remplis de cette bière noire et écumante appelée porter, circulent de main en main autour des tables d’acajou polies comme des miroirs. Là, accoudés dans un enviable bien-être, les électeurs discutent en même temps les mérites des candidats rivaux et ceux du porter et du jambon fournis par les tavernes du voisinage qui, en se faisant une vive concurrence, ont peine à satisfaire aux demandes de leurs nombreuses pratiques. Loin d’être alors inquiet et paralysé comme à l’approche de quelque événement subversif, le commerce, en ces jours de trémoussement national, prend une vigueur nouvelle, surtout le commerce des boissons et des comestibles. L’argent circule avec la joie chez les shopkeepers, boutiquiers, comme chez leurs pratiques, customers; joie accrue par l’espérance que le futur parlement fera plus et mieux que le dernier pour que le bien-être de la nation et l’abondance des vivres s’obtiennent à meilleur marché.
De même que les questions d’intérêt public, tout projet privé, toute entreprise particulière, grande ou petite, est, chez les Anglais, précédée d’un bon repas. A cette coutume hospitalière est due en grande partie le succès de la chose proposée.
La fondation d’un hôpital, d’un orphelinat, d’un asile pour les malheureux qui meurent de faim, se discute au milieu d’un festin splendide. Voilà pourquoi elle est votée à l’unanimité par les souscripteurs qu’une bonne action et un plaisir solide ont réunis de corps et d’esprit dans une même bonne pensée et un même bon dìner. Le sourire du contentement s’épanouit sur tous les visages, au fond de tous les cœurs parlent en même temps la satisfaction du bien-être actuel et la compassion pour les infortunés qui manquent des bonnes choses dont on vient de jouir si plantureusement. C’est en ce moment que le riche est véritablement pour le pauvre le ministre débonnaire de la Providence. Les bourses s’ouvrent avec les âmes, l’or et les sentiments de charité en découlent à la fois libéralement; la liste de souscription se trouve remplie, et dans quelque temps la mappemonde des misères humaines sera rétrécie d’un espace, hélas! infinitésimal, mais c’est toujours cela de moins. Aux spectacles, aux bals, aux concerts de bienfaisance, le riche donne aussi son or; mais, en de telles occasions, cet or est plus le don de la main que celui du cœur.
Le côté matériel de ces mœurs anglaises souvent frappe seul et scandalise les étrangers qui ne voient que les surfaces d’un peuple; mais le côté moral n’échappe point à quiconque a vécu longtemps dans ce pays. Et l’on peut affirmer que la stabilité de ses institutions sociales et politiques, malgré de grands et nombreux abus, est due, dans une grande mesure, à ce que les Anglais appellent a merry conviviality, une joyeuse convivialité. Ce terme a un sens bien plus large que ceux de commensalité et de sociabilité. Il implique les idées de joyeux repas, de convives réunis par une communauté harmonieuse de projets, de sentiments, de gaieté franche, poursuivant un but utile; l’unité dans la pluralité et l’accord dans la liberté, deux des plus belles et des plus rares choses de ce monde.
Voyez le parlement anglais, the English Parliament, les discussions y sont rarement brillantes, mais toujours solides. Il y a souvent antagonisme sur les moyens, presque jamais sur le but, s’il est utile et patriotique. Les fautes du gouvernement sont vigoureusement attaquées; le gouvernement lui-même est respecté et stable comme un roc. Les débats y sont de bonne humeur, parce qu’ils suivent de près le dìner des lords et des commoners, membres de la Chambre des communes. Le travail de la digestion n’ôte-t-il rien, direz-vous, à la lucidité des esprits? Non; il laisse le jugement sobre et apte à l’appréciation des questions graves, tout en modérant peut-être les écarts de l’imagination qui se lancerait dans l’utopie, si les orateurs étaient à jeun.
Les séances commencent entre sept et huit heures du soir et se prolongent jusqu’à trois et quatre heures du matin. Aussi, à la fin de chaque séance, les représentants de la nation, si dévoués qu’ils soient à ses intérêts, ne sont point insensibles au plaisir d’aller dormir jusqu’à onze heures ou midi, heure à laquelle ils ne quittent leur lit que pour se mettre à table.
Un instant de réflexion sur la nature mixte de l’homme, matière et intelligence, fait admirer la sagesse profonde et pratique de nos voisins. Le temps choisi par eux, entre le dîner et le coucher, pour s’occuper des affaires publiques est excellemment propre à cette tâche patriotique. Sous l’influence de ces deux grands bien-être de la vie, le manger et le dormir, le parlement anglais a un caractère que ne présente la législature d’aucun autre pays. Discussion calme, sans être froide; dignité patiente et courtoise dans le choc des opinions; liberté complète à chacun de développer et de défendre la sienne, si contraire qu’elle soit à celle de tous; dédain profond pour l’abstraction et l’utopie, ce qui laisse une aptitude admirable pour les choses pratiques, les améliorations possibles et opportunes. L’intelligence de ces hommes à figures reposées semble faite de deux éléments: le solide et l’utile. Le génie des révolutions, si éloquent qu’il fût, n’aurait nulle chance d’être écouté dans une telle réunion. Ceux qui la composent connaissent trop bien ce proverbe de leur pays: A bird in the hand is worth two in the bush, «un oiseau dans la main en vaut deux dans la haie.» Pas plus pour eux que pour le reste de l’humanité le présent n’est sans déboire, mais ils savent trop bien en goûter les réalités pour leur préférer les hasards incomfortable d’un avenir inconnu. «Je ne donnerais pas une demi-guinée, disait, il y a un siècle, le célèbre docteur Johnson, pour vivre sous une forme de gouvernement plutôt que sous une autre.» L’opinion du grand moraliste est encore et sera toujours celle des Anglais. Peu leur importe la forme, quand le fond est bon. Voilà pourquoi tous les bills, «projets de lois,» proposés dans cette grande assemblée, sont frappés au coin d’une utilité clairement démontrée et réalisable sans bouleversement. Par cette sage et habile tactique, les vrais patriotes, les sincères amis du peuple finissent toujours par triompher de l’égoïste résistance de l’aristocratie. Ces séances de nuit ont un autre avantage. Quand un orateur extravague, ce qui arrive quelquefois, même en Angleterre, ou qu’il parle trop longtemps, ce qui arrive souvent, l’assemblée, anticipant sur l’heure du départ, s’endort à l’unanimité, et ses ronflements seuls répondent au discoureur prolixe. Ce procédé, qui serait incivil si les séances se tenaient pendant le jour, paraît tout naturel aux heures tranquilles et somnifères de la nuit. Le Speaker, «président» (ainsi appelé par antiphrase, car il ne parle pas), après avoir résisté quelque temps à la somnolence générale, finit par s’endormir aussi sous son énorme perruque, et l’orateur diffus se tait ou parle aux banquettes.
Il serait à désirer que les séances législatives eussent lieu la nuit, après dîner, dans tous les pays où le régime parlementaire anglais n’a pu jusqu’ici s’établir solidement. Si, au moyen de cette mesure, qui est, comme le reste du système, toute britannique, ledit régime continuait à mal fonctionner, c’est que décidément il ne conviendrait qu’aux Anglais et qu’il faut à eux seuls en laisser la pratique.
Les observations précédentes, que plusieurs prendront pour une plaisanterie, je les déclare très-sérieuses. Elles s’appliquent avec la même vérité aux meetings et aux clubs où les débats ont lieu entre gens qui sortent de table et sont sous l’influence pacifique de la digestion. Voilà pourquoi on meeting de quinze à vingt mille personnes se tient en plein air sans tumulte ni danger pour l’ordre public. S’il s’élève par hasard des clameurs séditieuses, s’il se donne des coups de poings inconstitutionnels, au milieu de bousculades qui ne sont ni civiles ni politiques, c’est le fait d’estomacs à jeun, et partant, irritables, ou d’estomacs imprudemment gonflés de café et de spiritueux et plus irritables encore. Même dans ce dernier cas, il suffit qu’un commissaire, escorté de trois policemen, «agents de police,» vienne lire le Riot act, «ordonnance sur les attroupements tumultueux,» pour que le meeting se disperse aussitôt et sans résistance.
En mêlant les solides plaisirs du bien-vivre, aux exercices de la vie publique, les Anglais ont fait acte de gens sensés et en même temps de loyaux sujets. Ils ont suivi l’exemple de leurs rois, de tout temps amateurs passionnés de la bonne chère. Ces souverains joyeux et bien nourris ont quelquefois donné des domaines pour un plat de choix. Le château d’Addington, comté de Surrey, avec ses magnifiques dépendances, champs, prés, bois et forêts, fut donné autrefois par Henri III à un seigneur de sa cour nommé Trecothick, qui lui avait fait manger un ragoût délicieux et de son invention. Depuis le milieu du treizième siècle jusqu’à Charles II, la famille de Trecothick posséda le fief d’Addington, sous la teneur ou condition expresse, mais sans autres charges ni redevances, de présenter aux rois d’Angleterre un bon et succulent plat le jour de leur couronnement. De sorte que ces puissants seigneurs eussent été dépossédés et réduits à l’indigence, si, à l’avénement de chaque nouveau souverain, ils eussent manqué de cuisiner avec une habileté supérieure. Quelle fortune eussent faite dans ces heureux temps des artistes tels que Carême, Soyer ou Chevet! Le palais d’Addington appartient aujourd’hui aux archevêques de Canterbury, sans aucune clause culinaire.
La chronique du savant bénédictin William de Malmesbury nous apprend que Guillaume le Conquérant avait, lui aussi, récompensé les bons et loyaux services de son cuisinier Tzélin par une donation de terres riches et fertiles. Et Tzélin, dans sa reconnaissance, quoiqu’il ne dirigeât plus les cuisines du roi, lui envoyait chaque année, le jour de sa fête, un mets de sa composition et qu’on appelait deligrout.
Les raffinements de la table furent toujours une preuve de civilisation. Le sauvage mange son poisson cru ou son écureuil grillé ; l’homme civilisé mange l’esturgeon au bleu ou en papillotes et les perdrix à la chipolata. Ce n’était donc point un siècle barbare que celui où le talent d’un cuisinier était récompensé par une fortune en bonnes terres de labour.
L’importance qu’attachait le Conquérant au deligrout et aux autres mets de Tzélin prouve leur excellence et élucide en même temps un fait historique: c’est l’embonpoint de Guillaume, malgré les fatigues et les agitations d’une vie guerrière. On sait que cet embonpoint le fit plaisamment comparer par Philippe Ier, de France, à une femme prête à..... augmenter d’une unité, peut-être de deux, la somme toujours incomplète du genre humain. Cette plaisanterie eut peut-être coûté cher à Philippe, sans la blessure mortelle que reçut à Mantes-sur-Seine le gros homme qui venait se venger d’un bon mot par une guerre.
Voici un autre bon mot qui n’eût pas davantage été du goût des robustes hommes d’armes, qui, sous la conduite du vaillant Bâtard, firent cette belle conquête de l’Angleterre. Pour cette besogne peu facile ils avaient besoin d’un régime à la fois excitant et substantiel. Regnard, ce moqueur riant de tout et de tous, fait dire à Démocrite, dans sa comédie de ce nom:
Qui ne rirait de voir qu’avec un soin extrême
L’homme ait mis son plaisir à se tuer lui-même!
A force de ragoûts et de mets succulents,
Il creuse son tombeau lui-même avec ses dents.
Cela pouvait être vrai pour les comtes et les marquis du XVIIIe siècle, qui passaient la nuit à souper et le jour à dormir. Ils dansaient, dira-t-on, la gavotte et le menuet. Beaux exercices, ma foi! pour faire digérer des hommes qui sortaient d’un dîner à trois services, c’est-à-dire à quarante-cinq plats. Aussi quelle mine 1 des mannequins couverts de velours, de satin et de dentelles! pâles, chétifs, ou pléthoriques et goutteux, et portant sous la large basque de leur habit brodé une brette bonne pour tuer des rais. Ni goutte ni pléthore n’affligeaient les guerriers vêtus de fer qui à Hastings battirent Harold et ses Saxons.
Benè vivere et lœtari, a dit un médecin célèbre au commencement de ce siècle: bien vivre et se réjouir. Aujourd’hui beaucoup de gens peu sensés se réjouissent à voir courir des chevaux sur l’herbe, au lieu d’y courir soi-même, ce qui serait beaucoup plus hygiénique; ou à suivre d’un regard anxieux les mouvements d’hommes qui, au risque de se rompre le cou, sautillent et gambadent sur des cordes à cent pieds du sol comme des singes, auxquels ils s’efforcent de ressembler par des prodiges d’agilité stérile; mais il faut le reconnaître, le plus grand nombre, en France, fait de son mieux pour bien vivre: ce qui se voit à la bonne mine des gens de toutes conditions et au nombre merveilleux d’établissements qui ont la bouche pour pratique. Dans toutes les rues de Paris, sur huit boutiques, il y en a cinq qui sont restaurants ou débits de comestibles.
L’expérience du parlement d’Angleterre ne fut-elle jamais consultée par les rois sur la préparation d’un rôti ou d’une sauce, comme le fut celle du sénat romain pour le turbot de Domitien? Un navire anglais ne fut-il jamais équipe pour porter en toute hâte un Apicius couronné sur un lointain rivage où se trouvait quelque rare poisson digne seulement d’une bouche royale? Les chroniqueurs n’en parlent pas, mais de tels faits gastronomiques sont présumables dans le pays natal du roastbeaf, de la soupe à la tortue et du plumpudding.
Un honnête industriel de Gloucester, M. Lazenby, s’est illustré et a acquis une belle fortune par l’invention de la sauce qui porte son nom. Cette sauce transcendante rehausse également la saveur d’un poisson ou d’un rôti; elle est apéritive, digestive, tonique autant qu’agréable; elle fortifie la voix et la rend plus sonore; elle prolonge la vie en préservant de la pléthore les beaux mangeurs qui en font un constant usage; enfin elle est brevetée avec garantie du gouvernement et porte sur les étiquettes de ses bouteilles noires et plates les armes des trois royaumes, le trèfle, la rose et le chardon: ce qui n’empêche pas le débit d’une foule de contrefaçons, aussi préjudiciables au goût du public qu’aux intérêts de M. Lazenby, ainsi que l’affirme souvent, dans les journaux de Londres, le savant inventeur: Read well the label before you buy, lisez attentivement l’étiquette avant d’acheter et surtout avant de dîner.
Les clubs, dont, en certains pays, le nom seul est un épouvantail, ne font en Angleterre tressaillir personne, pas même les vieilles femmes, douairières ou lavandières.
Ce sont des hôtels magnifiques à l’extérieur comme à l’intérieur, dont mille à quinze cents personnes sont à la fois hôtes et propriétaires. Pour le prix modique de deux francs cinquante centimes à trois francs, elles y font d’excellents dìners, et y trouvent en même temps réunis les avantages et les plaisirs d’un café, d’un salon de lecture, d’un salon de conversation et d’une bibliothèque. Chacun, selon ses goûts, va prendre place, après dîner, dans une de ces différentes parties du vaste établissement. Les discussions politiques ne sont donc point, comme on le croit, l’unique objet des clubs, en Angleterre. Elles y ont, sans doute, leur place au salon de conversation, comme tous les grands intérêts du pays; mais comme au parlement, elles conservent le calme, la tolérance, l’esprit pratique, qui constituent la force et l’utilité de l’opinion publique chez un peuple. Assurément tout n’est pas pour le mieux dans la société anglaise. Les richesses et les priviléges énormes de la noblesse, la misère et l’ignorance de la grande majorité du peuple, les étroites limites où sont enfermés le droit électoral et l’exercice de ce droit; l’absence de contrôle sérieux dans l’emploi des deniers publics, et bien. d’autres abus appellent des réformes nombreuses et sévères. Comme tant d’autres, elles s’accompliront à leur jour, seront durables et porteront leurs fruits, parce qu’elles auront poussé dans le terrain de toute vraie réforme: discussions graves, ayant pour objet, non la parole, mais le fait; emploi de moyens où la pratique laisse très-peu de place aux théories impossibles, efforts non pour renverser, mais pour améliorer.
Ainsi, tout récemment , un membre du ministère, M. Milner Gibson, déclarait, dans un joyeux banquet que lui donnaient ses électeurs, que le moment était venu d’étendre le suffrage électoral à des classes de citoyens qui en sont actuellement exclues. Ce ministre admettait ainsi l’existence d’une opinion mûrie dans la conscience publique, et, comme telle, tombant d’elle-même dans le domaine des faits pour y prendre racine. Ce genre de progrès avec ordre, d’amélioration sans soubresaut, se retrouve même dans les deux grands Clubs essentiellement politiques qui existent en Angleterre, the Reform-Club «le Club de la Réforme» et le Carlton-Club «Club Conservateur.» Dans le premier, les abus sont battus en brèche par Cobden, Bright, Tompson et tous les vrais libéraux de l’école de Manchester. C’est au prix d’efforts et de sacrifices considérables de temps et d’argent, que ces hommes défendent en les étendant, les intérêts réels du peuple et les libertés publiques, sans les compromettre jamais par d’impraticables théories. Dans le second, lord Derby, lord Manners, les ducs de Richemond, de Rutland, défendent, avec la vaillance de l’égoïsme et la discipline de l’esprit de caste, la vieille citadelle dorée du privilège. Un signe certain que cette noble garnison ne tiendra pas longtemps dans la place, c’est qu’elle a été réduite à se donner pour leader, chef, un éloquent plébéien, transfuge du libéralisme, mais doué d’une énergique habileté que la vieille aristocratie ne trouvait plus dans ses rangs. Mais tout en combattant sous les ordres de M. Disraëli, l’aristocratie anglaise ne sauvera pas sa forteresse d’une destruction complète, qu’elle ne retarde qu’en en livrant de temps à autre une tourelle à l’ennemi. Ce qui-est, après tout, la vraie politique, la politique de concessions, par laquelle les révolutions sont reléguées aux antipodes. Or, il doit arriver un temps, et il n’est pas loin, où assiégeants et assiégés seront en nombre pareil dans la citadelle. Ce qui sera la fin du privilége et le règne de l’égalité.
Dans le Club de la Réforme, Reform-Club, comme dans le Club Conservateur de Carlton, c’est toujours après the merry conviviality, «la gaie convivialité de la table,» que l’on ouvre les débats politiques. Chaque jour on y déblaye un bout de la route qui mène du mal au bien et du bien au mieux. Bien différents, il est permis de le croire, seraient le caractère et les résultats de ces discussions, si ces grands centres de réunions politiques, au lieu de bonne chère n’avaient à offrir aux orateurs que du café, du Champagne et des liqueurs, même les plus fines et les mieux choisies. Il s’y ferait alors plus de bons mots que de bons speeches, «dis cours,» et la gloriole des orateurs y ferait souvent oublier les affaires du pays.
Il y eut cependant un club qui emprunta son nom au plus tragique événement de l’histoire d’Angleterre. Ce fut le Club de la Tète de Veau, Calf’s head Club; triste allusion à la tète de Charles 1er. Il ne faut pas croire pourtant que ce club eût pour objet spécial la glorification d’une décapitation royale. Les Anglais sont excentriques et mangent à propos de tout. Il leur parut que c’était une joyeuse originalité de dìner en souvenir d’un fait lamentable, mais sans précédent et qui probablement serait sans imitation. Je suis sûr qu’après chaque banquet les clubistes disaient: «Le roi a perdu la tête, vive le roi! et qu’ils chantaient l’hymne, ou comme on dit dans leur pays, l’antienne nationale: God save the King, «Dieu sauve le roi,» puis s’en allaient dormir, purs de toute velléité de régicide.
Nous appuyons ces assertions sur le jugement que les Anglais portent d’eux-mêmes. Un publiciste distingué, Douglas Jerrold, mort il y a quelques années, a dit: «Si demain un tremblement de terre engouffrait l’Angleterre, les Anglais trouveraient moyen de se réunir et dìner ensemble, quelque part au milieu des débris, ne fût-ce que pour célébrer l’événement.»
J’ignore si les membres du Club de la Tête de Veau portaient à leur boutonnière une hache en miniature et un petit billot ou un bouquet de persil ayant pour support les deux burettes d’un huilier. Mais ce qui est sûr, c’est que les membres du Beefsteak-Club portaient au cou, aussi fièrement que si c’eût été un collier de la Toison d’Or, un gril d’or suspendu à un ruban vert. Ce club qui existait encore en 1840, a compté parmi ses membres, Hogarth, Fox, Shéridan, John Kemble, le duc de Norfolk, le duc de Clarence (pas celui qui, sur sa demande, fut noyé dans un tonneau de Malvoisie, terrible excentricité britannico-bachique), lord Brougham, Samuel Rogers, auteur des Plaisirs de la Mémoire, et beaucoup d’autres célébrités.
Les amateurs de fleurs et d’oiseaux ont aussi leurs clubs. Ainsi, il y a le club du Dahlia et de l’OEillet, du Serin et du Bouvreuil, dont les membres sont des artisans, mechanics, et de petits boutiquiers, shopkeepers. Dans ces modestes clubs, comme dans les plus fashionables, on mange, car sans cet appoint nulle somme de plaisirs n’est complète pour le robuste Anglo-Saxon. Seulement, au lieu de rumpsteaks luxueux ou de côtelettes de veau, veal cutlets, mets dispendieux réservés aux fines bouches, on consomme la tranche de pain rôtie et beurrée, toasts, et du fromage de Gloucester; dans les occasions solennelles, comme la distribution des prix aux possesseurs des plus beaux spécimens de fleurs et d’oiseaux, on sert de l’excellent jambon d’York, York ham, et le bon fromage de Chester; le tout en abondante quantité.
Ces innocents passe-temps ont leur humble poésie. Ils reposent l’ouvrier de son travail de la semaine, le marchand des soucis de son petit commerce; ils établissent des rapports d’amitié et de confraternité entre les hommes d’un voisinage qui, autrement, n’auraient aucun motif de se fréquenter.
Mais partout ici-bas le mal est à côté du bien et la joie de l’un cause d’une façon quelconque la tristesse de l’autre. Les femmes se plaignent, non sans raison, de leur solitude sous le toit conjugal, délaissé pour le club par les maris. Les jeunes filles dévorent en silence l’ennui que leur cause l’absence de prétendus, sacrifiant aux charmes des clubs ceux de la grâce et de la beauté. Ce délaissement de la meilleure partie d’eux-mêmes, of their better half, comme on appelle l’épouse en Angleterre, n’est pas toujours sans périls pour les maris. Quant aux mères, surtout celles du grand monde, elles ont plus d’une fois lancé des protestations indignées contre le mauvais goût des jeunes gentlemen qui préfèrent à leurs filles, belles, jeunes et riches, le cigare et le journal, le billard et la partie de piquet des clubs du West-End, quartier de l’aristocratie, situé à l’ouest de la ville de Londres. Il y a cinq ou six ans, les journaux anglais ont publié les lamentations de ces nobles matrones sur la tendance des jeunes hommes du grand monde à l’égoïsme du célibat, et qui est due à la fatale influence des clubs. Que faire, oh! ciel! toute marquise ou comtesse que l’on soit, de cinq ou six grandes filles, — nombre très-ordinaire, en cet heureux pays favorisé de tous les genres d’abondance, — au teint de rose et de neige, aux yeux biens, aux longues chevelures blondes, vivants camellias que le séjour indéfini du toit paternel étiole et que le droit d’aînesse, personnifié dans un frère, verrait sans déplaisir transplantés ailleurs.
Une réaction vengeresse fut naguère tentée par le beau sexe d’Albion, que Shakspeare comparait à un nid de cygnes flottant sur les eaux. Des clubs de femmes se fondèrent. Ayant depuis lors quitté l’Angleterre, j’ignore s’ils ont prospéré ; j’en doute, et ce ne serait pas à désirer. Les attributs naturels des clubs: festins, tabac, cartes et billard, ne sont point à l’usage des femmes. Qu’y feront-elles donc? de la broderie, de la tapisserie ou d’interminables conversations, sans but et sans intérêt. Cela ne vaut pas la peine de s’assembler pendant six ou huit heures. Et puis, pendant ce temps-là, le foyer domestique, le home, serait tout à fait désert et les enfants orphelins la moitié de la journée.
Les clubs anglais, avec leurs avantages et leurs inconvénients, ont-ils chance de jamais s’établir en France? Non; un goût moins prononcé pour la bonne chère et plus vif |pour la société des femmes, surtout à Paris ( goût qui pourtant va s’affaiblissant depuis un quart de siècle ), et l’habitude générale de passer les heures de loisirs au café, ne permettent guère cette innovation.
Peut-être faut-il le regretter pour notre éducation politique; elle se ferait beaucoup mieux dans de tels clubs-restaurants que dans nos cafés où l’on boit, ou l’on ne mange pas, ce qui rend notre patriotisme impatient, irritable, et, disons le mot, trop souvent visionnaire. J’ai mainte fois entendu les Anglais dire que nous sommes un peuple qui aime à se tenir dans de l’eau trop chaude: To keep themselves in hot water. Proverbe qui signifie: se complaire dans le malaise. Pour nous, l’eau chaude, c’est le café, le vieux cognac, le chambertin âgé, le champagne pétillant de jeunesse: toutes choses exquises après le dîner, mais dangereuses avant, pour les têtes qui s’occupent des affaires d’État. M. Cobden, l’illustre chef de la ligue des céréales, anti-corn-law-league, a dit que pour sortir vainqueur de cette grande et patriotique lutte, il s’était condamné à ne boire que de l’eau pendant tout le temps qu’elle a duré. Loin de moi la pensée de proposer ce froid exemple à nos illustrations politiques, qui d’ailleurs ne le suivraient point. Seulement je leur dis avec une conviction profonde et la main sur l’estomac: Messieurs, n’allez à la Chambre qu’après un bon repas.
La Restauration n’était point aimée. Ce nom, à double sens, réveillait en France deux idées fort disparates: les baïonnettes étrangères et le plaisir de bien vivre. La dynastie restaurée s’appliqua habilement à faire oublier le sens irritant du mot par le sens comfortable. Les Tuileries devinrent une abbaye de Thélème, dont bien manger et ne rien faire étaient toute la liturgie. Et dans les hôtels des ministres, quelle chère! quels festins! Béranger les a immortalisés dans ces vers, qui sont encore dans toutes les mémoires et datent de 1825:
Quels dîners! quels dîners!
Les Ministres m’ont donnés;
Dieu! que j’ai fait de bons dîners!
Et malgré cela, cette excellente Restauration, qui vivait si bien, ne put vivre que dix-huit ans! C’est qu’en France les meilleurs dîners doivent être assaisonnés de gloire, et que cette épice était alors au-dessus des moyens des amphitryons qui gouvernaient la France et hébergeaient si plantureusement ses députés.
En Angleterre ils eussent mieux réussi. Cette nation passionnée pour le bien-être préférerait à Alexandre et à César lui-même, le roi d’Yvetot, non parce qu’il chevauchait sur un âne, — les Anglais aiment les beaux chevaux; non parce qu’il avait un palais de chaume, — rien de confortable comme les maisons anglaises; mais parce que ce bon roi faisait chaque jour ses quatre repas et dormait fort bien sans gloire. Si, du temps de ce digne et bon prince, la clémence eût été bannie de la terre, elle se fût réfugiée dans son cœur.
Cette influence de l’alimentation sur le caractère d’un individu n’est pas moins remarquable sur le caractère d’un peuple. Tout en est plus ou moins modifié : facultés physiques et morales, institutions sociales et politiques, efforts et succès. Nulle part plus qu’en Angleterre cette vérité physiologique n’est manifeste. Voici un proverbe anglais qui le prouve: «Le soldat anglais ne se bat bien que lorsqu’il est bien repu; l’Écossais, quand il est à jeun depuis la veille; l’Irlandais, quand il est à demi mort de faim.» Aussi le soldat coûte en Angleterre un tiers de plus qu’en France, un quart de plus qu’en Allemagne, moitié plus qu’en Russie. Quant au poids du corps, il est, en moyenne, de 136 livres pour un Français, de 140 livres pour les Allemands, les Belges et les Russes, et pour les Anglais de 150 livres. On voit que ce sont des braves de poids.
L’impuissance et le découragement de l’armée anglaise, à un certain moment de la guerre de Crimée, prouvèrent une fois de plus que les proverbes sont l’extrait de la sagesse des nations. Le défaut d’abondance et la mauvaise préparation des vivres furent pendant quelque temps pour les fils d’Albion des ennemis plus redoutables que les Russes. Leur bravoure tombait dans le marasme, et la défaite pour eux était imminente. Alarmé de cet état de langueur martiale et culinaire, qui mettait en péril l’honneur des armes britanniques, le Gouvernement dépêcha à la rescousse un cuisinier fameux: c’était M. Soyer, sujet français, auteur d’un livre immortel: La Régénération gastronomique; et, de plus, économiste et musicien distingué, grand connaisseur en tableaux, dont il possédait une galerie, et mari d’une artiste qui en a laissé plusieurs d’un grand prix. Restaurés et ralliés autour du bonnet blanc de ce nouveau chef, les soldats anglais retrouvèrent le chemin de la victoire. Les compatriotes de M. Soyer, que rien n’avait arrêtés sur ce chemin, étaient déjà fort loin, et arrivèrent au but, dit-on, un peu avant leurs frères d’armes d’outre-Manche. Peut-être pensaient-ils que c’était plus original d’aller festoyer dans la tour même de Malakoff.
Dans la sphère pacifique du travail, le bœuf, le porter, la pomme de terre sont aussi, tant par la qualité que par la quantité, une condition essentielle de succès chez nos voisins. Les statistiques parlementaires et les fourneaux toujours fumants des eating-houses «gargotes» démontrent que les ouvriers anglais ont besoin d’une nourriture double de celle des ouvriers des autres pays. Grâce à cette sustentation puissante, ces athlètes réalisent, chaque année, une somme de travaux qui fait la véritable prééminence de leur nation sur tous les marchés du monde.
Si les dieux de l’antiquité étaient encore à la mode, Hercule, Cornus et Plutus, dieux de la force, des festins et de la richesse, seraient les plus fêtés par les Anglais; et à tout prendre, parmi les folies de ce monde, le culte de Comus est peut-être la moins folle. Lord Chesterfield, philosophe aimable et profond, a dit à son fils, dans une de ses lettres qui sont restées un code de sagesse pour les jeunes gens prêts à entrer dans le monde: «Après avoir essayé de tous les plaisirs, j’ai trouvé que celui d’une bonne table est le plus durable, le plus innocent, celui qui dispose le mieux à l’indulgence pour les travers des hommes et à la philosophie contre les maux inséparables de la vie humaine.»