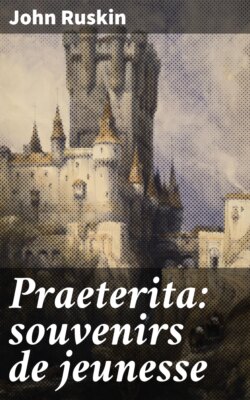Читать книгу Praeterita: souvenirs de jeunesse - John Ruskin - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LES RIVES DE LA TAY
ОглавлениеLE lecteur a remarqué, je l’espère, que, dans mon récit, j’ai surtout insisté sur les circonstances favorables qui ont entouré l’enfant dont j’ai entrepris de raconter l’histoire, et sur la docilité, la tranquillité de son tempérament pourtant très impressionnable.
Je ne lui ai attribué aucun talent, aucun don particulier; car, en réalité, il n’en possédait pas, en dehors de cette patience dans l’observation, de cette précision dans la sensation qui, plus tard, avec le travail, a constitué ma faculté d’analyse. En dehors de ces dispositions, je n’avais aucune de celles qui sont la condition du génie. Ma mémoire n’était que moyenne et je n’ai jamais vu un enfant plus incapable de jouer la comédie, ou de raconter une histoire; d’autre part, je n’en ai jamais connu un dont le goût pour le fait, la chose vue, fût à la fois aussi ardent et aussi méthodique.
Mais je m’aperçois que, dans le récit qui précède, et que j’aurais voulu extrêmement modeste, je me vante assez sottement de mon goût pour la grande littérature comme si elle avait été exclusivement l’objet de mes premières études. J’aurais dû dire que l’Iliade et ce qui était à ma portée dans la Genèse et dans l’Exode ne m’ont guère occupé avant l’âge de dix ans. Ma littérature de lait, si l’on peut dire, n’était pas toujours aussi austère. Je lisais la Dame Wiggins of Lee, The Peacock at Home et autres contes pour les enfants, ou encore le Frank et Harry et Lucy de Miss Edgeworth, ou les Dialogues scientifiques de Joyce. Les premières tentatives, marquant un mouvement quelconque des molécules de mon cerveau, sont six «poèmes» qui m’ont été inspirés par ces lectures; entre le quatrième et le cinquième, ma mère a écrit: janvier 1826. Cet opuscule, commencé au mois de septembre ou d’octobre 1826, a été terminé en janvier 1827. Il était écrit en caractères d’imprimerie: j’étais alors dans ma septième année. Je vois encore le petit cahier rouge réglé en bleu, et ses quarante ou cinquante pages écrites au crayon de chaque côté ; le titre, qui a été assez exactement reproduit à la page 51, était écrit à l’intérieur sur le cartonnage même. Des quatre volumes annoncés, il semble bien (selon une habitude à laquelle je suis resté fidèle jusqu’ici) que je n’en aie écrit qu’un seul. Sur les quarante pages, il y en avait deux consacrées aux «gravures», dont celle qui avait la prétention de représenter la «nouvelle route d’Harry». C’est, je crois, la première fois que j’aie essayé de dessiner une montagne. Le dernier paragraphe de ce premier volume me semble, pour différentes raisons, mériter d’être conservé. Je l’imprime tel que, avec ses interlignes et ses différents caractères.
Quant à la ponctuation, nous la laisserons aux soins du lecteur. Les espaces, on voudra bien le remarquer, étaient destinés à égaliser les lignes, non que l’on y soit jamais arrivé ; et les interlignes inégaux concourent au même effet.
HARRY AND LUCY
FIN
DERNIÈRE PARTIE
DE
PREMIÈRES LEÇONS
en quatre volumes
vol I
avec gravures
IMPRIMÉ et composé par un petit garçon dessiné par lui aussi.
Harry savait très bien ce que c’était et continuait à dessiner mais Lucy l’appela bientôt pour lui montrer un gros nuage noir qui semblait chargé d’électricité. Harry courut chercher un appareil électrique que son père lui avait donné, et le nuage électrisa l’appareil au positif, puis vint un autre nuage qui l’électrisa au négatif, suivi de nuages plus petits; devant ce nuage s’élevait une grosse nuée de poussière qui courait après le nuage positif elle finit par prendre contact avec lui et quand l’autre nuage arriva on vit un éclair traverser la nuée sur laquelle le nuage négatif s’étendait et se dissolvait en pluie ce qui bientôt éclaircit le ciel Le phénomène terminé Harry revenu de sa surprise se demanda comment il pouvait se faire qu’il y eût de l’électricité là où il y avait tant d’eau. Mais il aperçut bientôt un arc-en-ciel et là-dessus montait un brouillard où son imagination lui fit voir la silhouette d’une femme. Il pensa immédiatement à la sorcière des Alpes que l’on évoquait en prenant un peu d’eau dans le creux de la main que l’on répandait en prononçant des paroles inintelligibles 2. Et bien que ce ne fût qu’un conte Harry en fut impressionné lorsqu’il vit dans les nuages une forme qui y ressemblait.
fin de Harry
et Lucy.
Les raisons que j’ai données, et qui m’ont décidé à réimprimer ce morceau qui était trop littéralement une
«composition» sont: la première, que c’est un assez bon échantillon de mon orthographe à l’âge de sept ans; je dis assez bon, car il était rare que je fisse des fautes et qu’ici il y en a deux (takeing et unintelligable) que je ne peux m’expliquer que par la très grande hâte où j’étais de terminer mon volume; la seconde, que l’idée d’utiliser dans mon histoire des matériaux tirés à la fois des Dialogues scientifiques de Joyce et du Manfred de Byron est un exemple excellent du mélange bizarre que présentait mon cerveau et qu’il a conservé ; ce qui fait que les lecteurs sottement entichés de science ont toujours tenu mes livres en suspicion parce qu’ils y rencontraient l’amour du beau, et que les lecteurs sottement épris d’esthétique ne les prenaient pas au sérieux parce qu’ils y rencontraient l’amour de la science; la troisième, enfin, que la méthode de tout point raisonnable, du jugement définitif, au nom de laquelle je demande au lecteur sensé d’excuser ces fragments incohérents, ne peut trouver une meilleure démonstration que dans le fait qu’à sept ans, aucune histoire, si séduisante qu’elle fût, ne pouvait faire d’impression sur Harry, tant qu’il n’avait pas vu — dans les nuages ou ailleurs — quelque chose qui y ressemblât. Des six poèmes, le premier célèbre une machine à vapeur et débute ainsi:
When furious up from mines, the water pours
And clears from rusty moisture all the ores;
et le dernier, sur l’Arcen-ciel, en vers blancs, non rimés en raison de son caractère didactique, est accompagné de réflexions sur l’ignorance et la légèreté de certains individus:
But those that do not know about that light
Reflect not on it; and in all that light
Not one of all the colours do they know.
L’année de mes sept ans accomplie, ma mère joignit une leçon de latin à la lecture de la Bible et régla définitivement les occupations que j’ai énumérées dans le chapitre précédent. Mais, ce qui m’étonne quand j’essaie pour mon propre plaisir, si ce n’est pour celui du lecteur, de mettre ces souvenirs au point, c’est de ne pas me rappeler comment se passait la matinée. Je sais seulement que je déjeunais dans la nursery et que lorsque Bridget, ma cousine de Croydon, était à la maison, nous nous querellions à qui aurait les parties les plus rôties du pain grillé. Ceci même doit être postérieur, car, à l’époque qui nous occupe, je ne devais pas être promu à l’honneur de manger du pain grillé Je n’ai de souvenirs très précis sur les événements de la journée qu’à partir du moment où papa partait pour la Cité. Il prenait la diligence, et ma mère, après avoir rapidement donné ses ordres, m’appelait. Nous commencions nos leçons à neuf heures et demie par la lecture de la Bible, comme je l’ai dit plus haut, après quoi j’apprenais par cœur deux ou trois versets, plus un verset de paraphrase; et encore une déclinaison latine ou un temps de verbe et huit mots du vocabulaire de la grammaire latine d’Adam, la meilleure qu’il y ait jamais eu. Ceci fait, j’étais libre le reste de la journée. Pour l’arithmétique, elle fut salutairement remise à beaucoup plus tard; quant à la géographie, je l’appris très facilement moi-même à ma façon; mes notions d’histoire, je les ai puisées dans les Contes racontés par un grand-père, de Scott. Donc, vers midi, je descendais au jardin quand il faisait beau; quand il pleuvait, je passais le temps comme je pouvais. J’ai déjà parlé des fameux cubes de bois qui, dès que je pus me traîner à quatre pattes, furent mes compagnons de tous les instants; et je suis impardonnable d’avoir oublié à quel généreux ami (je soupçonne fort ma tante de Croydon) je dus, un peu plus tard, un pont à deux arches, impeccable quant aux voussures, aux clefs de voûte, et à l’ajustement de la maçonnerie taillée en biseau et assemblée en queue d’aronde sur le modèle du pont Waterloo. Les cintres très bien faits, et une suite de marches en marqueterie qui descendaient jusqu’à la rivière, faisaient de ce petit modèle quelque chose de vraiment instructif; je ne me lassais pas de le bâtir, de le débâtir (il était trop bien établi pour qu’on pût le jeter bas, il fallait toujours le démonter) et de le rebâtir. Le plaisir que j’avais à faire et à refaire les mêmes choses, à lire et à relire les mêmes livres, a beaucoup contribué à développer cette faculté, qui m’a été si précieuse, d’aller au fond des choses.
Quelques personnes diront certainement que ces joujoux, donnés par hasard, décidèrent de mon goût Pour l’architecture; mais je n’ai jamais entendu parler d’un autre enfant si passionnément épris de ses bois de construction, si ce n’est le Frank de Miss Edgeworth. Il est vrai qu’à l’époque où nous vivons — âge d’universelle briqueterie s’il en fut — on ne donne plus aux enfants pour jouer de modestes morceaux de bois, mais des locomotives; et ces petits êtres sont toujours à prendre des billets, à monter et descendre aux stations sans jamais chercher à s’expliquer le principe du puff-puff! A quoi cela leur servirait-il d’ailleurs, à moins qu’ils ne puissent apprendre en même temps que jamais le principe du puff-puff ne remplacera celui de la vie? Moi, au contraire, avec Harry et Lucy non seulement j’ai compris le système moteur du puff-puff, mais, grâce à mes briques de bois, je connus bientôt les lois de la stabilité en matière de tours et d’arceaux. J’étais aidé dans ces études par le goût passionné que j’avais de voir travailler des ouvriers: je pouvais rester des heures à regarder maçons, briquetiers, tailleurs de pierre, paveurs, quand ma bonne me permettait de m’arrêter pendant nos promenades; j’étais au comble du bonheur si, de la fenêtre de l’auberge ou de l’hôtel, quand nous voyagions, je pouvais voir des ouvriers travailler; la journée dans ce cas ne me paraissait jamais assez longue, je restais là des heures, en extase, et rien ne pouvait me distraire. Le plus souvent, au jardin, quand le temps le permettait, j’observais les habitudes des plantes, sans qu’il me vînt l’idée de les cultiver ou de les soigner; je n’aimais pas plus à m’occuper des fleurs que des oiseaux, des arbres, du ciel ou de la mer, mais je passais des heures à les regarder, à les fouiller. Sans la moindre curiosité morbide, mais avec une admiration étonnée, j’arrachais leurs pétales jusqu’à ce qu’elles m’eussent livré leurs secrets, du moins les secrets qui pouvaient intéresser un enfant; je faisais des collections de graines — elles me tenaient lieu de perles ou de billes — sans qu’il me vînt jamais la pensée de les semer. Un vieux jardinier venait une fois par semaine ratisser les allées, enlever les mauvaises herbes; je n’aurais pas mieux demandé que de l’aider, mais je fus découragé et humilié un jour où, sans rien dire, je le vis revenir sur les endroits déjà nettoyés par moi. Mais ce que j’aimais par-dessus tout, c’était de creuser des trous, forme de jardinage qui, hélas! n’avait pas l’approbation maternelle. Alors, tout naturellement, je retombais dans mes habitudes de contemplation; à neuf ans, je commençai un poème intitulé Eudosia — d’où me venait ce nom, que me représentait-il? — poème sur l’Univers. Une ou deux strophes qui rappellent le début à la fois de mon Deucalion et de ma Proserpine ne seront peut-être pas déplacées au milieu de ces graves souvenirs, d’autant que j’en puis donner la date exacte: 28 septembre 1828. Le «livre premier» commence ainsi:
When first the wrath of heaven o’erwhelmed the world,
And o’er the rocks, and hills, and mountains, hurl’d
The waters’ gathering mass; and sea o‘er shore —
Then mountains fell, and vales, unknown before,
Lay where they were. Far different was the Earth
When first the flood came down, than at its second birth.
Now for its produce! — Queen of flowers, O rose,
From whose fair colored leaves such odor flows,
Thou must now be before thy subjects named,
Both for thy beauty and thy sweetness famed.
Thou art the flower of England, and the flow’r
Of Beauty too — of Venus odrous bower.
And thou wilt often shed sweet odors round,
And often stooping, hide thy head on ground.
And then the lily, towering up so proud,
And raising its gay head among the various crowd,
There the black spots upon a scarlet ground,
And there the taper-pointed leaves are found.
En 220 vers de cette valeur, le premier livre s’élève de la rose au chêne. Le second débute — à ma grande surprise et contrairement à toutes mes habitudes — par une apostrophe extatique à quelque chose que je n’avais jamais vu:
I sing the Pine, which clothes high Switzer’s head,
And high enthroned, grows on a rocky bed,
On gulphs so deep, on cliffs that arc so high,
He that would dare to climb them, dares to die.
Mon enthousiasme ne se soutint pas longtemps; après une description de la descente de l’Alpnach, imitée de Harry et Lucy, en 76 vers, je m’arrête court. A l’autre bout et à l’envers du cahier, je fais observer que le «cristal de roche est entouré d’actinolithe, d’axinite et d’épidote au Bourg d’Oisans en Dauphiné ». Mais les méditations au jardin ne cessèrent pas, et qui pourrait dire si ces heures de rêverie m’ont été profitables ou si ce fut un temps absolument perdu? En tout cas, il ne fut pas perdu pour mon agrément. Le bonheur que j’y trouvais rendait toutes les autres occupations du dehors insipides. Le lecteur pourra bien trouver que ces rêveries improductives eussent pu facilement, si ma mère l’eût voulu, servir de base à de sérieuses connaissances botaniques. Mais s’il y avait alors des livres de géologie et de minéralogie à ma portée, les livres de botanique — et on a fait peu de progrès à cet égard depuis — étaient tous plus ardus encore que la grammaire latine. Je me bornai à la minéralogie et, en fin de compte, je crois que le temps Passé au jardin n’aurait pas pu être mieux employé, si ce n’est peut-être en sarclant les mauvaises herbes.
A six heures, le point sur l’aiguille, je prenais le thé avec mon père et ma mère dans le salon, ou plutôt dans ma niche d’où il m’était défendu de sortir sous aucun prétexte. J’ai déjà parlé de ce petit recoin à côté de la cheminée, bien éclairé par une fenêtre latérale en été, par la lampe de la cheminée en hiver, près du feu, sans en être gêné et à l’abri de tout courant d’air.
Une grande table à écrire, placée devant moi, m’enfermait; on y posait mon assiette, ma tasse, et les livres avec lesquels je m’amusais. Quand il avait pris son thé, mon père faisait la lecture à ma mère, sans se préoccuper de moi. J’écoutais ou je lisais pour mon compte. Mon père nous lut ainsi, et plus d’une fois, toutes les comédies de Shakespeare, ses drames historiques, tout Walter Scott et Don Quichotte, dont il raffolait. J’en riais alors aux larmes; aujourd’hui c’est pour moi un des livres les plus tristes et même, par endroits, les plus choquants. Mon père était un merveilleux lecteur; vers et prose: Shakespeare, Pope, Spenser, Byron et Scott, comme Goldsmith, Addison et Johnson. Pour la poésie plus légère, il manquait peut-être de la finesse d’oreille, de la subtilité nécessaire; mais le sentiment qu’il avait de la vigueur et de la sagesse d’une expression juste, de la puissance des syllabes bien ordonnancées, donnait a sa manière de lire Hamlet, Lear, Cœsar ou Marmion une justesse et une grandeur harmonieuses; il n’avait, par contre, aucune idée de la manière dont on doit moduler le refrain d’une ballade, et la préciosité des sentiments exprimés l’agaçait. Ce qu’il aimait avant tout, dans les œuvres, c’était la volonté, une volonté héroïque et une haute raison; il ne tolérait pas l’amour morbide de la souffrance et n’aurait jamais lu pour son plaisir ou pour mon instruction des ballades comme Burd Helen, les Twa Corbies ou autres poèmes ou contes dont tout l’intérêt repose sur un amour sans espoir ou une mort stérile.
Mais une pure et noble douleur vint bientôt mêler sa note grave aux accents joyeux de ces jours de bonheur; musique suave, magnifique comme un beau chant de cathédrale. Ceci m’oblige à revenir en arrière, à parler de choses qui m’ont été contées et dont cependant certaines sont aussi précises que si je les avais vues de mes yeux.
C’est aux environs de 1780 que ma grand’mère, Catherine Tweedale, se fit enlever par mon grand-père paternel; elle n’avait pas encore seize ans; ma tante Jessie, l’unique sœur de mon père, était née l’année suivante. Quelques semaines après cet événement, un ami entrant à l’improviste dans la chambre de ma grand’mère l’avait surprise dansant le branle à trois avec deux chaises comme partenaires, n’ayant pas, sur l’heure, trouvé d’autre moyen d’exprimer qu’elle trouvait la vie délicieuse et toute pleine de bénédictions et de promesses.
Elles ne se réalisèrent pas toutes par la suite; ma tante Jessie, une délicieuse créature, aux yeux noirs, les beaux yeux des Highlands, profondément pieuse, douce et résignée (le Destin, hélas! lui fut souvent contraire) épousa un tanneur de Perth quelque peu rude, mais dont les affaires étaient assez prospères. Lorsque je les vis pour la première fois, ma tante et mon oncle le tanneur habitaient une maison carrée, en pierre grise, dans un faubourg de Perth non loin du pont; le jardin descendait en pente rapide jusqu’à la Tay qui tourbillonnait, profonde et claire, autour des marches où les servantes venaient remplir leurs seaux.
Un de mes correspondants abusé s’est plaint dans Fors de la mauvaise habitude que j’avais de railler les gens qui n’ont point d’ancêtres. Je proteste là contre, bien que je me sente, il est vrai, toujours un peu gêné quand j’ai à parler de mon oncle le boulanger ou de mon oncle le tanneur. Mes lecteurs peuvent m’en croire quand j’affirme — évoquant aujourd’hui les rêves faits jadis sous le toit de l’honnête boulanger de Market Street à Croydon, ou chez Pierre, et non Simon, le tanneur, dans la petite maison du bord de la rivière — que je n’échangerais pas ces rêves et encore moins les tendres réalités de ces jours de mon enfance pour ceux des plus beaux seigneurs ou des plus grandes dames ayant pour théâtres des halls somptueux, de beaux gazons, des lacs, au milieu de parcs ombreux et profonds comme des forêts.
Les belles pelouses, les lacs ne manquaient pas dans le North-Inch de Perth, et les remous de la Tay s’attardant devant Rose Terrace faisaient mes délices; c’est là que nous habitions (après la mort de mon oncle, enlevé rapidement par une attaque d’apoplexie) dans le calme des beaux jours d’été écossais avec ma tante devenue veuve et ma petite cousine Jessie, l’heureuse petite Jessie de six, sept, huit et neuf ans, la petite Jessie aux yeux de velours noir, profondément noirs.
Jessie avait non seulement les yeux de sa mère, elle avait sa piété ; et le dimanche soir, elle et moi, nous passions une sorte d’examen sur les Écritures. C’était à qui répondrait le mieux et nous étions fiers comme des paons, quand les frères aînés de Jessie et sa sœur Marie étaient «recalés», et que Jessie ou moi étions «dux», ce qui arrivait presque toujours. Nous avions décidé de nous marier... dès que nous serions un peu plus âgés, il ne nous venait pas à l’idée de dire plus raisonnables.
Le hasard avait voulu que la bonne à tout faire dans la maison de Rose Terrace fût une très vieille «Mause» qui avait été servante chez mon grand-père à Edimbourg, un vrai type, le portrait frappant de la Mause des Puritains d’Écosse, avec peut-être une foi plus patiente encore, plus solennelle et plus intrépide; foi passée au crible, de souffrances sans nom; car Mause avait cruellement souffert dans sa jeunesse, souffert de la faim, au point de ramasser des croûtes de pain et des os dans les tas d’ordures. Aussi, pour elle, voir gâcher le plus petit atome de nourriture, c’était un crime impardonnable, comparable au blasphème. «Oh, Miss Margaret! s’écria-t-elle avec indignation en voyant ma mère jeter par la fenêtre quelques miettes de pain restées sur une assiette, j’aimerais mieux recevoir un coup de poing!» Elle faisait son dîner de tout ce que les autres servantes laissaient, souvent de pelures de pommes de terre, ayant donné son propre repas au premier pauvre venu; et elle restait debout pendant tout l’office — bien qu’âgée d’au moins soixante-dix ans et très faible quand je la connus — lorsqu’elle avait pu décider quelque dévoyé, rencontré dans la rue, à prendre sa place à l’église. Peut-être sa vieille figure parcheminée — figée dans une expression de résolution et de patience, qui ne savait pas sourire, et dont le sourcil froncé nous faisait trembler, Jessie et moi, lorsque nous osions redemander de la crème pour notre porridge, ou que, le dimanche, nous faisions trop de bruit — est-elle en partie responsable de mon tant soit peu de prévention contre la religion évangélique, prévention dont on retrouve la trace, je l’avoue, dans mes derniers ouvrages; mais je ne pourrai jamais être assez reconnaissant envers la Providence d’avoir pu voir dans notre
«vieille Mause» l’esprit puritain écossais dans toute sa foi et toute sa vigueur, et d’avoir été par conséquent à même de tracer l’action de cet esprit dans la politique réformatrice de l’Église avec le respect et l’honneur qui lui sont dus.
Ma tante, vraie prêtresse de Dodone dans les Highlands, si tant est qu’il y en ait jamais eu, était de nature infiniment plus douce; néanmoins, je n’osais l’approcher qu’à distance respectueuse. Elle ne s’était jamais consolée de la mort de trois petits enfants qu’elle avait perdus. Le petit Pierre, surtout, était la pierre angulaire de son édifice, l’amour sur lequel s’échafaudaient toutes ses autres tendresses. Il lui avait été enlevé si rapidement, d’une tumeur blanche au genou! L’enfant souffrait beaucoup, et il allait toujours s’affaiblissant, mais il restait obéissant, tendre et doux. Un jour que sa mère voulait lui faire prendre quelques gouttes de porto et qu’elle l’avait pris sur ses genoux, comme elle approchait le verre de ses lèvres: «Pas maintenant, maman, fit-il, dans une minute,» et, appuyant sa tête sur l’épaule maternelle, il avait poussé un grand soupir et était mort. Puis ç’avait été le tour de Catherine; et celui de..... j’oublie le nom de l’autre petite fille; je ne les ai connues ni l’une ni l’autre, mais ma mère m’en a souvent parlé ; Catherine était sa préférée. Un soir que ma tante, après une conversation sérieuse avec son mari sur l’éducation de leurs deux enfants, s’était couchée, elle fut quelque temps avant de pouvoir s’endormir et, comme elle s’agitait dans son lit, elle vit tout à coup la porte de sa chambre s’ouvrir et deux bêches entrer et se poser au pied de son lit. Les deux enfants mouraient quelques jours plus tard; je dis quelques jours, car je ne suis pas sûr de me rappeler exactement les paroles de ma mère.
A l’époque où nous allions à Perth, il y avait encore Marie, la fille aînée, qui était chargée de surveiller les enfants quand la vieille Mause était trop occupée; James, John, William et Andrew (je ne sais plus qui était le parrain de William, le seul des garçons qui n’eût pas un nom d’apôtre). Ils étaient d’ailleurs tous au collège ou à l’Université. William et Andrew, quand ils étaient à la maison, ne songeaient qu’à nous taquiner, Jessie et moi, et ils mangeaient les plus belles poires. Quant aux grands, on ne les voyait jamais. Les petites filles et moi nous nous amusions à notre manière, qui était toujours tranquille, soit dans le North Inch, soit sur les bords du Lead, un bras de la Tay qui, passant devant Rose Terrace, faisait tourner un moulin, et que, depuis, on a comblé. Alors, il était délicieux et ses eaux cristallines étaient un trésor de diamants, pour nous autres enfants. Mary avait alors près de douze ans; c’était une blonde aux yeux bleus, presque jolie; sa piété très fervente n’était point aussi agissante que celle de Jessie.
Mon père, le plus souvent, profitait de notre séjour à Perth pour faire des excursions en Écosse et, chose étrange, ma mère elle-même n’était plus à Rose Terrace qu’un personnage de second plan. Je ne m’explique pas pourquoi elle sortait si peu avec nous; elle et ma tante conservaient, en dépit de tout, leurs habitudes retirées. Mary, Jessie et moi avions la permission de faire tout ce que nous voulions dans le North Inch; je ne travaillais pas pendant ces séjours à Perth, en dehors des concours pieux du dimanche.
Si le hasard avait voulu qu’il se fût trouvé là quelqu’un en état de me donner des notions de botanique ou de minéralogie, quelle chance c’eût été pour moi; mais les choses étant ce qu’elles étaient, je passais mes journées un peu comme les chardons et les tanaisies du rivage, à regarder l’eau courir; d’étranges inquiétudes me venaient, devant les remous de la Tay, où l’eau passait du brun au bleu presque noir, et devant les précipices de Kinnoull; horreur sacrée créée en partie par mon imagination, mais aussi par les airs mystérieux que prenaient les servantes quand nous gravissions le chemin de Kinnoull et que je voulais rester en arrière, pour regarder la petite source de cristal de Bower’s Well.
«Vous dites pourtant que vous n’aviez peur de rien», m’écrit un ami qui s’inquiète, et qui ne voudrait pas que la véracité de ces souvenirs pût être mise en doute. En effet, j’ai dit que je n’avais peur ni des revenants, ni du tonnerre, ni des animaux, entendant par là les choses qui habituellement font la terreur des enfants. Mais chaque jour, la vie m’apprenait qu’il est raisonnable d’avoir peur; sans cela, comment aurais-je pu, dans les pages qui précèdent, me présenter comme la personne la plus sensée que je connaisse? C’est ainsi que jamais il ne m’est arrivé, même en ces années d’insouciance funeste, de passer sans ressentir quelque émoi devant les tourbillons noirs, que ne trouble aucun flocon d’écume, où la Tay se recueille, semblable à Méduse, et je ne dis pas non plus que je me promènerais dans un cimetière la nuit (ni même le jour) comme si ses pierres tumulaires n’étaient que des pavés mis debout. Tout au contraire. Mais il est très important, afin que le lecteur n’ait aucune inquiétude au sujet de certains de mes écrits qui ont paru extra-sensitifs et émotifs, qu’il sache bien que je n’ai jamais été sujet à me créer des fantômes, à me faire des illusions, peut-être devrais-je dire avec regret que je n’en ai jamais été capable et que je n’ai jamais été sujet non plus à avoir les nerfs ébranlés par la surprise. Lorsque j’avais cinq ans, nous avions à Herne-Hill un gros terre-neuve que j’aimais beaucoup. Revenant de voyage, un été, ma première pensée fut de courir dire bonjour à Lion. Ma mère me laissa aller à l’écurie avec notre unique domestique mâle, Thomas, lui recommandant bien de ne pas me laisser approcher du chien qui était à la chaîne. Thomas, pour plus de sûreté, me prit dans ses bras. Lion, qui mangeait sa pâtée, ne fit pas la moindre attention à nous; je demandai alors la permission de le caresser. Cet imbécile de Thomas se baissa pour que je pusse toucher le chien qui se jeta sur moi, m’enlevant un morceau de la lèvre. On me remonta par l’escalier de service, saignant abondamment mais nullement effrayé, et n’ayant qu’une crainte, c’est qu’on ne se débarrassât de Lion. Il fallut en effet s’en séparer, mais ma mère ne renvoya pas Thomas, elle lui pardonna car elle savait à quel point il regrettait sa maladresse qu’elle se trouvait d’ailleurs seule à blâmer dans la circonstance. La morsure du chien a laissé une trace qui ne s’est jamais effacée, déformant la bouche (alors réellement jolie), mais la blessure fut vite cicatrisée. Je me souviens que les derniers mots que je prononçai, avant d’être réduit par le Dr Aveline à un silence qui devait durer quelques jours, furent ceux-ci: «Maman, si je ne peux pas parler, je peux jouer du violon». On ne fut pas de cet avis à la maison, et je ne fis aucun progrès sur cet instrument, digne pourtant de mon génie. Cet accident ne diminua en rien mon amour pour les chiens, et jamais ils ne m’inspirèrent la moindre crainte.
Je ne sais si je courus un vrai danger dans cette même écurie un jour où, me trouvant seul, je tombai la tête la première dans une grande cuve pleine d’eau qui servait à l’arrosage du jardin; j’aurais été en assez mauvaise posture si je ne m’étais servi du petit arrosoir que je tenais à la main pour toucher le fond et me donner un bon élan; après quoi, de la main gauche, je saisis le bord de la cuve. Cet exploit me valut, après coup, de grands éloges; on vanta ma présence d’esprit, ma décision. En songeant aux rares occasions où j’ai eu à faire preuve de sang-froid, je constate que j’ai toujours trouvé ma tête lucide quand j’en ai eu besoin, et que je suis beaucoup plus exposé à me laisser troubler par un accès d’admiration soudain que par un danger imprévu.
Les sombres profondeurs de la Tay, point de départ de ce petit accès de vantardise, se trouvaient sous la rive escarpée, à l’extrémité du North-Inch. Nous prenions rarement le sentier qui les côtoie, si ce n’est au temps de la moisson, quand, pour nous amuser, nous allions glaner dans les champs. Au retour, Jessie et moi nous écrasions le grain des épis dans le moulin à poivre de la cuisine et nous en faisions des gâteaux au poivre qui n’auraient certainement pas trouvé d’acheteurs.
Si minutieux que puissent paraître ces détails, je m’élève avec toute l’indignation que permettent les bonnes manières contre l’imputation de partialité pour ces souvenirs. Ils ne me plaisent pas seulement parce qu’ils sont de ma jeunesse. Cependant, j’hésite à enregistrer comme une vérité établie l’impression que je garde de mes courses à travers champs avec Jessie à la suite des glaneurs: à savoir que les gerbes d’Écosse sont plus dorées que celles de tous les autres pays du monde et qu’il n’y a nulle part des moissons qui font plus songer au «froment du Ciel1» que celles de Strath-Tay et de Strath-Earn.