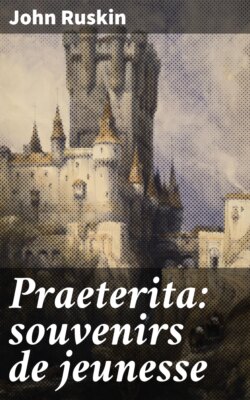Читать книгу Praeterita: souvenirs de jeunesse - John Ruskin - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LES SOURCES DE LA WANDEL
ОглавлениеJE suis, et mon père le fut avant moi, un enragé tory de la vieille école; j’entends de l’école de Walter Scott et d’Homère. Si je cite ces deux noms entre tant de grands écrivains tories, c’est que je les aime particulièrement, qu’ils ont été mes maîtres. Je lisais les romans de Walter Scott et l’Iliade, traduction Pope, d’un bout de la semaine à l’autre, quand j’étais enfant; le dimanche, par contre, c’était Robinson Crusoë et le Pilgrim’s Progress, ma mère ayant décidé dans son cœur de faire de moi un clergyman «évangélique». Fort heureusement, j’avais une tante, encore plus évangélique que ma mère, qui me faisait manger du gigot froid le dimanche, et je ne l’aimais que chaud. Ce gigot froid a fait le plus grand tort aux idées du Pilgrim’s Progress. Et voilà pourquoi, en fin de compte, tout en m’appropriant le noble et poétique enseignement de Defoe et de Bunyan, je ne suis pas devenu un clergyman évangélique.
Je recevais encore un meilleur enseignement, que j’y fusse disposé ou non, tous les jours de la semaine.
Walter Scott et Homère, c’était les lectures de mon choix; en même temps, ma mère m’obligeait à apprendre par cœur de longs chapitres de la Bible. De plus, il me fallait lire à haute voix, en prononçant chaque syllabe et en articulant les noms les plus rébarbatifs, le Livre Sacré, depuis la Genèse jusqu’à l’Apocalypse, au moins une fois l’an. C’est à cette discipline — patiente, très exacte et très ferme — que je dois non seulement une connaissance de la Bible qui m’a souvent été précieuse, mais la faculté que j’ai de me donner de la peine, et aussi le meilleur de mon goût en littérature. Des romans de Walter Scott, j’eusse pu facilement, à mesure que j’avançais en âge, tomber à d’autres romans; et Pope aurait pu m’amener à prendre l’anglais de Johnson ou de Gibbon comme type; mais quand j’eus appris par cœur, non seulement le trente-deuxième chapitre du Deutéronome, le CXVIIIe psaume, le XVe chap. de la Ire aux Corinthiens, le Sermon sur la Montagne et la plus grande partie de l’Apocalypse, comme j’ai toujours aimé à me rendre compte par moi-même de ce que les mots veulent dire, il ne m’a plus été possible, même aux jours de ma plus folle jeunesse, d’écrire un anglais tout à fait de surface ou de convention. Tout au plus aurais-je pu tomber dans l’innocente manie de pasticher le style de Hooker ou de George Herbert.
C’est donc à mes maîtres préférés, Scott et Homère, que je dois mon toryisme, toryisme que toutes mes observations ultérieures et mon expérience n’ont servi qu’à confirmer. J’entends parla un amour sincère pour les rois et une horreur instinctive pour quiconque tentait de leur désobéir. Il est vrai qu’Homère et Scott me donnaient d’étranges idées sur les rois, idées qui sont fort démodées à l’heure actuelle; car il est bon de remarquer que l’auteur de l’Iliade aussi bien que celui de Waverley exigent de leurs rois et de leurs partisans les tâches les plus héroïques. Tydée ou Idoménée tuaient vingt Troyens pour un, et Redgauntlet harponnait plus de saumons qu’aucun des pêcheurs du Solway; qui plus est — et cela me remplissait d’admiration — non seulement ils accomplissaient plus de hauts faits que les autres hommes, mais, toute proportion gardée, ils en tiraient infiniment moins de profit; que dis-je, les meilleurs d’entre eux étaient prêts à gouverner pour rien, laissant à leurs partisans le soin de se partager le butin. A l’heure actuelle, il me semble que l’idée de roi a changé et que le devoir des hauts personnages a paru être en général de gouverner moins et d’en tirer plus d’avantages. Si bien qu’il est fort heureux, pour mes convictions, qu’au temps de ma jeunesse je n’aie pu contempler la royauté que de loin.
La tante qui me faisait manger du gigot froid le dimanche était une sœur de mon père; elle habitait Bridge-end, dans la petite ville de Perth, et avait un jardin plein de groseilliers à maquereau qui descendait en pente jusqu’à la Tay; une petite porte ouvrait sur la rivière qui courait vive et claire. Le courant rapide, les remous, les tourbillons, quel monde infini, quel spectacle pour un enfant!
Mon père avait débuté dans le commerce des vins, sans capitaux et avec un stock considérable de dettes que lui avait légué mon grand-père. Il accepta la succession et paya ce qui était dû, jusqu’au dernier sou, avant de songer à rien mettre de côté, ce qui le fit traiter d’imbécile par ses meilleurs amis. Pour moi, sans porter un jugement sur ses idées que je savais en telles matières être au moins aussi strictes que les miennes, j’ai fait graver sur la plaque de granit de son tombeau qu’il fut «un marchand intègre». Plus tard, il se trouva en situation de louer une maison dans Hunter Street, Brunswick Square, dont les fenêtres, fort heureusement pour moi, donnaient sur un étonnant poste d’eau où les tonneaux d’arrosage venaient se remplir. Le nez collé aux vitres, je voyais de merveilleuses petites trappes se soulever pour donner passage à des tuyaux qui avaient des airs étranges de boas constrictors; je n’étais jamais las de contempler ce mystère et le délicieux ruissellement qui en résultait. Les années passant, je pouvais avoir alors quatre à cinq ans, mon père put se donner le luxe, pendant les deux mois d’été, d’une chaise de poste à deux chevaux pour faire la tournée chez ceux de ses clients qui habitaient la campagne, ce qui était pour ma mère et moi l’occasion d’un délicieux petit voyage. C’est ainsi, au petit trot, par les quatre fenêtres de la voiture qui encadraient le paysage à la façon d’un panorama, perché sur une petite banquette en avant (car, louant la chaise pour deux mois, nous la faisions agencer et organiser à notre gré), que j e vis les grandes routes et même la plupart des routes transversales de l’Angleterre, du Pays de Galles, la plus grande partie des lowlands d’Écosse, jusqu’à Perth où, tous les deux ans, nous passions l’été. Je lisais l’Abbé à Kinross, le Monastère à Glen Farg, que je confondais avec «Glendearg», et j’étais aussi sûr que la Dame Blanche avait vécu sur les bords du petit ruisseau de la vallée des Ochils, que la reine d’Écosse dans l’île de Loch Leven.
C’est ainsi que, pour mon plus grand profit, pendant toute mon enfance et ma jeunesse, je visitai les plus beaux châteaux de l’Angleterre. Ces magnifiques demeures m’inspiraient un respect, une admiration où il aurait été impossible de relever la plus légère trace d’envie. Je m’aperçus très vite, dès que je fus en âge de faire des observations philosophiques, qu’il était infiniment préférable d’habiter une modeste petite maison et d’avoir la joie de visiter Warwick et de l’admirer, que d’habiter Warwick et de ne s’étonner de rien; en tous cas, que Brunswick Square ne serait en rien plus agréable à habiter, si l’on démolissait le château de Warwick.
A l’heure actuelle, bien que j’aie reçu les plus aimables invitations de venir visiter l’Amérique, il me serait impossible, fût-ce pour deux ou trois mois, de vivre dans un pays assez malheureux pour ne pas posséder de châteaux.
Quoi qu’il en soit, toutes mes idées sur la royauté me venant surtout du Fitz James de la Dame du Lac, et mes idées sur la noblesse du Douglas de la même Dame ou du Douglas de Marmion, un étonnement pénible envahit mon cerveau d’enfant lorsque je dus constater que, de nos jours, les châteaux étaient toujours inhabités. Tantallon était toujours debout, mais d’Archibald d’Angus, point. Stirling n’avait pas changé, mais on n’y rencontrait pas de chevalier de Snowdoun. Les galeries, les parcs d’Angleterre étaient admirables, mais Sa Seigneurie, Mme la Duchesse, toujours en ville; c’était du moins la réponse invariable des jardiniers ou des femmes de charge. Alors, je faisais des vœux passionnés pour une «Restauration», une vraie «Restauration », car je sentais vaguement que la tentative de Charles II, ce n’était pas cela, bien que je portasse pieusement, le 29 mai, une pomme de chêne dorée à ma boutonnière. La Restauration de Charles II, pour moi, comparée à la Restauration de mes rêves, était ce que la pomme de chêne dorée était à une vraie pomme. Avec les années, la raison aidant, l’envie de manger de bonnes reinettes bien sucrées plutôt que des pommes âcres et de voir des rois vivants plutôt que des rois morts m’apparut comme aussi raisonnable que romantique; et depuis, le principal objectif de ma vie a toujours été de cultiver des reinettes, et mon espérance la plus chère, de voir des rois.
J’ai eu beau chercher, il m’a été impossible de donner à ces idées, ou préjugés, une origine aristocratique; car je ne sais rien de mes aïeux, soit du côté de mon père, soit du côté de ma mère, si ce n’est que ma grand’mère maternelle était la propriétaire de la «Tête du Vieux Roi», dans la rue du Marché à Croydon; que n’est-elle encore de ce monde, et que ne puis-je lui peindre, comme enseigne, la tête de Roi de Simone Memmi!
Mon grand-père maternel, je l’ai déjà dit, était marin et il avait coutume de s’embarquer à Yarmouth, comme Robinson Crusoë ; il ne revenait que de loin en loin à la maison où il ramenait la gaieté et la joie. J’ai quelque idée qu’il était «dans les harengs» comme mon père était «dans les vins», mais je ne sais rien de positif à cet égard, ma mère se montrant toujours très réservée à ce sujet. Il gâtait ma mère ainsi que sa cadette, autant qu’il était possible. Seule, la moindre dissimulation — que dis-je? — la moindre exagération ne trouvait pas grâce devant lui. Un jour qu’il avait pris ma mère en flagrant délit de mensonge, il envoya sur l’heure la servante acheter toute une poignée de ramilles neuves afin de la fustiger. «Cela ne me fit pas aussi mal que s’il m’avait fouettée avec une seule baguette, dit ma mère, mais cela me donna beaucoup à réfléchir».
Mon grand-père mourut à trente-deux ans pour avoir voulu entrer à Croydon à cheval plutôt qu’à pied. Il eut la jambe écrasée contre le mur; la blessure s’étant envenimée, il en mourut. Ma mère avait alors sept ou huit ans, elle allait chez Mrs Rice qui tenait un externat assez fashionable pour Croydon. Elle y fut élevée dans les principes évangéliques et devint une petite fille modèle; tandis que ma tante, que les principes évangéliques faisaient cabrer, fut bientôt à la fois l’enfant terrible et l’enfant gâté de la maison.
Ma mère, qui avait beaucoup de moyens et une bonne dose d’amour-propre, devenait tous les jours plus parfaite, sans se laisser intimider par les railleries de sa cadette, qui pourtant l’adorait. Cette petite sœur avait beaucoup plus d’esprit, infiniment moins d’orgueil et pas de sens moral. Lorsque ma mère fut devenue une ménagère accomplie, on l’envoya en Écosse pour diriger la maison de mon grand-père paternel. Celui-ci était alors fort occupé à se ruiner; il ne tarda pas à y parvenir et finit par en mourir. C’est alors que mon père partit pour Londres; il trouva un emploi dans une grande maison de commerce où, pendant neuf ans, il travailla sans prendre un seul jour de congé ; au bout de ce temps, il commença les affaires à son compte, paya les dettes de son père et épousa sa perfection de cousine.
L’autre petite cousine, ma tante, qui était restée à Croydon, avait épousé un boulanger. Lorsque j’eus quatre ans — époque où mes souvenirs commencent à se préciser — la situation commerciale de mon père à Londres prenant tous les jours plus d’importance, on eût pu constater un léger, oh! très léger embarras et tout à fait inexplicable pour moi comme enfant, entre notre maison de Brunswick Square et la boulangerie de la rue du Marché à Croydon. Ce qui n’empêchait pas que chaque fois que mon père était malade — et les soucis et le travail l’avaient déjà durement marqué de leur empreinte — nous nous en allions tous à Croydon pour nous faire gâter par la bonne petite tante, et courir sur la colline de Duppas et dans les bruyères d’Addington.
Ma tante habitait une petite maison qui passe encore pour la plus belle de la rue du Marché, avec deux fenêtres au second au-dessus de la boutique; ce qui se passait dans ces régions supérieures m’inquiétait peu, à moins que mon père n’y fût occupé à faire quelque dessin à l’encre de Chine, auquel cas je m’asseyais près de lui et je le regardais faire dévotement; mais ce que je préférais par-dessus tout, c’était la boutique; le fournil et les pierres qui entouraient la petite source de cristal (depuis longtemps, hélas! engloutie par l’égout moderne); mon plus cher compagnon était le chien de ma tante, Towzer, qu’elle avait recueilli par pitié, transformant la pauvre bête errante, hargneuse et affamée, en un brave et bon chien plein de cœur: procédé dont elle usa toute sa vie à l’égard de tous les êtres vivants qu’elle croisa sur sa route.
Pleinement satisfait d’avoir de loin en loin une vision des rivières du Paradis, je vécus jusqu’à plus de quatre ans sans quitter pour ainsi dire Hunter Street; l’été, et seulement pendant quelques semaines, nous louions des chambres meublées dans de petits cottages à la campagne (de vrais cottages, non des villas baptisées du nom de chaumières), soit aux environs d’Hampstead, soit à Dulwich, chez «Mrs Ridley», la dernière maison au bout du petit chemin bordé de haies qui conduit aux plaines de Dulwich, et qui lui-même était tout fleuri de boutons d’or au printemps et tout noir de mûres à l’automne. Mais les souvenirs les plus précis qui me soient restés de cette époque sont ceux qui se rapportent à Hunter Street.
Le grand principe d’éducation de ma mère, c’était, grâce à une étroite surveillance, de me préserver autant que possible de tout mal et de tout danger; ceci admis, je pouvais m’amuser à ma guise, à condition de n’être ni de mauvaise humeur, ni ennuyeux. La règle établie voulait qu’on ne s’occupât pas de m’amuser; à moi de trouver des jeux: les joujoux même étaient d’abord défendus; et la commisération qu’excitait, chez ma tante de Croydon, mon dénuement monastique à cet égard était sans borne. A l’occasion de mon jour de naissance, une fois, pensant faire revenir ma mère sur sa détermination grâce à la splendeur du cadeau, elle m’avait acheté le plus beau polichinelle qu’elle eût pu trouver au bazar: un Polichinelle et une mère Gigogne presque aussi grandsque nature, vêtus d’écarlate et d’or, et qui gesticulaient quand on les attachait au pied d’une chaise. Ces pantins m’ont fait une grande impression; je les vois encore, tandis que ma tante les faisait danser devant moi. Ma mère ne dit rien d’abord — qu’aurait-elle pu dire? — mais, quelques heures plus tard, tranquillement, elle déclara qu’elle ne trouvait pas bon que j’eusse ces joujoux; et je ne les ai jamais revus.
Je jouais d’ordinaire avec un trousseau de clefs, du moins tant que je trouvai plaisir à regarder ce qui brille et à faire tinter ce qui sonne; plus tard, j’eus une petite charrette et une balle; vers cinq ou six ans, on me donna deux boîtes de morceaux de bois, bien lisses et bien taillés. Avec ces modestes trésors, qu’à l’heure actuelle je considère encore comme absolument suffisants, d’ailleurs fouetté immédiatement dès que je pleurais, que je désobéissais ou que je tombais dans l’escalier, je ne tardai pas à me créer de sûres et sereines méthodes de vie et de mouvement. Je pouvais m’amuser toute la journée à suivre le dessin et à comparer les nuances de mon tapis, à examiner tous les nœuds du parquet; un autre divertissement était de compter les briques des maisons d’en face; et je ne parle pas des intermèdes passionnants que me procurait le remplissage du tonneau d’arrosage au moyen de son serpent de cuir fixé à la colonne ruisselante de la pompe, ou le procédé plus admirable encore par lequel le cantonnier ouvrait avec sa grande clef de fer le robinet et faisait jaillir un immense jet d’eau au milieu de la rue. Mais le tapis, et les dessins de toutes sortes des rideaux, couvre-lits, papiers de tenture, étaient mes plus précieuses ressources; l’intérêt qu’ils m’inspiraient était tel que, lorsqu’on me conduisit chez MrNorthcote qui devait faire mon portrait — je pouvais avoir trois ans ou trois ans et demi — je n’étais pas avec lui depuis dix minutes que je m’intéressais déjà à son tapis et que je lui demandais pourquoi il avait des trous. Le portrait en question représente un joli enfant aux cheveux blonds, en robe blanche, une robe de petite fille, avec une large ceinture bleu de ciel, et des souliers du même bleu, qui n’étaient pas moins larges pour les pieds que la robe pour le corps.
On avait envoyé au vieux peintre tous les objets de ma toilette, afin qu’il n’y eût rien de laissé au hasard; mais s’ils étaient à leur place dans la nursery, ils étonnaient dans un portrait où je suis représenté courant dans un champ sur la lisière d’une forêt. Les troncs des arbres coupent transversalement le fond du tableau à la manière de Sir Joshua Reynolds, tandis que deux collines rondes, du même bleu que les souliers, s’élèvent à l’horizon. C’est sur ma demande que Northcote avait mis ces collines; j’avais déjà été une fois, peut-être deux fois en Écosse; ma bonne, une Écossaise, me chantait lorsque nous approchions de la Tweed ou de l’Esk:
For Scotland, my darling, lies full in thy view,
With her barefooted lassies, and mountains so blue .
Et l’idée de collines dans un lointain bleu s’associait dans mon esprit aux plus pures joies de la vie, c’est-à-dire au jardin de ma tante, le jardin plein de groseilliers qui descendait en pente jusqu’à la Tay. Mais le simple fait que j’eusse répondu au vieux Mr Northcote me demandant ce que j’aimerais qu’il peignît comme fond à mon portrait (et j’imagine qu’il dut être fort étonné de la netteté de ma réponse), le simple fait que j’eusse répondu: «des collines bleues», et non des groseilliers, me paraît — sans qu’il y ait là, je crois, aucune tendance morbide à faire trop de cas de ma personnalité — suffisamment curieux et plein de promesses de la part d’un enfant de l’âge que j’avais alors.
J’ajouterai qu’ayant été, ainsi que je l’ai dit déjà, régulièrement fouetté toutes les fois que je me rendais insupportable, l’habitude que j’avais prise de rester parfaitement tranquille enchantait le vieux peintre; je pouvais en effet passer des heures immobile à compter les trous du tapis ou à le regarder presser ses tubes, opération qui me remplissait d’admiration; mais si j’aimais à voir étaler les couleurs sur la palette, je ne me souviens pas de m’être le moins du monde intéressé à la manière dont Mr Northcote les posait sur la toile; mes idées sur l’art et les joies qu’il pouvait procurer étaient alors indissolublement liées à la possession d’un immense pot de peinture du plus beau vert et à un gros pinceau qui en sortait tout ruisselant. Ma tranquillité faisait donc les délices du vieux peintre; aussi supplia-t-il mon père et ma mère de permettre que je posasse pour un de ses tableaux. Je représentais un enfant étendu sur une peau de léopard, tandis qu’un homme des bois lui enlevait une épine qu’il s’était enfoncée dans le pied.
Jusqu’ici les méthodes de mon éducation aussi bien que les circonstances ne pouvaient guère, il me semble, être plus favorables, étant donné un enfant de mon tempérament; mais la manière dont je fis mes débuts dans les lettres me paraît très contestable, et je n’introduirai pas cette méthode dans les écoles de Saint-George sans y apporter de grandes modifications. Je me refusais absolument à apprendre à lire en séparant les syllabes, tandis que j’apprenais facilement des phrases entières par cœur, montrant avec mon doigt et sans me tromper tous les mots de la page à mesure que je les prononçais. Seulement, il ne fallait pas les changer de place. Ce que voyant, ma mère renonça aux leçons de lecture, espérant qu’avec le temps je consentirais à adopter le système répandu de l’étude par syllabes. Je continuai donc à m’amuser à ma manière, à apprendre des mots entiers qui se gravaient dans ma tête comme des dessins.
L’effort que je faisais ainsi pour saisir les mots en bloc m’était facilité par l’admiration profonde que m’inspiraient les caractères d’imprimerie que je me mis à copier, pour mon plaisir, comme d’autres enfants auraient copié des chiens ou des chevaux. L’inscription suivante, qui est le fac-simile de la première page de mes Sept Paladins du Christianisme (à remarquer le caractère original de la lettre L et la hauteur du G) est, je crois, une de mes premières tentatives dans ce genre; et comme le Destin a voulu que les premières lignes de la lettre écrite cinquante ans plus tard, où je faisais mes recommandations à Mr Burgess, présente quelques traits de ressemblance assez frappants, j’ai pensé qu’il serait intéressant de les reproduire ensemble tels que.
Ma mère, comme elle me l’a dit plus tard, m’avait solennellement «voué à Dieu» dès avant ma naissance, suivant en cela l’exemple d’Anne, la mère du prophète Samuel. On rencontre ainsi d’excellentes femmes disposées à se débarrasser prématurément de leurs enfants: sans doute, dans l’idée que les fils de Zébédée ne devant pas être assis à la gauche et à la droite du Christ, elles peuvent espérer que leurs propres fils pourront, dans l’éternité, occuper cette respectable situation, surtout si elles le demandent très humblement chaque jour au Christ. Elles oublient, hélas! dans leur simplicité, que la chose ne dépend pas uniquement de Lui.
FAC-SIMILÉ DE L’ÉCRITURE DE RUSKIN. — LETTRE ÉCRITE EN 1883.
«Voué à Dieu» voulait dire, pour ma mère, autant qu’elle se comprenait, m’envoyer à l’Université, faire de moi un clergyman: je fus donc élevé pour «l’Église ». Mon père — que son âme repose en paix! — qui avait la très mauvaise habitude de s’incliner devant la volonté de ma mère toutes les fois que les choses avaient de l’importance, et de faire à sa tête lorsqu’elles n’en avaient point, souffrit sans mot dire que je fusse soustrait au commerce du vin de Xérès, comme étant chose impure; peut-être, au fond, les ambitions de ma mère à mon égard le flattaient-elles. Car je me souviens que bien des années plus tard, causant avec un de nos amis, un artiste, grand admirateur de Raphaël, qui se désespérait que j’eusse eu l’audace d’exposer au public mes idées sur Turner et Raphaël, et s’écriait:
«Quel dommage! quel aimable clergyman il eût fait. — Oui, reprit mon père les larmes aux yeux (larmes les plus vraies, larmes les plus tendres que jamais père ait versées) oui, il serait devenu évêque.»
Fort heureusement pour moi, ma mère, avec le sentiment qu’elle remplissait un devoir, quels que fussent d’ailleurs ses secrets espoirs d’avenir, me conduisit de très bonne heure aux offices où, en dépit de mes habitudes paisibles et du flacon d’or ciselé de ma mère que l’on m’abandonnait dans ces grandes occasions, je m’ennuyais affreusement. Je ne connaissais rien de plus triste que le banc de l’église, pas de jour plus lugubre que le dimanche, pas d’endroit où il me semblait plus difficile de se tenir tranquille. (Songez que, dès le matin, on me retirait les livres que j’aimais le plus.) Aussi j’avais l’horreur du dimanche, une horreur qui s’emparait de moi dès le vendredi et que l’éclat du lundi et la perspective des sept jours qui nous séparaient du service dominical n’arrivaient pas à contrebalancer.
Il me restait pourtant dans l’esprit des bribes de sermons que j’accommodais à ma façon et, de temps en temps, au retour, je prêchais, accoté aux coussins du grand divan rouge qui me servait de chaire; dans ces occasions-là, les amies les plus intimes de ma mère joignaient les mains avec attendrissement et déclaraient que cela dénotait des dispositions extraordinaires. Mon sermon, j’imagine, était fort court, ce qui était d’un excellent exemple, et empreint de la plus pure doctrine évangélique, car je me souviens qu’il commençait par ces mots: «O mes frères, soyez bons!»
Mes parents recevaient rarement et je n’étais jamais autorisé à venir à table, même au dessert. Je n’eus cette permission que bien des années plus tard, lorsque je sus casser proprement des noisettes. Ce fut moi alors qui fus chargé de casser les noisettes des invités (j’espère qu’ils ne jugeaient pas mon intervention indiscrète) mais il m’était défendu d’en manger, fût-ce une saule, non plus d’ailleurs qu’aucune autre friandise. Je me souviens encore du jour où, à Hunter Street, ma mère, qui faisait des rangements dans la chambre aux provisions, me donna trois grains de raisin sec, et je n’oublierai jamais l’occasion où, pour la première fois, je mangeai de la crème cuite. C’était dans le petit appartement meublé de Norfolk Street où nous nous étions réfugiés pendant qu’on repeignait la maison. Mon père, qui dînait dans la pièce du devant, avait laissé un peu de crème sur son assiette et ma mère me l’apporta, dans la pièce du fond.
Mais afin que le lecteur puisse suivre plus facilement les progrès de ma pauvre petite vie, progrès sur lesquels il trouve peut-être que je m’étends trop complaisamment, il est nécessaire que je donne quelques renseignements sur la situation commerciale de mon père à Londres.
La maison de commerce dont il était le principal associé (je ne doute pas que dans les vieilles maisons de la Cité on ne s’en souvienne) avait installé ses bureaux dans un immeuble peu spacieux, situé dans une petite rue de l’est de Londres — Billiter Street — l’artère principale qui relie Leadenhall Street à Fenchurch Street. Les noms des trois associés brillaient sur la plaque de cuivre de la porte, juste au-dessous de la sonnette: Ruskin, Telford & Domecq.
Le nom de Mr Domecq, en toute justice, eût dû occuper le premier rang, car, en réalité, mon père et Mr Telford n’étaient que ses agents. Il était le seul propriétaire du vignoble qui représentait la plus grosse partie du capital de la maison de commerce, le vignoble de Macharnudo, la colline de toute la péninsule hispanique la plus réputée pour ses vins blancs. C’était la vendange de Macharnudo qui fixait la qualité du vin de Xérès — sec ou doux — depuis le temps de Henry V jusqu’à nos jours; la marne invariable et unique de cette terre donnait au raisin une force que les années ne faisaient qu’accroître et enrichir, sans jamais l’altérer.
Mr Pierre Domecq, espagnol de naissance, je crois, et d’éducation mi-partie française et mi-partie anglaise, était un homme plein de délicatesse et du caractère le plus aimable. Était-il d’origine noble? je n’en sais rien; comment était-il devenu propriétaire de son vignoble? je n’en sais rien; quelle était sa situation dans la maison Gordon, Murphy & Cie, où mon père était employé ? je n’en sais rien. Je sais seulement qu’il avait vu mon père à l’œuvre et que lorsque la Société Murphy fut dissoute, il lui demanda d’être son représentant en Angleterre. Mon père savait qu’il pouvait avoir une confiance absolue dans la délicatesse de Mr Domecq, dans sa manière de traiter les affaires. Peut-être avait-il moins de confiance dans son sens pratique et dans son activité ; en tous cas, il insista, bien que ne mettant pas de capitaux dans l’affaire et ne touchant que des commissions, pour être, aussi bien en nom qu’en fait, le chef de la maison.
Mr Domecq habitait le plus souvent Paris; il allait rarement en Espagne,mais il n’en faisait pas moins prévaloir ses idées, lesquelles étaient fort arrêtées, sur le mode de culture de ses vignobles. Il avait autant d’autorité sur ses paysans qu’un chef de clan sur ses hommes, maintenait les vins au plus haut, comme qualité et comme prix, et laissait mon père libre d’organiser la vente à son gré. Le second associé, Mr Henry Telford, avait mis dans l’affaire le capital nécessaire pour que la maison de Londres pût marcher. Il possédait une jolie maison de campagne à Widmore, près de Bromley.
C’était le type accompli du gentilhomme campagnard anglais de fortune moyenne. Célibataire, il vivait avec trois sœurs non mariées, extrêmement cultivées et raffinées, simples et bonnes en même temps, et qui, dans leurs vies si heureuses et si bienfaisantes aux autres, m’apparaissent comme des figures de roman, les héroïnes d’un beau conte, plutôt que des êtres réels. Mais ni dans les livres, ni dans la réalité, je n’ai jamais entendu parler, ni vu personne qui ressemblât à Henry Telford: doux, modeste, affectueux, plein de bon sens. Il adorait les chevaux, sans qu’il y eût en lui rien qui sentît, fût-ce de très loin, le champ de courses ou l’écurie. Je crois pourtant qu’il ne manquait pas une réunion tant soit peu importante et qu’il passait la plus grande partie de sa vie à cheval, chassant tant que durait la saison de la chasse; mais il ne pariait jamais, n’avait jamais fait de chute sérieuse et n’avait jamais blessé un cheval. Entre mon père et lui régnait la confiance la plus absolue, et toute l’amitié qui peut exister, quand la manière de vivre est aussi différente.
Mon père était très fier de la position sociale de Mr Telford; Mr Telford admirait la capacité de travail de mon père, son instinct commercial si sûr.
Le concours actif de Mr Telford se bornait, en général, à deux mois de présence au bureau, les deux mois d’été pendant lesquels mon père prenait ses vacances; il suppléait aussi mon père pendant quelques semaines au commencement de l’année, quand celui-ci faisait sa tournée chez les clients. Dans ces cas-là, Mr Telford venait tous les matins de Widmore à Londres à cheval, signait le courrier, lisait les journaux et rentrait le soir à cheval. S’il y avait la moindre décision à prendre, on en référait à mon père ou on attendait son retour. Tout le monde à Widmore eût été disposé à faire, pour ma mère et pour moi, les plus grands frais; mais ma mère se tenait sur la réserve: elle sentait trop, dans ce milieu si cultivé — et elle avait trop de fierté pour ne pas en souffrir — tout ce qui avait manqué à son éducation première: le résultat en était qu’elle n’aimait guère à frayer qu’avec ceux qu’elle sentait lui être, en quelque sorte, inférieurs.
Quoi qu’il en soit, Mr Telford, si étrange que cela paraisse, eut une grande influence sur mon éducation. C’est lui qui me fit cadeau, sur le conseil de ses sœurs, je crois, de l’Italie de Rogers, édition illustrée, au moment où elle parut. Et ce fut ce livre qui me donna l’occasion d’étudier attentivement le travail de Turner; je puis donc dire, en toute justice, que c’est ce cadeau qui a décidé ma vocation. Mais la grande erreur des biographes superficiels est de prendre l’accident pour la cause, quand la cause seule a de l’importance. Le point essentiel à noter et à expliquer, c’est que je fusse en état de comprendre l’œuvre de Turner dès que je la vis, et non par quel hasard, ou en quelle année, je la vis pour la première fois. Le pauvre Mr Telford, en tout cas, a toujours été tenu responsable, par mon père aussi bien que par ma mère, de toutes les folies que m’a inspirées Turner.
Il fut mon bienfaiteur plus directement encore. Car avant que mon père ne se crût en droit de louer une voiture pour notre petit voyage de vacances, Mr Telford nous prêtait son «chariot».
Or, le vieux chariot anglais, cette voiture légère à deux places, est, sans contredit, la plus confortable des voitures de voyage quand on est deux et même trois, surtout quand le troisième voyageur est un enfant de trois à quatre ans. Haut suspendu, ce chariot permettait de voir par-dessus les parapets de pierre et les haies qui bordent les routes: il est vrai que, pour y monter, il fallait déplier un petit marche-pied capitonné qui rentrait à l’intérieur de la portière. Ce marche-pied était pour moi une des grandes joies du voyage, le voir baisser et relever par les garçons d’écurie un délice — joie et délice, il est vrai, gâtés par le désir, dirai-je l’ambition, de le baisser et le relever moi-même. Cette ambition, ai-je besoin de le dire, ne fut jamais satisfaite, ma mère craignant que je ne me pinçasse les doigts.
Le «dickey» (je m’étonne de n’avoir jamais eu l’idée de rechercher l’origine de ce mot, et aujourd’hui il m’est impossible d’y arriver), est ce siège élevé qui, dans la malle-poste royale, est occupé par le conducteur de la diligence, siège devenu légendaire, même pour les amateurs de littérature moderne, grâce à l’immortel colloque de Bob Sawyer et de Sam; le «dickey», très en arrière dans la voiture de Mr Telford, permettait d’allonger confortablement les jambes quand il vous prenait fantaisie de respirer l’air du dehors par un jour de beau temps. Sous le siège, il y avait place encore pour un grand coffre où l’on fourrait au dernier moment quantité de petits paquets et de sacs. Ce département des bagages était confié aux soins d’Anne, ma bonne; elle emballait, surveillait, aussi habile à plier une robe qu’à faire sauter des crêpes. Je vous prierai de remarquer que la précision et l’adresse demandent autant d’esprit que d’invention et que, pour faire une malle, comme pour diriger une bataille, la précision ne va pas sans prévoyance.
Parmi tous ceux qui manquent à l’appel, combien y en a-t-il, hélas! quand on a passé la cinquantaine? Une des personnes que je regrette le plus, après mon père et ma mère (je ne veux parler ici que des pertes sérieuses, non des imaginaires), celle qui me manque, encore tous les jours, c’est cette Anne, la vieille bonne de mon père et la mienne. Entrée à quinze ans à la maison, elle y passa sa vie et consacra tous ses talents à nous servir. Anne avait un goût naturel et la spécialité de faire les choses les plus désagréables; elle excellait dans le soin des malades et triomphait quand quelqu’un d’entre nous était dans son lit. Mais Anne avait non seulement la spécialité de faire les choses désagréables, elle avait encore celle de les dire; on pouvait s’en rapporter à elle. Elle commençait par voir tout au pire, par le déclarer très haut, avant de rien faire pour y remédier. Elle avait, de plus, une répugnance honorable et toute républicaine à exécuter les ordres tels qu’on les lui donnait, si bien que, lorsque ma mère et elle eurent vieilli ensemble, qu’avec les années ma mère fut devenue un peu exigeante, qu’elle attachait une certaine importance à ce que sa tasse de thé fût posée à tel endroit sur la petite table ronde, Anne avait toujours grand soin de la mettre du côté opposé. Aussi ma mère me déclarait-elle gravement tous les matins à déjeuner que, s’il y avait femme au monde que l’esprit malin possédât, c’était bien la vieille Anne.
En dépit de ces aspirations violentes mais brèves vers la liberté et l’indépendance, la pauvre Anne fut toute sa vie la femme la plus serviable; elle n’eut d’autre occupation, depuis l’âge de quinze ans jusqu’à celui de soixante-douze, que de faire la volonte des autres, de s’oublier elle-même: je n’ai pas entendu dire qu’elle ait jamais fait mal à personne au monde, si ce n’est peut-être en économisant quelques milliers de francs que ses héritiers se disputèrent après sa mort; la pauvre femme n’était pas enterrée qu’ils étaient tous brouillés.
Le siège en question, réservé à Anne, était assez large pour que mon père pût y monter quand le temps était beau et le paysage engageant. La voiture toute chargée, bagages et le reste, roulait aisément enlevée par de bons chevaux sur les routes très bien entretenues des malles-poste; courir la poste, en ce temps-là, était si répandu qu’aux relais, dans quelque pays qu’on se trouvât, au cri de: «Des chevaux! des chevaux!» on voyait apparaître, sous la porte cochère, le postillon en bottes et en veste de couleur voyante, monté sur ses chevaux caparaçonnés qui trottaient gaiement. Pas de siège par devant, pas de cocher; mais quatre larges vitres qui fermaient hermétiquement, glissant l’une sur l’autre, et qui se baissaient aussi sans la moindre peine. Ces glaces formaient un large cadre mouvant, une sorte de fenêtre en saillie à travers laquelle on pouvait voir la campagne. De ma place, la vue était plus étendue encore. J’étais assis sur la malle qui contenait mes vêtements, une petite caisse solide sur laquelle on avait fixé un coussin, et qui était posée de champ, devant mon père et ma mère. Je ne les gênais pas et la vue de ce siège haut perché était aussi étendue que possible. Lorsque le paysage n’offrait rien de particulièrement intéressant, je trottais à califourchon sur ma caisse, suivant les mouvements du postillon; le coussin me tenait lieu de selle et les jambes de mon père, de chevaux; au début, cela n’avait été qu’un simulacre, mais mon père m’ayant imprudemment fait cadeau d’un fouet de postillon à manche d’argent, la chose devint plus sérieuse; les jambes de papa pourraient le certifier.
Ces vacances d’été, si délicieuses grâce à la bonté de Mr Telford, commençaient en général vers le 15 mai — la fête de mon père était le 10, et nous ne pouvions partir avant que cette solennité fût accomplie. Ce jour-là, on me permettait de cueillir les groseilles à maquereau, celles d’un certain groseillier contre le mur du nord, avec lesquelles on faisait la première tarte de l’année — vacances, si l’on veut, qui consistaient en une tournée chez les clients pour prendre les commandes. Nous parcourions ainsi la moitié des comtés de l’Angleterre; si c’était les comtés du Nord, nous poussions jusqu’en Écosse pour voir ma tante.
Notre manière de voyager était aussi méthodique, aussi réglée que notre vie ordinaire. Nous faisions de quarante à cinquante milles par jour, nous mettant en route d’assez bon matin afin d’arriver, sans nous presser, pour le dîner de quatre heures. En général, nous partions vers six heures, quand les prairies sont encore couvertes de rosée et que les aubépines embaument l’air du matin. Si, dans notre course d’après-midi, on pouvait visiter quelque château, surtout celui d’un lord ou mieux encore d’un duc, mon père faisait dételer et nous conduisait, ma mère et moi, à travers les appartements de gala. Je nous vois, dans ce cas, parlant à voix basse à la femme de charge, au majordome ou à toute autre autorité en fonction et recueillant pieusement leurs récits.
En analysant, plus haut, les impressions que m’ont laissées ces expéditions, j’ai été un peu vite, j’ai anticipé le résultat, à savoir qu’il est infiniment préférable de vivre dans une petite maison que dans une grande. Ce qui est certain c’est que, jusqu’à ce jour, tandis qu’il m’est impossible de passer devant un cottage couvert de roses et de verdure sans désirer en être le propriétaire, je n’ai pas encore rencontré le château qui m’ait fait porter envie au châtelain. Et, bien qu’au cours de ces pèlerinages pieux, j’aie recueilli quantité de renseignements d’art et de nature qui m’ont été infiniment précieux, je constate qu’ils n’ont eu aucune influence sur mon caractère, et que mon goût personnel, mon instinct naturel avaient reçu une empreinte indélébile bien avant cette époque; je restais attaché aux scènes modestes et simples de ma petite enfance entrevues sous les toits rouges et bas de Croydon, au bord des petits cours d’eau pleins de cresson au fond duquel dansait le sable d’or et où filaient les vairons, en amont des sources de la Wandel.