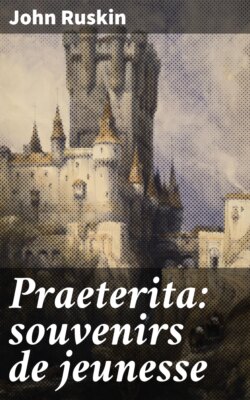Читать книгу Praeterita: souvenirs de jeunesse - John Ruskin - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
HERNE HILL. LES AMANDIERS EN FLEUR
ОглавлениеLORSQUE j’eus quatre ans, mon père se trouva en situation d’acheter une maison à Herne Hill, jolie colline verdoyante qui se trouve à quatre milles au sud du «Standard in Cornhill», dont la solitude ombragée n’a pas changé de caractère, au moins dans ses grandes lignes: certaines splendeurs gothiques, auxquelles quelques-uns de nos plus riches voisins se sont abandonnés en ces dernières années, sont les seules innovations; encore sont-elles si gracieusement dissimulées par les beaux arbres de leurs parcs que le passant inoffensif n’en est pas offusqué ; et lorsque je me promène sur la route, entre la taverne du Renard et la station du chemin de fer, je pourrais m’imaginer que j’ai encore quatre ans.
Notre maison était la dernière, côté nord, du petit groupe perché sur la crête même de la colline, là où le terrain s’aplatit et forme une sorte de plate-forme semblable à celle où, sur le sommet du Mont-Blanc, les neiges s’accumulent; mais il redescend bientôt par une pente rapide jusqu’à notre vallée de Chamonix (ou plutôt de Dulwich); la descente du côté de «Cold Harbour Lane» est beaucoup moins raide.
Au sud, la colline dévale à travers un joli pays jusque dans le vallon de l’Effra (Effra pour Effrena, sans doute, qui signifie «débridée» ; pauvre petite rivière que l’on a, j’ai le regret de le dire, tout récemment canalisée, murée, pour la plus grande commodité de Mr Biffin, pharmacien, et autres); au nord, au contraire, elle se prolonge en pente douce sur une longueur d’un demi-mille, prend sur la paroisse de Lambeth le nom héroïque de «Champion Hill» et finit par se perdre dans les plaines de Peckham et la barbarie rurale de Goose Green.
Le groupe dont faisait partie notre maison se composait de deux maisons jumelles couplées avec jardins, dépendances, le tout absolument identique. Ce sont encore aujourd’hui les plus hautes; on les aperçoit de Norwood; si bien que de la maison, une maison à trois étages avec greniers, on avait, en ces jours bénis où les fumées n’obscurcissaient pas complètement le ciel, une vue très étendue sur les collines de Norwood où le soleil se levait en hiver; de l’autre côté s’étendait la vallée de la Tamise. Avec une longue-vue on pouvait apercevoir Windsor dans le lointain et à l’œil nu Harrow, quand le temps était clair, à l’heure du coucher du soleil. Devant la maison et derrière, s’étendaient deux jardins de taille moyenne. Celui du devant était planté d’arbustes à feuilles persistantes, de lilas et de faux ébéniers; le jardin du fond, qui pouvait avoir soixante mètres de long sur dix-huit de large, était renommé aux alentours pour ses poires et ses pommes, lesquelles étaient l’orgueil de notre prédécesseur (honte à moi, j’ai oublié le nom d’un homme auquel je dois tant). Il y avait encore un vieux mûrier trapu, Un grand cerisier qui donnait des cerises à chair blanche, un merisier du comté de Kent, et, tout autour, une haie ininterrompue de groseilliers à grappes et de groseilliers à maquereau. Surchargées quand venait la saison (car le terrain était excellent) de fruits merveilleux que l’on voyait passer du vert le plus doux à l’ambre doré et au rouge vermillon, leurs branches épineuses s’inclinaient sous le poids des grappes de perles ou de rubis. Quelle joie de les découvrir sous leurs belles et larges feuilles, qui rappelaient celles de la vigne!
La seule différence pour moi, entre ce jardin et celui du Paradis, tel du moins que je me le représentais, c’est que dans le jardin de Herne Hill, tous les fruits étaient défendus, et ensuite qu’il n’y avait pas d’animaux avec lesquels on pût lier amitié ; mais, sous tous les autres rapports, ce petit coin était vraiment pour moi le Paradis; le climat (était-il plus clément alors?) me permettait d’y passer la plus grande partie de ma vie. Ma mère, qui me faisait travailler, s’arrangeait pour que, si j’y mettais de la bonne volonté, toutes les leçons fussent finies à midi. Mais si je ne savais pas ma leçon à midi, tant pis pour moi, je restais jusqu’à ce qu’elle fût sue; en général, et cela même quand la grammaire latine vint s’ajouter aux Psaumes, j’étais libre avant le dîner d’une heure et pour le reste de la journée.
Ma mère, qui adorait les fleurs, jardinait, taillait auprès de moi, du moins s’il me convenait de rester avec elle. Mais, si sa présence n’était pas pour moi une gêne (car jamais je n’aurais eu l’idée de faire en cachette quoi que ce soit que je n’eusse fait devant elle) elle n’était pas non plus un très grand plaisir; habitué à vivre seul, j’étais toujours occupé par une foule de petites affaires personnelles; à sept ans, j’avais déjà une mentalité trop indépendante, même vis-à-vis de mon père et de ma mère, et comme, en dehors d’eux, personne ne s’occupait de moi, je m’étais organisé une petite vie très égoïste, très heureuse, dans une suffisance de jeune coq et l’indépendance solitaire d’un Robinson Crusoë, vie qui m’apparaissait (comme il est naturel à tout animal à l’esprit géométrique) comme le centre de l’univers.
Ceci tenait en partie à l’extrême modestie de mon père, en partie à son orgueil. Il avait une telle confiance dans le jugement de ma mère, qu’il considérait, dans les choses de ce genre, comme très supérieur au sien, qu’il ne se serait jamais avisé de la contrecarrer en rien au sujet de mon éducation; d’autre part, avec l’idée fixe de faire de moi un prélat aux grandes manières, ayant accès dans les coteries les plus raffinées, les plus huppées, aussi bien dans les milieux mondains que dans les milieux ecclésiastiques, les visites à Croydon, où j’étais tout le jour avec la chère et simple tante et les petits cousins boulangers, se firent de plus en plus rares. Pour voisiner avec les habitants de la colline, il eût fallu risquer de troubler notre vie si doucement égoïste; de sorte que, somme toute, il n’y avait pas un être vivant à qui j’eusse pu m’intéresser de façon enfantine, si ce n’est moi-même, quelques fourmilières que le jardinier dérangeait sans cesse et un ou deux oiseaux à demi apprivoisés, car je n’ai jamais eu ni le talent, ni la persévérance d’en apprivoiser un tout à fait. Il est vrai de dire qu’à peine y en avait-il un qui prenait assez confiance pour s’approcher, les chats le happaient.
Cet état de choses donné, tout ce que je pouvais avoir d’imagination se reportait sur les objets inanimés: ciel, feuilles, cailloux, tout ce que l’on pouvait observer entre les murs du Paradis; ou encore, sous les prétextes les plus futiles, mon imagination s’élançait dans les régions de la fiction, du moins celles qui étaient compatibles avec les réalités objectives de l’existence au XIXe siècle, aux environs de Camberwell Green.
Par bonheur, je trouvai sur ce chapitre, en mon père, un guide excellent, et toujours disposé à se prêter à ma fantaisie lorsqu’il pouvait le faire sans enfreindre aucune des règles instituées par ma mère. Un de mes grands plaisirs était de le voir se raser; j’avais la permission de monter dans sa chambre tous les matins (celle qui est au-dessous de celle où j’écris à l’heure actuelle), et j’assistais, immobile et muet, à cette grave opération.
Je vois encore, au-dessus de la toilette, une aquarelle exécutée par mon père sous la direction de Nasmyth père, à l’École supérieure d’Édimbourg, je crois. Elle était faite dans la manière primitive que le Dr Munro enseignait à Turner au moment même où mon père était au «High school» ; c’est-à-dire dans ces demi-teintes à base de bleu de Prusse ou d’encre ordinaire, et lavées en couleurs vives dans les lumières. Elle représentait le château de Conway à l’embouchure de la rivière, avec, au premier plan, une chaumière, un pêcheur et une barque amarrée au bord de l’eau.
Quand mon père avait fait sa barbe, il me racontait une histoire dont l’aquarelle fournissait le sujet. Pure affaire de hasard, sans aucune préméditation de la part de mon père, la curiosité que m’inspirait ce pêcheur n’étant jamais satisfaite. Habitait-il la petite maison? Où allait-il dans son bateau? On était convenu une fois pour toutes, et pour avoir la paix, qu’il demeurait dans la chaumière et qu’il allait pêcher du côté du Château. L’histoire ensuite se corsait de souvenirs tirés de la tragédie de Douglas et du Château Fantôme, deux pièces que mon père avait jouées dans sa jeunesse à Édimbourg devant quelques amis et devant ma mère, alors dans toute l’austérité de ses vingt ans et de son rôle de «housekeeper » modèle. Elle avait, ce jour-là, fait taire les pieuses préventions que lui inspiraient toutes espèces de représentations théâtrales, et celle-ci lui avait laissé des souvenirs ineffaçables; elle ne se lassait pas, quand je fus plus âgé, de me dire combien mon père était beau dans son costume de Montagnard avec la haute plume noire au bonnet.
Mon père rentrait de ses affaires tous les jours à la même heure. Il dînait à quatre heures et demie dans le salon du devant. Ma mère, assise à ses côtés, se faisait raconter les événements de la journée, donnant son avis, l’encourageant, car mon père était de nature inquiète et toujours prêt à se décourager dès que les commandes de vin de Xérès faiblissaient le moins du monde. A cette époque je restais confiné dans la nursery, je n’ai donc pas entendu les conversations de mon père et de ma mère, mais je les imagine facilement; car, entre quatre ans et six ans, j’eusse commis la plus grave inconvenance si je m’étais seulement approché de la porte du salon! Plus tard, le dîner achevé, en été, nous restions au jardin jusqu’à la nuit, et nous prenions le thé sous le cerisier; en hiver, ou quand il faisait mauvais, on servait le thé à six heures dans le salon. On m’apportait, à moi, une tasse de lait et Une tartine de pain et de beurre que je mangeais dans un petit renfoncement à côté de la cheminée, devant lequel on plaçait une table; c’était mon sanctuaire. Je restais là toute la soirée, comme une idole dans sa niche, pendant que ma mère tricotait et que mon père faisait la lecture pour elle et pour moi, s’il me plaisait d’écouter.
La série des romans de Waverley, qui touchait alors à sa fin, faisait les délices de tous les milieux quelque peu littéraires; je ne puis pas plus me souvenir du temps où je ne les connaissais pas que du temps où je ne lisais pas la Bible; et je vois aussi nettement que si c’était hier l’expression à la fois chagrine et dédaigneuse avec laquelle mon père laissa tomber le Comte Robert de Paris, après en avoir lu les trois ou quatre premières pages, disant: «C’est la fin de Walter Scott» ; sentiment très complexe chez mon père et très amer: mépris pour le livre lui-même, mais surtout pour les misérables qui tourmentaient et trafiquaient du pauvre cerveau malade; mépris aussi, s’il faut tout dire, pour l’improbité, cause première de cette ruine. Mon père n’a jamais pu pardonner à Scott de n’avoir pas avoué son association avec Ballantyne.
Tels étaient les purs plaisirs de Herne Hill. Mais il me faut dire aussi toute la reconnaissance que je dois à ma mère pour ses leçons inexorables, grâce auxquelles les moindres mots de la Sainte Écriture chantaient familièrement dans mon cœur, musique respectée en dépit de cette familiarité, comme devant dominer toute pensée et régler toute action .
Ma mère avait obtenu ce résultat non par des discours ou en usant de son autorité personnelle, mais en m’obligeant à lire le livre à fond, moi-même. Aussitôt que je sus lire couramment, nous commençâmes une série de lectures de la Bible qui ne furent jamais interrompues, jusqu’au jour de mon entrée à Oxford. Alternativement, elle et moi lisions un verset; elle veillait sur ma façon de dire, corrigeant chaque intonation fausse jusqu’à ce que j’aie compris le sens du verset s’il était à ma portée, que j’en aie bien senti toute la force. Il se pouvait que cela passât au-dessus de ma tête, elle ne s’en inquiétait pas, elle savait que le jour où je comprendrais, ce serait compris comme cela devait l’être.
Nous commençâmes par la Genèse, allant d’un bout à l’autre jusqu’aux derniers versets de l’Apocalypse — mots barbares, chiffres, loi Lévitique, et le reste — recommençant par la Genèse dès le jour suivant, sans prendre le temps de respirer. Si on se heurtait à un nom terrible, tant mieux, c’était un excellent exercice de prononciation; si le chapitre était ennuyeux, quelle admirable leçon de patience! S’il était répugnant, quelle occasion d’exercer sa foi et de dire: tout est préférable au mensonge. Après la lecture des chapitres (deux ou trois par jour selon leur longueur, séance qui avait lieu tout de suite après le déjeuner, et que les domestiques ne devaient interrompre sous aucun prétexte; s’il venait des amis à cette heure, ils devaient se résigner à écouter ou attendre dans le salon; en voyage seulement, le règlement changeait) je devais aussi apprendre quelques versets par cœur, et repasser ce que j’avais déjà appris afin de ne pas l’oublier. En même temps, il me fallait me mettre dans la tête toutes les belles et vieilles paraphrases écossaises, de bons vers, sonores et puissants, auxquels, sans parler de la Bible elle-même, je dois l’éducation première de mon oreille au point de vue du son.
Ce qui est extraordinaire, c’est qu’entre toutes les parties de la Bible que j’appris ainsi avec ma mère, celle que j’eus le plus de peine à retenir, celle qui choquait le plus mon imagination d’enfant — le CXVIIIe psaume — est celle qui m’est devenue la plus précieuse en raison de cet amour pour la Loi de Dieu dont il est plein, en opposition avec l’abus que font les prédicateurs modernes de ce qu’ils se figurent être Son évangile.
Ce n’est que par un effort de volonté que j’évoque le souvenir de ces longues matinées de travail, aussi régulières que le lever du soleil, de travail très dur de part et d’autre, pendant lesquelles, années après années, ma mère me forçait à apprendre paraphrases et chapitres (le huitième du Premier des Rois entre autres; essayez-en, cher lecteur, un jour que vous aurez une heure de loisir!) sans qu’il fût permis de changer fût-ce une syllabe; me faisant répéter et répéter chaque phrase jusqu’à ce que l’intonation lui donnât complète satisfaction. Je me souviens d’une lutte entre nous qui dura plus de trois semaines, à propos de l’accent sur le «of» de ces vers:
Shall any following spring revive
The ashes of the urn?
Je voulais par entêtement, mais poussé aussi par mon instinct naturel (sans attacher d’ailleurs la moindre importance aux urnes, ni à leur contenu), mettre l’accent sur de, et ce ne fut, comme je l’ai dit, qu’au bout de trois semaines d’efforts que ma mère réussit à me le faire alléger sur de et renforcer sur cendres. Mais eût-il fallu trois ans, elle y fût parvenue. Ne l’eût-elle pas fait, je ne sais trop ce qui serait arrivé ; en tous cas, je lui suis très reconnaissant de sa persévérance.
Je viens d’ouvrir ma Bible, la plus vieille, celle dont je me sers de temps immémorial; c’est un petit volume imprimé très fin, très serré, édité à Édimbourg par Sir D. Hunter Blair et J. Bruce, imprimeurs du Roi, en 1816. Toute jaunie maintenant par l’usage, elle n’est ni salie, ni déchirée; seuls les coins de pages du huitième chapitre du Premier Livre des Rois et du XXXIIe du Deutéronome, un peu noircis et affinés, témoignent de la peine que j’ai eue à me mettre ces deux chapitres dans la tête. La liste des chapitres que j’ai appris ainsi par cœur, et sur lesquels ma mère posait les fondements de ma vie morale, vient de s’échapper des feuillets jaunis du vieux livre.
Je demande au lecteur, que cela l’intéresse ou non, la permission de transcrire cette liste, que le hasard remet ainsi sous mes yeux:
En vérité, si j’ai glané, ici et là, quelques connaissances supplémentaires en mathématiques, météorologie ou autres, dans le courant de ma vie, si je dois beaucoup à des maîtres excellents, l’insistance maternelle à me rendre cette littérature familière, à en pénétrer mon esprit, est ce qui m’apparaît comme l’acquisition la plus précieuse qu’il m’ait été donné de faire; c’est, sans contredit, la partie essentielle de toute mon éducation.
Peut-être est-ce le moment de récapituler ce qu’en bien et en mal les circonstances avaient pu, jusqu’à cet âge de sept ans, laisser en moi de traces indélébiles.
Commençons par les bienfaits (ce qu’un ami, qui ne manquait pas de sagesse, me recommandait toujours, tandis que j’ai la très mauvaise habitude de me lamenter pour la plus petite épine que je m’enfonce dans le doigt, au lieu de me dire qu’une épine est peu de chose, et que j’aurais pu, par exemple, me casser la main).
Parmi les plus pures et les plus précieuses bénédictions, il me faut compter celle d’avoir appris à connaître l’exacte signification du mot Paix, en pensée, en action, en parole.
Je n’avais jamais entendu entre mon père et ma mère une discussion où ils eussent élevé la voix; je ne me souviens pas avoir jamais surpris un regard irrité, ou seulement offensé, dans les yeux de l’un ou de l’autre. Je n’avais jamais entendu gronder ou réprimander sévèrement un domestique, jamais observé le moindre désordre dans les choses de la maison, rien de fait à la hâte ou à une heure où cela ne devait pas être fait.
Je ne soupçonnais pas l’existence d’un sentiment comme l’anxiété. Les petits accès de mauvaise humeur de mon père, quand il rentrait avec une commande de douze fûts alors qu’il avait compté sur une de quinze, ne se manifestaient jamais devant moi; simple question d’amour-propre d’ailleurs: il s’agissait de savoir si son nom serait plus ou moins honorablement placé sur la liste annuelle des exportateurs de sherry; car, ne dépensant jamais plus de la moitié de son revenu, il aurait supporté facilement une petite diminution dans ses bénéfices.
Je n’avais jamais fait le mal, du moins consciemment, si ce n’est parfois, en omettant d’apprendre par cœur quelque verset édifiant pour observer une guêpe sur le carreau de la fenêtre ou un oiseau dans le cerisier; et je ne savais pas ce que c’était que d’avoir du chagrin.
En même temps que ce don inappréciable de la Paix, j’avais pénétré le sens profond et de l’Obéissance et de la Foi. J’obéissais au doigt et à l’oeil; un geste de mon père ou de ma mère suffisait, comme le navire répond au gouvernail; et non seulement sans l’ombre d’une résistance, mais avec le sentiment que cette direction faisait partie de ma vie, était ma force, que c’était une loi salutaire qui m’était aussi nécessaire au point de vue moral que la loi de la pesanteur l’est à quiconque saute.
Quant à mon expérience en matière de Foi, elle fut bientôt complète: jamais de promesses fallacieuses; ce qui était promis était donné sur l’heure; jamais de menaces vaines, jamais de mensonges.
La paix, l’obéissance, la foi, tels étaient les principaux bienfaits; venait ensuite l’habitude de l’attention, attention de l’esprit et attention des yeux, mais je ne m’y arrêterai pas ici, cette faculté étant certainement celle qui m’a été le plus utile dans le cours de ma vie, celle qui faisait dire à Mazzini, un ou deux ans avant sa mort — la conversation m’a été textuellement rapportée — que j’avais «le cerveau le plus analytique d’Europe». Opinion, dans la mesure où je connais l’Europe, que je suis tout disposé à partager.
Je noterai, enfin, une très grande délicatesse du palais et des autres sens: odorat, ouïe. Ce que je dois à l’interdiction absolue de toute espèce de gâteaux, vins, sucreries et même, sauf certaines circonstances exceptionnelles, de fruits; et au soin avec lequel étaient préparés les plats que je mangeais.
J’estime que ce sont là les principales bénédictions de mon enfance. Voyons maintenant quelles en ont été les plus grandes calamités.
Premièrement, je n’avais rien à aimer.
Mes parents étaient pour moi des puissances visibles de la nature; je ne les aimais ni plus ni moins que le soleil ou la lune: j’aurais seulement été extrêmement ennuyé ou embarrassé si l’un ou l’autre s’était éclipsé, éteint (je le sens cruellement aujourd’hui que tous deux ont disparu derrière un nuage). J’aimais encore moins Dieu; non que je me fusse querellé avec Lui ou que j’en eusse peur, mais uniquement parce que les devoirs qu’on me disait qu’il fallait Lui rendre me paraissaient ennuyeux, et parce que le livre que l’on me disait être Son livre ne m’amusait pas. Je n’avais aucun camarade avec qui me disputer, personne à aider et personne à remercier. Les domestiques avaient ordre de ne jamais s’occuper de moi en dehors de leur service strict; et pourquoi aurais-je témoigné de la reconnaissance à la cuisinière pour faire la cuisine, au jardinier pour s’occuper de son jardin, quand l’une n’osait même pas me donner une pomme de terre cuite au four sans permission, et que l’autre ne pouvait pas laisser mes fourmis en repos sous le prétexte qu’elles abîmaient les allées? Il n’arriva pas, cependant, ce qui aurait fort bien pu arriver, que je devinsse égoïste, sec, peu affectueux. Seulement, quand les sentiments tendres s’éveillèrent en moi, ils me submergèrent: ce fut un véritable torrent que je fus incapable de maîtriser, de diriger, moi qui n’avais jusque-là rien eu à diriger.
Car (seconde des grandes calamités) je n’avais pas appris à souffrir, tout m’avait été épargné : dangers, douleurs m’étaient également inconnus; jamais je n’avais occasion d’exercer ma force, ni mon courage, ni ma patience. Non que je fusse facilement effrayé : ni les revenants, ni le tonnerre, ni les animaux ne me faisaient peur; je me souviens même que le jour où, tout enfant, je fus le plus tenté de me rebeller contre l’autorité supérieure, ce fut une fois que je voulais jouer avec les petits lionceaux de la ménagerie de Wombwell.
Troisièmement. On ne m’enseigna pas les bonnes manières, les manières du monde; il suffisait, quand il y avait des invités à la maison, que je ne fusse pas gênant et que je répondisse sans timidité quand on m’adressait la parole: la timidité m’est venue plus tard et elle a augmenté à mesure que j’ai pris conscience de ma gaucherie. Il me fut impossible de jamais acquérir aucune souplesse dans les exercices physiques, aucune adresse à aucun jeu et même la moindre aisance dans l’ordinaire de la vie.
Enfin, et ce fut le plus grand de tous mes maux, on ne s’appliqua jamais à développer en moi l’indépendance, la volonté d’agir, ni le jugement sur ce qui est bien et ce qui est mal, car on ne me débarrassa jamais ni de la bride, ni des œillères.
Les enfants devraient avoir, comme les soldats, des moments où ils ne seraient pas de service, et, l’habitude de l’obéissance une fois donnée, l’enfant devrait, très jeune, être livré à lui-même, à certaines heures, abandonné à ses caprices, obligé de se débattre contre lui-même et de se vaincre. L’autorité qui a incessamment veillé sur mes jeunes années m’a longtemps rendu incapable; et lorsque, enfin, je me suis trouvé lancé dans le monde, je n’ai pu faire autre chose que me laisser emporter par ses tourbillons.
Le jugement qu’à l’heure actuelle je serais tenté de porter sur l’ensemble de mon éducation, c’est d’avoir été à la fois trop formaliste et trop luxueuse, imprimant sa marque sur mon caractère, mais au moment très important où il se formait, le laissant plutôt comprimé que discipliné : si j’étais innocent, c’était par protection et non par vertu. Ma mère s’en rendit compte, elle ne le vit que trop clairement par la suite, et chaque fois qu’il m’arrivait de faire quelque chose d’injuste, de stupide ou d’inhumain (et souvent ce fut tout cela à la fois) elle ne manquait jamais de me dire:
«C’est que vous étiez trop gâté.»
Jusqu’ici, sauf certaines omissions voulues, je n’ai guère réimprimé que ce que j’avais déjà dit dans Fors; je crains que la suite du récit n’ait point autant d’intérêt. Ce qui me reste à dire ne gagnera pas à être développé et sera encore moins amusant. Dans Fors, j’ai tenté de présenter les choses de façon un peu piquante; je tâcherai au contraire, ici, que mon récit soit aussi simple que possible. Suis-je arrivé dans Fors à écrire avec esprit? Je ne sais. Ce qui est certain, c’est que j’ai été souvent fort obscur et que la description que j’ai donnée plus haut de Herne Hill demande à être faite en termes moins exagérés.
La hauteur de la longue crête de Herne Hill, au-dessus de la Tamise ou plutôt du niveau de la Tamise, à Camberwell Green, n’a pas, j’imagine, plus de cent cinquante pieds; mais la descente sur les deux versants est rapide, s’étageant sur un quart de mille du côté est, aussi bien que du côté ouest, à travers une succession de parcs et de jardins; route très vite séchée après l’averse, et que les enfants dégringolaient en courant; mais aussi quel courage il fallait pour remonter la pente avec son cerceau! Du sommet, avant qu’il n’y eût de chemins de fer, la vue était absolument délicieuse; vers le soir, du côté du couchant, elle était même grandiose, embrassant une longue succession de pentes boisées.
La Tamise elle-même se cachait derrière les arbres; pas d’espaces libres, pas de prairies, si ce n’est directement au-dessous; sur une étendue de vingt milles carrés, rien que des frondaisons verdoyantes et des bosquets. De l’autre côté, vers l’est et le sud, s’allongeaient les collines de Norwood, plantées de bouleaux et de chênes, coupées de landes, hérissées d’ajoncs et de ronces d’un vert sombre, avec, ici et là, des pentes gazonnées qui faisaient deviner déjà toute la beauté rurale du Surrey et du Kent et d’une ondulation si large qu’elles donnaient l’illusion de la montagne. Association d’idées qui paraît absolument invraisemblable aujourd’hui que le Palais de Cristal, sans parvenir à suggérer l’idée de grandeur et sans avoir plus de majesté lui-même qu’une cloche à melon posée entre deux tuyaux de cheminées, réussit pourtant, grâce au voisinage de sa bête de masse creuse, à donner des airs de pygmées aux collines environnantes, qui ressemblent aujourd’hui à trois gros tas d’argile prêts à être livrés à un entrepreneur de construction. Mais, en ce temps-là, le Norwood ou North wood, comme on disait à Croydon, par opposition avec le South wood des plateaux du Surrey, montait en demi-cercle sur une étendue de cinq milles autour de Dulwich vers le sud, coupé ici et là par de petits sentiers rapides bordés de haies tels que Gipsy Hill et autres; du sommet, le regard s’étendait dans la direction de Dartford et sur la plaine de Croydon. C’est devant ce spectacle qu’un jour j’épouvantai ma mère, en m’écriant que «je sentais mes yeux me sortir de la tête». Elle crut que j’avais attrapé un coup de soleil.
Herne Hill était au centre de cet amphithéâtre, et l’un de ses principaux charmes consistait en ce qu’après avoir longé le faîte des collines, en venant de Londres, au milieu des marronniers d’Inde, des lilas et des pommiers dont les branches pendaient au-dessus des palissades des deux côtés, le pays se découvrait soudain et on se trouvait à l’extrémité d’une grande plaine qui dévalait vers le sud jusque dans la vallée de Dulwich, prairie semée de boutons d’or où paissaient des vaches avec, tout au fond, les beaux pâturages et les avenues séculaires de Dulwich, et à l’horizon le demi-cercle des collines de Norwood. Sur la gauche, un sentier auquel on accédait par une barrière et qui était si abrité que les convalescents venaient s’y promener dès le mois de mars; il était si paisible et si solitaire que, lorsque j’étais en mal d’écrire, que j’avais besoin de calme et de réflexion, j’y venais, le préférant au Jardin. De simples balises en bois, hautes de quatre Pieds, séparaient la route de la prairie; elles n’étaient là que pour empêcher les vaches de s’échapper. Hélas! depuis le temps où j’allais méditer dans le petit sentier, que de perfectionnements! Le besoin d’une nouvelle église s’étant fait sentir, on a bâti, en bordure de la prairie, une pauvre église gothique grêle dont le clocher n’est là que pour l’ornement; derrière, s’élève le presbytère, si bien que ces deux constructions bouchent les trois quarts de la vue. Ensuite, ce fut le Palais de Cristal, qui gâte irrémédiablement tout le panorama d’où qu’on l’aperçoive et qui, les jours de fête, attire une foule de piétons et de fumeurs dont le pauvre sentier gardait la trace toute la semaine. Puis ce fut le tour des chemins de fer qui vomissaient, par chaque train de plaisir, tous les voyous de Londres, et l’on sait que le plus grand plaisir de ces messieurs consiste à démolir les barrières, à effrayer les vaches et à casser les pauvres branches fleuries qui ont l’imprudence de s’avancer au-dessus des clôtures. Ce que voyant, les propriétaires en bordure firent élever un mur de briques pour se protéger.
Le joli sentier, devenu intolérable de chaleur et de saleté, fut bientôt abandonné aux rôdeurs, que l’on se contentait de faire surveiller de loin par un policeman placé à l’entrée. Enfin, cette année, c’est le comble! On a élevé en face du mur une palissade en planches de deux mètres de haut, si bien que le malheureux excursionniste est réduit à goûter de la campagne, comme air et comme vue, ce qui peut lui en arriver soit par-dessus le mur, soit par-dessus la palissade; il marche, avec l’odeur d’un mauvais cigare en avant, un autre en arrière, un troisième dans la bouche.
Je serais désolé que ce livre prît des allures maussades, des airs grognons, car ma disposition naturelle, dont je voudrais qu’il fût l’écho, est le plus souvent aimable — que l’on me pardonne cette apparence de fatuité — surtout quand on ne me contrarie pas. Je grognerai ailleurs, quand il faudra absolument que je grogne, et je note seulement en passant le tort fait aux habitants et aux promeneurs de Herne Hill, parce que les questions de droit de passage sont à l’ordre du jour et que, dans la plupart des cas, le passage est le moindre du vieux droit bien compris. Le droit devrait s’étendre à la jolie vue et au bon air.
Je tiens aussi à faire remarquer que, bien que l’on ait toujours en Angleterre la Grande Charte à la bouche, il y a peu d’Anglais qui sachent que l’une de ses principales clauses est l’interdiction de trafiquer de la loi. Or, il me semble que la loi anglaise pourrait conserver Banstead et autres terrains aux pauvres de l’Angleterre sans me faire payer, comme elle vient de le faire, deux mille cinq cents francs pour l’exécution temporaire de ce devoir d’ailleurs gratuit.
Il me faudra revenir plus tard sur ces années d’enfance afin de combler quelques lacunes, mais je tiens à expliquer ici (ce qui pourra paraître un peu fastidieux) que lorsque j’ai dit que «dans le jardin de Herne Hill tous les fruits étaient défendus», j’ai simplement voulu dire: défendus en dehors de certaines circonstances, car les cueillettes de fruits, selon les saisons, étaient de véritables fêtes, et la défense maternelle, sous son apparente sévérité, avait de grands avantages: la pêche que ma mère me donnait quand elle était certaine qu’elle fût mûre à point, la tarte dont j’avais trié les cerises une à une, afin de m’assurer qu’elles étaient bien rouges de tous les côtés, avaient pour moi une saveur qu’elles n’auraient pas eue pour un enfant habitué à manger des fruits à sa fantaisie; mais le plaisir absolument pur, le vrai bonheur était de voir le verger en fleur; je préférais mille fois ses fleurs à ses fruits. Quant aux jouissances gastronomiques, pommes de terre bien rissolées, petits pois fondants, grosses fèves ayant juste le degré d’amertume voulu, et les bocaux de prunes de Damas ou de groseilles, pour le remplissage annuel desquels on comptait encore plus sur le fruitier que sur le jardinier, me paraissaient d’une importance mille fois supérieure à la douzaine de brugnons dont on me donnait quelques bribes, ou aux deux ou trois boisseaux de poires que l’on gardait pour l’hiver. Si bien que, de très bonne heure, mes réflexions sur les arbres m’avaient amené à la conclusion donnée cinquante ans plus tard dans Proserpine, à savoir que graines et fruits n’étaient là que pour les fleurs, et non pas les fleurs pour les fruits. C’étaient les perce-neige qui me donnaient ma première joie de l’année; la seconde, la plus intense, je la devais aux amandiers en fleur; à partir de ce moment, c’était chaque jour, dans le jardin ou dans les bois, des plaisirs variés, une suite ininterrompue de fleurs brillantes ou de feuilles rougissantes; et pendant de longues années, ce que j’ai demandé au Ciel avec le plus d ardeur, c’est qu’à l’époque de la floraison la gelée épargnât les amandiers!