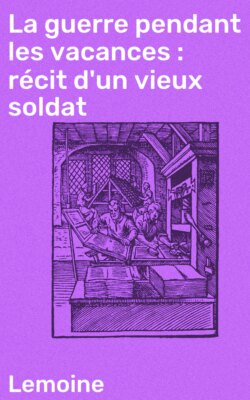Читать книгу La guerre pendant les vacances : récit d'un vieux soldat - Lemoine - Страница 4
ОглавлениеLE PARC
Mettez-vous là, et ouvrez les oreilles de manière à bien m’entendre. Ce n’est point un conte que je vous fais, c’est une histoire que je vous raconte, une histoire dans laquelle tout est vrai, tout jusqu’aux noms, et vous rencontrerez peut-être un jour les petits personnages qui vont figurer dans mon récit; seulement, comme il y a longtemps que ce dont je vous parle s’est passé, les enfants sont devenus des hommes, et c’est sous l’uniforme d’un général avec des épaulettes à graines d’épinard, sous le chapeau à plumes d’un intendant couvert de décorations et sous l’habit d’un médecin en chef de l’armée, que vous les retrouveriez à l’heure qu’il est.
Vous savez que la France est le plus beau pays du monde entier et qu’en France il y a peu de provinces qui puissent être comparées à certaines parties du Jura. Le Doubs, qui coule tantôt entre des coteaux couverts de bois et tantôt entre des prairies pleines de fleurs, a des bords si charmants qu’on ne peut les oublier quand on les a vus et qu’on les regrette toujours quand on les a quittés.
C’était sur les bords de cette belle rivière qu’était situé le château du général Grandjean, qui, après une glorieuse carrière, s’y reposait des fatigues de la guerre. Son fils, colonel d’un de nos braves régiments de chasseurs d’Afrique, avait été tué en chargeant contre les Bédouins. Le vieux général avait horriblement souffert de cette perte;. mais, comme c’était un homme d’un caractère très énergique, il était parvenu à surmonter sa douleur et avait tourné toutes ses pensées vers l’éducation des quatre enfants de son fils qui étaient venus habiter avec lui, ainsi que leur mère, après la mort du colonel. L’aîné de ces enfants était un beau garçon de quatorze ans nommé Georges; Marie, sa sœur, n’en avait pas encore neuf; Robert venait ensuite; enfin Louis, qu’on appelait habituellement M. Lolo, à cause de son air sérieux et réfléchi, fermait la marche.
Je vous laisse à penser quelles parties tout ce monde-là faisait dans le pare qui s’étendait derrière le château du général et descendait jusqu’à la rivière. Quand Georges, qui était déjà au collège, revint chargé de prix passer ses premières vacances auprès de ses parents, ce fut une fête complète. Ses frères l’aimaient beaucoup; Georges le leur rendait bien. Il avait cependant un peu d’amitié de plus encore pour sa sœur Marie. Il disait souvent que, tout jeune qu’il était, il se sentait la force de manger un homme de six pieds, s’il faisait la moindre peine à sa petite Marie. Ce fut justement cette grande amitié qui fut la cause de la guerre dont le parc fut le théâtre pendant les vacances de 18.., et dont je veux vous raconter les différents événements.
CE N’EST POINT UN CONTE QUE JE VOUS FAIS.
De l’autre côté du mur du parc, il y avait un jardin au milieu duquel s’élevait une jolie maison en forme de pavillon. Elle servait de demeure à M. Fontaine, avocat célèbre du barreau de Paris, qui venait y passer le peu de temps que ses occupations lui laissaient de libre, à l’époque où les juges et les tribunaux suspendent leurs travaux et où la justice, elle aussi, prend ses vacances. M. Fontaine était ami du général Grandjean, et chaque soir ils se réunissaient tantôt chez l’un, tantôt chez l’autre, avec quelques personnes des environs. Ils faisaient leur partie de whist, — jeu difficile, mes chers petits amis, que tout le monde croit savoir jouer et que peu de gens jouent bien.
M. Fontaine avait deux fils, Henri, qui avait à peu près l’âge de Georges Grandjean, et Paul, qui était un peu plus jeune. A l’exemple de leurs parents, les enfants vivaient en bonne amitié et parfaite intelligence, et la petite porte qui donnait du parc dans le jardin était les trois quarts du temps ouverte. On était continuellement les uns chez les autres. On jouait tous ensemble après les heures de travail, car, même pendant les vacances, le vieux général et M. Fontaine, qui savaient combien il est indispensable d’être instruit, exigeaient que leurs enfants travaillassent. Ils n’entendaient pas raillerie là-dessus. Ils prétendaient d’ailleurs, et ils avaient raison, que le temps est moins long et la récréation plus agréable lorsqu’on a pris à la journée quelques-unes de ses heures pour les consacrer à l’étude.
Marie Grandjean, qui ne pouvait pas prendre part à tous les jeux de ses frères et de leurs camarades, avait trouvé une petite compagne bien aimable et d’un bien bon caractère. C’était Louise de Brimont, qui habitait avec sa mère un château situé sur l’autre rive du Doubs et presque en face du parc de la famille Grandjean.
Le château où demeurait Louise s’appelait Azan; il avait appartenu anciennement aux comtes de Reculot, vieille et noble famille du pays, et qui ont une bien belle devise; c’est: «Je ne recule que de nom.» La mère de Louise avait acheté cette habitation et était venue s’y retirer avec sa fille dont elle faisait elle-même l’éducation. M. de Brimont, était bien loin, bien loin, dans des pays dont les noms écorchent les oreilles. Son père lui avait laissé de grands biens en Amérique; ils se trouvaient dans cette partie du Nouveau-Monde où il y a encore des peuplades sauvages, et M. de Brimont s’était décidé, plus facilement qu’un autre, à faire ce voyage. Il en avait déjà tant entrepris! Deux choses l’y avaient poussé : le soin de la fortune qu’il voulait laisser à sa chère Louise d’abord, ensuite la curiosité ; car M. de Brimont, qui avait vu des pays de toutes les couleurs, aurait voulu qu’il ne restât pas sur terre un petit coin qui lui fût inconnu. Quelquefois il disait en riant qu’il ne se consolerait jamais de ce qu’on n’eût pas encore trouvé le moyen d’aller voir dans les étoiles ce qui s’y passe, et que, si jamais on le découvrait, il se dépêcherait d’aller prendre son passe-port. S’il avait été prévenu à temps de l’expédition de la terre à la lune, de M. Jules Verne, il eût certes demandé à en faire partie.
Mme de Brimont trouvait un grand charme et une grande distraction à élever Louise. Du reste, cette jolie enfant avait une santé très délicate qui nécessitait tous les soins d’une mère aussi attentive que la sienne. Louise était si douce, si affectueuse, que Marie aurait voulu être jour et nuit avec elle. C’était avec regret qu’elle la voyait s’éloigner quand elles se quittaient, bien qu’elle fût certaine de la revoir le lendemain.