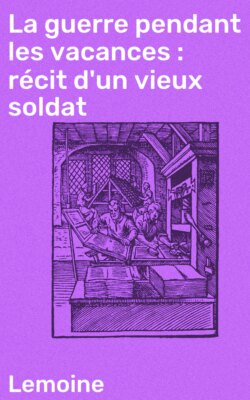Читать книгу La guerre pendant les vacances : récit d'un vieux soldat - Lemoine - Страница 5
ОглавлениеBROUILLE A MORT
Un jour, il arriva chez Mme de Brimont une dame alliée à sa famille et que M. de Brimont avait fortement engagée, avant son départ, à venir passer quelque temps à Azan pour tenir compagnie à sa femme. Mme Wolff, c’était le nom de la nouvelle arrivée, vivait en Suisse avec son mari et ses trois fils; mais M. Wolff n’avait pas beaucoup de temps à donner à sa famille. Il était ingénieur. C’est à peine s’il avait le loisir de prendre ses repas. Dès qu’il avait fini, il courait s’enfermer dans son cabinet au milieu de ses chiffres, de ses plans, de ses équerres et de ses compas, dont il ne se séparait qu’à la dernière extrémité. Il fallait presque employer la force pour l’arracher à son travail. Bien souvent il passait les nuits à travailler, et le jour, en se levant, le retrouvait encore comme il l’avait laissé la veille, le tire-ligne à la main.
Il était chargé de percer je ne sais quelle montagne; il avait promis qu’il s’occuperait de ce travail gigantesque de manière qu’il fût terminé dans un temps qu’il avait fixé, et lorsqu’on lui disait que sa santé se ressentirait de la grande fatigue à laquelle il se soumettait sans relâche, il répondait que les peines et la santé devaient être comptées pour rien quand il s’agissait de tenir sa promesse et de remplir un engagement.
Mme Wolff était la meilleure femme du monde; mais elle n’avait pas dans le caractère la fermeté nécessaire pour conduire ses trois garçons. Il en était arrivé que, sans être méchants, c’étaient de vrais diables à quatre, et que dans leurs jeux ils avaient l’air de chevaux échappés. L’aîné se nommait Franck, le second Rodolphe, le troisième Albert.
Une fois installés à Azan, ils firent vite connaissance avec les petits Grandjean et les petits Fontaine, et pendant que Louise et Marie cueillaient des fleurs, soignaient leurs jardins, travaillaient à des trousseaux qu’elles donnaient ensuite aux enfants pauvres de la campagne, ou se promenaient en causant des choses qu’elles avaient lues ou entendues, les garçons des trois familles faisaient des courses, des sauts, des bonds. C’étaient des parties de balle, de cerceau, de chat-coupé et de barres interminables. Ils y mettaient un tel entrain qu’on entendait leurs cris joyeux d’un bout du parc à l’autre et que le père Mélin, garde-chasse du général Grandjean, disait en branlant la tête et en secouant la cendre de sa vieille pipe: «A-t-on jamais vu! a-t-on jamais vu! (c’était le dicton du père Merlin.) — A-t-on jamais vu, disait-il donc, des gaillards comme, ça! ils sont capables de mettre le feu à la rivière; c’est pas des enfants, à proprement parler, c’est des lions déchaînés.»
Le domestique qui avait soin des chevaux du général, et qui avait servi sous ses ordres comme soldat, avait toujours soin le dimanche de fermer à double tour la serrure de l’écurie et de mettre la clef dans sa poche. Il craignait que les diablotins (c’était le nom qui était définitivement et généralement adopté pour exprimer la troupe de garçons qui prenait ses ébats dans le parc et qui se composait de Georges, de Robert et de Louis (M. Lolo) Grandjean, de Henri et de Paul Fontaine, de Franck, de Rodolphe et d’Albert Wolff), il craignait, dis-je, que les diablotins ci-dessus désignés n’allassent tourmenter les chevaux, qui étaient très vifs, et ne reçussent quelque coup de pied. On ne prenait pas la même précaution pour l’armoire où étaient les fusils; le général avait un jour réuni tous les enfants et leur avait raconté l’histoire de tant de malheurs arrivés par des imprudences ou des maladresses de gens qui ne savent pas se servir des armes, qu’ils avaient donné leur parole d’honneur que jamais ils n’approcheraient de l’armoire aux fusils. Le général, qui leur avait souvent fait comprendre que la parole d’un homme d’honneur et d’un enfant bien élevé est une chose sacrée, voulait, en laissant la clef à l’armoire, leur faire voir qu’il avait confiance dans ce qu’ils lui avaient juré solennellement. Il disait qu’il ne reverrait de sa vie celui qui, sans sa permission, aurait eu seulement l’idée d’approcher de l’armoire défendue.
Comme surcroît de précaution, le père Mélin, qui, en sa qualité de garde-chasse, avait les fusils sous sa direction, s’arrangeait pour qu’il n’y en eût jamais de chargés quand on les remettait en place. Le potager et la basse-cour étaient ouverts aussi; aucun des enfants n’était gourmand, et il y avait tant de fruits qu’ils ne pensaient pas à prendre en cachette ceux qui étaient sur les quenouilles, puisqu’on leur donnait ceux qu’ils désiraient, pourvu qu’ils fussent mûrs. Dans la basse-cour, messieurs les diablotins faisaient quelquefois, à la vérité, courir les canards et les oies un peu plus vite qu’il n’eût fallu; ils s’amusaient aussi trop souvent à imiter le cri des dindons, et ne s’arrêtaient, dans cet étrange exercice, que quand ils étaient aussi rouges que les crêtes de leurs modèles; mais ils n’approchaient pas des poules qui avaient des poussins, parce qu’ils savaient par expérience que ces pauvres bêtes, auxquelles leur amour maternel donne un grand courage, vous sautent très joliment aux yeux quand elles craignent qu’on ne fasse du mal à leurs petits. Ils n’approchaient pas de la faisanderie, parce qu’à la porte qui y conduisait il y avait un gardien qui s’appelait M. Turc. C’était un énorme chien des Pyrénées à poils longs et rudes, jaunes et blancs; il avait une gueule et des dents à ne faire qu’une bouchée de celui qui aurait voulu violer sa consigne. Le souvenir était resté d’un imprudent polichinelle qui ne s’était tiré de ses crocs qu’avec un bras de moins. Ils n’allaient point non plus tourmenter les lapins ni les empêcher de manger leurs carottes; il y avait tout près de la cage aux lapins une petite maisonnette où logeait Mlle Rose, qui ressemblait un peu plus à un grenadier qu’à une fleur. Mlle Rose était chargée du soin de la basse-cour, et quand on venait faire enrager ses élèves et qu’elle n’était pas de bonne humeur, elle empoignait son grand balai, un balai formidable, mes chers enfants, et courait les bras levés sur l’imprudent, quel qu’il fût, qui venait troubler la paix de son royaume; elle était forte comme trois hommes ordinaires et disait qu’avec son balai elle mettrait un escadron de Cosaques en déroute.
Un certain dimanche, après avoir entendu la messe à Azan, on s’était réuni chez le général qui, pour fêter l’arrivée de Mme Wolff, donnait un grand déjeuner. Tout le monde, c’est ainsi que le général appelait sa société habituelle, devait se trouver autour de sa table à manger, qui fut bien servie et bien entourée surtout. Ce jour-là, outre les personnes raisonnables, et dans ce nombre je comprends Mlles Louise et Marie, il s’y trouvait huit garçons qui, à peine le repas commencé, auraient déjà voulu être au dessert, pour le dessert d’abord, mais surtout pour aller reprendre leurs parties. Le dimanche il y avait repas général et cessation de travail sur toute la ligne.
A la fin du repas, qui fut gai et animé, les enfants s’envolèrent comme une volée de perdreaux, les. uns sur la pelouse, les autres dans les allées du parc.
On était au mois d’août. Malgré la chaleur, les enfants, habitués au grand air, s’occupaient peu de chercher l’ombre; ils allaient, sans autre protection pour leur teint que leurs chapeaux de paille ou leurs casquettes. — Ils auraient bien ri si on leur avait fait voir un de nos soi-disant élégants d’aujourd’hui, un de ceux qui ont imaginé de se mettre des voiles verts, comme les dames, pour se préserver le visage quand ils vont à la campagne, et qui n’osent pas se déganter de peur de se brûler les mains aux rayons du soleil, un de ceux qui mériteraient qu’on leur coupât la barbe et qu’on leur mît un jupon, si toutefois de pareils efféminés n’étaient indignes d’en porter un. — Toute la bande de nos garçons avait la figure et les mains un peu hâlées, mais ils n’en étaient que plus beaux, et avec leurs yeux vifs, leur air de santé et leur vivacité, ils réjouissaient le cœur de tous ceux qui les voyaient. Quand ils revenaient ayant bien couru et souvent en nage, on ne les grondait pas, et leurs mamans, fières de les voir si forts et si adroits, se bornaient à leur essuyer le front avec leur mouchoir et à leur donner un bon baiser par-dessus le marché, prétendant qu’il n’y avait rien de tel pour finir de les sécher.
Tout allait pour le mieux dans notre petite colonie; mais, comme disent les marins, quand le ciel est trop pur, quand la mer est trop calme, il faut s’attendre au tonnerre et à la tempête.
Ce fut du jardin de Mlle Marie que partit l’éclair qui devait tout mettre sens dessus dessous, et voici comment cela arriva:
MARIE, s’adressant en pleurant aux garçons formés en cercle autour d’elle. Qui est-ce qui a saccagé mon parterre de fleurs que j’arrosais si précieusement? Celui-là ne peut être qu’un méchant.
FRANCK, entrant dans le cercle et se posant fièrement devant Marie. C’est moi! pas d’autres. Qu’on n’accuse personne, et je ne me crois pas un méchant garçon parce que j’ai pris quelque méchantes fleurs dans le jardin de Mlle Marie pour les donner à Louise. Il n’y a pas de quoi pleurer. Ne dirait-on pas que c’est un grand malheur, ma foi! Il faut être de bien désagréable humeur, pour faire tant de bruit pour si peu. — Ça n’est pas beau d’être avare de ses fleurs!!! Mademoiselle! !!
MARIE, piquée. Puisque vous m’appelez mademoiselle, je vous dirai, monsieur Franck, qu’il est encore moins beau de prendre ce qui est aux autres et de détruire tout un parterre pour faire un bouquet avec des fleurs qui ne vous appartiennent pas. Il me semble, monsieur, que vous pouviez bien au moins me demander la permission si vous aviez envie de donner mes fleurs à Louise.
FRANCK. Oui, pas mal! vous m’auriez donné la permission de prendre... les plus laides... les fanées!!! Je connais ça!
MARIE. Oh! si on peut parler ainsi! Tenez, allez-vous-en, monsieur Franck, je vous défends de me parler.
LOUISE, embrassant Marie et lui tendant le bouquet que lui a donné Franck. Je suis bien fâchée, ma chère Marie, je ne savais pas d’où venaient les fleurs que Franck m’a données. Si j’avais su qu’il les eût prises dans ton jardin, je ne les aurais pas acceptées. Veux-tu que je te les rende et que nous allions réparer le désordre que Franck à mis dans ton parterre?
FRANCK. J’irai avec vous; vous verrez, Louise, qu’il n’y a pas tant de dégât qu’on veut bien le dire. En cinq minutes je veux qu’on n’y voie plus rien, et que ce soit plus beau qu’avant. Allons, venez-vous?
MARIE. Monsieur Franck, je vous prie de rester où vous êtes; je n’ai pas besoin de vous. Louise gardera son bouquet si elle le veut; moi, je rentre à la maison, et je vais prier ma mère de faire mettre autour de mon jardin une barrière bien haute et une bonne serrure pour empêcher les pillards d’y entrer.
LOUISE, retenant Marie. Tu es fâchée, ma chère Marie, ne me quitte pas ainsi! Il n’y a pas de ma faute. Ce serait la première fois que nous nous bouderions. Voyons, sois bien gentille. — Franck...
QUI EST-CE QUI A SACCAGÉ MON PARTERRE?
MARIE, se dégageant. Je vous dis que M. Franck est un méchant garçon. Si vous le soutenez, tant mieux pour lui! Moi, je vous le répète, je vais tâcher, si c’est possible, de mettre mon parterre à l’abri des...
FRANCK. Des... des... de quoi?... Voulez-vous dire qu’on vous les a volées, vos vilaines fleurs?... Je m’en moque pas mal de vos fleurs... D’abord je ne sais pas pourquoi je les ai cueillies; elles étaient affreuses, vos fleurs! Vous faites bien votre fière! Voyez donc madame la princesse, avec son parterre! Son parterre! Vous pouvez bien y faire mettre des barrières à votre beau parterre; ce n’est pas ça qui m’empêcherait d’y entrer, si je voulais. En attendant, apprenez, mademoiselle, que je ne suis pas un voleur, comme vous aviez envie de le dire, et que vous, vous êtes une pimbêche.
MARIE, en sanglots. Pimbêche! Je ne vous pardonnerai jamais ce mot-là... Oh! c’est affreux! c’est affreux! Ils sont tous là à se regarder, et personne ne prend mon parti.
(Elle s’en va en mettant son mouchoir sur ses yeux.
Louise la suit en cherchant à la consoler.)