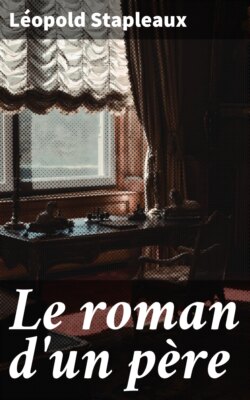Читать книгу Le roman d'un père - Léopold Stapleaux - Страница 5
ОглавлениеIII
Richard n’avait point assisté au mariage de son père.
Un mot d’Henri l’eût fait revenir; mais ce mot, Renaud ne l’écrivit point, et son fils ne manifesta, dans la lettre qu’il lui adressa ausujet de ce mariage, nul désir assez puissant pour le provoquer.
Rien pourtant, même une femme, ne pouvait altérer l’affection du père et du fils; mais à la veille de donner à Marguerite le même nom que la mère de Richard avait porté, Renaud, sans s’arrêter à ce scrupule véritablement outré vis-à-vis d’un jeune homme de vingt-quatre ans, redouta d’éveiller en son cœur la moindre pensée fâcheuse, et, avouons-le, ivre de son bonheur, tout à son amour, fut presque heureux de pouvoir se consacrer entièrement à Marguerite, loin des yeux du seul être qui, avec elle, devait occuper la meilleure place dans son cœur.
Le jour de son mariage, Renaud partit avec sa femme.
Leur voyage dura deux mois.
Ferrand était resté à Chatou avec Angèle.
Dès que madame Renaud eut quitté le chalet, dont la fin de l’automne avait assombri quelque peu l’aspect en le privant, en grande partie, du gai feuillage à l’abri duquel il bravait les flèches d’or du soleil d’été, ce charmant asile sembla d’une tristesse extrême à la jeune fille.
L’absence de Marguerite la privant d’une amie qui depuis l’enfance ne s’était jamais séparée d’elle, avait chassé le rire de ses lèvres et lui avait, pour la première fois, fait comprendre la monotonie de sa paisible vie.
Certes, elle adorait son père; mais Ferrand appartenait plus encore à son art qu’à sa fille, et, malgré toutes les complaisances dont il n’était pas avare envers elle, il ne pouvait nullement remplacer Marguerite.
Lorsqu’une lettre de celle-ci arrivait, c’était une fête.
Chaque missive de la jeune femme était divisée en deux parties, dont l’une était exclusivement destinée à Angèle.
L’autre, que le peintre lisait avec sa fille, n’était que la constatation du bonheur complet de madame Renaud et le récit des excursions que lui faisait faire son mari.
Celle qu’Angèle lisait en cachette était la suprême et sincère expression des pensées de Marguerite.
Tout à son rôle de confidente, mademoiselle Ferrand répondait longuement à sa chère cousine, lui donnant des conseils, et tâchant de chasser de l’esprit de l’absente certaine préoccupation visible, quoique mal définie, dont l’existence apparaissait clairement dans ses lettres intimes.
Régulièrement une fois par semaine, Angèle pouvait donner tout son temps à sa chère correspondance; mais en dehors du dimanche, que Ferrand voulait bien consacrer entièrement à sa fille, les autres jours paraissaient à celle-ci d’une interminable longueur.
Ferrand finissait alors, pour le Salon qui allait s’ouvrir, un Léonidasaux Thermopyles, auquel il travaillait tout le jour et pensait toute la nuit.
Tant que ce tableau ne fut pas complètement achevé, il ne s’aperçut point du vide que l’absence de Marguerite avait fait dans sa maison, ni de la tristesse douce, mais évidente, que ce vide causait à Angèle; mais dès que sa toile fut placée, vernie, et qu’il n’eut plus qu’à attendre l’arrêt des amateurs et des critiques influents, l’air morose de sa fille chérie le frappa.
Angèle n’avait aucune raison pour cacher la cause de son chagrin à son père.
Ferrand le traita d’enfantillage, néanmoins il fit tous ses efforts pour distraire Angèle, mais ce fut en vain; et il allait supplier Henri de revenir, lorsqu’un incident inattendu vint donner au chalet une animation nouvelle.
Un matin, la cloche de la grille retentit, et la servante du peintre vit à travers les barreaux un robuste garçon de vingt à vingt-trois ans, ni beau ni laid, portant un peu longs et négligemment rejetés en arrière, ses cheveux châtains, de même teinte que ses moustaches et que sa mouche taillées à la Van-Dyck.
Un teint vif, des yeux gris-foncé, intelligents plus que résolus, et un nez assez large, dont le mot ordinaire eût été le signalement dans un passe-port, complétaient l’ensemble de sa physionomie franche et ouverte, qui respirait l’insouciance et la probité.
Vêtu simplement, quoique avec une certaine recherche dans laquelle dominait l’excentrique, le nouveau venu portait un carton à dessins sous le bras.
Lorsque la servante de l’artiste, après lui avoir ouvert, lui demanda qui elle devait annoncer à son maître:
–Lambert Bonnichon, futur peintre, répondit le jeune homme.
Fils d’un épicier de la rue des Lombards, qui lui avait fait donner une éducation assez soignée, tout en le destinant cependant à lui succéder un jour, Lambert avait joui de bonne heure d’une liberté très-grande, et jusqu’à l’âge de dix-huit ans, avait considéré sans frémir la triste perspective de trafiquer sur les denrées coloniales plus ou moins falsifiées, à l’enseigne du Pain couronné.
Toutes les vocations ne se manifestent pas de bonne heure chez ceux qui doivent les avoir, et souvent le plus mince événement les fait se révéler, avec d’autant plus de puissance alors que celui chez qui l’une d’elles apparaît, est resté longtemps sans soupçonner l’aspiration latente qu’il avait en lui.
Lambert était un exemple frappant de cette vérité: il n’avait jamais touché un crayon et n’avait vu que des enseignes, lorsqu’un jour il entra au Louvre.
L’aveugle à qui tout à coup la lumière est rendue n’éprouve pas de plus formidable éblouissement que celui dont le jeune Bonnichon subit la puissante influence. Dès ce moment, tout un art, un monde, un culte se révéla à son imagination.
Comme les païens peuplèrent l’Olympe, il se créa des dieux nouveaux, et adora Rubens, Rembrandt, le Corrége, Raphaël et le Titien, avec une ardente ferveur, dont la grandeur ne fut égalée que par l’impérieux désir qu’il ressentit immédiatement de marcher sur les traces de ces poëtes sur toile.
–Je serai peintre, je le jure! dit-il, et nul ne m’en fera démordre.
Et il se mit aussitôt à réfléchir aux moyens à employer pour réaliser ce gigantesque projet.
Le confier au père Bonnichon eût été une folie.
Lambert le comprit immédiatement.
En voyant son unique héritier renoncer à lui succéder un jour, l’honnête épicier devait évidemment tenter tout au monde pour le retenir sur ce qu’il n’aurait point manqué d’appeler: le bord de l’abîme!
Persuadé de cette navrante vérité et édifié sur l’influence négative que possédait madame Bonnichon, sa mère, sur l’esprit entier du digne marchand de denrées coloniales, Lambert adopta un projet de conduite persuasif et conciliant qu’il mit rapidement à exécution en se présentant dès le lendemain chez un peintre célèbre dont l’atelier comptait de nombreux élèves.
–Monsieur, lui dit Lambert, je veux devenir peintre, et je serais excessivement flatté d’être admis au nombre de vos disciples.
–Très-bien, jeune homme. Que savez-vous déj à?
–Rien.
–C’est peu.
–Oui; mais je sens que j’apprendrai vite. Seulement, je vous préviens d’avance que je ne pourrai pas vous payer tout de suite. Mon père résisterait à mes désirs si je lui en faisais part immédiatement, et je ne pourrai lui avouer que je prends vos leçons que lorsque je serai à même de lui prouver que j’en ai sérieusement profité.
La franchise et la conviction du jeune Bonnichon charmèrent l’artiste, qui l’installa dans son atelier.
Six mois après, un grand jour sonnait pour Lambert.
Il avait tenu parole en profitant des conseils de son maître d’une façon étonnante: aussi avait-il dessiné pour ce jour-là, jour de la Saint-André, patron du papa Bonnichon, une tête fort réussie, d’après la Danseuse de Canova.
A l’heure du repas, Lambert, portant triomphalement sous le bras son chef-d’œuvre, qu’il avait fait splendidement encadrer, se dirigea vers la rue des Lombards.
Le cœur lui battait un peu. Quelle révélation pour le chef de la famille Bonnichon!
Son fils ne serait pas un simple épicier, mais un artiste capable un jour de rendre le nom de Bonnichon l’égal de ceux des princes de l’art!
Bercé par cette riante perspective, Lambert jouissait déjà de l’étonnement de son père, de ses exclamations admiratives, et se voyait couvert, à la fin, des plus chaudes larmes que l’attendrissement puisse jamais procurer à un épicier.
Mais rien ne se passa ainsi que l’espérait le jeune rapin. A la vue du dessin, le père Bonnichon resta froid; et lorsqu’il en connut l’auteur, il lui adressa une verte semonce.
Le moment était critique.
Lambert n’en comprit pas tout le danger, et alors qu’il eût fallu employer tous les ménagements possibles, déclara hautement son irrévocable détermination artistique.
C’en était trop.
Le père Bonnichon entra en fureur, brisa le verre qui recouvrait le dessin de son fils, et piétina dessus avec rage.
–C’est du vandalisme! s’écria Lambert avec autant de colère que de chagrin.
–Tu m’insultes, misérable! s’écria l’épicier à ce mot qu’il n’avait pas compris. Eh bien! je te chasse!
Ce fut en vain que madame Bonnichon voulut calmer son mari, et les parents de l’épicier qui assistaient à cette scène de famille eurent toutes les peines du monde à l’empêcher de maudire Lambert, qui quitta la maison paternelle avec toute la dignité et le calme plein de résignation qui conviennent aux génies incompris.
Après avoir erré toute la nuit dans Paris, Lambert, plus résolu que jamais à suivre la difficile carrière qu’il avait embrassée, alla dès le jour tout raconter à son maître. Celui-ci avait foi dans l’avenir du jeune homme, et loin de ne plus l’admettre, il lui offrit généreusement une hospitalité complète.
Dès ce jour, Lambert vécut dans le milieu artistique et il fit de sensibles progrès.
Quatre années s’écoulèrent.
Le père Bonnichon demeurait inflexible.
Sa femme, qui voyait Lambert en cachette, car l’épicier ne l’appelait plus que «mon gredin, mon fainéant de fils,» afin d’amener un rapprochement entre eux, avait fait plusieurs tentatives, qui toutes étaient restées infructueuses.
Un jour, le vieux maître de Lambert mourut.
Ce fut une grande douleur pour ce dernier.
L’atelier se ferma.
Et après les discours qui furent prononcés sur la tombe du digne homme, sauf ses toiles qui du Luxembourg furent transportées au Louvre, il ne resta plus de lui qu’une pierre au cimetière Montparnasse sur laquelle fut gravé son nom sous une banale phrase de regret.
Un mois après l’événement, Lambert y fit un saint pèlerinage, et y déposa une fraîche couronne d’immortelles, symbole de reconnaissance et d’admiration.
Puis il chercha un directeur nouveau dans la route ardue qu’il s’était volontairement tracée.
Il hésitait entre deux ou trois notoriétés, lorsqu’il se rendit au Salon qui venait de s’ouvrir.
Le tableau de Ferrand frappa ses regards.
Son plan fut instantanément arrêté.
Il acheta le catalogue officiel, chercha le nom du peintre, et lut:
FERRAND (Louis-Auguste), né à Saint-Maur (Seine), élève de Davjd. Méd. 2e cl. (Histoire), 1823.–Méd. 1re cl. 1835.–#3030avril1836 –[EX].
A Chatou, route de Croissv, 22.
Le lendemain Bonnichon prenait le train de Saint-Germain, et arrivait une demi-heure après à la grille du chalet de l’oncle de madame Renaud, où, ainsi que nous l’avons vu, il était reçu par Ursule, qui ne tarda point à l’introduire dans l’atelier de Ferrand.
–Je n’ai jamais pris d’élève, monsieur, dit le peintre à Lambert, lorsque celui-ci lui eut exposé le but de sa visite.
–Je ne suis pas précisément un élève, monsieur, et voici ce que je sais faire, répliqua Bonnichon, en tirant une ébauche de son carton et en la présentant à l’artiste.
–Où avez-vous fait cela?
–Au Louvre, monsieur.
Ferrand, tout en admirant l’ébauche, hésitait encore.
–Monsieur Ferrand, fit Lambert avec conviction, si vous ne consentez pas, je me fais photographe!
Ce mot terrible vainquit toutes les hésitations de l’artiste, et dès ce moment Lambert ne quitta plus le chalet.