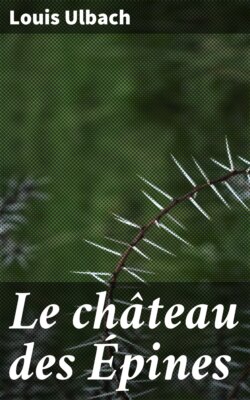Читать книгу Le château des Épines - Louis Ulbach - Страница 5
III
LA SÉPARATION
ОглавлениеUne grande partie de la matinée s’écoula, sans que le comte eût manifesté sa présence au château. Les domestiques allaient et venaient pour le service, paraissant ignorer son retour.
Était-il reparti clandestinement, comme il était arrivé? S’était-il repenti de sa violence? Dressait-il un piège nouveau?
Antonie, après s’être adressé ces questions, sans pouvoir y répondre, descendit dans le jardin. Si quelqu’un la guettait, elle voulait prouver l’inaltérable fermeté de sa conscience, en reprenant sa vie de la veille. Elle était seulement très pâle, et ses yeux bleus paraissaient plus doux et plus beaux dans le cercle de bistre dont l’insomnie les avait entourés.
Madame de Sabaillan était douée de ces physionomies dont l’attrait insinuant ne s’affirme par aucun éclat particulier, mais qui se fixe dans une empreinte ineffaçable sous une lumière continue.
Ses cheveux châtains paraissaient blonds, tant la clarté débordait du visage. Sa taille moyenne paraissait grande, tant elle avait pris l’habitude, à certains moments d’autorité charmante, de se hausser, de se grandir du geste et, pour ainsi dire, du regard.
Sa jeunesse pauvre, son séjour prolongé dans une institution, d’où elle était sortie pour aller instruire à domicile, lui avaient imposé une correction légèrement puritaine de maintien, de toilette, de langage, qu’elle corrigeait de son mieux, quand elle avait le temps d’y songer, par une coquetterie toute naïve et, par là, toute-puissante.
Il fallait vivre dans son intimité pour subir son charme; mais on ne pouvait s’y soustraire quand on l’avait subi. Elle n’était pas remarquée à première vue: elle n’avait pas à recevoir et à repousser des hommages embarrassants pour sa modestie; mais elle comprenait, dans l’ingénuité de son estime pour soi-même, qu’on n’avait aucune raison de cesser de l’aimer, quand on la connaissait.
La force de son caractère était latente et voilée comme la grâce de son extérieur, mais elle était aussi réelle que peu visible.
J’ai dit comment elle était devenue comtesse de Sabaillan. Elle ne se repentait pas d’avoir accepté ce nom, bien qu’elle n’eût pas sur son mari toute l’influence qu’elle avait rêvée, et bien que l’exubérante floraison de Céline de Sabaillan eût déconcerté la tendresse inquiète de l’institutrice.
Mais, sans se repentir, elle souffrait des responsabilités de sa maternité; elle les acceptait comme une épreuve, comme un châtiment d’un peu de présomption.
Le contraste entre la belle-mère et la belle-fille était une sorte de provocation de la nature.
Un philosophe eût compris tout de suite qu’il ne pouvait y avoir qu’un antagonisme perpétuel, longtemps dissimulé sous les verdeurs de la première jeunesse entre cette fille hardie, insoumise, et cette femme contenue, résignée. En observant avec soin, peut-être fût-il arrivé vite à deviner que la passion qui palpitait pour ainsi dire à la surface de cette créature phosphorescente s’évaporait dans l’air agité par elle, mais qu’elle se concentrait sous la placidité extérieure et sous la ferme volonté d’Antonie.
Madame de Sabaillan s’arrêta sur la terrasse supérieure et regarda au loin.
Le jardin, au-dessous d’elle, était vert, embaumé, paisible. Elle entendait râteler les allées. Un aide-j ardinier, qui suppléait Martial, faisait son office en chantant.
Devant la façade de la maison, dorée par le soleil, des hirondelles, qui bâtissaient leur nid sous un balcon du premier étage, passaient avec un petit cri.
Derrière le château, dans le clocher de l’église, on sonnait pour un mariage. Un air de fête et de bonheur vibrait dans l’atmosphère de cette belle matinée d’été.
Antonie soupira et descendit plus vite l’escalier de la seconde terrasse. Quand elle fut au bas, près des pelouses qui s’étendaient, en alternant avec des massifs et des allées, jusqu’à la haie de clôture, elle aperçut tout au fond du jardin Céline qui l’avait devancée, et se hâta d’aller la rejoindre;
Mademoiselle de Sabaillan ne l’entendit pas venir. Elle était occupée à refermer la petite porte à claire-voie dans la haie d’épines. Dès qu’elle eut fini, elle se retourna, releva la tête, vit sa belle-mère et lui dit:
–Je ne te croyais pas levée!
–Tu as été bien matinale!
Elles se regardèrent, chacune interrogeant l’autre et voulant la prendre en flagrant délit d’enquête et d’inquiétude.
–Tu m’avais gâté mon sommeil, reprit Céline avec une nonchalance affectée et ironique; j’ai eu ce matin des idées absurdes. J’ai voulu m’en débarrasser, et je suis venue me promener.
–Au bord de la rivière?
–Oui.
–Qu’as-tu remarqué?
–Rien.
Un petit silence suivit. Antonie était toujours très pâle. Céline ne voulait pas l’être. D’un ton dégagé qui lui coûta un léger effort:
–Où est mon père?
–Je l’ignore.
–J’ai été dans sa chambre sans l’y trouver; aucun domestique ne l’a vu.
–As-tu interrogé Martial?
–Non, il est sorti.
–Avec ton père, probablement.
Antonie jugea sans doute superflu de recommencer en détail l’inspection que venait de faire Céline sur le chemin, au bord de l’eau. Elle se borna à jeter un long coup d’œil par-dessus la haie basse.
Le Loiret coulait dans un frétillement de lu-–mière; le soleil avait renouvelé les agaçantes broderies de la lune; l’herbe ne semblait pas avoir été froissée au bord. Là, comme dans le jardin, comme au ciel, tout paraissait animé d’une gaieté sereine; tout excluait les idées lugubres, les évocations de meurtre.
Le jardinier s’approcha des deux promeneuses; il allait effacer sous son râteau, dans cette partie du jardin, ainsi qu’il l’avait fait ailleurs, les traces de pas. Antonie interrogea; mais aucune n’indiquait une lutte, ne rappelait une scène de violence.
Céline, qui observait sa belle-mère, lui dit à demi-voix:
–Avoue .que tu as voulu me faire peur, cette nuit?
–Non.
–Regarde si tout ne Le donne pas un démenti.
Antonie regarda par complaisance, mais en conservant sa tristesse pensive. Elle ne répliqua pas et reprit une allée pour revenir à la maison. Céline marchait à côté d’elle. Aucun mot ne fut échangé dans le trajet. A l’approche de la terrasse, elles virent toutes deux ensemble M. de Sabaillan qui venait de leur côté.
Lui ne démentait rien des émotions de la veille.
Il paraissait accablé. Son visage, d’un teint mat, avait ce matin-là de rouges marbrures, qui semblaient des empreintes de doigts sanglants. Ses yeux, noirs comme ceux de sa fille, remuaient sous des sourcils épais et grisonnants une lueur intermittente.
D’ordinaire, le colonel, même dans les circonstances les plus graves, ne faisait aucune infraction à cette habitude de tenue correcte qu’il avait contractée au régiment. Mais, cette fois, l’oubli était flagrant et éloquent; il révélait un débraillement moral, supérieur au courage du soldat, à l’orgueil du gentilhomme.
Il était évident que le colonel n’avait pas pris une minute de repos pendant la nuit; qu’il n’avait rien changé à sa toilette; que celle-ci, aux souillures d’un voyage long et précipité, ajoutait encore les traces de l’insomnie, ainsi que la poussière des courses matinales faites dans le village et la campagne.
Sa moustache, toujours soigneusement tordue et maintenue inflexible, tombait sur la bouche, qui la mordillait. On sentait, on voyait un premier affaissement, les menaces d’un effondrement, dans l’attitude de cet homme, qui ne pouvait plus dissimuler son âge et qui s’avouait soudainement vieilli, n’ayant jamais jusque-là laissé voir qu’il devenait vieux.
Antonie s’arrêta, prise de pitié plutôt que de terreur.
–Comme il est changé! pensa-t-elle.
Céline constatait aussi ces ravages et s’en alarmait comme d’une menace. Elle eut un léger frisson et s’appuya sur le bras de sa belle-mère.
–Prends garde! lui dit vivement madame de Sabaillan, nous aurions l’air d’avoir échangé dés confidences.
Céline s’écarta d’Antonie.
–Tu deviens pâle! lui dit encore celle-ci; prends garde.
Mademoiselle de Sabaillan aussitôt se mit à rire aux éclats, pour faire jouer les muscles de son visage et dissiper sa pâleur. Elle affecta une surprise joyeuse, et, avançant presque en sautant au-devant de son père:
–Tu viens donc d’arriver? lui demanda-t-elle.
Elle n’attendit pas sa réponse. Elle se jeta à son cou et l’embrassa à plusieurs reprises, chaudement, nerveusement, sur les joues, dans le cou, aux places qu’il aimait, l’ébranlant et l’émouvant de l’assaut d’une tendresse inaccoutumée, avec un art prodigieux qui révélait par explosion la coquetterie d’instinct, la science féminine de cette créature faite pour séduire.
La paternité de M. de Sabaillan avait un fond orgueilleux et sensuel. Ce père adorait sa fille, parce qu’il la trouvait extraordinairement belle. La pureté d’un sentiment ne chasse pas toujours une sorte de volupté sournoise qui se mêle à toutes les affinités humaines.
Dans sa colère, dans son remords, ce mari devenu meurtrier éprouvait un soulagement subit, une détente, à recevoir ces caresses, qui étaient sa grande gourmandise.
Il les rendit à sa fille avec une larme; puis, craignant de trop accorder à son attendrissement, il serra les deux mains de Céline, en l’éloignant de lui:
–Va, mon enfant, tout préparer; je t’emmène, nous partons.
–Céline surprise, mais triomphant de son étonnement, donna un gros baiser filial à son père, hésita à regarder sa belle-mère, et n’envoya à celle-ci un bon coup d’œil d’adieu, d’encouragement, de remerciement et de recommandation, que lorsqu’elle fut elle-même sur les premières marches de l’escalier de la terrasse, hors de la portée de son père.
Madame de Sabaillan était restée en face de son mari, sans crainte, sans provocation, grave, simple, résolue dans sa tristesse.
Dès qu’ils furent seuls, le comte lui dit:
–Vous avez entendu, madame; je repars avec ma fille.
–Et moi?
–Vous restez ici.
–Il était plus simple de me chasser!
–Il est plus simple de ne rien ébruiter, jusqu’à ce qu’il vous plaise de me déclarer la vérité.
–Je vous l’ai dite.
–Vous m’avez dit que vous n’aviez pas d’amant, reprit M. de Sabaillan, en ranimant sa colère lassée par une nuit d’angoisses; mais je ne vous crois pas.
–Je vous pardonne de ne pas me croire; les apparences sont contre moi; mais je vous plains de toute mon âme.
–Est-ce pour me railler que vous me parlez ainsi?
–C’est bien sincèrement, je vous le jure.
–N’ai-je pas vu un homme s’introduire ici?
–Sans doute.
–Ne l’attendiez-vous pas?
–Peut-être.
S’il ne venait pas pour vous, pour qui donc venait-il?
Le comte fit un geste en se tournant à demi, comme s’il allait rappeler Céline. Sa femme l’arrêta.
–Il venait pour moi, puisque j’allais au-devant de lui.
–M’expliquerez-vous alors?…
–Je ne puis rien vous expliquer.
–Rien! et vous voulez que je me satisfasse de cette réponse?
–Je veux que vous vous souveniez que je ne vous ai jamais menti, et que, même au prix de ma vie, même au prix de ma renommée, que vous appelez mon honneur, je ne veux pas mentir. Oui, un homme est venu. Ce n’était pas un amant; c’était un ami, dépositaire d’un secret que je partageais avec lui. Puisque vous l’avez guetté, puisque vous l’avez frappé, il fallait le fouiller: peut-être auriez-vous trouvé le mot du mystère que je n’ai pas le droit de vous livrer.
La fermeté tranquille, la douceur avec laquelle Antonie parlait, intimida M. de Sabaillan. Il porta ses deux mains à son front, chancela presque, . comme pris de vertige. Un banc du jardin était tout près de là, il alla s’y asseoir. Antonie s’approcha avec une compassion qu’elle tenait prête à intervenir, mais qu’elle n’osait montrer, de peur de la faire calomnier.
–Je me suis juré d’être calme, dit M. de Sabaillan, après quelques minutes et d’une voix oppressée. J’ai bien cru que cette nuit vous seriez délivrée de moi. J’ai eu peur d’un coup de sang. C’eût été bien mérité, n’est-ce pas? Hier, j’ai fait une folie: je n’ai pas été maître de moi. Ah! cet homme, j’aurais dû l’amener ici, devant vous; il eût parlé. Son silence insolent m’a exaspéré, quand je l’ai sommé de me dire son nom!
–Vous voyez bien, monsieur, que le silence était pour lui comme pour moi une question d’honneur. J’ajoute qu’il est une preuve de cet honneur. Un amant eût tout avoué. C’était la seule façon de n’être pas lâche. Celui-là, s’il est mort, a eu l’héroïsme de l’amitié. Faites de moi, si vous voulez, ce que vous avez fait de lui.
–Sais-je seulement s’il est mort! s’écria le comte en se levant du banc.
–Que voulez-vous dire?
–Quand nous sommes retournés à la rivière, le bateau attaché à la rive n’y était plus. Est-ce cet homme qui l’a détaché? Quelqu’un s’est-il trouvé là juste à point pour lui porter secours?… Ce matin, au point du jour, nous avons sondé, fait sonder la rivière; on n’a rien trouvé. Je suis allé me dénoncer comme le meurtrier volontaire d’un inconnu qui voulait pénétrer chez moi, par escalade et effraction, d’un voleur enfin. Je me croyais terrible; j’ai vu au sourire incrédule du magistrat auquel je me dénonçais que j’étais grotesque. Personne n’a été tué ou blessé dans le pays. Personne n’a perdu et n’avait prêté de; bateau; personne n’en a recueilli. Avec mes yeux effarés, j’avais l’air d’un fou, d’un halluciné!. Dites-moi donc au moins, madame, que je n’ai pas rêvé; que vous attendiez cet homme; que cet homme est venu; que j’ai pris le fusil de Martial, et que j’ai tiré; dites-moi cela, pour que je ne tente pas autrement la réalité, en essayant de m’assurer que je ne suis pas non plus un fantôme invulnérable.
Antonie, par un mouvement involontaire, plus fort que sa méfiance et son ressentiment, saisit la main de son mari.
M. de Sabaillan, à ce contact, eut une secousse; ses yeux devinrent humides. Les deux époux se regardèrent indécis, troublés jusqu’au plus profond de leur être.
Antonie lutta contre la tentation de tout dire; mais la lutte fut courte.
–Croyez-vous donc, balbutia-t-elle, que, si je pouvais parler, je vous laisserais dans cette incertitude cruelle? Je ne puis que vous répéter qu’il faut me croire aveuglément, obstinément, follement, si vous voulez, et attendre; pour tous les deux, le salut est dans cette confiance difficile, absurde, mais nécessaire.
Le comte eut une tentation de faiblesse, ou de force sublime:
–Quel terme me fixez-vous?
–Je ne puis vous en fixer aucun.
–Voyons, Antonie, reprit-il, en s’avisant tout à coup d’une supposition à laquelle il avait songé, mais que sa fièvre lui avait fait oublier, si cet homme était un parent, un frère qui eût besoin de se cacher pour un crime politique, ou même pour un crime vulgaire, dites-le-moi. Je partagerai votre secret. Je ne vous rendrai solidaire, en aucune façon, ou de la misère ou de l’infamie de cet homme; mais ne me laissez pas partir ainsi.
–Pourquoi partez-vous?
–Est-ce que nous pouvons rester un jour, une heure de plus, en face l’un de l’autre, avec cette énigme entre nous?
Antonie devenait rêveuse.
–Partez donc! dit-elle en soupirant.
Elle ajouta:
–Vous emmenez Céline?
–Oui.
–Vous avez peur que je ne lui donne un mauvais exemple?
Le comte allait dire oui. Sa loyauté l’arrêta; son orgueil l’empêcha de dire non. Il murmura:
–Elle me consolera!
Antonie avait parlé avec une ironie secrète; elle continua avec dignité:
–Merci, monsieur, d’avoir besoin d’être consolé. Mais, si j’accepte cette séparation qui m’outrage, je la veux entière. Oh! ne vous méprenez pas à mes paroles. Je ne la veux pas définitive. J’espère qu’un jour, un jour que je souhaite prochain, un événement, une circonstance me permettra de me justifier. Je n’attendrai pas plus d’excuse que je ne demande de pardon. La vérité aura son heure; voilà tout. Puisque vous ne voulez pas que cette heure-là vienne en famille, je m’incline. Vous me punissez comme mère, en me punissant comme femme. C’est beaucoup; mais je ne chicane pas sur la mesure d’une épreuve qui ne dépasse pas mon courage. Je me soumets. Seulement, si je reste ici, seule, je veux ma liberté dans ma solitude.
–Vous l’aurez.
–Non seulement la liberté visible, mais la liberté invisible.
–Je crois vous comprendre: Martial quitte le château.
–Si un autre le remplace…
–Vous avez donc bien peur d’être surprise encore?
–Vous ai-je montré que j’avais peur! Je vous avertis que je prétends agir comme si j’avais encore votre confiance. Je ne recevrai personne que le docteur, qui est votre ami, que le curé, qui est un peu le mien. Mais, si j’ai besoin d’aller visiter des malades et d’entrer à l’église, à une autre heure que celle des offices, je ne veux pas être suivie, guettée, mise en joue. C’est assez d’un guet-apens.
Antonie avait peu à peu élevé et affermi sa voix. Pourtant la fierté de son langage rayonnait surtout dans ses yeux.
M. de Sabaillan se fût révolté contre l’accent des paroles; le regard l’intimida.
–Il serait plus simple de tout m’avouerr, répondit-il, en voulant lutter de noblesse.
Antonie ne répliqua pas.
–Soit, poursuivit le comte, que l’impatience reprenait. Vous serez libre. Je vous engage ma parole d’honneur que je ne laisserai ni un ordre ni un confident dont vous puissiez vous alarmer. Je ne fais aucune menace; je ne vous demande aucune promesse; mais vous portez mon nom, et je garde mon droit
Antonie s’inclina. M. de Sabaillan ajouta:
–N’avez-vous plus rien à me dire?
–Un mot seulement. Expliquerez-vous à Céline la cause de notre séparation?
–Si elle doit se prolonger et devenir définitive. oui. D’ailleurs, cette séparation deviendra-forcément publique, quand Céline se mariera.
–Sera-ce bientôt?
–Elle est demandée.
Antonie perdit son sang-froid à cette nouvelle. Elle faillit pousser un cri. Mais sa bouche ouverte se tordit dans la crispation d’un sourire.
–Je n’ose pas vous demander par qui, dit-elle d’une voix qui tremblait, en paraissant hésiter à faire cette question, quand elle était surtout très inquiète d’en recevoir la réponse.
M. de Sabaillan crut de bon goût de déférer à cette curiosité maternelle:
–C’est un officier; mais le projet est encore bien vague.
Antonie essuya un peu de sueur qui lui était venue au front.
–C’est à Paris que ce projet de mariage va se discuter?.
–Oui, mais je n’emmène pas Céline immédiatement à Paris. Je la conduis d’abord chez sa cousine, madame de Marval, qui me la redemande, et où elle restera jusqu’à l’hiver.
Cette fois, madame de Sabaillan eut un tremblement presque visible, qu’elle voulut arrêter, en serrant fortement ses mains l’une contre l’autre; ses yeux se voilèrent dans un effroi rapide, aigu. Elle osa dire, avec une hardiesse que son autorité maternelle excusait, si elle ne la justifiait plus:
–Le dernier séjour de Céline chez madame de Marval ne lui a pas été bon. C’est là qu’elle a été –si malade.
–Il n’y paraît plus.
–Madame de Marval est bien jeune!
–Elle a votre âge.
–C’est possible; mais…
–Je sais que vous ne l’aimez pas.
Madame de Sabaillan dédaigna de confirmer ou –de démentir cette remarque; elle reprit, avec une dignité très fière dans sa soumission apparente:
–Pourrai-je écrire à Céline?
–Sans doute.
–Vous partez… tout de suite?
–La voiture qui nous conduira au chemin de fer doit être attelée.
–Me permettez-vous d’aider Céline dans ses préparatifs?
Le comte hésita, et, se mordant les lèvres:
–C’est inutile; j’avais donné des ordres. Céline doit être prête.
–Je vois que vous avez tout prévu; vous m’autorisez au moins à l’embrasser.
L’ironie sereine et méprisante de la question força le comte au respect.
–Certainement, dit-il, en faisant quelques pas pour remonter vers la maison et pour rompre l’entretien qu’il ne savait comment terminer.
Antonie–continua avec une douceur impla-. cable:
–Si l’on venait, de la part de la justice, pour faire une enquête sur ce qui s’est passé hier au soir?
M. de Sabaillan se retourna violemment.
–Vous n’avez pas besoin de moi pour répondre.
–Comme je ne répondrais pas, j’ai besoin de savoir où l’on pourrait vous interroger.
Le regard tranquille d’Antonie soutenait celui de son mari. C’était sa dernière protestation, sa
vengeance, ou, plutôt, c’était un dernier effort, bien incertain, bien fragile, pour inspirer à celui qu’elle ne pouvait persuader autrement la révélalation subite de son innocence.
Le comte ne vit qu’une bravade dans cette tentative touchante.
–Adressez-moi, dit-il brusquement, les faiseurs d’enquête à Paris; j’y serai demain.
Il monta l’escalier, alla droit à la cour, où la voiture attelée attendait que mademoiselle Céline de Sabaillan eût fini de faire emplir les cartons et fermer les malles.
Elle parut en toilette de voyage, belle d’une beauté que les palpitations involontaires de la matinée augmentaient en l’excitant, souriante d’un sourire presque timide, qui révélait une grande appréhension, interrogeant, avec une peur coquette, son père et sa belle-mère.
Que s’était-il passé dans le court entretien auquel il lui avait été défendu d’assister? Le colonel avait l’attitude contenue, sévère; il paraissait moins courroucé et plus triste. Antonie, qui se tenait en arrière, la rassura de loin par un coup d’œil résigné.
Céline, pour lui dire adieu, s’approcha de madame de Sabaillan, et, comme celle-ci, par calcul, était restée à une assez grande distance de son mari, de façon à n’être point entendue, elles purent échanger quelques paroles:
–Tu vas chez madame de Marval.
–Ah! tant mieux!
–Non, tant pis! je t’en conjure, sois prudente.
Céline secouait la tête en signe d’acquiescement à la recommandation, tout en paraissant enchantée d’aller chez madame de Marval.
Elle embrassa Antonie avec une tendresse qu’elle ne lui montrait guère d’habitude. Elle la remerciait de sa bonne nouvelle.
–Et toi, tu restes ici? demanda-t-elle, par scrupule de gentillesse et de reconnaissance.
–Oui.
–Pauvre maman!
De toutes les duretés, les plus brutales sont celles qui trahissent l’insensibilité dans les formules de tendresse.
Antonie reçut une blessure de ces mots enfantins, qu’elle savait n’être pas sincères.
–Ne me plains pas! dit-elle. Mais prouve-moi que tu m’aimes, en m’obéissant.
Antonie serra contre elle sa belle-fille, lui dit encore tout bas deux ou trois mots à l’oreille qui la firent rougir, et, la tenant par la main, la conduisit jusqu’à la voiture.
Le comte salua, fit monter sa fille, monta lui-même, en regardant l’heure à sa montre, comme s il eût craint de n’avoir que le temps de gagner la station voisine.
Il voulait un prétexte pour ne rien dire à madame de Sabaillan devant les domestiques qui restaient.
La voiture sortit de la cour et s’engagea dans une avenue de platanes.
Antonie resta quelques minutes, immobile, suivant de loin ceux qui partaient, le cœur tiré par les deux êtres qu’elle avait si sincèrement aimés et qui la fuyaient, l’un son mari, ayant peur de la condamner, s’il restait, l’autre, sa fille, ayant peur de l’estimer.
La lourde porte pleine fut refermée. La vision disparut, et madame de Sabaillan, en entendant retomber sur le pavé le grand verrou perpendiculaire qui assujettissait la porte massive, se sentit enfermée dans une prison que sa liberté elle-même resserrait, car elle était gardée par ses propres méfiances, autant, sinon plus, que par les soupçons de son mari.
Elle alla s’accouder à la balustrade de la terrasse, à l’endroit même où la veille au soir elle s’était penchée pour accueillir un confident, un ami qui ne reviendrait plus.
Elle resta longtemps, pensant à lui, pensant à cette tâche qu’elle devait continuer seule, désormais, et qui se trouvait augmentée d’un fardeau nouveau par ce meurtre commis ou tenté, dont sa conscience la rendait pour ainsi dire respon-– sable.