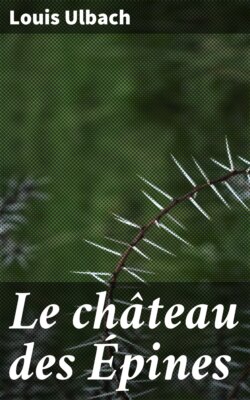Читать книгу Le château des Épines - Louis Ulbach - Страница 6
IV
ROLAND D’AMBREVILLE
ОглавлениеAntonie avait un de ces caractères qui se développent, par un mouvement successif et régulier, comme un éventail, en montrant l’une après l’autre chacune des lames droites et lisses dont l’ensemble étalé porte une image complète et rayonnante.
Le lendemain du départ de M. de Sabaillan et de Céline, elle commença par éprouver la liberté dont elle jouissait.
Martial avait quitté le château. Mais, sans interroger personne, Antonie sut qu’il n’avait pas quitté le pays.–
–Mis à la retraite, il allait s’occuper, pour son : compte, de jardinage, dans les petites propriétés des environs.
M. de Sabaillan, trop fier pour le charger d’un espionnage, aurait-il assez de force pour se refuser à toute dénonciation nouvellee? Martial, qui haïssait Antonie autant qu’il aimait son colonel, serait-il désarmé par une disgrâce, dont il souffrait comme d’une injustice? Ne voudrait-il pas surveiller toujours son ennemie?
Antonie avait commis des imprudences, cruellement expiées. Elle n’avait pas la présomption de supposer qu’elle serait désormais infaillible dans ses démarches, dans ses actes extérieurs. Tout ce qu’elle pouvait, tout ce qu’elle devait faire, c’était de prendre des précautions et de s’assurer des alliés éventuels.
Elle en avait indiqué deux à l’approbation de son mari, le curé du village, le médecin du pays.
Résolue et logique, dans la journée même, elle alla tout droit au presbytère, le cœur gros d’une confidence ou d’une confession. Mais, si pieuse qu’elle fût, par devoir plus que par sentiment, elle avait une indépendance de pensée qui avait besoin d’être charmée, pour se soumettre au delà du respect.
Elle n’osa jamais parler de son secret, enveloppé de toutes sortes de pudeurs féminines, au bonhomme naïf, obséquieux et plein de déférence qui la reçut dans sa salle à manger. Il eût fallu un homme du monde, si médiocre qu’il eût été; la science usuelle de la vie eût suffi pour l’inspirer.
Ce paysan honnête, qui ne savait que ce qu’on apprend au séminaire et qui n’avait jamais eu à manier que les gros péchés des paysans ses paroissiens, ne pouvait lui offrir que des consolations banales, sans un conseil pratique, des absolutions complaisantes ou des intercessions pieuses. Il la plaindrait, et elle ne voulait pas être plainte. Il serait fort embarrassé du mystère, ou bien il s’abandonnerait à une sensibilité qu’elle serait obligée de consoler.
Elle sortit du presbytère, sans avoir parlé d’autre chose que de ses charités habituelles.
Du presbytère, elle alla chez le médecin, le docteur Bourbeau.
C’était un vieillard, gai, alerte, bon vivant, fort ami de M. de Sabaillan, dont il soignait la goutte, mais ami surtout à table, à cheval, à la chasse. Il reçut Antonie avec galanterie, l’interrogea sur sa santé, lui trouva un peu de fièvre, lui fit une prescription et s’informa du comte.
Précisément il était furieux contre lui. Il avait, en rentrant d’une tournée matinale, rencontré la voiture du colonel; il avait appris ainsi l’arrivée brusque et le brusque départ de M. de Sabaillan. Ce voyage-là ne comptait pas. Les malades étaient rares, et le gibier pullulait. Le docteur était bien contrarié de l’absence de son ami Sabaillan.
Antonie rentra chez elle, non pas déçue, car elle avait prévu l’impuissance du prêtre et l’insuffisance du médecin, mais la conscience en règle, vis-à-vis des auxiliaires naturels de toute détresse morale ou physique.
Elle était réduite à ses seules forces.
Comment faire pour reprendre sa tâche, augmentée de la responsabilité terrible que l’événement du jardin faisait peser sur elle?
Elle avait réclamé sa liberté; elle l’avait obtenue du comte; mais cette liberté l’effrayait comme un désert inconnu.
–Personne ne la gardait, mais personne ne la protégeait.
En admettant que Martial ne fût plus disposé à l’espionnage et à la dénonciation, n’avait-elle pas à redouter un hasard?
La blessure d’un premier soupçon restait ouverte dans le cœur de M. de Sabaillan. Si Antonie. avait intimidé et étonné la colère de son marri, elle ne l’avait pas désarmée.
Elle se disait cela, en rentrant au château, qui lui parut tout à coup sombre, formidable, plein d’échos mystérieux, avides de l’écouter penser.
Elle n’avait plus à son service qu’une femme de chambre, une cuisinière, l’aide-jardinier, promu subitement aux fonctions délaissées par Martial, et le vieux cocher qui avait été conduire le comte. C’était trop pour la servir; c’était assez pour la surveiller.
Par modestie, non par fierté, Antonie ne s’était jamais préoccupée d’obtenir plus que de la déférence de ses domestiques.
En passant du rôle délicat d’institutrice à celui de maîtresse du château, elle avait redouté de paraître, par sa complaisance, s’excuser envers l’office de cet agrandissement de sa fortune. On l’eût méprisée pour une bonté trop familière. Ne la haïssait-on pas de sa réserve travestie en orgueil? Martial n’avait-il rien dit devant les domestiques de ce qui s’était passé dans le jardin? Son dévouement absolu au comte de Sabaillan pouvait lui imposer le silence; mais sa haine absurde pour la comtesse pouvait l’avoir poussé à des indiscrétions mêlées de réticences qui germeraient en méchancetés vénéneuses.
Antonie devait s’enfermer plus que jamais en elle-même, et, si sa conscience lui inspirait du courage, la tâche qu’elle avait à continuer, au milieu de difficultés nouvelles, l’obligeait à des précautions qui, aux yeux d’un témoin attentif, eussent semblé de la dissimulation et de la peur.;
En effet, sa vie fatalement condamnée, pour un temps indéfini, à cette solitude, à cette vaste prison ouverte, l’appelait au dehors.
Le lendemain du départ de M. de Sabaillan, après l’essai infructueux de ses deux visites, elle fut tentée de faire une longue promenade sans but, pour bien mesurer son horizon, pour maintenir son droit à aller et venir dans le parc.
Mais à peine fut-elle dans la campagne, qu’elle eut pitié et presque honte de cet exercice qui ne lui donnerait pas tout l’espace dont elle avait besoin.
Alors, elle se résigna à une démarche qui coûtait beaucoup à sa fierté, à la pudeur de son rôle maternel.
Le troisième jour de sa solitude, après une nuit passée en méditation, elle écrivit la lettre suivante:
«A M. Roland d’Ambreville,
secrétaire d’ambassade à la légation de Z…
Château des Épines, le… 1869.
Monsieur,
Vous serez moins surpris de recevoir une lettre de moi, que je ne suis étonnée d’avoir l’obligation de vous l’écrire.
Depuis qu’il ne m’est plus possible d’ignorer votre nom, j’attendais que vous fussiez devenu le gendre de M. de Sabaillan pour vous connaître et vous parler.
Mais j’ai trop attendu, et je ne puis plus attendre.
Votre ami est mort ou blessé. Votre enfant est sans protection, car il ne m’est plus possible de veiller sur elle, comme je le faisais, par l’intermédiaire de M. Dontilly.
C’est à vous d’agir, et d’agir vite. Retrouvez le mort ou le blessé; préservez l’enfant innocente.
Je ne vous adresse aucun reproche. Ce serait de ma part une rigueur inutile. D’ailleurs, je me sens coupable aussi.
La beauté de Céline vous a égaré; sa jeunesse ne vous a pas arrêté. Mais je savais avant vous combien elle était belle; je savais mieux que vous combien sa jeunesse la rendait coquette. Mon ignorance du monde ne me justifie pas. J’ai failli à mon devoir d’institutrice en ne m’établissant pas dans cette conscience étourdie pour vous interdire de la troubler. J’ai failli à mon devoir maternel, en permettant à Céline ce séjour, sans moi, chez madame de Marval, qui a été l’occasion de votre rencontre et de votre séduction.
J’expierai toute ma vie, si je dois vivre, cette responsabilité, dans un malheur qui peut se réparer en apparence, qui, pour moi, demeurera irréparable.
Si je meurs, car l’épreuve que je traverse a des brutalités matérielles dont je puis être–victime, souvenez-vous de mon cri de détresse, de mon testament:–Ayez pitié de votre enfant! Ayez pitié de sa mère, que vous méprisez peut-–être, parce que vous l’avez perdue, que vous devez sauver, afin de pouvoir l’estimer!
Votre ami m’a parlé de vous souvent. Il m’a assuré que vous aviez un grand repentir et une grande honte.
Je n’ai pas compris jusqu’ici que l’une et l’autre ne vous aient pas amené au château. des Épines, pour demander Céline à son père.
Je dis que je ne comprends pas; car la loyauté et la générosité de votre meilleur ami, M. Dontilly, m’empêchaient de croire que vous fussiez déloyal et égoïste. Qu’est-ce qui vous retient?
Le soin que nous avons pris de cacher la vérité à tout le monde, même à madame de Marval, n’aurait-il fait qu’alléger votre conscience? Vous croyez-vous libre, parce qu’on ignore le lien qui vous attache tous les deux à un berceau?
Non, non, c’est impossible. Il y a dans votre conduite un mystère qui s’expliquera sans doute, mais qui ne peut plus vous empêcher d’agir.
Ah! monsieur, j’ai bien souffert; j’accepte de souffrir encore. Mais n’ajoutez pas à mes épreuves l’horrible vision d’un pauvre enfant abandonné.
Si vous saviez déjà ce que cette petite fille, même avant de naître, m’a donné d’angoisses! Je ne parle pas seulement du péril de l’honneur pour la mère: je parle du péril de la vie pour elle-même.
Comment ai-je eu assez de sang-froid, quand Céline m’a tout avoué, pour ne pas la trahir par une démarche imprudente? Comment madame de Marval, dans sa grâce d’insouciance, ne s’est-elle aperçue de rien? Je l’ignore; mais ce que je sais, c’est que j’ai entendu plusieurs fois madame de Marval parler si légèrement de malheurs pareils à celui-là que j’ai eu peur d’un crime possible sous l’influence d’une humeur si gaie et d’une gaieté si hautaine!
Pardonnez-moi si je la calomnie, cette mondaine.
Je vous fais cet aveu, pour vous révéler toutes mes tortures. Céline est en ce moment au château de madame de Marval, où je ne puis être. Si elle allait tout lui confier! Oh! sans doute, je ne crains plus ce que j’ai redouté à la naissance, un meurtre réel, puisqu’il faut écrire ce mot Mais qui donc défendrait la petite Julie, votre enfant, si l’on voulait la reprendre à sa nourrice, l’envoyer bien loin, la faire disparaître dans cette mort de l’abandon, plus effroyable que l’autre pour un cœur maternel?
Seriez-vous jaloux de moi? Croyez-vous que j’ai pris une part pour usurper l’autre? Mais M. Dontilly a dû vous dire que je réservais vos droits. En voulez-vous à Céline de la lettre qu’elle vous a écrite, quand vous étiez reparti pour l’étranger? N’attribuez qu’à moi la sécheresse de ces quelques lignes. J’avais exigé qu’elles continssent peu de mots, l’annonce d’une maternité , prochaine, sans rien des serments que j’ignorais et qui avaient pu être échangés entre vous.
Qu’avez-vous à me reprocher? J’ai fait de mon mieux, je vous l’assure. Pensez donc à mon embarras! Céline m’avouant ses craintes; son père voulant qu’elle retournât passer une partie de la saison chez madame de Marval! Je n’osais contredire mon mari. Il eût été plus difficile encore de lui cacher la vérité, ici, à côté de lui.
D’ailleurs, si, malgré mes précautions, un scandale nous menaçait, j’aimais mieux quele premier éclat de la honte frappât celle qui l’avait permise. C’était une pensée mauvaise: je m’en accuse; pourtant je me suis appliquée à ne rien laisser soupçonner par madame de Marval, et j’ai réalisé ce tour de force de m’installer auprès de ma belle-fille, qui feignait d’être malade, chez une amie de mon mari qui ne m’aime pas et qui ne m’avait pas invitée, d’obtenir pour elle et pour moi un pavillon dans le parc, de concerter avec le bon docteur Vernon la délivrance de la mère, l’enlèvement de l’enfant, la nuit.
Je suis fière d’avoir accompli cela. Depuis cinq mois que ces événements se sont passés, j’avais tous les deux ou trois jours des nouvelles de la petite Julie. L’admirable dévouement de M. Dontilly, qui s’était offert de votre part, dès les premiers périls, me tenait au courant des moindres petits incidents d’une santé délicate.
Je ne recevais pas ouvertement la visite de votre ami au château. Je n’aurais eu aucun prétexte pour le présenter à mon mari, et il me semble que cette association fût devenue une complicité, en s’exerçant clandestinement sous les regards d’un père. Nous nous rencontrions dans le village. Parfois, M. Dontilly traversait le Loiret en bateau, abordait à l’extrémité du jardin et Tenait me parler de l’autre côté de la haie.
Ce fut une imprudence. Il y a quatre jours, le soir, au moment où votre ami abordait, il s’est trouvé en présence de M. de Sabaillan, qui le reçut par un coup de fusil.
Il vous importe peu de savoir comment mon mari a été prévenu, égaré. M. Dontilly ne s’est pas nommé, ne nous a pas trahis. Est-il mort? blessé seulement? qui l’a recueilli? J’ignore tout; je suis sans nouvelles de lui, sans nouvelles dei l’enfant. Je n’ose en faire prendre, je ne puis en chercher.
M. de Sabaillan, qui croit avoir tué mon amant, m’a épargnée. Il a quitté le château. Céline, je vous l’ai dit, a été conduite chez madame) de Marval. Je suis seule, moins libre que si j’avais des geôliers. Ne pensez pas à moi; pensez à votres ami, à votre enfant.
Vous pleurerez M. Dontilly, s’il est mort. Je vous jure de prier, comme pour un frère, pour cet admirable ami; mais, au nom de votre fille, je vous en conjure, ajournons nos douleurs. Votre enfant est abandonnée à des soins mercenaires qui peuvent se ralentir, s’interrompre. Les bra-! ves gens qui en sont chargés ne savent pas mon nom et ne connaissent que M. Dontilly. Ils ont deviné seulement qu’ils sont mêlés à un mystère. Que deviendrions-nous s’ils songeaient à l’exploiter? L’idée d’une spéculation odieuse peut-elle leur venir?
Le docteur Vernon, notre premier confident, habite à douze lieues. Je ne peux le Voir; je n’ose lui écrire. Il m’effraye pour d’autres causes. Il souffre de ne pouvoir tout dire. Il n’a jamais été d’avis de garder si longtemps le secret. Il a des préventions contre Céline, contre vous. Je crains son intervention inflexible. De tous les côtés, la peur me vient; aidez-moi!
Je vous le dis encore, je ne vous fais ni reproches ni leçons. Votre ami est mort ou blessé, à cause de vous. C’est un miracle que je n’aie pas été tuée. Que serait-il advenu de votre enfant?
Le danger reste effroyable. Ce n’est plus d’une question de bonheur ou d’honneur qu’il s’agit, c’est d’une question d’humanité. Il y a une pauvre petite créature exposée à l’abandon. Sauvez-la! Soyez homme d’abord. Nous verrons après si vous voulez être père ou époux!
Je ne vous demande pas de me répondre directement. Surtout, ne vous excusez pas, ne plaidez pas! agissez, agissez! J’en suis à redouter les dénonciations involontaires d’une adresse de lettre. Trouvez un moyen de m’avertir de ce que vous aurez appris. Ce que vous devez faire? c’est d’accourir. Est-ce qu’il y a au monde un intérêt d’orgueil et d’ambition qui puisse vous arrêter?
S’il faut cependant que vous m’écriviez, pour une raison ou pour une autre, inventez des formules qui me disent tout, sans paraître me dire rien; ou plutôt non, ne vous embarrassez pas de m’écrire; je devinerai ce qui se passera.
Agissez, agissez! Il n’y a pas un jour, pas– une heure, pas une minute à perdre.
ANTONIE DE SABAILLAN.»