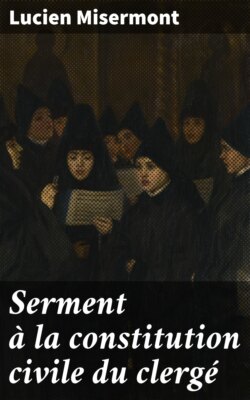Читать книгу Serment à la constitution civile du clergé - Lucien Misermont - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCHAPITRE PREMIER
Table des matières
LES PREMIERS SERMENTS
(10 AOUT 1789-27 NOVEMBRE 1790).
Pendant la Révolution, la vogue était aux serments. Depuis le Roi ou le chef de l’État, jusqu’aux moindres fonctionnaires, pensionnés et même simples citoyens, tout le monde devait prêter serments On ne compta pas moins de 10 formules successives et différentes appliquées au clergé. Jamais on ne vit pareille fureur à exiger ou prêter des serments, ni pareille facilité à les fouler aux pieds, quand on les avait prononcés. Du 27 novembre 1790 au 10 août 1792, une formule particulière, dont le refus créa pour longtemps une catégorie spéciale de suspects et devint le prétexte de toute espèce de persécutions, fut exigée des prêtres fonctionnaires publics; nous voudrions l’étudier dans ces pages; mais auparavant, il nous paraît nécessaire d’énumérer au moins les serments qui précédèrent cette époque funeste, témoin de la désorganisation complète de l’Église de France. Nous trouvons une première loi sur un serment à prêter, le 10 août 1789. Ce jour-là, un arrêté, sanctionné par lettres patentes du Roi le 14 du même mois, impose aux troupes, savoir: aux officiers de tout grade et aux simples soldats, le serment de «rester fidèle à la nation, au Roi et à la loi », formule que nous retrouverons dans tous les serments postérieurs, jusqu’à la chute du roi arrivée le 10 août 1792. Il n’est pas question des ecclésiastiques dans cet arrêté, mais dans une déclaration publiée par le Roi pour le rétablissement de l’ordre et de la tranquillité dans son royaume, donnée à Versailles, aussi le 14 août 1789, Louis XVI ordonne «que les curés des
«villes et des campagnes feront lecture du présent
«arrêté à leurs paroissiens réunis dans l’église...». Toutefois il n’y a rien d’extraordinaire dans cette mesure, la lecture à l’église n’était-elle pas le grand moyen de publication des lois au commencement de la Révolution?
«Les curés, les vicaires et desservans qui se refuseraient à faire au prône à haute et intelligible voix, lisons-nous dans la loi du 12 août 1790, la publication des décrets de l’Assemblée nationale acceptés ou sanctionnés par le Roi, sont incapables de remplir aucune fonction de citoyen actif; mais il faut que la réquisition et le refus soient constatés par un procès-verbal dressé à la diligence du procureur de la Commune».
Une seconde loi de serment est votée dans les premiers jours d’octobre de la même année; elle supprime le serment jusque-là exigé des accusés mais formule avec beaucoup de soins celui des adjoints à l’instruction criminelle. Ce dernier serment est assez curieux, quand on songe à ce qui allait bientôt se passer dans les tribunaux de la Révolution:
«Ils prêteront serment à la commune, entre les mains des officiers municipaux ou syndics, ou de celui qui la préside, de remplir fidèlement leurs fonctions, et surtout de garder un secret inviolable sur le contenu en la plainte et autres actes de la procédure...»
Le décret du 22 décembre 1789, relatif à la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives, à l’article 8 de la section 1re, impose aux citoyens actifs:
«Le serment de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume, d’être fidèles à la nation, à la loi et au Roi et de remplir avec zèle et courage les fonctions civiles et politiques qui leur seront confiées».
C’est la première formule de serment civique, c’est-à-dire exigé pour l’exercice des droits des citoyens.
Le serment fut imposé aux ambassadeurs, consuls, envoyés, ministres et résidents, le 26 octobre 1790.
Le décret des 29 et 3o décembre 1789-janvier 1790, relatif aux fonctions municipales et à la tenue des assemblées primaires, à l’article 2, prescrivait l’élection d’un président et d’un secrétaire, et voulait qu’aussitôt après, président, secrétaire et membres de l’assemblée prêtassent le serment:
«De maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume;
«d’être fidèles à la nation, à la loi et au Roi; de choisir en leur
«âme et conscience les plus dignes de la confiance publique, et de
«remplir avec zèle et courage les fonctions civiles et politiques
«qui pourront leur être confiées.» «Ceux qui refusent de prêter
«ce serment, ajoute le décret, seront incapables d’élire et d’être
«élus».
Le 7 janvier 1790, un décret imposait aux gardes nationales:
«Le serment d’être fidèles à la nation, à la loi et au Roi; de
«maintenir de tout leur pouvoir, sur la réquisition des corps ad-
«ministratifs et municipaux, la constitution du royaume et de
«prêter, pareillement sur les mêmes réquisitions, main-forte à
«l’exécution des ordonnances de justice et à celles des décrets de
«l’Assemblée nationale, acceptés et sanctionnés par le Roi.»
Le décret du 28-28 mai 1790 relatif aux assemblées électorales établissait à l’article 4:
«Après le serment civique prêté par les membres de l’Assemblée, dans les mêmes termes ordonnés par le décret du 4 février dernier, le président de l’Assemblée ou de chacun des bureaux prononcera avant de commencer les scrutins, cette formule de serment: «Vous jurez et promettez de ne nommer que ceux que vous aurez choisis en votre âme et conscience, comme les plus dignes de la confiance publique, sans avoir été déterminé par les dons, promesses, sollicitations ou menaces.» Cette formule sera écrite en caractères très visibles et exposée à côté du vase du scrutin. Chaque citoyen, apportant son bulletin, lèvera la main et, en la mettant dans le vase, prononcera à haute voix: Je le jure.
«Le même serment sera prêté dans toutes les élections des juges et officiers municipaux et députés à l’Assemblée nationale .»
Le 4-7 juillet 1790, un décret prescrivit le serment que devaient prêter les députés à la fédération:
«Nous jurons de rester à jamais fidèles à la nation, à la loi et au Roi; de maintenir de tout notre pouvoir la constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le Roi, de protéger, conformément aux lois, la sûreté des personnes et des propriétés, la libre circulation des grains et subsistances dans l’intérieur du royaume, et la perception des contributions publiques, sous quelques formes qu’elles existent; de demeurer unis à tous les Français par les liens indissolubles de la fraternité.»
A la fédération nationale, le 14 juillet 1790, le roi prêta le serment suivant:
«Moi, roi des Français, je jure d’employer tout le pouvoir qui m’est délégué par la loi constitutionnelle de l’État, à maintenir la constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par moi, et à faire exécuter la loi».
Le président de l’Assemblée s’exprima en ces termes:
«Je jure d’être fidèle à la nation, à la loi et au Roi, et de maintenir de tout mon pouvoir la constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le Roi».
M. de la Fayette jura au nom des fédérés de toute la France:
«Nous jurons d’être à jamais fidèles à la nation, à la loi et au Roi;
«De maintenir de tout notre pouvoir la constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le Roi;
«De protéger conformément aux lois, la sûreté des personnes et des propriétés;
«La circulation des grains et subsistances dans l’intérieur du royaume;
«La perception des contributions publiques, sous quelques formes qu’elles existent;
«De demeurer unis à tous les Français par les liens indissolubles de la fraternité.»
Pour imposer la prestation du serment civique, l’Instruction de l’Assemblée nationale concernant les fonctions des Assemblées administratives porta, le 12 août 1790, la sanction suivante:
«La qualité de citoyen subsiste, mais l’exercice en est suspendu, tant que le citoyen n’a pas prêté le serment civique, soit dans une assemblée de commune ou primaire, soit au directoire du district. Il en sera de même à l’avenir pour ceux qui ne se seront pas fait inscrire sur le registre du service de la garde nationale.»
En septembre 1790 et en janvier 1791 l’Assemblée s’occupa du serment des avocats et des avoués. Dans aucun document de ce genre il n’est question des prêtres comme tels.
Ces citations, mieux que tous les raisonnements, nous semblent montrer clairement la mentalité spéciale de l’époque, au sujet des serments, et expliquer, en partie du moins, l’acharnement avec lequel furent exigés des ecclésiastiques, des religieux, des religieuses, les serments contre lesquels leur conscience protestait. Nous allons étudier maintenant le premier et le plus mauvais de ces tristes serments religieux, celui que Pie VI condamna comme schismatique et hérétique, et dont le refus par la majeure partie du clergé de France fut l’origine et la cause de toutes les persécutions. Il ne fut exigé en lui-même que jusqu’au 10 août 1792, mais son esprit et l’esprit de la Constitution civile du clergé, dont il était la garantie et l’expression, dominèrent les rapports de l’Église et de l’État pendant toute la Révolution et jusqu’au Concordat conclu par Bonaparte.