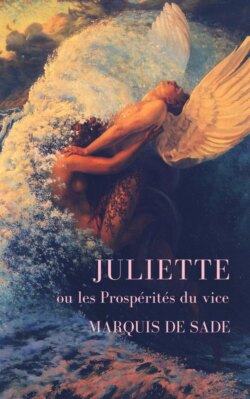Читать книгу Marquis de Sade: Juliette ou les Prospérités du vice - Marquis de Sade, Marquis de Sade - Страница 5
I
ОглавлениеCe fut au couvent de Panthemont que Justine et moi fûmes élevées. Vous connaissez la célébrité de cette abbaye, et vous savez que c’était de son sein que sortaient depuis bien des années les femmes les plus jolies et les plus libertines de Paris. Euphrosine, cette jeune personne dont je voulus suivre les traces, qui, logée dans le voisinage de mes parents, s’était évadée de la maison paternelle pour se jeter dans le libertinage, avait été ma compagne dans ce couvent; et comme c’est d’elle et d’une religieuse de ses amies que j’avais reçu les premiers principes de cette morale qu’on est surpris de me voir, aussi jeune, dans les récits que vient de vous faire ma sœur, je dois, ce me semble, avant tout, vous entretenir de l’une et de l’autre… vous rendre un compte exact de ces premiers instants de ma vie où, séduite, corrompue par ces deux sirènes, le germe de tous les vices naquit au fond de mon cœur.
La religieuse dont il s’agit s’appelait Mme Delbène; elle était abbesse de la maison depuis cinq ans, et atteignait sa trentième année, lorsque je fis connaissance avec elle. Il était impossible d’être plus jolie: faite à peindre, une physionomie douce et céleste, blonde, de grands yeux bleus pleins du plus tendre intérêt, et la taille des Grâces. Victime de l’ambition, la jeune Delbène avait été mise à douze ans dans un cloître, afin de rendre plus riche un frère aîné qu’elle détestait. Enfermée dans l’âge où les passions commencent à s’exprimer, quoique Delbène n’eût encore fait aucun choix, aimant le monde et les hommes en général, ce n’avait pas été sans s’immoler elle-même, sans triompher des plus rudes combats, qu’elle s’était enfin déterminée à l’obéissance. Très avancée pour son âge, ayant lu tous les philosophes, ayant prodigieusement réfléchi, Delbène, en se condamnant à la retraite, s’était ménagé deux ou trois amies. On venait la voir, on la consolait; et comme elle était fort riche, l’on continuait de lui fournir tous les livres et toutes les douceurs qu’elle pouvait désirer, même celles qui devaient le plus allumer une imagination… déjà fort vive, et que n’attiédissait pas la retraite.
Pour Euphrosine, elle avait quinze ans lorsque je me liai avec elle; et elle était depuis dix-huit mois l’élève de Mme Delbène, lorsque l’une et l’autre me proposèrent d’entrer dans leur société, le jour où je venais d’entrer dans ma treizième année. Euphrosine était brune, grande pour son âge, fort mince, de très jolis yeux, beaucoup d’esprit et de vivacité, mais moins jolie, bien moins intéressante que notre supérieure.
Je n’ai pas besoin de vous dire que le penchant à la volupté est, dans les femmes recluses, l’unique mobile de leur intimité; ce n’est pas la vertu qui les lie, c’est le foutre; on plaît à celle qui bande pour nous, on devient l’amie de celle qui nous branle. Douée du tempérament le plus actif, dès l’âge de neuf ans j’avais accoutumé mes doigts à répondre aux désirs de ma tête, et je n’aspirais, depuis cet âge, qu’au bonheur de trouver l’occasion de m’instruire et de me plonger dans une carrière dont la nature précoce m’ouvrait déjà les portes avec autant de complaisance. Euphrosine et Delbène m’offrirent bientôt ce que je cherchais. La supérieure, qui voulait entreprendre mon éducation, m’invita un jour à déjeuner… Euphrosine s’y trouvait; il faisait une chaleur incroyable, et cette excessive ardeur du soleil leur servit d’excuse à l’une et à l’autre sur le désordre où je les trouvai: il était tel, qu’à cela près d’une chemise de gaze, que retenait simplement un gros nœud de ruban rose, elles étaient en vérité presque nues.
— Depuis que vous êtes entrée dans cette maison, me dit Mme Delbène, en me baisant assez négligemment sur le front, j’ai toujours désiré de vous connaître intimement. Vous êtes très jolie, vous m’avez l’air d’avoir de l’esprit, et les jeunes personnes qui vous ressemblent ont des droits bien certains sur moi… Vous rougissez, petit ange, je vous le défends; la pudeur est une chimère; unique résultat des mœurs et de l’éducation, c’est ce qu’on appelle un mode d’habitude; la nature ayant créé l’homme et la femme nus, il est impossible qu’elle leur ait donné en même temps de l’aversion ou de la honte pour paraître tels. Si l’homme avait toujours suivi les principes de la nature, il ne connaîtrait pas la pudeur: fatale vérité qui prouve, ma chère enfant, qu’il y a certaines vertus qui n’ont d’autre berceau que l’oubli total des lois de la nature. Quelle entorse on donnerait à la morale chrétienne, en scrutant ainsi tous les principes qui la composent! Mais nous jaserons de tout cela. Aujourd’hui, parlons d’autre chose, et déshabillez-vous comme nous.
Puis, s’approchant de moi, les deux friponnes, en riant, m’eurent bientôt mise dans le même état qu’elles. Les baisers de Mme Delbène prirent alors un caractère tout différent…
— Qu’elle est jolie, ma Juliette! s’écria-t-elle avec admiration; comme sa délicieuse petite gorge commence à bondir! Euphrosine, elle l’a plus grosse que toi… et cependant à peine treize ans.
Les doigts de notre charmante supérieure chatouillaient les fraises de mes seins, et sa langue frétillait dans ma bouche. Elle s’aperçut bientôt que ses caresses agissaient sur mes sens avec un tel empire que j’étais prête à me trouver mal.
— Oh, foutre! dit-elle, ne se contenant plus et me surprenant par l’énergie de ses expressions. Sacredieu, quel tempérament! Mes amies, ne nous gênons plus: au diable tout ce qui voile encore à nos yeux des attraits que la nature ne nous créa point pour être cachés!
Et jetant aussitôt loin d’elle les gazes qui l’enveloppaient, elle parut à nos regards belle comme la Vénus qui fixa l’hommage des Grecs. Il était impossible d’être mieux faite, d’avoir une peau plus blanche… plus douce… des formes plus belles et mieux prononcées. Euphrosine, qui l’imita presque tout de suite, ne m’offrit pas autant de charmes; elle n’était pas aussi grasse que Mme Delbène; un peu plus brune, peut-être devait-elle plaire moins généralement; mais quels yeux! que d’esprit! Émue de tant d’attraits, vivement sollicitée, par les deux femmes qui les possédaient, de renoncer comme elles à tous les freins de la pudeur, vous croyez bien que je me rendis. Au sein de la plus tendre ivresse, la Delbène m’emporte sur son lit et me dévore de baisers.
— Un moment, dit-elle, tout en feu; un instant, mes bonnes amies, mettons un peu d’ordre à nos plaisirs, on n’en jouit qu’en les fixant.
A ces mots, elle m’étend les jambes écartées, et, se couchant sur le lit à plat ventre, sa tête entre mes cuisses, elle me gamahuche pendant qu’offrant à ma compagne les plus belles fesses qu’il soit possible de voir, elle reçoit des doigts de cette jolie petite fille les mêmes services que sa langue me rend. Euphrosine, instruite de ce qui convenait à Delbène, entremêlait ses pollutions de vigoureuses claques sur le derrière, dont l’effet me parut certain sur le physique de notre aimable institutrice. Vivement électrisée par le libertinage, la putain dévorait le foutre qu’elle faisait à chaque instant jaillir de mon petit con. Quelquefois elle s’interrompait pour me regarder… pour m’observer dans le plaisir.
— Qu’elle est belle! s’écriait la tribade… Oh! sacredieu, qu’elle est intéressante! Secoue-moi, Euphrosine, branle-moi, mon amour; je veux mourir enivrée de son foutre! Changeons, varions tout cela, s’écriait-elle le moment d’après; chère Euphrosine, tu dois m’en vouloir; je ne pense pas à te rendre tous les plaisirs que tu me donnes… Attendez, mes petits anges, je vais vous branler toutes les deux à la fois.
Elle nous place sur le lit, à côté l’une de l’autre; par ses conseils nos mains se croisent, nous nous polluons réciproquement. Sa langue s’introduit d’abord dans l’intérieur du con d’Euphrosine, et de chacune de ses mains elle nous chatouille le trou du cul; elle quitte quelquefois le con de ma compagne pour venir pomper le mien, et recevant ainsi chacune trois plaisirs à la fois, vous jugez si nous déchargions. Au bout de quelques instants la friponne nous retourne. Nous lui présentions nos fesses, elle nous branlait en dessous en nous gamahuchant l’anus. Elle louait nos culs, elle les claquait, et nous faisait mourir de plaisir. Se relevant de là comme une bacchante:
— Rendez-moi tout ce que je vous fais, disait-elle, branlez-moi toutes les deux; je serai dans tes bras, Juliette, je baiserai ta bouche, nos langues se refouleront… se presseront… se suceront. Tu m’enfonceras ce godemiché dans la matrice, poursuit-elle en m’en donnant un; et toi, mon Euphrosine, tu te chargeras du soin de mon cul, tu me le branleras avec ce petit étui; infiniment plus étroit que mon con, c’est tout ce qu’il lui faut… Toi, ma poule, continua-t-elle en me baisant, tu n’abandonneras pas mon clitoris; c’est le véritable siège du plaisir dans les femmes: frotte-le jusqu’à l’égratigner, je suis dure… je suis épuisée, il me faut des choses fortes; je veux me distiller en foutre avec vous, je veux décharger vingt fois de suite si je le puis.
Ô Dieu! comme nous lui rendîmes ce qu’elle nous prêtait! il est impossible de travailler avec plus d’ardeur à donner du plaisir à une femme… impossible d’en trouver une qui le goûtât mieux. Nous nous remîmes.
— Mon ange, me dit cette charmante créature, je ne puis t’exprimer le plaisir que j’ai d’avoir fait connaissance avec toi; tu es une fille délicieuse; je vais t’associer à tous mes plaisirs, et tu verras qu’il est possible d’en goûter de bien vifs, quoiqu’on soit privé de la société des hommes. Demande à Euphrosine si elle est contente de moi.
— Oh, mon amour! que mes baisers te le prouvent! dit notre jeune amie en se précipitant sur le sein de Delbène; c’est à toi que je dois la connaissance de mon être; tu as formé mon esprit, tu l’as dégagé des stupides préjugés de l’enfance: c’est par toi seule que j’existe au monde; ah! que Juliette est heureuse, si tu daignes prendre d’elle les mêmes soins.
— Oui, répondit Mme Delbène, oui, je veux me charger de son éducation, je veux dissiper dans elle, comme je l’ai fait dans toi, ces infâmes prestiges religieux qui troublent toute la félicité de la vie, je veux la ramener aux principes de la nature, et lui faire voir que toutes les fables dont on a fasciné son esprit ne sont faites que pour le mépris. Déjeunons, mes amies, restaurons-nous; lorsqu’on a beaucoup déchargé, il faut réparer ce qu’on a perdu.
Un repas délicieux, que nous fîmes nues, nous rendit bientôt les forces nécessaires pour recommencer. Nous nous rebranlâmes… nous nous replongeâmes toutes trois, par mille nouvelles postures, dans les derniers excès de la lubricité. Changeant à tout moment de rôle, quelquefois nous étions les épouses de celles dont nous redevenions l’instant d’après les maris, et, trompant ainsi la nature, nous la forçâmes un jour entier à couronner de ses voluptés les plus douces tous les outrages dont nous l’accablions.
Un mois se passa de la sorte, au bout duquel Euphrosine, la tête perdue de libertinage, quitta le couvent et sa famille pour se jeter dans tous les désordres du putanisme et de la crapule. Elle revint nous voir, elle nous fit le tableau de sa situation, et trop corrompues nous-mêmes pour trouver du mal au parti qu’elle prenait, nous nous gardâmes bien de la plaindre ou de la détourner.
— Elle a bien fait, me disait Mme Delbène; j’ai voulu cent fois me jeter dans la même carrière, et je l’eusse fait infailliblement, si le goût des hommes l’eût emporté chez moi sur l’extrême amour que j’ai pour les femmes; mais, ma chère Juliette, le ciel, en me destinant à une clôture éternelle, m’a créée assez heureuse pour ne désirer que très médiocrement toute autre sorte de plaisirs que ceux que me permet cette retraite; celui que les femmes se procurent entre elles est si délicieux, que je n’aspire à presque rien au-delà. Je comprends pourtant qu’on aime les hommes; j’entends à merveille qu’on fasse tout pour s’en procurer; je conçois tout sur l’article du libertinage… Qui sait même si je n’ai pas été beaucoup au-dessus de ce que peut saisir l’imagination?
Les premiers principes de ma philosophie, Juliette, continua Mme Delbène, qui s’attachait plus particulièrement à moi depuis la perte d’Euphrosine, sont de braver l’opinion publique; tu n’imagines pas à quel point, ma chère, je me moque de tout ce qu’on peut dire de moi. Et que peut faire au bonheur, je t’en prie, cette opinion de l’imbécile vulgaire? Elle ne nous affecte qu’en raison de notre sensibilité; mais si, à force de sagesse et de réflexion, nous sommes parvenues à émousser cette sensibilité au point de ne plus sentir ses effets, même dans les choses qui nous touchent le plus, il deviendra parfaitement impossible que l’opinion bonne ou mauvaise des autres puisse rien faire à notre félicité. Ce n’est qu’en nous seules que doit consister cette félicité; elle ne dépend que de notre conscience, et peut-être encore un peu plus de nos opinions, sur lesquelles seules doivent être étayées les plus sûres inspirations de la conscience. Car la conscience, poursuivait cette femme remplie d’esprit, n’est pas une chose uniforme; elle est presque toujours le résultat des mœurs et de l’influence des climats, puisqu’il est de fait que les Chinois, par exemple, ne répugnent nullement à des actions qui nous feraient frémir en France. Si donc cet organe flexible peut se prêter à des extrêmes, seulement en raison du degré de latitude, il est donc de la vraie sagesse d’adopter un milieu raisonnable entre des extravagances et des chimères, et de se faire des opinions compatibles à la fois aux penchants qu’on a reçus de la nature et aux lois du gouvernement qu’on habite; et ces opinions doivent créer notre conscience. Voilà pourquoi l’on ne saurait travailler trop jeune à adopter la philosophie qu’on veut suivre, puisqu’elle seule forme notre conscience, et que c’est à notre conscience de régler toutes les actions de notre vie.
— Quoi! dis-je à Mme Delbène, vous avez porté cette indifférence au point de vous moquer de votre réputation?
— Absolument, ma chère; j’avoue même que je jouis intérieurement beaucoup plus de la conviction où je suis que cette réputation est mauvaise, que je n’aurais de plaisir à la savoir bonne. Ô Juliette! retiens bien ceci: la réputation est un bien de nulle valeur, il ne nous dédommage jamais des sacrifices que nous lui faisons. Celle qui est jalouse de sa gloire éprouve autant de tourments que celle qui la néglige: l’une craint toujours que ce bien précieux ne lui échappe, l’autre frémit de son insouciance. S’il est donc autant d’épines dans la carrière de la vertu que dans celle du vice, d’où vient se tourmenter autant sur le choix, et d’où vient ne pas s’en rapporter pleinement à la nature sur celui qu’elle nous suggère?
— Mais en adoptant ces maximes, objectai-je à Mme Delbène, j’aurais peur de briser trop de freins.
— En vérité, ma chère, me répondit-elle, j’aimerais autant que tu me disses que tu craindrais d’avoir trop de plaisirs! Et quels sont-ils donc, ces freins? Osons les envisager de sang-froid… Des conventions humaines presque toujours promulguées sans la sanction des membres de la société, détestées par notre cœur… contradictoires au bon sens: conventions absurdes, qui n’ont de réalité qu’aux yeux des sots qui veulent bien s’y soumettre, et qui ne sont que des objets de mépris aux yeux de la sagesse et de la raison… Nous jaserons sur tout cela. Je te l’ai dit, ma chère: je t’entreprends; ta candeur et ta naïveté me prouvent que tu as grand besoin d’un guide dans la carrière épineuse de la vie, et c’est moi qui t’en servirai.
Rien n’était effectivement plus délabré que la réputation de Mme Delbène. Une religieuse à laquelle j’étais particulièrement recommandée, fâchée de mes liaisons avec l’abbesse, m’avertit que c’était une femme perdue; elle avait gangrené presque toutes les pensionnaires du couvent, et plus de quinze ou seize avaient déjà, par ses conseils, pris le même parti qu’Euphrosine. C’était, m’assurait-on, une femme sans foi, ni loi, ni religion, affichant impudemment ses principes, et contre laquelle on aurait déjà vigoureusement sévi, sans son crédit et sa naissance. Je me moquais de ces exhortations; un seul baiser de la Delbène, un seul de ses conseils, avaient plus d’empire sur moi que toutes les armes qu’on pouvait employer pour m’en séparer. Eût-elle dû m’entraîner dans le précipice, il me semblait que j’eusse mieux aimé me perdre avec elle que de m’illustrer avec une autre. Ô mes amis! il est une sorte de perversité délicieuse à nourrir; entraînés vers elle par la nature… si la froide raison nous en éloigne un moment, la main des voluptés nous y replace, et nous ne pouvons plus nous en écarter.
Mais notre aimable supérieure ne tarda pas à me faire voir que je ne la fixais pas toute seule, et je m’aperçus bientôt que d’autres partageaient des plaisirs où le libertinage avait plus de part que la délicatesse.
— Viens demain goûter avec moi, me dit-elle un jour; Élisabeth, Flavie, Mme de Volmar et Sainte-Elme seront de la partie, nous serons six en tout; je veux que nous fassions des choses inconcevables.
— Comment! dis-je, tu t’amuses donc avec toutes ces femmes?
— Assurément. Eh quoi! tu t’imagines que je m’en tiens là? Il y a trente religieuses dans cette maison: vingt-deux m’ont passé par les mains; il y a dix-huit novices: une seule m’est encore inconnue; vous êtes soixante pensionnaires: trois seulement m’ont résisté; à mesure qu’il en paraît une nouvelle, il faut que je l’aie, je ne lui donne pas plus de huit jours de réflexion. Ô Juliette, Juliette! mon libertinage est une épidémie, il faut qu’il corrompe tout ce qui m’entoure! Il est très heureux pour la société que je m’en tienne à cette douce façon de faire le mal; avec mes penchants et mes principes, j’en adopterais peut-être une qui serait bien plus fatale aux hommes.
— Eh! que ferais-tu, ma bonne?
— Que sais-je? Ignores-tu que les effets d’une imagination aussi dépravée que la mienne sont comme les flots impétueux d’un fleuve qui déborde? La nature veut qu’il fasse du dégât, et il en fait, n’importe comment.
— Ne mettrais-tu pas, dis-je à mon interlocutrice, sur le compte de la nature ce qui ne doit être que sur celui de la dépravation?
— Écoute-moi, mon ange, me dit la supérieure, il n’est pas tard, nos amies ne doivent se rendre ici que sur les six heures; je veux répondre avant qu’elles n’arrivent à tes frivoles objections.
Nous nous assîmes.
— Comme nous ne connaissons les inspirations de la nature, me dit Mme Delbène, que par ce sens que nous appelons conscience, c’est en analysant ce qu’est la conscience que nous pourrons approfondir avec sagesse ce que sont les mouvements de la nature, qui fatiguent, tourmentent ou font jouir cette conscience.
On appelle conscience, ma chère Juliette, cette espèce de voix intérieure qui s’élève en nous à l’infraction d’une chose défendue, de quelque nature qu’elle puisse être: définition bien simple, et qui fait voir du premier coup d’œil que cette conscience n’est l’ouvrage que du préjugé reçu par l’éducation, tellement que tout ce qu’on interdit à l’enfant lui cause des remords dès qu’il l’enfreint, et qu’il conserve ses remords jusqu’à ce que le préjugé vaincu lui ait démontré qu’il n’y avait aucun mal réel dans la chose défendue.
Ainsi la conscience est purement et simplement l’ouvrage ou des préjugés qu’on nous inspire, ou des principes que nous nous formons. Cela est si vrai, qu’il est très possible de se former avec des principes nerveux une conscience qui nous tracassera, qui nous affligera, toutes les fois que nous n’aurons pas rempli, dans toute leur étendue, les projets d’amusements, même vicieux… même criminels, que nous nous étions promis d’exécuter pour notre satisfaction. De là naît cette autre sorte de conscience qui, dans un homme au-dessus de tous les préjugés, s’élève contre lui, quand, par des démarches fausses, il a pris, pour arriver au bonheur, une route contraire à celle qui devait naturellement l’y conduire. Ainsi, d’après les principes que nous nous sommes faits, nous pouvons donc également nous repentir ou d’avoir fait trop de mal, ou de n’en avoir pas fait assez. Mais prenons le mot dans l’acception la plus simple et la plus commune: alors le remords, c’est-à-dire l’organe de cette voix intérieure que nous venons d’appeler conscience, est une faiblesse parfaitement inutile, et dont nous devons étouffer l’empire avec toute la vigueur dont nous sommes capables; car le remords, encore une fois, n’est que l’ouvrage du préjugé produit par la crainte de ce qui peut nous arriver après avoir fait une chose défendue, de quelque nature qu’elle puisse être, sans examiner si elle est mal ou bien. Ôtez le châtiment, changez l’opinion, anéantissez la loi, déclimatisez le sujet, le crime restera toujours, et l’individu n’aura pourtant plus de remords. Le remords n’est donc plus qu’une réminiscence fâcheuse, résultative des lois et des coutumes adoptées, mais nullement dépendante de l’espèce du délit. Eh! si cela n’était pas ainsi, parviendrait-on à l’étouffer? Et n’est-il pas pourtant bien certain qu’on y réussit, même dans les choses de la plus grande conséquence, en raison des progrès de son esprit et de la manière dont on travaille à l’extinction de ses préjugés; en sorte qu’à mesure que ces préjugés s’effacent par l’âge, ou que l’habitude des actions qui nous effrayaient parvient à endurcir la conscience, le remords, qui n’était que l’effet de la faiblesse de cette conscience, s’anéantit bientôt tout à fait, et qu’on arrive ainsi, tant qu’on veut, aux excès les plus effrayants? Mais, m’objectera-t-on peut-être, l’espèce de délit doit donner plus ou moins de violence au remords. Sans doute, parce que le préjugé d’un grand crime est plus fort que celui d’un petit… la punition de la loi plus sévère; mais sachez détruire également tous les préjugés, sachez mettre tous les crimes au même rang, et, vous convainquant bientôt de leur égalité, vous saurez modeler sur eux le remords, et, comme vous aurez appris à braver le remords du plus faible, vous apprendrez bientôt à vaincre le repentir du plus fort et à les commettre tous avec un égal sang-froid… Ce qui fait, ma chère Juliette, que l’on éprouve du remords après une mauvaise action, c’est que l’on est persuadé du système de la liberté, et l’on se dit: Que je suis malheureux de n’avoir pas agi différemment! Mais si l’on voulait bien se persuader que ce système de la liberté est une chimère, et que nous sommes poussés à tout ce que nous faisons par une force plus puissante que nous, si l’on voulait être convaincu que tout est utile dans le monde, et que le crime dont on se repent est devenu aussi nécessaire à la nature que la guerre, la peste ou la famine dont elle désole périodiquement les empires, infiniment plus tranquilles sur toutes les actions de notre vie, nous ne concevrions même pas le remords; et ma chère Juliette ne me dirait pas que j’ai tort de mettre sur le compte de la nature ce qui ne doit être que sur celui de ma dépravation.
Tous les effets moraux, poursuivit Mme Delbène, tiennent à des causes physiques auxquelles ils sont irrésistiblement enchaînés. C’est le son qui résulte du choc de la baguette sur la peau du tambour: point de cause physique, c’est-à-dire point de choc, et, nécessairement, point d’effet moral, c’est-à-dire point de son. De certaines dispositions de nos organes, le fluide nerval plus ou moins irrité par la nature des atomes que nous respirons… par l’espèce ou la quantité de particules nitreuses contenues dans les aliments que nous prenons, par le cours des humeurs, et par mille autres causes externes, déterminent un homme au crime ou à la vertu, et, souvent dans le même jour, à l’un et à l’autre: voilà le choc de la baguette, le résultat du vice ou de la vertu; cent louis volés dans la poche de mon voisin, ou donnés de la mienne à un malheureux, voilà l’effet du choc, ou le son. Sommes-nous maîtres de ces seconds effets, quand les premières causes les nécessitent? Le tambour peut-il être frappé sans qu’il en résulte un son? Et pouvons-nous nous opposer à ce choc, quand il est lui-même le résultat de choses si étrangères à nous, et si dépendantes de notre organisation? Il y a donc de la folie, de l’extravagance, et à ne pas faire tout ce que bon nous semble, et à nous repentir de ce que nous avons fait. Le remords n’est donc, d’après cela, qu’une faiblesse pusillanime que nous devons vaincre, autant que cela peut dépendre de nous, par la réflexion, le raisonnement et l’habitude. Quel changement, d’ailleurs, le remords peut-il apporter à ce que l’on a fait? Il n’en peut diminuer le mal, puisqu’il ne vient jamais qu’après l’action commise; il empêche bien rarement de la commettre encore, et n’est donc, par conséquent, bon à rien. Après que le mal est commis, il arrive nécessairement deux choses: ou il est puni, ou il ne l’est pas. Dans cette seconde hypothèse, le remords serait assurément d’une bêtise affreuse: car à quoi servirait-il de se repentir d’une action, de quelque nature qu’elle pût être, qui nous aurait apporté une satisfaction très complète et qui n’aurait eu aucune suite fâcheuse? Se repentir, dans un tel cas, du mal que cette action aurait pu faire au prochain, serait l’aimer mieux que soi, et il est parfaitement ridicule de se faire un chagrin de la peine des autres, quand cette peine nous a fait plaisir, quand elle nous a servis, chatouillés, délectés, en quelque sens que ce puisse être. Conséquemment, dans ce cas-ci, le remords ne saurait avoir lieu. Si l’action est découverte, et qu’elle soit punie, alors, si l’on veut bien s’examiner, on reconnaîtra que ce n’est pas du mal arrivé au prochain par notre action que l’on se repent, mais de la maladresse que l’on a eue en le commettant, de manière à ce qu’elle ait pu être découverte; et alors il faut se livrer sans doute aux réflexions produites par le regret de cette maladresse… seulement pour en recueillir plus de prudence, si la punition vous laisse vivre; mais ces réflexions ne sont pas des remords, car le remords réel est la douleur produite par celle qu’on a occasionnée aux autres, et les réflexions dont nous parlons ne sont que les effets de la douleur produite par le mal que l’on s’est fait à soi-même: ce qui fait voir l’extrême différence qui existe entre l’un et l’autre de ces sentiments, et, en même temps, l’utilité de l’un et le ridicule de l’autre.
Quand nous nous sommes livrés à une mauvaise action, de quelque atrocité qu’elle puisse être, que la satisfaction qu’elle nous a donnée, ou le profit que nous en avons recueilli, nous console amplement du mal qui en a rejailli sur notre prochain! Avant que de commettre cette action, nous avons bien prévu le mal qu’en ressentiraient les autres; cette pensée ne nous a pourtant point arrêtés: au contraire, le plus souvent elle nous a fait plaisir. Lui permettre plus de force après l’action commise, ou une manière différente de nous agiter, est la plus grande sottise que l’on puisse faire. Si cette action influe sur le malheur de notre vie, parce qu’elle a été découverte, appliquons tout notre esprit à démêler, à combiner les causes qui ont pu la faire découvrir; et sans nous repentir d’une chose qu’il n’a pas été en nous de pouvoir arranger autrement, mettons tout en œuvre pour ne pas manquer de prudence à l’avenir, tirons du malheur qui a pu nous arriver de cette faute l’expérience nécessaire à améliorer nos moyens, et nous assurer dorénavant l’impunité, au moyen de l’épaisseur des voiles que nous jetterons sur l’involontaire dérèglement de notre conduite. Mais, par de vains et inutiles remords, n’entreprenons point d’extirper les principes, car cette mauvaise conduite, cette dépravation, ces égarements vicieux, criminels ou atroces, nous ont plu, nous ont délectés, et nous ne devons pas nous priver d’une chose agréable. Ce serait ici la folie d’un homme qui, parce qu’un grand dîner lui aurait fait mal, voudrait à l’avenir se priver à jamais de ce repas.
La véritable sagesse, ma chère Juliette, ne consiste pas à réprimer ses vices, parce que les vices constituant presque l’unique bonheur de notre vie, ce serait devenir soi-même son bourreau que de les vouloir réprimer; mais elle consiste à s’y livrer avec un tel mystère, avec des précautions si étendues, qu’on ne puisse jamais être surpris. Qu’on ne craigne point par là d’en diminuer les délices: le mystère ajoute au plaisir. Une telle conduite, d’ailleurs, assure l’impunité, et l’impunité n’est-elle pas le plus délicieux aliment des débauches?
Après t’avoir appris à régler le remords né de la douleur d’avoir fait le mal trop à découvert, il est essentiel, ma chère amie, que je t’indique à présent la manière d’éteindre totalement en soi cette voix confuse qui, dans le calme des passions, vient encore quelquefois réclamer contre les égarements où elles nous ont portés; or, cette manière est aussi sûre que douce, puisqu’elle ne consiste qu’à renouveler si souvent ce qui nous a donné des remords, que l’habitude, ou de commettre cette action, ou de la combiner, énerve entièrement toute possibilité d’en pouvoir former des regrets. Cette habitude, en anéantissant le préjugé, en contraignant notre âme à se mouvoir souvent de la manière et dans la situation qui primitivement la gênaient, finit par lui rendre le nouvel état adopté facile, et même délicieux. L’orgueil vient à l’appui; non seulement on a fait une chose que personne n’oserait faire, mais on s’y est même si bien accoutumé, qu’on ne peut plus exister sans cette chose: voilà d’abord une jouissance. L’action commise en produit une autre; et qui doute que cette multiplication de plaisirs n’accoutume bien promptement une âme à se plier à la manière d’être qu’elle doit acquérir, quelque pénible qu’ait pu lui sembler, en commençant, la situation forcée où cette action la contraignait?
N’éprouvons-nous pas ce que je te dis dans tous les prétendus crimes où la volupté préside? Pourquoi ne se repent-on jamais d’un crime de libertinage? Parce que le libertinage devient très promptement une habitude. Il en pourrait être de même de tous les autres égarements; tous peuvent, comme la lubricité, se changer aisément en coutume, et tous peuvent, comme la luxure, exciter dans le fluide nerval un chatouillement qui, ressemblant beaucoup à cette passion, peut devenir aussi délicieux qu’elle, et par conséquent, comme elle, se métamorphoser en besoin.
Ô Juliette, si tu veux, comme moi, vivre heureuse dans le crime… et j’en commets beaucoup, ma chère… si tu veux, dis-je, y trouver le même bonheur que moi, tâche de t’en faire, avec le temps, une si douce habitude, qu’il te devienne comme impossible de pouvoir exister sans le commettre; et que toutes les convenances humaines te paraissent si ridicules, que ton âme flexible, et malgré cela nerveuse, se trouve imperceptiblement accoutumée à se faire des vices de toutes les vertus humaines et des vertus de tous les crimes: alors un nouvel univers semblera se créer à tes regards; un feu dévorant et délicieux se glissera dans tes nerfs, il embrasera ce fluide électrique dans lequel réside le principe de la vie. Assez heureuse pour vivre dans un monde dont ma triste destinée m’exile, chaque jour tu formeras de nouveaux projets, et chaque jour leur exécution te comblera d’une volupté sensuelle qui ne sera connue que de toi. Tous les êtres qui t’entoureront te paraîtront autant de victimes dévouées par le sort à la perversité de ton cœur; plus de liens, plus de chaînes, tout disparaîtra promptement sous le flambeau de tes désirs, aucune voix ne s’élèvera plus dans ton âme pour énerver l’organe de leur impétuosité, nuls préjugés ne militeront plus en leur faveur, tout sera dissipé par la sagesse, et tu arriveras insensiblement aux derniers excès de la perversité par un chemin couvert de fleurs. C’est alors que tu reconnaîtras la faiblesse de ce qu’on t’offrait autrefois comme des inspirations de la nature; quand tu auras badiné quelques années avec ce que les sots appellent ses lois, quand, pour te familiariser avec leur infraction, tu te seras plu à les pulvériser toutes, tu verras la mutine, ravie d’avoir été violée, s’assouplissant sous tes désirs nerveux, venir d’elle-même s’offrir à tes fers… te présenter les mains pour que tu la captives; devenue ton esclave au lieu d’être ta souveraine, elle enseignera finement à ton cœur la façon de l’outrager encore mieux, comme si elle se plaisait dans l’avilissement, et comme si ce n’était réellement qu’en t’indiquant de l’insulter à l’excès qu’elle eût l’art de te mieux réduire à ses lois. Ne résiste jamais, quand tu en seras là; insatiable dans ses vues sur toi, dès que tu auras trouvé le moyen de la saisir, elle te conduira pas à pas d’écart en écart; le dernier commis ne sera jamais qu’un acheminement à celui par lequel elle se prépare à se soumettre à toi de nouveau; telle que la prostituée de Sybaris, qui se livre sous toutes les formes et prend toutes les figures pour exciter les désirs du voluptueux qui la paye, elle t’apprendra de même cent façons de la vaincre, et tout cela pour t’enchaîner plus sûrement à son tour. Mais une seule résistance, je te le répète, une seule te ferait perdre tout le fruit des dernières chutes; tu ne connaîtras rien si tu n’as pas tout connu; et si tu es assez timide pour t’arrêter avec elle, elle t’échappera pour jamais. Prends garde surtout à la religion, rien ne te détournera du bon chemin comme ses inspirations dangereuses: semblable à l’hydre dont les têtes renaissent à mesure qu’on les coupe, elle te fatiguera sans cesse, si tu n’as le plus grand soin d’en anéantir perpétuellement les principes. Je crains que les idées bizarres de ce Dieu fantastique dont on empoisonna ton enfance ne reviennent troubler ton imagination au milieu de ses plus divins écarts: ô Juliette, oublie-la, méprise-la, l’idée de ce Dieu vain et ridicule; son existence est une ombre que dissipe à l’instant le plus faible effort de l’esprit, et tu ne seras jamais tranquille tant que cette odieuse chimère n’aura pas perdu sur ton âme toutes les facultés que lui donna l’erreur. Nourris-toi sans cesse des grands principes de Spinoza, de Vanini, de l’auteur du Système de la Nature, nous les étudierons, nous les analyserons ensemble; je t’ai promis de profondes discussions sur ce sujet, je te tiendrai parole: nous nous remplirons toutes deux de l’esprit de ces sages principes. S’il te survient encore des doutes, tu me les communiqueras, je te tranquilliserai: aussi ferme que moi, tu m’imiteras bientôt, et, comme moi, tu ne prononceras plus le nom de cet infâme Dieu que pour le blasphémer et le haïr. L’idée d’une telle chimère est, je l’avoue, le seul tort que je ne puisse pardonner à l’homme; je l’excuse dans tous ses écarts, je le plains de toutes ses faiblesses, mais je ne puis lui passer l’érection d’un tel monstre, je ne lui pardonne pas de s’être forgé lui-même les fers religieux qui l’ont accablé si violemment, et d’être venu présenter lui-même le cou sous le joug honteux qu’avait préparé sa bêtise. Je ne finirais pas, Juliette, s’il fallait me livrer à toute l’horreur que m’inspire l’exécrable système de l’existence d’un Dieu: mon sang bouillonne à son nom seul; il me semble voir autour de moi, quand je l’entends prononcer, les ombres palpitantes de tous les malheureux que cette abominable opinion a détruits sur la surface du globe; elles m’invoquent, elles me conjurent d’employer tout ce que j’ai pu recevoir de forces ou de talent, pour extirper de l’âme de mes semblables l’idée du dégoûtant fantôme qui les fit périr sur la terre.
Ici, Mme Delbène me demanda où j’en étais sur ces choses-là.
— Je n’ai point encore fait ma première communion, lui dis-je.
— Ah! tant mieux, me répondit-elle en m’embrassant; va, mon ange, je t’éviterai cette idolâtrie; à l’égard de la confession, réponds, lorsqu’on t’en parlera, que tu n’es pas préparée. La mère des novices est mon amie, elle dépend de moi, je te recommanderai à elle, et tu n’en seras point tracassée. Quant à la messe, malgré nous il faut y paraître; mais, tiens, vois-tu cette jolie petite collection de livres? me dit-elle en me montrant une trentaine de volumes reliée en maroquin rouge; je te prêterai ces ouvrages, et leur lecture, pendant l’abominable sacrifice, te consolera de l’obligation d’en être témoin.
— Ô mon amie! dis-je à Mme Delbène, que d’obligations je t’aurai! Mon cœur et mon esprit avaient devancé tes conseils… non sur la morale, tu viens de me dire des choses trop fortes et trop neuves pour qu’elles se fussent déjà présentées à moi; mais je ne t’avais pas attendue pour détester, comme toi, la religion, et ce n’était qu’avec le plus extrême dégoût que j’en remplissais les affreux devoirs. Que de plaisirs tu me fais en me promettant d’étendre mes lumières! Hélas! n’ayant rien entendu dire sur ces objets superstitieux, tous les frais de ma petite impiété ne sont encore dus qu’à la nature.
— Ah! suis ses inspirations, mon ange… voilà celles qui ne te tromperont jamais.
— Sais-tu, poursuivis-je, que tout ce que tu viens de m’apprendre est bien fort, et qu’il est rare d’être instruite à ce point à ton âge. Me permets-tu de le dire, ma bonne, il est difficile que la conscience soit au degré où tu peins la tienne, sans quelques actions très extraordinaires; et comment, pardonne à ma question, comment, dans ton intérieur, as-tu eu l’occasion des délits capables dé t’endurcir à ce point?
— Un jour tu sauras tout cela, me répondit la supérieure en se levant.
— Et pourquoi ces retards?… crains-tu?
— Oui, de te faire horreur.
— Jamais, jamais!
Et la compagnie qui se fit entendre empêcha Delbène de m’éclaircir sur ce que je brûlais de savoir.
— Chut, chut! me dit-elle, pensons au plaisir maintenant… Baise-moi, Juliette; je te promets ma confiance un jour.
Mais nos amies paraissent; il faut que je vous les peigne.
Mme de Volmar venait de prendre le voile, il y avait environ six mois. A peine âgée de vingt ans, grande, mince, élancée, fort blanche, les cheveux châtains, et le plus beau corps possible, Volmar, douée de tant de charmes, était avec raison une des élèves les plus riches de Mme Delbène, et, après elle, la plus libertine de toutes les femmes qui allaient assister à nos orgies.
Sainte-Elme était une novice de dix-sept ans, d’une figure charmante, très animée, de beaux yeux, une gorge moulée, et l’ensemble excessivement voluptueux. Élisabeth et Flavie étaient deux pensionnaires, dont la première avait à peine treize ans, la seconde seize. La figure d’Élisabeth était fine, des traits fort délicats, des formes agréables et déjà prononcées. Pour Flavie, c’était bien la plus céleste figure qu’il fût possible de voir au monde: on n’avait point un plus joli rire, de plus belles dents, de plus beaux cheveux; on ne possédait point une plus belle taille, une peau plus douce et plus fraîche. Ah! mes amis, si j’avais la déesse des fleurs à peindre, je ne choisirais jamais d’autre modèle.
Les premiers compliments ne furent pas longs; toutes, sachant bien la cause de leur réunion, ne tardèrent pas à en venir au fait; mais leurs propos, je l’avoue, m’étonnèrent. On ne saisit pas, au milieu même d’un bordel, tous ceux du libertinage, avec l’aisance et la facilité de ces jeunes personnes; et rien n’était plaisant comme le contraste de leur modestie, de leur retenue dans le monde, et de leur énergique indécence dans ces assemblées luxurieuses.
— Delbène, dit Mme de Volmar en entrant, je te défie de me faire décharger aujourd’hui; je suis épuisée, ma chère; j’ai passé la nuit avec Fontenille… J’adore cette petite friponne; de ma vie je ne fus mieux branlée… je n’ai jamais versé tant de foutre, avec tant d’abondance… avec tant de délices! Oh, ma bonne, nous avons fait des choses!
— Incroyables, n’est-ce pas? dit Delbène. Eh bien, je veux que nous en fassions ce soir de mille fois plus extraordinaires.
— Oh, foutre! dépêchons-nous donc, dit Sainte-Elme; je bande, moi: je ne suis pas comme Volmar, j’ai couché seule.
Et se troussant:
— Tiens, vois mon con… vois comme il a besoin de secours!
— Un moment, dit la supérieure; ceci est une cérémonie de réception. J’admets Juliette dans notre société: il faut qu’elle remplisse les formalités d’usage.
— Qui? Juliette? dit étourdiment Flavie qui ne m’avait point encore aperçue; ah! je connais à peine cette jolie fille… Tu te branles donc, mon cœur? continua-t-elle en venant me baiser sur la bouche… Tu es donc libertine… tu es donc tribade comme nous?
Et la friponne, sans plus de préliminaires, me prit le con et la gorge à la fois.
— Laisse-la donc, dit Volmar, qui, me troussant par derrière, examinait mes fesses; laisse-la donc, il faut qu’elle soit reçue avant que nous ne nous en servions.
— Tiens, Delbène, dit Élisabeth, regarde donc Volmar qui baise le cul de Juliette: elle la prend pour un petit garçon; la garce veut l’enculer!
(Et remarquez que c’était la plus jeune qui parlait ainsi.)
— Ne sais-tu pas, dit Sainte-Elme, que Volmar est un homme? Elle a un clitoris de trois pouces, et, destinée à outrager la nature, quel que soit le sexe qu’elle adopte, il faut que la putain soit tout à tour tribade ou bougre; elle n’y connaît pas de milieu.
Puis, s’approchant elle-même et m’examinant de tous côtés, attendu que Flavie montrait mon devant et Volmar mon derrière:
— Il est certain, poursuivit-elle, que la petite coquine est bien faite, et je jure qu’avant la fin du jour je saurai le goût de son foutre.
— Un moment donc, un moment, mesdemoiselles! dit Delbène en cherchant à rétablir l’ordre.
— Eh, sacredieu! presse-toi, dit Sainte-Elme, je bande! Qu’attends-tu donc pour commencer? Faut-il que nous fassions nos prières avant que de nous branler le con? A bas les robes, mes amies!…
Et, dans l’instant, vous eussiez vu six jeunes filles, plus belles que le jour, s’admirer… se caresser nues, et former entre elles les groupes les plus agréables et les plus variés.
— Oh! pour à présent, reprit Delbène avec autorité, vous ne pouvez me refuser un peu d’ordre:… Écoutez-moi: Juliette va s’étendre sur ce lit, et vous irez, chacune à votre tour, goûter le plaisir qui vous conviendra le mieux avec elle; moi, bien en face de l’opération, je vous prendrai toutes à mesure que vous la quitterez, et les luxures commencées avec Juliette s’achèveront sur moi; mais je ne me presserai point, mon foutre n’éjaculera que quand je vous aurai toutes les cinq sur le corps.
L’extrême vénération que l’on avait pour les ordres de la supérieure fit mettre à leur exécution la ponctualité la plus entière. Toutes ces créatures étant fort libertines, peut-être ne serez-vous pas fâchés d’entendre ce que chacune exigea de moi.
Comme elles arrivaient par rang d’âge, Élisabeth passa la première. La jolie friponne m’examina partout, et, après m’avoir couverte de baisers, elle s’entrelaça dans mes cuisses, se frotta sur moi, et nous nous pâmâmes toutes deux. Flavie vint après; elle y mit plus de recherches. Après mille délicieux préliminaires, nous nous couchâmes en sens inverse l’une et l’autre, et, de nos langues frétillantes, nous fîmes jaillir des torrents de foutre. Sainte-Elme approche, elle s’étend sur le lit, me fait asseoir sur son visage, et, pendant que son nez branle le trou de mon cul, sa langue s’enfonce dans mon con. Courbée sur elle par mon attitude, je puis la gamahucher de même: je le fais; mes doigts chatouillent son cul, et cinq éjaculations de suite me prouvent que le besoin qu’elle annonçait n’était pas illusoire. Je le lui rendis complètement; jamais encore je n’avais été plus voluptueusement sucée. Volmar ne veut que mes fesses, elle les dévore de baisers, et, préparant la voie étroite avec sa langue de rose, la libertine se colle sur moi, m’enfonce son clitoris dans le cul, se secoue longtemps, retourne ma tête, baise ardemment ma bouche, suce ma langue et me branle en m’enculant. La gueuse ne s’en tient pas là: m’armant d’un godemiché qu’elle-même fixe le long de mes reins, elle se présente à mes coups, et, les dirigeant au derrière, la coquine est sodomisée; je la branlais, elle pensa mourir de plaisir.
Après cette dernière incursion, je fus prendre le poste qui m’attendait sur le corps de la Delbène. Voici comment la putain disposa le groupe:
Élisabeth, sur le dos, était établie au bord du lit. Delbène, étendue dans ses bras, s’en faisait branler le clitoris. Flavie, à genoux, les jambes sous le lit, la tête à la hauteur du con de la supérieure, la gamahuchait et lui pressait les cuisses. Au-dessus d’Élisabeth, Sainte-Elme, le cul sur le visage de cette dernière, présentait en plein son con aux baisers de Delbène, que Volmar enculait de son clitoris brûlant. On m’attendait pour compléter le groupe. Mise un peu courbée auprès de Sainte-Elme, j’offrais à lécher à l’envers ce que celle-ci faisait gamahucher par-devant. Delbène passait avec inconstance et rapidité du con de Sainte-Elme au trou de mon cul, léchait, pompait ardemment l’un et l’autre, et, se remuant avec l’agilité la plus incroyable sous les doigts d’Élisabeth, sous la langue de Flavie et sous le clitoris de Volmar, la tribade n’était pas une minute sans répandre des torrents de foutre.
— Oh! sacredieu! dit Delbène en se retirant de là rouge comme une bacchante, double Dieu! comme j’ai déchargé! N’importe, suivons nos opérations; que chacune de vous maintenant se place sur le lit; Juliette exigera d’elle tour à tour ce qui lui conviendra, vous serez contraintes à vous y prêter; mais comme elle est encore bien neuve, je la conseillerai; le groupe se formera sur elle ensuite, comme il vient de se former sur moi, et nous ferons éjaculer son foutre jusqu’à ce qu’elle demande grâce.
Élisabeth est la première offerte à mon libertinage.
— Place-la, me dit Delbène qui me conseillait, de manière à ce que tu puisses baiser sa jolie petite bouche pendant qu’elle te branlera; et, pour que tu sois chatouillée de partout, je vais, pendant toute la séance, me charger du trou de ton cul.
Flavie remplace Élisabeth.
— Je te recommande les jolis tétons de cette petite fille, me dit l’abbesse; suce-les-lui, pendant qu’elle te chatouille… A cause des goûts de Volmar, il faut que tu lui enfonces ta langue dans le cul, pendant que, courbée sur toi, la friponne te gamahuchera… Pour Sainte-Elme, poursuivit la supérieure, sais-tu ce que j’en ferais? Je m’arrangerais de manière à pouvoir lui sucer à la fois le cul et le con, pendant qu’elle te le rendrait… Et quant à moi, commande, ma mie, je suis à tes ordres.
Échauffée de ce que j’avais vu faire à Volmar:
— Je veux t’enculer, dis-je, avec ce godemiché.
— Fais, ma bonne, fais, me répond humblement Delbène en se présentant à mes coups, voilà mon cul, je te le livre.
— Eh bien! dis-je en sodomisant mon institutrice, puisque le groupe doit s’arranger sur moi, qu’il commence tout de suite. Chère Volmar, continuai-je, que ton clitoris rende à mon cul ce que je fais à celui de Delbène; tu ne saurais à quel point mon tempérament s’irrite de cette manière de jouir. De chacune de mes mains, je voudrais branler Élisabeth et Sainte-Elme, pendant que je sucerais le con de Flavie.
Les ordres de la supérieure étant de m’épuiser, je n’eus la peine de rien dire: les situations varièrent sept fois, et sept fois mon foutre coula dans leurs bras.
Les plaisirs de la table succédèrent à ceux de l’amour une superbe collation nous attendait. Différentes sortes de vins ou de liqueurs ayant vivement échauffé nos têtes, on se remit au libertinage; trois groupes se dessinèrent. Sainte-Elme, Delbène et Volmar, comme les plus âgées, se choisirent chacune une branleuse; par hasard ou par prédilection, Delbène ne me manqua pas; Élisabeth était devenue le choix de Sainte-Elme, et Flavie celui de Volmar. Les groupes étaient arrangés de manière à ce que chacun jouissait de la vue des plaisirs de l’autre. On n’a pas l’idée de ce que nous fîmes. Oh! comme Sainte-Elme était délicieuse! Ardemment passionnées l’une pour l’autre, nous nous branlâmes toutes deux jusqu’à l’extinction: il ne fut rien que nous n’imaginâmes, rien que nous ne fîmes. Enfin, tout se remêla, et les deux dernières heures de cette voluptueuse débauche furent si lascives, que dans aucun bordel peut-être il ne se commit tant de luxures.
Une chose m’avait paru singulière: c’était l’extrême ménagement qu’on avait pour le pucelage des pensionnaires. On n’observait pas sans doute les mêmes lois vis-à-vis de celles dont les vœux étaient prononcés; mais on respectait à un point que je ne pouvais comprendre celles qui se destinaient au monde.
— Leur honneur y tient, me dit Delbène, que j’interrogeai sur cette réserve; nous voulons bien nous amuser de ces jeunes filles, mais pourquoi les perdre? pourquoi leur faire détester les moments qu’elles ont passés auprès de nous? Non, nous avons cette vertu, et quelque corrompues que tu nous supposes, nous ne compromettons jamais nos amies.
Ces procédés me parurent superbes; mais créée par la nature pour l’emporter de scélératesse, un jour, sur tout ce qui devait m’entourer, le désir de flétrir une de mes compagnes m’échauffa dès ce moment la tête pour le moins autant que celui d’être flétrie moi-même.
Delbène s’aperçut bientôt que je lui préférais Sainte-Elme. J’adorais effectivement cette charmante fille; il m’était impossible de la quitter; mais comme elle était infiniment moins spirituelle que la supérieure, un penchant naturel me ramenait invinciblement vers celle-ci.
— Avec la passion dont je te vois dévorée pour dépuceler une fille, ou pour l’être, me dit un jour cette charmante femme, je ne doute pas que Sainte-Elme, ou ne t’ait accordé ces plaisirs, ou ne te les promette bientôt. Il n’y a sûrement point de risque avec elle, puisqu’elle est destinée à passer comme moi ses jours dans le cloître; mais, Juliette, si elle t’en faisait autant, tu ne trouverais jamais à te marier, et que de malheurs pourraient devenir les suites de cette faute! Cependant, écoute-moi, mon ange, tu sais que je t’adore, fais-moi le sacrifice de Sainte-Elme, et je te satisfais à l’instant sur tous les plaisirs que tu souhaites. Tu choisiras dans le couvent celle dont tu voudras cueillir les prémices, et ce sera moi qui flétrirai les tiens… Les déchirements: les blessures… tranquillise-toi, j’arrangerai tout. Mais ceci sont de grands mystères; pour y être initiée, il faut ta parole sacrée que, dès ce moment-ci, tu ne parleras plus à Sainte-Elme: autrement je ne mets point de bornes à ma vengeance.
Aimant trop cette charmante fille pour la compromettre, brûlant d’ailleurs de goûter les plaisirs qu’on me faisait espérer si je renonçais à elle, je promis tout.
— Eh bien! me dit Delbène au bout d’un mois d’épreuve, ton choix est-il fait? Qui veux-tu dépuceler?
Et ici, mes amis, vous ne devineriez de la vie sur quel objet mon imagination libertine s’arrêtait avec complaisance! Sur cette fille que voilà sous vos yeux… sur ma sœur. Mais Mme Delbène la connaissait trop bien pour ne pas me détourner de ce projet.
— Eh bien! dis-je donne-moi Laurette.
Son enfance (à peine avait-elle dix ans), sa jolie petite mine éveillée, l’éclat de sa naissance, tout m’irritait… tout m’enflammait pour elle; et la supérieure y voyant d’autant moins d’obstacles que cette jeune orpheline n’avait pour protecteur au couvent qu’un vieil oncle demeurant à cent lieues de Paris, m’assura que je pourrais regarder comme déjà sacrifiée la victime qu’immolaient d’avance mes perfides désirs.
Le jour était pris, lorsque Delbène m’ayant fait venir la veille pour passer la nuit dans ses bras, remit la conversation sur les matières religieuses.
— Je crains, me dit-elle, que tu n’ailles trop vite, mon enfant; ton cœur, trompé par ton esprit, n’est pas encore au point où je le voudrais. Ces infamies superstitieuses te gênent toujours, je le parierais. Écoute, Juliette, prête-moi toute ton attention, et tâche qu’à l’avenir ton libertinage, étayé sur d’excellents principes, puisse avec effronterie, comme chez moi, se porter à tous les excès sans remords.
Le premier dogme qui s’offre à moi, lorsqu’on me parle de religion, est celui de l’existence de Dieu: comme il est la base de tout l’édifice, c’est par son examen que je dois raisonnablement commencer.
Ô Juliette! n’en doutons pas, ce n’est qu’aux bornes de notre esprit qu’est due la chimère d’un Dieu; ne sachant à qui attribuer ce que nous voyons, dans l’extrême impossibilité d’expliquer les inintelligibles mystères de la nature, nous avons gratuitement placé au-dessus d’elle un être revêtu du pouvoir de produire tous les effets dont les causes nous étaient inconnues.
Cet abominable fantôme ne fut pas plus tôt envisagé comme l’auteur de la nature, qu’il fallut bien le voir également comme celui du bien et du mal. L’habitude de regarder ces opinions comme vraies, et la commodité que l’on y trouvait pour satisfaire à la fois la paresse et la curiosité, firent promptement donner à cette fable le même degré de croyance qu’à une démonstration géométrique; et la persuasion devint si vive, l’habitude si forte, qu’on eut besoin de toute sa raison pour se préserver de l’erreur. De l’extravagance qui admet un Dieu à celle qui le fait adorer, il ne devait y avoir qu’un pas: rien de plus simple que d’implorer ce que l’on craignait; rien que de très naturel au procédé qui fait fumer l’encens sur les autels de l’individu magique que l’on fait à la fois le moteur et le dispensateur de tout. On le croyait méchant, parce que de très méchants effets résultaient de la nécessité des lois de la nature; pour l’apaiser, il fallait des victimes: de là les jeûnes, les macérations, les pénitences, et toutes les autres imbécillités, fruits résultatifs de la crainte des uns et de la fourberie des autres; ou, si tu l’aimes mieux, effets constants de la faiblesse des hommes, puisqu’il est certain que partout où il y en aura, se trouveront aussi des dieux enfantés par la terreur de ces hommes, et des hommages rendus à ces dieux, résultats nécessaires de l’extravagance qui les érige. Ne doutons pas, ma chère amie, que cette opinion de l’existence et du pouvoir d’un Dieu dispensateur des biens et des maux ne soit la base de toutes les religions de la terre. Mais laquelle préférer de toutes ces traditions? Toutes allèguent des révélations faites en leur faveur, toutes citent des livres, ouvrages de leurs dieux, et toutes veulent exclusivement l’emporter l’une sur l’autre. Pour m’éclairer dans ce choix difficile, je n’ai que ma raison pour guide, et dès qu’à son flambeau j’examine toutes ces prétentions, toutes ces fables, je ne vois plus qu’un tas d’extravagances et de platitudes qui m’impatientent et me révoltent.
Après avoir rapidement parcouru les absurdes idées de tous les peuples sur cette importante matière, je m’arrête enfin à ce qu’en pensent les juifs et les chrétiens. Les premiers me parlent d’un Dieu, mais ils ne m’en expliquent rien, ils ne m’en donnent aucune idée, et je ne vois sur la nature du Dieu de ce peuple que des allégories puériles, indignes de la majesté de l’être dans lequel on veut que j’admette le créateur de l’univers; ce n’est qu’avec des contradictions révoltantes que le législateur de cette nation me parle de son Dieu, et les traits sous lesquels il me le peint sont bien plus propres à me le faire détester que servir. Voyant que c’est ce Dieu même qui parle dans les livres qu’on me cite pour me l’expliquer, je me demande comment il est possible qu’un Dieu ait pu donner de sa personne des notions si propres à le faire mépriser des hommes. Cette réflexion me détermine à étudier ces livres avec plus de soin: que deviens-je, lorsque je ne puis m’empêcher de voir, en les examinant, que non seulement ils ne peuvent être dictés par l’esprit d’un Dieu, mais qu’ils sont même écrits très longtemps après l’existence de celui qui ose affirmer les avoir transmis d’après Dieu même! Eh! voilà donc comme on me trompe! m’écriai-je au bout de mes recherches; ces livres saints qu’on veut me donner comme l’ouvrage d’un Dieu ne sont plus que celui de quelques charlatans imbéciles, et je n’y vois, au lieu de traces divines, que le résultat de la bêtise et de la fourberie. Et, en effet, quelle plus lourde ineptie que celle d’offrir partout, dans ces livres, un peuple favori du souverain qu’il vient de se forger, annonçant à toutes les nations que ce n’est qu’à lui que Dieu parla; que ce ne fut qu’à son sort qu’il put s’intéresser; que ce n’est que pour lui qu’il dérange le cours des astres, qu’il sépare les mers, qu’il épaissit la rosée: comme s’il n’eût pas été bien plus facile à ce Dieu de pénétrer dans les cœurs, d’éclairer les esprits, que de déranger le cours de la nature, et comme si cette prédilection en faveur d’un petit peuple obscur, abject, ignoré, pouvait convenir à la majesté suprême de l’être auquel vous voulez que j’accorde la faculté d’avoir créé l’univers? Mais quelle que soit l’envie que j’aurais d’acquiescer à ce que ces livres absurdes m’apprennent, je demande si le silence universel de tous les historiens des nations voisines sur les faits extraordinaires qui y sont consignés, ne devrait pas suffire à me faire révoquer en doute les merveilles qu’ils m’annoncent. Que dois-je penser, je vous prie, lorsque c’est dans le sein du peuple même qui m’entretient si fastueusement de son Dieu que je trouve le plus d’incrédules? Quoi! ce Dieu comble son peuple de faveurs et de miracles, et ce peuple chéri ne croit pas à son Dieu? Quoi! ce Dieu tonne sur le haut d’une montagne avec l’appareil le plus imposant, il dicte sur cette montagne des lois sublimes au législateur de ce peuple, qui, dans la plaine, doute de lui, et des idoles s’élèvent dans cette plaine pour narguer le Dieu législateur tonnant sur la montagne? Il meurt enfin, cet homme singulier qui vient d’offrir aux Juifs un Dieu si magnifique, il expire; un miracle accompagne sa mort: tant de motifs vont pénétrer sans doute de la majesté de ce Dieu le peuple témoin de sa grandeur que ne doivent point admettre les descendants de ceux qui ont tout vu. Mais, plus incrédules que leurs pères, l’idolâtrie culbute en peu d’années les autels chancelants du Dieu de Moïse, et les malheureux Juifs opprimés ne se souviennent de la chimère de leurs ancêtres que quand ils recouvrent leur liberté. De nouveaux chefs leur en parlent alors: malheureusement les promesses qu’ils leur font ne s’accordent pas avec les événements. Les Juifs, selon ces nouveaux chefs, devraient être heureux tant qu’ils seraient fidèles au Dieu de Moïse: jamais ils ne le respectèrent davantage, et jamais le malheur ne les opprima plus durement. Exposés à la colère des successeurs d’Alexandre, ils n’échappent aux fers de ceux-ci que pour retomber sous ceux des Romains, qui, las enfin de leur perpétuelle révolte, culbutent leur temple et les dispersent. Et voilà donc comment leur Dieu les sert! voilà comme ce Dieu, qui les aime, qui ne trouble qu’en leur faveur l’ordre sacré de la nature, voilà comme il les traite, voilà comme il leur tient ce qu’il leur a promis!
Ce ne sera donc plus chez les Juifs que je chercherai le Dieu puissant de l’univers; ne rencontrant chez cette misérable nation qu’un fantôme dégoûtant, né de l’imagination exaltée de quelques ambitieux, j’abhorrerai le Dieu méprisable offert par la scélératesse, et je jetterai les yeux sur les chrétiens.
Que de nouvelles absurdités se présentent ici! Ce ne sont plus les livres d’un fou sur une montagne qui doivent me servir de règles: le Dieu dont il s’agit maintenant s’annonce par un ambassadeur bien plus noble, et le bâtard de Marie est bien autrement respectable que le fils délaissé de Jochabed! Examinons donc ce polisson: que fait-il, qu’imagine-t-il pour me prouver son Dieu? quelles sont ses lettres de créance? Des gambades, des soupers de putains, des guérisons de charlatans, des calembours et des escroqueries. Il est le fils du Dieu qu’il m’annonce, ce malotru qui ne sait pas même m’en parler et qui, dès ce jour, n’écrivit une ligne; il est Dieu lui-même, je dois le croire dès qu’il l’a dit. Le coquin est pendu, qu’importe? sa secte l’abandonne, tout cela est égal: c’est là, c’est là seul qu’est le Dieu de l’univers. Il n’a pu prendre racine que dans le sein d’une Juive, il n’a pu naître que dans une étable; c’est par l’abjection, la pauvreté, l’imposture, qu’il doit me convaincre: si je n’y crois point, tant pis pour moi, d’éternels supplices m’attendent! Vous voyez bien que tout cela peint un Dieu, et qu’il n’est pas un seul trait dans le tableau qui n’élève l’âme et ne la persuade! Ô comble de contradiction! c’est sur l’ancienne loi que la nouvelle loi s’étaye, et la nouvelle, cependant, anéantit l’ancienne. Quelle sera donc la base de cette nouvelle? Christ est donc à présent le législateur qu’il faut croire? Lui seul va m’expliquer le Dieu qui me l’envoie; mais si Moïse avait intérêt à me prêcher un Dieu dans lequel il prenait sa puissance, quel plus grand intérêt n’a pas le Nazaréen à me parler de Dieu dont il dit qu’il descend! Certes, le législateur moderne en savait bien plus que l’ancien; il suffisait au premier de causer familièrement avec son maître: le second est du même sang. Moïse, content de s’étayer des miracles de la nature, persuade à son peuple que la foudre ne s’allume que pour lui; Jésus, bien plus adroit, fait le miracle lui-même; et si tous deux méritent à jamais le mépris de leurs contemporains, il faut convenir au moins que le nouveau sut, avec plus de friponnerie, prétendre à l’estime des hommes; et la postérité qui les juge en assignant à l’un une loge aux petites-maisons, ne pourra cependant s’empêcher de donner à l’autre une des premières places au gibet.
Tu vois, Juliette, dans quel cercle vicieux tombent les hommes, dès que leur tête s’égare sur ces inepties… La religion prouve le prophète, et le prophète, la religion.
Ce Dieu ne s’étant point encore montré, ni dans la secte juive, ni dans la secte bien autrement méprisable des chrétiens, je le cherche de nouveau, j’appelle la raison à mon secours, et je l’analyse elle-même, pour qu’elle me trompe moins. Qu’est-ce que la raison? C’est cette faculté qui m’est donnée par la nature de me déterminer pour tel objet et de fuir tel autre, en proportion de la dose de plaisir ou de peine reçue de ces objets: calcul absolument soumis à mes sens, puisque c’est d’eux seuls que je reçois les impressions comparatives qui constituent ou les douleurs que je veux fuir, ou le plaisir que je dois chercher. La raison n’est donc autre chose, ainsi que le dit Fréret, que la balance avec laquelle nous pesons les objets, et par laquelle, remettant sous le poids ceux qui sont éloignés de nous, nous connaissons ce que nous devons penser, par le rapport qu’ils ont entre eux, en telle sorte que ce soit toujours l’apparence du plus grand plaisir qui l’emporte. Cette raison, enfin, tu le vois, dans nous comme dans les animaux qui en sont eux-mêmes remplis, n’est que le résultat du mécanisme le plus grossier et le plus matériel. Mais comme nous n’avons point d’autre flambeau, ce n’est donc qu’au sien seul qu’il faut soumettre la foi impérieusement exigée par des fourbes pour des objets ou sans réalité, ou si prodigieusement vils par eux-mêmes, qu’ils ne sont faits que pour nos mépris. Or, le premier effet de cette raison est, tu le sens, Juliette, d’assigner une différence essentielle entre l’objet qui apparaît et l’objet qui est aperçu. Les perceptions représentatives d’un objet sont encore de différente espèce. Si elles nous montrent les objets comme absents et comme ayant été autrefois présents à notre esprit, c’est ce que nous appelons alors mémoire, souvenir. Si elles nous offrent les objets sans nous avertir de leur absence, c’est alors ce qu’on nomme imagination, et cette imagination est la vraie cause de toutes nos erreurs. Or, la source la plus abondante de ces erreurs vient de ce que nous supposons une existence propre aux objets de ces perceptions intérieures, et qu’ils existent séparément de nous, de même que nous les concevons séparément. Je donnerai donc, pour me faire entendre de toi, je donnerai, dis-je, à cette idée séparée, à cette idée née de l’objet qui apparaît, le nom d’idée objective, pour la différencier de celle qui est apparue, et que je nommerai réelle. Il est très important de ne pas confondre ces deux genres d’existence; on n’imagine pas dans quel gouffre d’erreurs on tombe, faute de caractériser ces distinctions. Le point divisé à l’infini, si nécessaire en géométrie, est dans la classe des existences objectives; et les corps, les solides, dans celle des existences réelles. Quelque abstrait que ceci te paraisse, ma chère, il faut pourtant me suivre, si tu veux arriver avec moi au but où je veux te conduire par mes raisonnements.
Observons d’abord ici, avant que d’aller plus loin, que rien n’est plus commun ni plus ordinaire que de se tromper lourdement entre l’existence réelle des corps qui sont hors de nous et l’existence objective des perceptions qui sont dans notre esprit. Nos perceptions elles-mêmes sont distinguées de nous, et entre elles, autant qu’elles aperçoivent les objets présents, et leurs rapports, et les rapports de ces rapports. Ce sont des pensées, en tant qu’elles nous rapportent les images des choses absentes; ce sont des idées, en tant qu’elles nous rapportent les images des objets qui sont en nous. Cependant toutes ces choses ne sont que des modalités, ou manières d’exister de notre être, qui ne sont pas plus distinguées entre elles ni de nous-mêmes que l’étendue, la solidité, la figure, la couleur, le mouvement d’un corps, le sont de ce corps. On a ensuite forcément imaginé des termes qui convinssent généralement à toutes les idées particulières qui étaient semblables; on a nommé cause tout être qui produit quelque changement dans un autre être distingué de lui, et effet, tout changement produit dans un être par une cause quelconque. Comme ces termes excitent en nous au moins une image confuse d’être, d’action, de réaction, de changement, l’habitude de s’en servir a fait croire que l’on en avait une perception nette et distincte, et l’on en est venu enfin à imaginer qu’il pouvait exister une cause qui ne fût pas un être ou un corps, une cause qui fût réellement distincte de tout corps, et qui, sans mouvement et sans action, pût produire tous les effets imaginables. On n’a pas voulu faire réflexion que tous les êtres, agissant et réagissant sans cesse les uns sur les autres, produisent et souffrent en même temps des changements; la progression intime des êtres qui ont été successivement cause et effet a bientôt fatigué l’esprit de ceux qui veulent absolument trouver la cause dans tous les effets: sentant leur imagination épuisée par cette longue suite d’idées, il leur a paru plus court de remonter tout d’un coup à une première cause, qu’ils ont imaginée comme la cause universelle, à l’égard de laquelle les causes particulières sont des effets, et qui n’est, elle, l’effet d’aucune cause.
Voilà le Dieu des hommes, Juliette; voilà la sotte chimère de leur débile imagination. Tu vois par quel enchaînement de sophismes ils sont venus à bout de la créer; et, d’après la définition particulière que je t’ai donnée, tu vois que ce fantôme, n’ayant qu’une existence objective, ne saurait être hors de l’esprit de ceux qui le considèrent, et n’est par conséquent qu’un pur effet de l’embrasement de leur cerveau. Voilà pourtant le Dieu des mortels, voilà l’être abominable qu’ils ont inventé, et dans les temples duquel ils ont fait couler tant de sang!
Si je me suis étendue, poursuivit Mme Delbène, sur les différences essentielles entre les existences réelles et les existences objectives, c’est, tu le vois, ma chère, parce qu’il était urgent que je te démontrasse les variétés qui se trouvent dans les opinions pratiques et spéculatives des hommes, et que je te fisse voir qu’ils donnent une existence réelle à beaucoup de choses qui n’ont qu’une existence spéculative: or, c’est au produit de cette existence spéculative que les hommes ont donné le nom de Dieu. S’il ne résultait de tout cela que de faux raisonnements, l’inconvénient serait médiocre; mais malheureusement on va plus loin: l’imagination s’enflamme, l’habitude se forme, et l’on s’accoutume à considérer comme quelque chose de réel ce qui n’est l’ouvrage que de notre faiblesse. On ne s’est pas plus tôt persuadé que la volonté de cet être chimérique est cause de tout ce qui nous arrive, que l’on emploie tous les moyens de lui être agréable, toutes les façons de l’implorer.
Que de plus mûres réflexions nous éclairent, et, ne nous déterminant sur l’adoption d’un Dieu que d’après ce qui vient d’être dit, persuadons-nous que toute l’idée de Dieu ne pouvant se présenter à nous que d’une manière objective, il ne peut résulter d’elle que des illusions et des fantômes.
Quelques sophismes qu’allèguent les partisans absurdes de la divinité chimérique des hommes, ils ne vous disent autre chose, sinon qu’il n’y a point d’effet sans cause; mais ils ne vous démontrent pas qu’il faille en revenir à une première cause éternelle, cause universelle de toutes les causes particulières, et qui soit elle-même créatrice, et indépendante de toute autre cause. Je conviens que nous ne comprenons pas la liaison, la suite et la progression de toutes les causes; mais l’ignorance d’un fait n’est jamais un motif suffisant pour en croire ou déterminer un autre. Ceux qui veulent nous persuader l’existence de leur abominable Dieu osent effrontément nous dire que, parce que nous ne pouvons assigner la véritable cause des effets, il faut que nous admettions nécessairement la cause universelle. Peut-on faire un raisonnement plus imbécile? Comme s’il ne valait pas mieux convenir de son ignorance que d’admettre une absurdité; ou comme si l’admission de cette absurdité devenait une preuve de son existence. L’aveu de notre faiblesse n’a nul inconvénient, sans doute; l’adoption du fantôme est remplie d’écueils contre lesquels nous ne ferons que nous heurter si nous sommes sages, mais où nous nous briserons si nos têtes s’exaltent: et les chimères échauffent toujours.
Accordons, si l’on veut, un instant, à nos antagonistes l’existence du vampire qui fait leur félicité[1]. Je leur demande, dans cette hypothèse, si la loi, la règle, la volonté par laquelle Dieu conduit les êtres, est de même nature que notre volonté et que notre force, si Dieu, dans les mêmes circonstances, peut vouloir et ne pas vouloir, si la même chose peut lui plaire et lui déplaire, s’il ne change pas de sentiment, si la loi par laquelle il se conduit est immuable. Si c’est elle qui le conduit, il ne fait que l’exécuter: de ce moment, il n’a aucune puissance. Cette loi nécessaire, qu’est-elle alors elle-même? est-elle distincte de lui ou inhérente à lui? Si, au contraire, cet être peut changer de sentiment et de volonté, je demande pourquoi il en change. Assurément, il lui faut un motif, et un bien plus raisonnable que ceux qui nous déterminent, car Dieu doit l’emporter sur nous en sagesse, comme il nous surpasse en prudence; or, ce motif peut-il s’imaginer sans altérer la perfection de l’être qui y cède? Je vais plus loin: si Dieu sait d’avance qu’il changera de volonté, pourquoi, dès qu’il peut tout, n’a-t-il pas arrangé les circonstances de manière à ce que cette mutation toujours fatigante, et prouvant toujours de la faiblesse, ne lui devînt nullement nécessaire? et s’il l’ignore, qu’est-ce qu’un Dieu qui ne prévoit pas ce qu’il doit faire? S’il le prévoit, et qu’il ne puisse se tromper, comme il faut le croire pour avoir de lui une idée convenable, il est donc arrêté, indépendamment de sa volonté, qu’il agira de telle ou telle façon: or, qu’est-elle, cette loi que sa volonté suit? où est-elle! d’où tire-t-elle sa force!
Si votre Dieu n’est pas libre, s’il est déterminé à agir en conséquence des lois qui le maîtrisent, alors c’est une force semblable au destin, à la fortune, que des vœux ne toucheront point, que des prières ne fléchiront point, que des offrandes n’apaiseront pas davantage, et qu’il vaut mieux mépriser éternellement qu’implorer avec aussi peu de succès.
Mais si, plus dangereux, plus méchant et plus féroce encore, votre exécrable Dieu a caché aux hommes ce qui devenait nécessaire à leur bonheur, son projet n’était donc pas de les rendre heureux; il ne les aime donc pas, il n’est donc alors ni juste ni bienfaisant. Il me semble qu’un Dieu ne doit rien vouloir que de possible, et il ne l’est pas que l’homme observe des lois qui le tyrannisent ou qui lui sont inconnues.
Ce vilain Dieu fait encore plus: il hait l’homme pour avoir ignoré ce qu’on ne lui a point appris; il le punit pour avoir transgressé une loi inconnue, pour avoir suivi des penchants qu’il ne tient que de lui seul. Ô Juliette! s’écria mon institutrice, puis-je concevoir cet infernal et détestable Dieu autrement que comme un tyran, un barbare, un monstre, auquel je dois toute la haine, tous les courroux, tout le mépris que mes facultés physiques et morales peuvent exhaler à la fois!
Ainsi, vînt-on même à bout de me démontrer… de me prouver l’existence de Dieu; dût-on réussir à me convaincre qu’il a dicté des lois, qu’il a choisi des hommes pour les attester aux mortels; me fît-on voir que le plus harmonieux accord règne dans toutes les relations qui viennent de lui: rien ne pourrait me prouver que je lui plais en suivant ses lois, car, s’il n’est pas bon, il peut me tromper, et ma raison, qui ne vient que de lui, ne me rassurera pas, puisqu’il peut alors ne me l’avoir donnée que pour mieux me précipiter dans l’erreur.
Poursuivons. Je vous demande maintenant, ô déistes, comment ce Dieu, que je veux bien admettre un moment, se conduira vis-à-vis de ceux qui n’ont aucune connaissance de ses lois. Si Dieu punit l’ignorance invincible de ceux auxquels ses lois n’ont pu être annoncées, il est injuste; s’il ne peut les en instruire, il est impuissant.
Il est certain que la révélation des lois de l’Éternel doit porter des caractères qui prouvent le Dieu dont elles émanent or, de toutes les révélations qui nous sont parvenues, je demande laquelle porte ce caractère aussi évident qu’indispensable. C’est donc par la religion même que se détruit le Dieu qu’annonce la religion: or, que deviendra cette religion, quand le Dieu qu’elle établit n’aura plus d’existence que dans la tête des sots!
Que les connaissances humaines soient réelles ou fausses, peu importe au bonheur de la vie: il n’en est pas de même en matière de religion. Lorsque les hommes ont une fois réalisé les objets imaginaires qu’elle présente, ils se passionnent pour ces objets; ils se persuadent que ces fantômes qui voltigent dans leur esprit existent réellement, et, de ce moment, rien ne peut plus les retenir. Chaque jour, nouveaux sujets de trembler: tels sont les uniques effets produits en nous par l’idée dangereuse d’un Dieu. C’est cette idée seule qui cause les maux les plus cuisants de la vie de l’homme; c’est elle qui le contraint à la privation des plus doux plaisirs de la vie, dans la frayeur de déplaire à ce fruit dégoûtant de son imagination en délire. Il faut donc, mon aimable amie, se délivrer le plus tôt possible des terreurs que cette chimère inspire; et pour cela, sans doute, il ne faut que porter la faux sur l’idole, il ne faut que la pulvériser d’un bras ferme.
L’idée que les prêtres veulent nous donner de la divinité n’est autre chose que celle d’une cause universelle, et de laquelle toutes les autres sont des effets. Les imbéciles, auxquels ces imposteurs se sont adressés, ont cru qu’une telle cause existait… pouvait exister séparément des effets particuliers qu’elle produit, comme si les modalités d’un corps pouvaient être séparées de ce corps, comme si la blancheur étant une des qualités de la neige, il était possible de séparer d’elle cette qualité. Les modifications quittent-elles les corps qu’elles modifient! Eh bien! votre Dieu n’est qu’une modification de la matière perpétuellement en action par son essence: cette action que vous croyez pouvoir en séparer, cette énergie de la matière, voilà votre Dieu. Examinez maintenant, sots adorateurs d’un tel être, de quel hommage il peut être digne!
Ceux qui ne font produire à la première cause que le mouvement local des corps, et qui donnent à nos esprits la force de se déterminer, bornent étrangement cette cause et lui ôtent son universalité, pour la réduire à ce qu’il y a de plus bas dans la nature, c’est-à-dire à l’emploi de remuer la matière. Mais comme tout est lié dans la nature, que les sentiments spirituels produisent des mouvements dans les corps vivants, que les mouvements des corps excitent des sentiments dans les âmes, on ne peut avoir recours à cette supposition pour établir ou pour défendre le culte religieux. Nous ne voulons qu’en conséquence de la perception des objets qui se présentent à nous; les perceptions ne nous viennent qu’à l’occasion du mouvement excité dans nos organes: donc la cause du mouvement est celle de notre volonté. Si cette cause ignore l’effet que produira le mouvement en nous, quelle idée indigne d’un Dieu! S’il le sait, il en est complice, et il y consent; si, le sachant, il n’y consent pas, il est donc forcé de faire ce qu’il ne veut pas; il y a donc quelque chose de plus puissant que lui: donc il est contraint de suivre des lois. Comme nos volontés sont toujours suivies de quelques mouvements, Dieu est par conséquent obligé de concourir avec notre volonté: il est donc dans le bras du parricide, dans le flambeau de l’incendiaire, dans le con de la prostituée. Dieu n’y consent-il pas, le voilà moins fort que nous, le voilà contraint à nous obéir. Donc, quelque chose que l’on dise, il faut avouer qu’il n’y a point de cause universelle; ou si vous voulez absolument qu’il y en ait une, il faut que nous convenions qu’elle consent à tout ce qui nous arrive et ne veut jamais autre chose; il faut que vous avouiez encore qu’elle ne peut aimer ni haïr aucun des êtres particuliers qui émanent d’elle, parce que tous lui obéissent également, et que, d’après cela, les mots de peines, de récompenses, de lois, de défenses, d’ordre, de désordre, ne sont que des mots allégoriques, tirés de ce qui se passe parmi les hommes.
Si l’on n’est pas obligé de regarder Dieu comme un être essentiellement bon, comme un être qui aime les hommes, on peut croire qu’il a voulu les tromper. Ainsi, quand même tous les prodiges sur lesquels se fondent ceux qui prétendent connaître les lois qu’il a révélées à quelques hommes seraient véritables, comme tout nous confirme que c’est un être injuste, inhumain, nous n’avons pas d’assurance qu’il n’ait pas fait ces prodiges exprès pour nous tromper, et rien ne nous autorise à croire que l’observation la plus stricte de ses lois puisse jamais me rendre son ami. S’il ne punit pas ceux qui ont observé ces lois, leur observance devient inutile; et comme cette observance est pénible, votre Dieu, en la promulguant, s’est à la fois rendu coupable d’inutilité et de méchanceté: je vous demande dès lors si c’est là un être digne de nos hommages. Ces lois, d’ailleurs, n’ont rien de respectable: elles sont absurdes, contraires à la raison, elles répugnent au moral, affligent le physique; ceux qui les annoncent les violent à tout moment; et s’il est quelques individus dans le monde qui s’avisent d’y ajouter foi, scrutons avec soin leur esprit: nous les reconnaîtrons bientôt pour des imbéciles. Veux-je approfondir les preuves de ce fatras de mystères et de lois dictées par ce Dieu ridicule, je ne les trouve appuyées que sur des traditions confuses, incertaines, et toujours victorieusement combattues par les adversaires.
Disons-le avec vérité: de toutes les religions établies parmi les hommes, il n’en est aucune qui puisse légitimement l’emporter sur l’autre; pas une qui ne soit remplie de fables, de mensonges, de perversités, et qui n’offre à la fois les dangers les plus imminents, à côté des contradictions les plus palpables. Des fous veulent-ils établir leurs rêveries, ils appellent les miracles à leur secours: d’où il résulte que, toujours dans le même cercle, à présent c’est le miracle qui prouve la religion, tandis que tout à l’heure la religion prouvait le miracle. Encore s’il n’en était qu’une qui pût s’étayer de prodiges: mais toutes en citent, toutes en offrent.
Et le beau cygne de Léda
Vaut bien le pigeon de Marie.
Si, néanmoins, tous ces miracles étaient vrais, il résulterait nécessairement que Dieu aurait permis qu’il en fût fait pour les fausses religions comme pour les bonnes, et que, d’après cela, l’erreur ne le toucherait guère plus que la vérité. Ce qu’il y a de plaisant, c’est que chaque secte est également persuadée de la réalité de ses prodiges. Si tous sont faux, on doit en conclure que des nations entières ont pu croire des prodiges supposés: donc sur le chapitre des prodiges, la persuasion vive d’une nation entière n’en prouve pas la vérité. Mais il n’y a aucun de ces faits dont on puisse autrement prouver la vérité que par la persuasion de ceux qui les croient maintenant: donc il n’y en a aucun dont la vérité soit suffisamment établie; et comme ces prodiges sont les seuls moyens par lesquels on puisse nous obliger à croire une religion, nous devons conclure qu’il n’en est aucun de prouvé, et les regarder comme l’ouvrage du fanatisme, de la fourberie, de l’imposture et de l’orgueil.
— Mais, interrompis-je ici, s’il n’y a ni Dieu, ni religion, qui gouverne donc l’univers?
— Ma chère amie, reprit Mme Delbène, l’univers est mû par sa propre force, et les lois éternelles de la nature, inhérentes à elle-même, suffisent, sans une cause première, à produire tout ce que nous voyons; le mouvement perpétuel de la matière explique tout: quel besoin de supposer un moteur à ce qui est toujours en mouvement? L’univers est un assemblage d’êtres différents qui agissent et réagissent mutuellement et successivement les uns sur les autres; je n’y découvre aucune borne, je n’y aperçois seulement qu’un passage continuel d’un état à un autre, par rapport aux êtres particuliers qui prennent successivement plusieurs formes nouvelles, mais je ne crois point une cause universelle, distinguée de lui, qui lui donne l’existence et qui produise les modifications des êtres particuliers qui le composent: j’avoue même que j’y vois absolument tout le contraire, et que je crois l’avoir démontré. Ne nous inquiétons donc nullement de mettre quelque chose à la place des chimères, et n’admettons jamais comme cause de ce que nous ne comprenons pas quelque chose que nous comprenons encore moins.
Après t’avoir démontré l’extravagance du système déifique, poursuivit cette charmante femme, je n’aurai pas grand-peine, sans doute, à détruire en toi les préjugés inculqués dès l’enfance sur le principe de notre vie. Est-il rien de plus extraordinaire en effet que la supériorité que les hommes s’arrogent sur les autres animaux? Dès qu’on leur demande ce qui fonde cette supériorité: Notre âme, répondent-ils imbécilement. Les prie-t-on d’expliquer ce qu’ils entendent par ce mot: âme? Oh! pour lors, vous les voyez balbutier, se contredire: C’est une substance inconnue, disent-ils; c’est une force secrète distinguée de leur corps; c’est un esprit dont ils n’ont nulle idée. Demandez-leur comment cet esprit, qu’ils supposent, comme leur Dieu, totalement privé d’étendue, a pu se combiner avec leur corps étendu et matériel, ils vous diront qu’ils n’en savent rien, que c’est un mystère, que cette combinaison est l’effet de la toute-puissance de Dieu. Voilà les idées nettes que l’imbécillité se forme de sa substance cachée, ou plutôt imaginaire, dont elle a fait le mobile de toutes ses actions.
A cela je ne réponds qu’une chose: si l’âme est une substance essentiellement différente du corps et qui ne peut avoir aucune relation avec lui, leur union est une chose impossible; d’ailleurs cette âme, étant d’une essence différente du corps, devrait nécessairement agir d’une façon différente de lui; cependant nous voyons que les mouvements éprouvés par les corps se font sentir à cette âme prétendue, et que ces deux substances, diverses par leur essence, agissent toujours de concert. Vous nous direz encore que cette harmonie est un mystère, et moi je vous répondrai que je ne vois pas mon âme, que je ne connais et ne sens que mon corps, que c’est le corps qui sent, qui pense, qui juge, qui souffre, qui jouit, et que toutes ses facultés sont des résultats nécessaires de son mécanisme et de son organisation.
Quoique les hommes soient dans l’impossibilité de se faire la moindre idée de leur âme, quoique tout leur prouve qu’ils ne sentent, ne pensent, n’acquièrent des idées, ne jouissent et ne souffrent que par le moyen des sens ou des organes matériels du corps, ils se persuadent pourtant que cette âme inconnue est exempte de mort. Mais, en supposant même l’existence de cette âme, dites-moi, je vous prie, si l’on peut s’empêcher de reconnaître qu’elle dépend totalement du corps, et qu’elle subit conjointement avec lui toutes les vicissitudes qu’il éprouve lui-même. Et cependant on porte l’absurdité jusqu’à croire qu’elle n’a, par sa nature, rien d’analogue à lui; on veut qu’elle puisse agir et sentir sans le secours de ce corps; en un mot, on prétend que, privée de ce corps et dégagée des sens, cette âme sublime pourra vivre pour souffrir, éprouver le bien-être ou sentir des tourments rigoureux. C’est sur un pareil tas d’absurdités conjecturales que l’on bâtit l’opinion merveilleuse de l’immortalité de l’âme.
Si je demande quels motifs on a de supposer l’âme immortelle, on me répond aussitôt: C’est que l’homme, par sa nature, désire d’être immortel. Mais, répliquerai-je, votre désir devient-il une preuve de son accomplissement? Par quelle étrange logique ose-t-on décider qu’une chose ne peut manquer d’arriver, seulement parce qu’on la souhaite? Les impies, continue-t-on, privés des espérances flatteuses d’une autre vie, désirent d’être anéantis. Eh bien! ne sont-ils pas autant autorisés à conclure, d’après ce désir, qu’ils seront anéantis, que vous vous prétendez autorisés à conclure, vous, que vous existerez simplement parce que vous le désirez?
Ô Juliette, poursuivait cette femme philosophe avec toute l’énergie de la persuasion, ô ma chère amie, n’en doute pas, nous mourons tout entiers, et le corps humain, après que la Parque a coupé le fil, n’est plus qu’une masse incapable de produire les mouvements dont l’assemblage constituait la vie. On n’y voit plus alors ni circulation, ni respiration, ni digestion, ni parole, ni pensée. On prétend que, pour lors, l’âme s’est séparée du corps; mais dire que cette âme, qu’on ne connaît point, est le principe de la vie, c’est ne rien dire, sinon qu’une force inconnue est le principe caché de mouvements imperceptibles. Rien de plus naturel et de plus simple que de croire que l’homme mort n’est plus; rien de plus extravagant que de croire que l’homme mort est encore en vie.
Nous rions de la simplicité de quelques peuples dont l’usage est d’enterrer des provisions avec les morts: est-il donc plus absurde de croire que les hommes mangeront après la mort, que de s’imaginer qu’ils penseront, qu’ils auront des idées agréables ou fâcheuses, qu’ils jouiront, qu’ils souffriront, qu’ils éprouveront du repentir ou de la joie, lorsque les organes, propres à leur porter des sensations ou des idées, seront une fois dissous et réduits en poussière? Dire que les âmes humaines seront heureuses ou malheureuses après la mort, c’est prétendre que les hommes pourront voir sans yeux, entendre sans oreilles, goûter sans palais, flairer sans nez, toucher sans mains, etc. Des nations qui se croient très raisonnables adoptent pourtant de pareilles idées.
Le dogme de l’immortalité de l’âme suppose que l’âme est une substance simple, en un mot, un esprit: mais je demanderai toujours ce que c’est qu’un esprit.
— On m’a appris, répondis-je à Mme Delbène, qu’un esprit était une substance privée d’étendue, incorruptible, et qui n’a rien de commun avec la matière.
— Mais si cela est, reprit avec vivacité mon institutrice, comment ton âme naît-elle, s’accroît-elle, se fortifie-t-elle, se dérange-t-elle, vieillit-elle, dans les mêmes proportions que ton corps?
A l’exemple de tous les sots qui ont eu les mêmes principes, tu me répondras que tout cela sont des mystères. Mais, imbéciles que vous êtes, si ce sont des mystères, vous n’y comprenez donc rien, et si vous n’y comprenez rien, comment pouvez-vous décider affirmativement une chose dont vous êtes incapables de vous former aucune idée? Pour croire ou pour affirmer quelque chose, il faut au moins savoir en quoi consiste ce que l’on croit et ce que l’on affirme. Croire à l’immortalité de l’âme, c’est dire que l’on est persuadé de l’existence d’une chose dont il est impossible de se former aucune notion véritable, c’est croire à des mots sans y pouvoir attacher aucun sens; affirmer qu’une chose est telle qu’on la dit, c’est le comble de la folie et de la vanité.
Que de théologiens sont d’étranges raisonneurs! Dès qu’ils ne peuvent deviner les causes naturelles des choses, ils inventent des causes surnaturelles, ils imaginent des esprits, des dieux, des causes occultes, des agents inexplicables, ou plutôt des mots bien plus obscurs que les choses qu’ils s’efforcent d’expliquer. Demeurons dans la nature quand nous voudrons nous rendre compte des effets de la nature; ne nous écartons jamais d’elle quand nous voudrons expliquer ses phénomènes; ignorons les causes trop déliées pour être saisies par nos organes, et soyons persuadés qu’en sortant de la nature nous ne trouverons jamais la solution des problèmes que la nature nous présente.
Dans l’hypothèse même de la théologie, c’est-à-dire en supposant un moteur tout-puissant à la matière, de quel droit les théologiens refuseraient-ils à leur Dieu de donner à cette matière la faculté de penser! Lui serait-il plus difficile de créer ces combinaisons de matière dont résultât la pensée, que des esprits qui pensent? Au moins, en supposant une matière qui pensât, nous aurions quelques notions du sujet de la pensée ou de ce qui pense en nous; tandis qu’en attribuant la pensée à un être immatériel, il nous est impossible de nous en faire la moindre idée.
On nous objecte que le matérialisme fait de l’homme une pure machine, ce que l’on juge très déshonorant pour l’espèce humaine; mais cette espèce humaine sera-t-elle bien plus honorée, quand on dira que l’homme agit par les impulsions secrètes d’un esprit ou d’un certain je ne sais quoi qui sert à l’animer sans qu’on sache comment?
Il est aisé de s’apercevoir que la supériorité que l’on donne à l’esprit sur la matière, ou à l’âme sur le corps, n’est fondée que sur l’ignorance où l’on est de la nature de cette âme, tandis que l’on est plus familiarisé avec la matière ou le corps, que l’on s’imagine connaître et dont on croit démêler les ressorts; mais les mouvements les plus simples de nos corps sont, pour tout homme qui les médite, des énigmes aussi difficiles à deviner que la pensée.
L’estime que tant de gens ont pour la substance spirituelle ne paraît avoir pour motif que l’impossibilité où ils se trouvent de la définir d’une manière intelligible; le peu de cas que nos théologiens font de la matière ne vient que de ce que la familiarité engendre le mépris. Lorsqu’ils nous disent que l’âme est plus excellente que le corps, ils ne nous disent rien, sinon que ce qu’ils ne connaissent aucunement doit être bien plus beau que ce dont ils ont quelques faibles idées.
On nous vante sans cesse l’utilité du dogme de l’autre vie; on prétend que, quand même ce serait une fiction, elle serait avantageuse, parce qu’elle en imposerait aux hommes et les conduirait à la vertu. A cela je demande s’il est bien vrai que ce dogme rende les hommes plus sages et plus vertueux. J’ose affirmer, au contraire, qu’il ne sert qu’à les rendre fous, hypocrites, méchants, atrabilaires, et qu’on trouvera toujours plus de vertus, plus de mœurs chez les peuples qui n’ont aucune de ces idées, que chez ceux où elles font la base des religions. Si ceux qui sont chargés d’instruire et de gouverner les hommes avaient eux-mêmes des lumières et des vertus, ils les gouverneraient bien mieux par des réalités que par des chimères; mais fourbes, ambitieux, corrompus, les législateurs ont partout trouvé plus court d’endormir les nations par des fables que de leur enseigner des vérités… que de développer leur raison, que de les exciter à la vertu par des motifs sensibles et réels… que de les gouverner enfin d’une façon raisonnable.
Ne doutons pas que les prêtres aient eu leurs motifs, pour imaginer la fable ridicule de l’immortalité de l’âme: eussent-ils, sans ces systèmes, mis les mourants à contribution? Ah! si ces dogmes épouvantables d’un Dieu… d’une âme qui nous survit, ne sont d’aucune utilité pour le genre humain, convenons qu’ils sont au moins de la plus grande nécessité pour ceux qui se sont chargés d’en infecter l’opinion publique[2].
— Mais objectai-je à Mme Delbène, le dogme de l’immortalité de l’âme n’est-il pas consolant pour les malheureux? quand ce serait une illusion, n’est-elle pas douce, n’est-elle pas agréable? n’est-ce pas un bien pour l’homme que de croire qu’il pourra se survivre à lui-même, et jouir quelque jour au ciel d’un bonheur qui lui est refusé sur la terre?
— En vérité, me répondit mon amie, je ne vois pas que le désir de tranquilliser quelques malheureux imbéciles vaille la peine d’empoisonner des millions d’honnêtes gens. Est-il raisonnable d’ailleurs de faire de ses souhaits la mesure de la vérité? Ayez un peu plus de courage, consentez à la loi générale, résignez-vous à l’ordre du destin dont les décrets sont qu’ainsi que tous les êtres, vous retombiez dans le creuset de la nature pour en sortir sous d’autres formes. Car, dans le fait, rien ne périt dans le sein de cette mère du genre humain; les éléments qui nous composent se réuniront bientôt sous d’autres combinaisons; un laurier perpétuel croit sur le tombeau de Virgile. Cette transmigration glorieuse n’est-elle pas, sots déistes, aussi douce que votre alternative de l’enfer ou du paradis? Car si ce dernier est consolant, on m’avouera que l’autre est affreux. Ne dites-vous pas, imbéciles chrétiens, qu’il faut, pour se sauver, des grâces que votre Dieu n’accorde qu’à très peu de gens? Certes, voilà des idées fort consolantes; et ne vaut-il pas mieux cent fois être anéanti que de brûler éternellement? Qui osera donc soutenir, d’après cela, que l’opinion qui débarrasse de ces craintes ne soit mille fois plus agréable que l’incertitude où nous laisse l’admission d’un Dieu qui, maître de ses grâces, ne les donne qu’à ses favoris, et qui permet que tous les autres se rendent dignes des supplices éternels? Il n’y a que l’enthousiasme ou la folie qui puisse faire préférer un système évident qui tranquillise à des conjectures improbables qui désespèrent.
— Mais que deviendrai-je? dis-je encore à Mme Delbène; cette obscurité m’effraye, cet éternel anéantissement m’effarouche.
— Et qu’étais-tu, je te prie, avant que de naître? me répondit cette femme pleine de génie. Quelques portions pleines de matière non organisée, n’ayant encore reçu aucune forme, ou en ayant reçu dont tu ne peux te souvenir. Eh bien! tu redeviendras les mêmes portions de matière, prêtes à organiser de nouveaux êtres, dès que les lois de la nature le trouveront convenable. Jouissais-tu? Non. Souffrais-tu? Non. Est-ce donc là un état si pénible, et quel est l’être qui ne consentirait pas à sacrifier toutes ses jouissances à la certitude de n’avoir jamais de peines? Que serait-il alors, s’il pouvait conclure ce marché? Un être inerte, sans mouvement. Que sera-t-il après la mort? Positivement la même chose. A quoi sert-il donc de s’affliger, puisque la loi de la nature vous condamne positivement à l’état que vous accepteriez de bon cœur si vous en étiez le maître? Eh! Juliette, la certitude de n’être pas toujours est-elle plus désespérante que celle de n’avoir pas toujours été? Va, va, tranquillise-toi, mon ange; la frayeur de cesser d’être n’est un mal réel que pour l’imagination créatrice du dogme absurde d’une autre vie.
L’âme, ou, si l’on veut, ce principe actif… vivifiant, qui nous anime, qui nous meut, qui nous détermine, n’est autre chose que de la matière subtilisée à un certain point, moyen par lequel elle a acquis les facultés qui nous étonnent. Toutes les portions de matière, sans doute, ne seraient pas capables des mêmes effets; mais combinées avec celles qui composent nos corps, elles en deviennent susceptibles, ainsi que le feu peut devenir flamme quand il est combiné avec des corps gras ou inflammables. L’âme, en un mot, ne peut être considérée que sous deux sens, comme principe actif et comme principe pensant; or, sous l’un et sous l’autre rapport, nous allons la démontrer matière par deux syllogismes sans réplique. 1° Comme principe actif, elle se divise; car le cœur conserve encore son mouvement longtemps après sa séparation d’avec le corps. Or, tout ce qui se divise est matière; l’âme, comme principe actif, se divise: donc elle est matière. 2° Tout ce qui périclite est matière; ce qui serait essentiellement esprit ne saurait péricliter. Or, l’âme suit les impressions du corps: elle est faible dans l’âge tendre, affaissée dans l’âge décrépit; elle éprouve donc les influences du corps; cependant, tout ce qui périclite est matière: l’âme périclite, donc elle est matière.
Osons le dire et le redire sans cesse: rien d’étonnant dans le phénomène de la pensée, ou du moins rien qui prouve que cette pensée soit distincte de la matière, rien qui fasse voir que la matière, subtilisée ou modifiée de telle ou telle façon, ne puisse produire la pensée; cela est infiniment moins difficile à comprendre que l’existence d’un Dieu. Si cette âme sublime était effectivement l’ouvrage de Dieu, pourquoi subirait-elle tous les différente changements ou accidents du corps? Il me semble que, comme l’ouvrage de Dieu, cette âme devrait être parfaite, et c’est ne l’être pas que de se modifier à l’égal d’une matière aussi remplie de défauts. Si cette âme était l’ouvrage d’un Dieu, elle n’aurait pas besoin de sentir ni d’éprouver ses gradations; elle ne le pourrait, ni ne le devrait; elle se joindrait à l’embryon toute formée, et dès le berceau, Cicéron aurait pu composer ses Tusculanes, Voltaire son Alzire, etc. Si cela n’est pas ni ne peut être, l’âme observe donc les mêmes gradations que le corps. Elle a donc des parties, puisqu’elle croît, baisse, augmente ou diminue; or, tout ce qui a des parties est matière: donc l’âme est matière, puisqu’elle est composée de parties. Convenons qu’il est absolument impossible que l’âme puisse exister sans le corps, et celui-ci sans l’autre.
Rien de merveilleux, au reste, dans l’empire absolu de l’âme sur le corps; ce n’est qu’un même tout, composé de parties égales, j’en conviens, mais dans lequel néanmoins les parties grossières doivent être soumises aux parties subtiles, par la même raison de l’empire qu’a la flamme, qui est matière, sur la cire qu’elle consume, qui est également matière; et voilà, comme dans nos corps, l’exemple de deux matières aux prises, dont la plus subtile domine la plus grossière.
En voilà plus qu’il ne t’en faut, Juliette, pour te convaincre, à ce que j’imagine, du néant de l’existence de Dieu et de celui du dogme de l’immortalité de l’âme. Quelle adresse dans ceux qui inventèrent ces deux monstrueux dogmes! Et que n’entreprenait-on pas sur un peuple, en se disant les ministres d’un Dieu dont la haine ou l’amour était d’un si grand intérêt pour la vie future! Quel crédit n’avait-on pas sur l’esprit de gens qui, redoutant des peines ou des récompenses futures, étaient obligés de recourir à ces fourbes, comme aux médiateurs d’un Dieu, seuls capables d’éviter les unes et de valoir les autres! Toutes ces fables ne sont donc que le fruit de l’ambition, de l’orgueil et de la démence de quelques individus, nourries par l’absurdité de quelques autres, mais qui ne sont faites que pour nos mépris… que pour être éteintes… absorbées dans nous, au point de ne jamais reparaître. Oh! combien je t’exhorte, ma chère Juliette, à les détester comme moi! Ces systèmes, dit-on, mènent à la dégradation des mœurs. Eh! mais les mœurs sont-elles donc plus importantes que les religions? Absolument soumises au degré de latitude d’un pays, elles n’ont et ne peuvent avoir rien que d’arbitraire. Rien ne nous est défendu par la nature: les lois seules se sont crues autorisées d’imposer de certaines bornes au peuple, relatives à la température de l’air, à la richesse ou à la pauvreté du climat, à l’espèce d’hommes qu’elles maîtrisent. Mais ces freins, purement populaires, n’ont rien de sacré, rien de légitime aux yeux de la philosophie, dont le flambeau dissipe toutes les erreurs, ne laisse exister dans l’homme sage que les seules inspirations de la nature. Or, rien n’est plus immoral que la nature: jamais elle ne nous imposa de freins; elle ne nous dicta jamais de lois. Ô Juliette! tu vas me trouver bien tranchante, bien ennemie de toutes les chaînes; mais je vais jusqu’à repousser sévèrement cette obligation aussi enfantine qu’absurde, qui nous enjoint de ne pas faire aux autres ce que nous ne voudrions pas qu’il nous fût fait. C’est précisément tout le contraire que la nature nous conseille, puisque son seul précepte est de nous délecter, n’importe aux dépens de qui. Sans doute, il peut arriver, d’après ces maximes, que nos plaisirs troubleront la félicité des autres: en seront-ils moins vifs pour cela? Cette prétendue loi de la nature, à laquelle les sots veulent nous astreindre, est donc aussi chimérique que celles des hommes, et nous savons, en foulant aux pieds les unes et les autres, nous persuader intimement qu’il n’est de mal à rien. Mais nous reviendrons sur tous ces objets, et je me flatte de te convaincre en morale comme je crois t’avoir persuadée en religion. Mettons maintenant nos principes en pratique, et après t’avoir démontré que tu peux tout faire sans crime, commettons tant soit peu de crimes, pour nous convaincre que l’on peut faire tout.
Électrisée par ces discours, je me jette dans les bras de mon amie; je lui rends mille et mille grâces des soins qu’elle veut bien prendre de mon éducation.
— Je te devrai bien plus que la vie, ma chère Delbène! m’écriai-je; qu’est-ce que l’existence sans la philosophie? Est-ce la peine de vivre quand on languit sous le joug du mensonge et de la stupidité? Va, poursuivis-je avec chaleur, je me sens digne de toi maintenant, et c’est sur ton sein que je fais le serment sacré de ne jamais revenir aux chimères que ta tendre amitié vient de détruire en moi! Continue de m’instruire, de diriger mes pas vers le bonheur; je me livre à tes conseils; tu ferais de moi ce que tu voudras, bien sûre que tu n’auras jamais eu d’écolière ni plus ardente, ni plus soumise que Juliette.
La Delbène était dans l’ivresse: il n’est point, pour un esprit libertin, de plaisir plus vif que celui de faire des prosélytes. On jouit des principes qu’on inculque; mille sentiments divers sont flattés, en voyant les autres se gangrener à la corruption qui nous mine. Ah! comme on chérit cette influence obtenue sur leur âme, unique ouvrage de nos conseils et de nos séductions! Delbène me rendit tous les baisers dont je l’accablais; elle me dit que j’allais devenir une fille perdue, comme elle, une fille sans mœurs, une athée, et qu’unique cause de mon désordre, elle aurait à répondre devant Dieu de l’âme qu’elle lui enlevait. Et ses caresses devenant plus ardentes, nous allumâmes bientôt le feu des passions au flambeau de la philosophie.
— Tiens, me dit Delbène, puisque tu veux être dépucelée, je vais te satisfaire à l’instant.
Ivre de luxure, la friponne s’arme aussitôt d’un godemiché; elle me branle pour endormir en moi la douleur qu’elle va, dit-elle, me causer, et me porte ensuite des coups si terribles, que mon pucelage disparut au second bond. On ne se peint point ce que je souffris; mais, aux douleurs cuisantes de cette terrible opération, succédèrent bientôt les plus doux plaisirs. Delbène, que rien n’épuisait, était loin de se fatiguer; me limant à tour de reins, sa langue enfoncée dans ma bouche, et de ses mains chatouillant mon derrière, il y avait une heure que je déchargeais dans ses bras, lorsqu’à la fin je lui demandai grâce.
— Rends-moi tout ce que je viens de te faire, me dit-elle aussitôt… Je suis dévorée de luxure, je n’ai pas joui, moi, pendant que je te foutais; je veux décharger à mon tour.
De maîtresse chérie je devins bientôt l’amant le plus passionné: j’enconne Delbène, je la lime. Dieu! quel égarement! Nulle femme n’était aussi aimable, aucune n’était emportée comme elle dans le plaisir; dix fois de suite la friponne se pâma dans mes bras, je crus qu’elle se distillerait en foutre.
— Ô ma bonne, lui dis-je, n’est-il pas vrai que plus l’on a d’esprit et mieux l’on goûte les douceurs de la volupté?
— Assurément, me répondit Delbène, et la raison de cela
est bien simple: la volupté n’admet aucune chaîne, eue ne jouit jamais mieux que quand elle les rompt toutes; or, plus un être a d’esprit, plus il brise de freins: donc l’homme d’esprit sera toujours plus propre qu’un autre aux plaisirs du libertinage.
— Je crois que l’extrême finesse des organes y contribue beaucoup aussi, répondis-je.
— Cela n’est pas douteux, dit Mme Delbène: plus la glace est polie, mieux elle reçoit, et mieux elle réfléchit les objets qui lui sont présentés.
Enfin, épuisées toutes deux, je rappelai à mon institutrice la promesse qu’elle m’avait faite de dépuceler Laurette.
— Je ne l’ai point oubliée, me répondit Mme Delbène, c’est pour cette nuit. Dès que l’on sera remonté dans les dortoirs, tu t’échapperas, Volmar et Flavie en feront autant. Ne t’inquiète pas du reste; te voilà maintenant initiée dans nos mystères: sois ferme, sois courageuse, Juliette, et je te ferai voir d’étonnantes choses.
Je quittai mon amie pour reparaître dans la maison; mais jugez quelle fut ma surprise lorsque j’entendis raconter qu’une pensionnaire venait de se sauver du couvent; je demande aussitôt son nom: c’est Laurette.
— Laurette! m’écriai-je; puis à part: Ô Dieu! elle sur qui je comptais; elle qui m’avait si bien échauffé la tête!… Perfides désirs, vous aurai-je donc conçus vainement?
Je demande des détails, personne ne peut m’en donner; je vole chez Delbène pour l’instruire, sa porte est fermée, il m’est impossible de la joindre avant l’heure qu’elle m’a indiquée. Qu’elle me parut longue, cette heure! Elle sonne enfin; Volmar et Flavie m’avaient devancée; elles étaient déjà chez Delbène[3].
— Eh bien, dis-je à la supérieure, comment me tiendras-tu la parole que tu m’as donnée? Laurette n’est plus ici: par qui la remplacer maintenant?
Et puis avec un peu d’aigreur:
— Ah! je vois bien que je ne jouirai jamais du plaisir que vous m’avez promis.
— Juliette, me dit Mme Delbène d’un air très sérieux, la première des lois de l’amitié est la confiance: si tu veux être des nôtres, ma chère, il faut et plus de retenue et moins de soupçons. Est-il vraisemblable que je t’eusse promis un plaisir que je ne saurais te faire goûter? et ne devais-tu pas me supposer assez d’adresse… me croire assez de crédit dans cette maison, pour que, les moyens de ces voluptés ne dépendant que de moi, tu ne dusses jamais craindre de n’en pas jouir? Suis-nous, tout est calme. Ne t’avais-je pas dit que je te ferais voir des choses singulières?
Delbène allume une petite lanterne; elle marche devant nous; Volmar, Flavie et moi la suivions. Arrivées dans l’église, quel est mon étonnement de voir la supérieure ouvrir un tombeau et pénétrer dans l’asile des morts! Mes compagnes, au fait, la suivent en silence; je témoigne un peu de frayeur, Volmar me rassure; Delbène rabaisse la pierre. Nous voilà dans les souterrains destinés à servir de sépulture à toutes les femmes qui mouraient dans le couvent. Nous avançons, une nouvelle pierre se lève, et quinze à seize marches à descendre nous font parvenir dans une espèce de salle basse très artistement décorée, et qui prenait de l’air par des ventouses correspondant au milieu des jardins. Ô mes amis! je vous laisse à penser qui je trouvai là… Laurette, parée comme les vierges qu’on immolait jadis au temple de Bacchus… l’abbé Ducroz, grand vicaire de l’archevêque de Paris, homme de trente ans, d’une très jolie figure, spécialement chargé de la police de Panthemont, et le père Télème, récollet, beau brun de trente-six ans, confesseur des novices et des pensionnaires.
— Elle a peur, dit Delbène en s’avançant vers ces deux hommes et me présentant à eux; apprends, jeune innocente, continua-t-elle en me baisant, que nous ne nous réunissons ici que pour foutre… que pour nous livrer à des horreurs… à des atrocités. Si nous nous engloutissons au fond de la région des morts, c’est pour être le plus loin possible des vivants. Quand on est aussi libertins, aussi dépravés, aussi scélérats, on voudrait être dans les entrailles de la terre, afin de mieux fuir les hommes et leurs absurdes lois.
Quelque avancée que je fusse dans la carrière de la lubricité, j’avoue que ce début m’interdit.
— Ô ciel! dis-je tout émue, qu’allons-nous donc faire dans ces souterrains?
— Des crimes, me dit Mme Delbène; nous allons nous en souiller à tes yeux, nous allons t’apprendre à nous imiter… Redouterais-tu quelques faiblesses?… Aurais-je eu tort de répondre de toi?
— Ne le crains point, répondis-je avec vivacité, je fais serment entre tes mains de ne m’effrayer de quoi que ce puisse être.
Aussitôt, Delbène ordonne à Volmar de me déshabiller.
— Elle a le plus joli cul du monde, dit le grand vicaire dès qu’il m’eut vue toute nue.
Et des baisers… des attouchements couvrirent aussitôt mes fesses; puis, passant une de ma mains sur ma motte, l’homme de Dieu tâchait que son membre pût frotter assez hermétiquement mon derrière pour en être lubriquement chatouillé: bientôt il y pénètre presque sans peine, et dans le même instant Télème enfile mon con. Tous deux déchargent, et j’avoue que je les suivis de près.
— Juliette, me dit la supérieure, nous venons de vous procurer les deux plus grands plaisirs dont une femme puisse jouir: il faut que vous nous disiez franchement duquel des deux vous avez été le mieux délectée.
— En vérité, madame, répondis-je, l’un et l’autre m’ont donné tant de plaisir, qu’il me serait impossible de prononcer. J’éprouve encore, par réminiscence, des sensations en même temps si confuses et si voluptueuses, que je leur assignerais bien difficilement leur véritable place.
— Il faut la faire recommencer, dit Télème; l’abbé et moi nous varierons nos attaques, nous prierons la belle Juliette d’interroger ses sensations, et de nous en rendre un compte plus exact.
— Eh bien! volontiers, répondis-je; je crois comme vous que ce n’est qu’en recommençant qu’il me sera possible de décider.
— Elle est charmante, dit la supérieure; il y a bien là de quoi nous faire la plus jolie petite putain que nous ayons formée depuis longtemps. Mais il faut arranger tout ceci non seulement pour que Juliette décharge délicieusement, mais pour qu’il rejaillisse quelque chose sur nous des plaisirs qu’elle va goûter.
En conséquence de ces libertins projets, voici comment le tableau se dessina:
Télème, qui venait de foutre mon con, s’arrangea dans mon cul; il l’avait un peu plus gros que son confrère, mais, toute novice que j’étais, la nature sans doute m’avait si bien créée pour ces plaisirs, que je ne souffris point de la différence. J’étais couchée à plat ventre sur la supérieure, de manière à ce que mon clitoris posât sur sa bouche, et la friponne, mollement étendue sur des carreaux, le suçait en écartant les cuisses. Entre ses jambes, Laurette, courbée, lui rendait ce qu’elle me faisait, et le plaisir que la coquine recevait, elle le faisait voluptueusement refluer sur Volmar et Flavie, qu’elle masturbait de droite et de gauche. Ducroz derrière Laurette, se branlait légèrement sur ses fesses, mais sans y pénétrer: l’honneur de l’un et l’autre pucelage de cette petite fille ne regardait absolument que moi.
Toutes les scènes de fouterie commencent par un moment de calme: il semble que l’on veuille savourer la volupté tout entière et qu’on craigne de la laisser échapper en parlant. Il m’était recommandé de jouir avec attention, afin de comparer; j’étais dans une extase silencieuse; et, je l’avoue, les plaisirs incroyables que je recevais des secousses vives et réitérées du vit de Télème dans le trou de mon cul, les angoisses lubriques où me plongeaient les frétillements de la langue de l’abbesse sur mon clitoris, les scènes luxurieuses dont j’étais entourée, la réunion enfin de tant d’épisodes lascifs, tenaient mes sens dans un délire où j’aurais voulu vivre éternellement.
Télème essaya de parler le premier, mais ses bégaiements, ses soupirs entrecoupés, exprimaient bien moins ses idées que son désordre. Tout ce que nous pûmes comprendre, c’est qu’il jurait beaucoup, et que l’extrême chaleur, le resserrement de mon anus, lui faisaient goûter de bien grands plaisirs.
— Je suis prêt à décharger dans le plus divin des derrières! s’écria-t-il enfin; je ne sais si Juliette sera plus délectée de recevoir mon foutre dans son cul qu’elle ne l’a été de le sentir éjaculer dans son con; mais pour moi, je jure que j’ai mille fois plus de plaisir à la sodomiser que je n’en ressentis au fond de son vagin.
— C’est histoire de goût, dit Ducroz, qui se branlait fortement sur le cul de Laurette en baisant Flavie.
— C’est philosophie, c’est raison, dit Volmar nerveusement branlée par Delbène et langotant Ducroz; quoique femme, je pense de même, et je proteste bien que, si j’étais homme, je ne foutrais jamais qu’en cul.
Et la voluptueuse créature décharge en prononçant ces paroles impures. Télème la suit de près; il devient furieux; retournant ma tête vers lui, il enfonce d’un pied sa langue dans ma bouche; Delbène me suce si voluptueusement pendant ce temps-là, que je m’abandonne. Je veux crier de plaisir, la langue chatouilleuse de Télème repousse mes paroles, le libertin avale mes soupirs; j’inonde les lèvres et le gosier de ma suceuse qui, elle-même, lance des torrents dans la bouche de Laurette; Flavie se joint bientôt à nous, et la charmante libertine perd son foutre en jurant comme un charretier.
— Passons à autre chose, dit Delbène en se relevant. Ducroz, enconnez Juliette; elle se couchera dans vos bras; Volmar, également à plat ventre, lui gamahuchera le cul; je me coulerai sous Volmar pour lui sucer le clitoris; pendant que Télème m’enconnera, Flavie donnera la diligence à Télème, qui chatouillera le con de Laurette, et cela tout en me foutant.
De nouvelles libations à Cypris terminèrent cette seconde épreuve et l’on m’interrogea.
— Ô mon amie, dis-je à Delbène qui me questionnait, j’avoue, puisqu’il faut que je réponde avec vérité, que le membre qui s’est introduit dans mon derrière m’a causé des sensations infiniment plus vives et plus délicates que celui qui a parcouru mon devant. Je suis jeune, innocente, timide, peu faite aux plaisirs dont je viens d’être comblée; il serait possible que je me trompasse sur l’espèce et la nature de ces plaisirs en eux-mêmes, mais vous me demandez ce que j’ai senti, je le dis.
— Viens me baiser, mon ange, me dit Mme Delbène, tu es une fille digne de nous. Eh! sans doute, poursuivit-elle avec enthousiasme, sans doute, il n’est aucun plaisir qui puisse se comparer à celui du cul: malheur aux filles assez simples, assez imbéciles pour n’oser pas ces lubriques écarts; elles ne seront jamais dignes de sacrifier à Vénus, et jamais la déesse de Paphos ne les comblera de ses faveurs[4]!
— Ah! qu’on m’encule, s’écrie la putain, en s’agenouillant sur un canapé. Volmar, Flavie, Juliette, armez-vous de godemichés; vous, Ducroz et Télème, bandez ferme, et que vos vits mutins entrelacent les membres postiches de ces coquines; voilà mon cul: foutez-le tous! Laurette sera devant moi pendant ce temps-là, et je lui ferai tout ce qui me passera par la tête.
Les ordres de la supérieure s’exécutent. A la manière dont la libertine reçoit ces attaques, il est facile de voir à quel point elle y est habituée; à mesure qu’un des acteurs la travaille, un autre, se courbant sous elle, lui chatouille le clitoris ou l’intérieur de la motte. C’est de la réunion de ces deux actes que la volupté s’améliore; elle n’est vraiment entière qu’autant qu’une douce masturbation du devant vient prêter, aux intromissions du cul, le sel piquant qui peut résulter de cette jouissance. A force d’irritation, Delbène devint furieuse; les passions parlaient impétueusement dans cette femme ardente, et nous ne tardâmes pas à nous apercevoir que c’était bien plutôt à ses fureurs qu’à ses caresses que servait la petite Laurette; elle la mordait, elle la pinçait, elle l’égratignait.
— Sacredieu! s’écria-t-elle à la fin, sodomisée par Télème, chatouillée par Volmar, oh! foutre, je décharge! vous m’avez fait mourir de volupté! Asseyons-nous, et dissertons. Ce n’est pas tout que d’éprouver des sensations, il faut encore les analyser. Il est quelquefois aussi doux d’en savoir parler que d’en jouir, et quand on ne peut plus celui-ci, il est divin de se jeter sur l’autre. Faisons cercle. Juliette, calme-toi, je lis déjà ton inquiétude dans tes regarde; as-tu donc peur que nous te manquions de parole? Voilà ta victime, continua-t-elle en me montrant Laurette; tu l’enconneras, tu l’enculeras, cela est sûr: les promesses des libertins sont solides comme leurs dérèglements. Télème, et vous, Ducroz, soyez près de moi; je veux manier vos vits en parlant, je veux les faire rebander, je veux que l’énergie qu’ils retrouveront sous mes doigts se communique à mes discours, et vous verrez mon éloquence s’accroître, non comme celle de Cicéron, en raison des mouvements du peuple entourant la tribune aux harangues, mais comme celle de Sapho, en proportion du foutre qu’elle obtenait de Damophile.
J’avoue, nous dit Delbène dès qu’elle se fut mise en état de discourir, qu’il n’est rien au monde qui m’étonne comme l’éducation morale que l’on donne aux jeunes filles: il semble que l’on ne s’attache, dans les principes qu’on leur inculque, qu’à contrarier dans elles tous les mouvements de la nature. Je voudrais bien que quelqu’un me répondît à quoi sert une femme sage dans le monde, et s’il existe quelque chose de plus inutile que ces pratiques de vertu dont on ne cesse d’étourdir notre sexe: nous existons dans deux situations où ces pratiques nous sont recommandées, et c’est dans l’une et l’autre époque de notre vie où je vais entreprendre de prouver leur inutilité.
Jusqu’à ce qu’une fille se marie, à quoi sert-il, je le demande, qu’elle conserve sa virginité? Et comment peut-on porter l’extravagance au point de croire qu’une créature féminine devrait valoir mieux, pour avoir une partie de son corps un peu plus ou un peu moins ouverte? Pour quel but la nature a-t-elle créé tous les humains? N’est-ce pas pour se donner mutuellement tous les secours, et par conséquent tous les plaisirs qui dépendent d’eux? Or, s’il est vrai qu’un homme doive attendre de très grands plaisirs d’une jeune fille, ne contrariez-vous pas les lois de la nature, en composant à cette pauvre fille une vertu féroce qui lui défend de se prêter aux désirs impétueux de cet homme? Pouvez-vous vous permettre une telle barbarie sans la justifier par quelque chose? Or, que m’alléguez-vous pour me convaincre que cette jeune fille fait bien de garder sa virginité? Votre religion, vos mœurs, vos usages? Et qu’y a-t-il, je vous prie, de plus méprisable que tout cela? Je ne parle pas de la religion, je vous connais assez tous pour être bien persuadée du peu de cas que vous en faites. Mais les mœurs, qu’est-ce que les mœurs, j’ose vous le demander? On appelle ainsi, ce me semble, le genre de conduite des individus d’une nation, entre eux et avec les autres. Or, les mœurs, vous en conviendrez, doivent être basées sur le bonheur individuel; si elles n’assurent pas ce bonheur, elles sont ridicules; si elles y nuisent, elles sont atroces, et une nation sage doit travailler sur-le-champ à la prompte réforme de ces mœurs, dès qu’elles ne servent plus au bonheur général. Or, je demande qu’on me prouve qu’il y a quelque chose dans nos mœurs françaises qui, relativement au plaisir de la chair, puisse coopérer au bonheur de la nation: en vertu de quoi contraignez-vous cette jeune fille à conserver son pucelage, malgré la nature qui lui dit de le perdre, et malgré sa santé que sa sagesse dérange! Me répondrez-vous que c’est pour qu’elle arrive pure dans les bras de son époux: mais cette prétendue nécessité est-elle autre chose que l’histoire des préjugés? Quoi! pour faire jouir un homme du frivole plaisir de moissonner des prémices, il faut que cette malheureuse se sacrifie dix ans; il faut qu’elle fasse de la peine à cinq cents individus, pour en délecter tristement un seul? Existe-t-il quelque chose de plus barbare et de plus mal combiné que cela? Où, je vous prie, l’intérêt général est-il plus cruellement immolé que dans des lois aussi absurdes! Vivent à jamais les nations qui, loin de ces puérilités, n’estiment au contraire les jeunes personnes de notre sexe qu’en raison de leurs désordres! Dans cette seule multiplicité réside la véritable vertu d’une fille: plus elle se livre, plus elle est aimable; plus elle fout, plus elle fait d’heureux, et plus elle est utile au bonheur de ses concitoyens. Qu’ils renoncent donc, ces maris barbares, au vain plaisir de cueillir une rose, droit despotique qu’ils ne s’arrogent qu’aux dépens du bonheur des autres hommes; qu’ils cessent de mésestimer une fille qui, ne les connaissant pas, n’a pu les attendre pour leur faire présent de ce qu’elle a de plus précieux, et qui certainement ne l’a pas dû si elle a consulté la nature! Examinerons-nous la nécessité de la vertu des êtres de notre sexe sous le second rapport, je veux dire quand nous sommes mariées? Ceci nous ramène à l’adultère, et c’est ce prétendu délit que je veux traiter à fond.
Nos mœurs, nos religions, nos lois, toutes ces viles considérations locales ne méritent aucun égard dans cet examen: l’objet n’est pas de savoir si l’adultère est un crime aux yeux du Lapon qui le permet, ou du Français qui le défend, mais si l’humanité et la nature sont offensées de cette action. Pour pouvoir admettre une hypothèse semblable, il faudrait méconnaître l’étendue des désirs physiques dont cette mère commune des hommes a doué les deux sexes. Sans doute, si un homme suffisait aux désirs d’une seule femme, ou qu’une seule femme pût contenter les ardeurs d’un seul homme, dans cette hypothèse alors, tout ce qui violerait la loi outragerait aussi la nature. Mais si l’inconstance et l’insatiabilité de ces désirs sont telles, que la pluralité des hommes soit aussi nécessaire à la femme que celle des femmes le devient aux hommes, vous m’avouerez que, dans ce cas, toute loi qui s’oppose à leurs désirs devient tyrannique et s’éloigne visiblement de la nature. Cette fausse vertu qu’on nomme chasteté, étant certainement le plus ridicule de tous les préjugés, en ce que cette manière d’être ne coopère en rien au bonheur des autres et nuit infiniment à la prospérité générale, puisque les privations qu’impose cette vertu sont nécessairement très cruelles, cette fausse vertu, dis-je, étant l’idole qu’on encense, dans la crainte qu’on a de l’adultère, doit d’abord être mise, par tout être sensé, au rang des freins les plus odieux dont il a plu à l’homme de grever les inspirations de la nature. Osons arracher le voile; le besoin de foutre n’est pas d’une moins haute importance que celui de boire et de manger, et l’on doit se permettre l’usage de l’un et de l’autre avec aussi peu de contrainte. L’origine de la pudeur ne fut, soyons-en bien sûrs, qu’un raffinement luxurieux: on était bien aise de désirer plus longtemps pour s’exciter davantage, et des sots prirent ensuite pour une vertu ce qui n’était qu’une recherche du libertinage[5]. Il est aussi ridicule de dire que la chasteté est une vertu, qu’il le serait de prétendre que c’en est une de se priver de nourriture. Qu’on le remarque bien: c’est presque toujours la sotte importance que nous mettons à certaine chose qui finit par l’ériger en vertu ou en vice; renonçons à nos imbéciles préjugés sur cela; qu’il soit aussi simple de dire à une fille, à un garçon, ou à une femme, qu’on a envie de s’en amuser, qu’il l’est, dans une maison étrangère, de demander les moyens d’apaiser sa faim ou sa soif, et vous verrez que le préjugé tombera, que la chasteté cessera d’être une vertu, et l’adultère un crime. Eh! quel mal fais-je, je vous prie, quelle offense commets-je, en disant à une belle créature, quand je la rencontre: Prêtez-moi la partie de votre corps qui peut me satisfaire un instant, et jouissez, si cela vous plaît, de celle du mien qui peut vous être agréable?
En quoi cette créature quelconque est-elle lésée de ma proposition? En quoi le sera-t-elle en acceptant la mienne? Si je n’ai rien de ce qu’il lui faut pour lui plaire, que l’intérêt tienne lieu du plaisir, et qu’alors, pour un dédommagement convenu, elle m’accorde sur-le-champ la jouissance de son corps, et qu’il me soit permis d’employer la force et tous les mauvais traitements qu’elle entraîne, si, en la satisfaisant comme je peux, ou de ma bourse, ou de mon corps, elle ose ne pas me donner à l’instant ce que je suis en droit d’exiger. Elle seule offense la nature, en refusant ce qui peut obliger son prochain: je ne l’outrage point, moi, en proposant d’acheter d’elle ce qui m’en convient, et de payer ce qu’elle me cède au prix qu’elle peut désirer. Eh! non, non! encore une fois, la chasteté n’est point une vertu; elle n’est qu’une mode de convention, dont la première origine ne fut qu’un raffinement du libertinage; elle n’est nullement dans la nature, et une fille, une femme, ou un garçon, qui accorderait ses faveurs au premier venu, qui se prostituerait effrontément en tous sens, en tous lieux, à toute heure, ne commettrait qu’une chose contraire, j’en conviens, aux usages du pays qu’habiterait peut-être cet individu; mais il n’offenserait en quoi que ce puisse être, ni son prochain, qu’il servirait bien plutôt que de l’outrager, ni la nature, aux desseins de laquelle il n’a fait que complaire en se livrant aux derniers excès du libertinage. La continence, soyez-en bien certains, n’est que la vertu des sots et des enthousiastes; elle a beaucoup de dangers, aucuns bons effets; elle est aussi pernicieuse aux hommes qu’aux femmes; elle est nuisible à la santé, en ce qu’elle laisse corrompre dans les reins une semence destinée à être lancée au-dehors, comme toutes les autres sécrétions. La corruption la plus affreuse des mœurs, en un mot, a infiniment moins d’inconvénients, et les peuples les plus célèbres de la terre, ainsi que les hommes qui l’illustrèrent le plus, furent incontestablement les plus débauchés. La communauté des femmes est le premier vœu de la nature, elle est générale dans le monde, les animaux nous en donnent l’exemple; il est absolument contraire aux inspirations de cette agente universelle d’unir un homme avec une femme, comme en Europe, et une femme avec plusieurs hommes, comme dans certaine pays de l’Afrique, ou un homme avec plusieurs femmes comme en Asie et dans la Turquie d’Europe; toutes ces institutions sont révoltantes, elles gênent les désirs, elles contraignent les humeurs, elles enchaînent les volontés, et, de toutes ces infâmes coutumes, il ne peut résulter que des malheurs. Ô vous, qui vous mêlez de gouverner les hommes, gardez-vous de lier aucune créature! Laissez-la faire ses arrangements toute seule, laissez-la se chercher elle-même ce qui lui convient, et vous vous apercevrez bientôt que tout n’en ira que mieux.
Quelle nécessité y a-t-il donc, diront tous les hommes raisonnables, que le besoin de perdre un peu de semence me lie à une créature que je n’aimerai jamais? De quelle utilité peut-il être que ce même besoin enchaîne à moi cent infortunées que je ne connais seulement pas! Pourquoi faut-il que ce même besoin, avec quelque différence pour la femme, l’assujettisse à une contrainte et à un esclavage perpétuels? Eh quoi! cette malheureuse fille brûle de tempérament; le besoin de se rassasier la consume, et vous allez, pour la satisfaire, lier son sort à celui d’un homme… peut-être fort loin du goût de ces plaisirs, et qui, ou ne la verra pas quatre fois dans sa vie, ou ne se servira d’elle que pour la soumettre à des plaisirs dont le partage deviendra impossible à cette jeune personne? Quelle injustice de part et d’autre! et comme elle est évitée en abrogeant vos ridicules mariages, en laissant les deux sexes libres de se chercher et de se trouver réciproquement ce qu’il leur faut! Quel bien établissent les mariages dans la société? Bien loin de resserrer les nœuds, ils les brisent. Lequel, selon vous, paraît le plus uni, ou d’une seule et même famille, comme le serait alors chaque gouvernement de la terre, ou de cinq ou six millions de petites, dont les intérêts, toujours personnels, divisent nécessairement l’intérêt général et le combattent perpétuellement? Quelle différence d’union… de tendresse entre tous les hommes, si tous également, frères, pères, mères, époux, en cherchant à se combattre ou à se nuire, nuisaient ou combattaient alors ce qu’ils auraient de plus cher! Mais cette universalité, direz-vous, affaiblirait les liens; il n’y en aurait plus, à force d’en avoir. Eh! qu’importe? il vaut bien mieux qu’il n’y en ait d’aucune espèce, que d’en avoir dont le but ne peut être que de troubler ou que de nuire. Jetons un coup d’œil sur l’histoire. Que seraient devenus les ligues, les différente partis qui ont déchiré la France, parce que chacun suivait sa famille et s’unissait à elle pour combattre; que tout cela, dis-je, serait-il devenu, s’il n’y eût eu qu’une seule famille en France? Cette famille se serait-elle divisée par troupes pour se combattre réciproquement, pour adopter, les unes le parti d’un tyran, les autres le parti contraire? Plus d’Orléanais contre les Bourguignons, plus de Guises contre les Bourbons, plus de toutes ces horreurs qui ont déchiré la France, et dont l’unique objet était l’orgueil et l’ambition des familles. Ces passions s’anéantissent avec l’égalité que je propose; elles s’oublient avec la destruction de ces liens ridicules appelés mariages. Plus qu’une vue, plus qu’un projet, plus qu’un désir dans l’État: vivre heureux ensemble, et défendre ensemble la patrie. Il est impossible que la machine subsiste longtemps avec les usages adoptée jusqu’à ce jour. Les richesses et le crédit s’étayant, se cherchant sans cesse, il y aura nécessairement avant un siècle une portion de l’État si puissante et si riche qu’elle culbutera l’autre, et voilà encore la patrie désolée[6].
Que l’on y réfléchisse bien, on verra que tous les troubles n’ont jamais eu d’autres causes. Une puissance sourdement accrue a toujours fini par essayer de culbuter l’autre, et elle y a réussi. Que d’obstacles levés, que d’inconvénients prévenus, en abolissant les mariages: plus de chaînes abhorrées, plus de repentirs amers, plus aucun des crimes, fruits de ces abus monstrueux, puisque c’est la loi seule qui fait le crime, et que le crime tombe dès que la loi n’existe plus. Aucune cabale dans l’État, plus d’inégalité choquante de fortune. Mais les enfants… la population?… C’est cela que nous allons traiter.
Nous commencerons par établir un fait auquel nous croyons difficile de répondre: c’est que, pendant l’acte de la jouissance, assurément l’on s’occupe fort peu de la créature qui peut en résulter; celui qui serait assez bête pour y penser aurait assurément la moitié moins de plaisir que celui qui ne s’en occupe pas. C’est un ridicule outré, sans doute, ou de ne voir une femme que dans cette idée, ou que de concevoir même cette idée en la voyant. C’est à tort que l’on suppose que la propagation est une des lois de la nature: notre seul orgueil nous a fait imaginer cette sottise. La nature permet la propagation, mais il faut bien se garder de prendre sa tolérance pour un ordre. Elle n’a pas le plus petit besoin de la propagation; et la destruction totale de la race, qui deviendrait le plus grand malheur du refus de la propagation, l’affligerait si peu qu’elle n’en interromprait pas plus son cours que si l’espèce entière des lapins ou des lièvres venait à manquer sur notre globe. Ainsi, nous ne la servons pas plus en propageant, que nous ne l’offensons en ne propageant pas. Soyons bien persuadés que cette intéressante propagation, que notre orgueil érige sottement en vertu, devient, relativement aux lois de la nature, la chose la plus inutile et qui doit le moins nous inquiéter. Deux êtres de sexe différent, que l’instinct du plaisir rapproche, doivent donc s’attacher à goûter le plaisir unanimement dans toute l’étendue qu’il peut avoir, et y mettre, tant pour son augmentation que pour son amélioration, toutes les recherches qui peuvent dépendre d’eux, puis se moquer absolument des suites, et parce que ces suites ne sont nullement nécessaires, et parce que la nature s’en embarrasse on ne saurait moins[7].