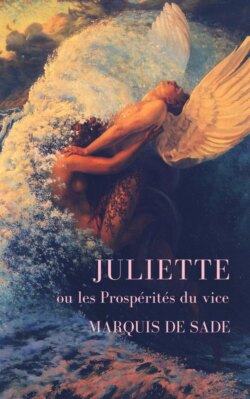Читать книгу Marquis de Sade: Juliette ou les Prospérités du vice - Marquis de Sade, Marquis de Sade - Страница 6
II
ОглавлениеA l’égard du père, il devient totalement dégagé du soin de cette progéniture, si elle a lieu. Et comment pourrait-il s’en inquiéter, avec la communauté que je suppose? Un peu de semence jetée par lui dans une matrice commune, où ce qui peut germer germe, ne peut lui devenir une obligation de prendre soin de l’embryon germé, et ne peut pas plus lui imposer de devoirs envers cet embryon qu’envers celui de l’insecte que ses excréments déposés au pied d’un arbre auraient fait éclore quelques jours après: c’est, dans l’un et dans l’autre cas, de la matière dont le besoin oblige de se débarrasser, et qui devient ce qu’elle peut. La femme seule, dans le cas supposé, devient maîtresse de l’embryon; comme unique propriétaire de ce fruit plaisamment précieux, elle en peut donc entièrement disposer à son gré, le détruire au fond de son sein, s’il la gêne, ou après qu’il est né, si l’espèce ne lui convient pas, et dans tous les cas l’infanticide ne peut jamais lui être défendu. C’est un bien entièrement à elle, que personne ne réclame, qui n’appartient à personne, dont la nature n’a aucun besoin, et que, par conséquent, elle peut ou nourrir ou étouffer si elle veut. Eh! ne craignons pas de manquer d’hommes; il y aura plus qu’on ne voudra de femmes envieuses d’élever le fruit qu’elles portent; et vous aurez toujours plus de bras qu’il ne vous en faudra pour vous défendre et pour cultiver vos terres. Formez, pour lors, des écoles publiques, où les enfants soient élevés dès qu’ils n’ont plus besoin du sein de leur mère; que, déposés là comme enfants de l’État, ils oublient même jusqu’au nom de cette mère, et que, s’unissant ensuite vulgivaguement à leur tour, ils fassent comme leurs parents.
Voyez, d’après ces principes, ce qu’est maintenant l’adultère, et s’il est possible ou vrai qu’une femme puisse faire mal en se livrant à qui bon lui semble. Voyez si tout ne subsisterait pas également, même avec l’entière destruction de nos lois. Mais, d’ailleurs, sont-elles générales, ces lois? Tous les peuples ont-ils le même respect pour ces liens absurdes? Faisons un examen rapide de ceux qui les ont méprisés.
En Laponie, en Tartarie, en Amérique, c’est un honneur que de prostituer sa femme à un étranger.
Les Illyriens ont des assemblées particulières de débauches, où ils contraignent leurs femmes à se livrer au premier venu, devant eux.
L’adultère était publiquement autorisé chez les Grecs. Les Romains se prêtaient mutuellement leurs femmes. Caton prêta la sienne à Hortensius, qui désirait une femme féconde.
Cook découvrit une société à Otaïti où toutes les femmes se livrent indifféremment à tous les hommes de l’assemblée. Mais si l’une d’elles devient enceinte, l’enfant est étouffé au moment de sa naissance: tant il est vrai qu’il existe des peuples assez sages pour sacrifier à leurs plaisirs les lois futiles de la population! Cette même société, à quelques différences près, existe à Constantinople[8].
Les nègres de la côte de Poivre et de Riogabar prostituent leurs femmes à leurs propres enfants.
Chez les anciens Bretons, huit ou dix maris se rassemblaient et mettaient leurs femmes en commun. Les intérêts, les partis différents s’opposent chez nous à ces trafics délicieux. Quand serons-nous donc assez philosophes pour les établir?
Singha, reine d’Angola, avait fait une loi qui établissait la vulgivaguibilité des femmes. Cette même loi leur enjoignait de se garantir de grossesse, sous peine d’être pilées dans un mortier: loi sévère, mais utile, et qui doit toujours suivre la défense des liens et la communauté, afin de mettre des bornes à une population dont la trop grande abondance pourrait devenir dangereuse.
Mais on peut tarir cette population par des moyens plus doux: ce serait en accordant des honneurs et des récompenses au saphotisme, à la sodomie, à l’infanticide, comme Sparte en décernait au vol. Ainsi la balance s’égaliserait sans avoir besoin, comme à Angola ou à Formose, d’écraser le fruit des femmes dans leur propre sein.
En France, par exemple, où la population est beaucoup trop nombreuse, en établissant la communauté dont je parle, il faudrait fixer le nombre des enfants, faire impitoyablement noyer tout le reste, et, comme je viens de le dire, vénérer les amours illégitimes entre sexes égaux. Le gouvernement, maître alors et de ces enfants et de leur nombre, compterait nécessairement autant de défenseurs qu’il en aurait élevé, et l’État n’aurait point, par grandes villes, trente mille malheureux à soulager dans les temps de disette. C’est pousser trop loin le respect pour un peu de matière fécondée, que d’imaginer qu’on ne puisse pas, quand il en est besoin, la détruire avant terme ou même beaucoup après.
Il y a, en Chine, une société pareille à celles d’Otaïti et de Constantinople. On les appelle les maris commodes. Ils n’épousent de filles qu’à la condition qu’elles se prostitueront à d’autres: leur maison est l’asile de toutes les luxures. Ils noient les enfants qui naissent de ce commerce.
Il existe des femmes au Japon qui, quoique mariées, se tiennent, avec l’agrément de leurs époux, aux environs des temples et des grands chemins, le sein découvert, comme les courtisanes d’Italie, et sont toujours prêtes à favoriser les désirs du premier venu.
On voit une pagode à Cambaye, lieu de pèlerinage où toutes les femmes se rendent avec la plus grande dévotion; là, elles se prostituent publiquement, sans que leurs maris y trouvent à redire. Celles qui ont amassé une certaine fortune à ce métier achètent, avec cet argent, de jeunes esclaves qu’elles dressent au même usage et qu’elles mènent ensuite à la pagode pour se prostituer à leur exemple[9].
Un mari, au Pégu, méprise souverainement les premières faveurs de sa femme; il les fait prendre par un ami, souvent même par l’étranger qu’il considère. Mais il n’en ferait pas de même pour les prémices d’un jeune garçon: cette jouissance est, pour les habitants de ces pays, la plus délicieuse de toutes.
Les Indiennes du Darien se prostituent au premier venu. Si elles sont mariées, l’époux se charge de l’enfant; si elles sont filles, ce serait un déshonneur d’être grosses, et elles se font alors avorter, ou prennent, dans leur jouissance, des précautions qui les délivrent de cette inquiétude.
Les prêtres de Cumane ravissent la fleur des jeunes mariées: l’époux n’en voudrait pas sans cette cérémonie préalable. Ce précieux bijou n’est donc qu’un préjugé national, ainsi que tant d’autres choses sur lesquelles nous ne voulons jamais ouvrir les yeux.
Combien de temps la féodalité usa-t-elle de ce droit dans plusieurs provinces de l’Europe, et particulièrement en Écosse? Ce sont donc des préjugés que la pudeur… que la vertu… que l’adultère.
Il s’en faut bien que tous les peuples aient également estimé les prémices. Plus une fille, dans l’Amérique septentrionale, avait eu d’aventures galantes, plus elle trouvait d’époux qui la recherchaient. On n’en voulait point si elle était vierge: c’était une preuve de son peu de mérite.
Aux îles Baléares, le mari est le dernier qui jouisse de sa femme: tous les parents, tous les amis le précèdent dans cette cérémonie; il passerait pour un homme fort malhonnête, s’il s’opposait à cette prérogative. Cette même coutume s’observait en Islande, et chez les Nazaméens, peuple de l’Égypte: après le festin, l’épouse nue allait se prostituer à tous les convives et recevait un présent de chacun.
Chez les Massagètes, toutes les femmes étaient en commun: lorsqu’un homme en rencontrait une qui lui plaisait, il la faisait monter sur son chariot, sans qu’elle pût s’en défendre; il suspendait ses armes au timon, et cela suffisait pour empêcher les autres d’approcher.
Ce ne fut point en faisant des lois de mariage, mais en établissant, au contraire, la parfaite communauté des femmes, que les peuples du Nord furent assez puissants pour culbuter trois ou quatre fois l’Europe et l’inonder de leurs émigrations.
Le mariage est donc nuisible à la population, et l’univers rempli de peuples qui l’ont méprisé. Il est donc contraire au bonheur des individus, aux yeux de la nature, et généralement à toutes les institutions qui peuvent assurer la félicité de l’homme sur la terre. Or, si c’est l’adultère qui le pulvérise, l’adultère qui détruit ses lois, l’adultère qui rentre si énergiquement dans celles de la nature, l’adultère pourrait donc bien, au lieu d’être un crime, facilement passer pour une vertu.
Ô tendres créatures, ouvrages divins, créées pour les plaisirs de l’homme! cessez de croire que vous ne soyez faites que pour la jouissance d’un seul; foulez aux pieds, sans nulle frayeur, ces liens absurdes qui, vous enchaînant dans les bras d’un époux, nuisent au bonheur que vous attendez de l’amant qui vous est cher! Songez que ce n’est qu’en lui résistant que vous outragez la nature: en vous formant le plus sensible, le plus ardent des sexes, elle gravait dans vos cœurs le désir de vous livrer à toutes vos passions. Vous indiquait-elle de vous captiver à un seul homme, en vous donnant la force d’en lasser quatre ou cinq de suite? Méprisez les vaines lois qui vous tyrannisent; elles ne sont l’ouvrage que de vos ennemis, sitôt que ce n’est pas vous qui les avez faites: dès qu’il est sûr que vous vous seriez bien gardées de les approuver, de quel droit prétendrait-on vous y astreindre? Songez qu’il n’est qu’un âge pour plaire, et que vous verserez dans votre vieillesse des larmes bien cruelles, si vous l’avez passé sans jouir: et quel fruit recueillerez-vous de cette sagesse, quand la perte de vos charmes ne vous laissera plus prétendre à nuls droits? L’estime de votre époux, quelle faible consolation! quels dédommagements pour de tels sacrifices! Qui, d’ailleurs, vous répond de son équité? qui vous dit que votre constance lui soit aussi précieuse que vous l’imaginez? Vous voilà donc réduites à votre propre orgueil. Ah! femmes aimables, la plus mince des jouissances que donne un amant vaut mieux que celles de soi-même: ce sont de pures chimères que toutes ces jouissances isolées, personne n’y croit, personne ne s’en doute, personne ne vous en sait gré, et, toujours destinées à être victimes, vous mourrez celles du préjugé, au heu de l’avoir été de l’amour. Servez-le, jeunes beautés, servez-le donc sans crainte, ce Dieu charmant qui vous créa pour lui; c’est au pied de ses autels, c’est dans les bras de ses sectateurs que vous trouverez la récompense des petits chagrins que vous fait éprouver une première démarche. Songez qu’il n’y a que celle-là qui coûte; elle n’est pas plus tôt faite que vos yeux se dessillent: ce n’est plus la pudeur qui colore de roses vos joues fraîches et blanches, c’est le dépit d’avoir pu respecter une minute le frein méprisable dont l’atrocité des parents ou la jalousie des époux osa vous fier un seul jour.
Dans l’état cruel où les choses sont, et c’est ce qui doit faire la seconde partie de mon discours, dans cet état de gêne affreux, dis-je, il ne reste plus qu’à donner aux femmes quelques conseils sur la manière de se conduire, et qu’à examiner si réellement il résulte un inconvénient de ce fruit étranger que se trouve contraint d’adopter le mari.
Voyons d’abord si ce n’est pas une vaine chimère pour un mari que de placer son honneur et sa tranquillité dans la conduite d’une femme.
L’honneur! et comment un autre être que nous peut-il donc disposer de notre honneur? Ne serait-ce pas ici un moyen adroit que les hommes auraient employé pour obtenir davantage de leurs femmes, pour les enchaîner plus fortement à eux? Eh quoi! il sera permis à cet homme injuste de se livrer lui-même à toutes les débauches qui lui plairont, sans entamer cet honneur frivole; et cette femme qu’il néglige, cette femme vive et ardente dont il ne contente pas le quart des désirs, le déshonore en ayant recours à un autre? Mais ceci est positivement le même genre de folie que celui de ce peuple où le mari se met au lit quand la femme accouche. Persuadons-nous donc que notre honneur est à nous, qu’il ne peut jamais dépendre de personne, et qu’il y a de l’extravagance à imaginer que jamais les fautes des autres puissent y donner la moindre atteinte.
Si donc il devient absurde d’imaginer qu’il puisse résulter, pour un homme, du déshonneur de la conduite de sa femme, quel autre chagrin pouvez-vous prouver qu’il puisse en revenir? De deux choses l’une: ou cet homme aime sa femme, ou il ne l’aime point; dans la première hypothèse, dès qu’elle lui manque, c’est qu’elle ne l’aime plus; or, dites-moi si la plus haute de toutes les extravagances n’est pas d’aimer quelqu’un qui ne vous aime plus? L’homme dont il s’agit doit donc, dès ce moment, cesser d’être attaché à son épouse, et, dans cette supposition, l’inconstance doit être parfaitement permise à cette épouse. Si c’est le second cas, et que, n’aimant plus sa femme, l’homme ait donné lieu à cette inconstance, de quoi peut-il se plaindre? Il a ce qu’il mérite, ce qui devait nécessairement lui arriver en se comportant comme il le fait. Il commettrait donc la plus grande injustice en s’en plaignant, ou le trouvant mauvais: n’a-t-il pas dix mille objets de dédommagement autour de lui? Eh! qu’il laisse s’amuser en paix cette femme, assez malheureuse déjà d’être obligée de se contraindre, pendant que lui n’a besoin d’aucun voile, et qu’aucune opinion ne le condamne. Qu’il la laisse goûter tranquillement des plaisirs qu’il ne peut plus lui procurer, et sa complaisance peut encore lui faire une amie d’une femme… outragée par des procédés contraires. La reconnaissance, alors, fera ce que le cœur n’avait pu opérer, la confiance naîtra d’elle-même, et tous deux, parvenus au déclin de l’âge, se dédommageront ensemble dans le sein de l’amitié de ce que leur aura refusé l’amour.
Époux injustes, cessez donc de tourmenter vos femmes, si elles vous sont infidèles. Ah! si vous voulez bien vous examiner, vous vous trouverez toujours le premier tort, et ce qui persuadera le publie que ce tort est véritablement toujours de votre côté, c’est que tous les préjugés sont contre l’inconduite des femmes; c’est qu’elles ont, pour être libertines, une infinité de liens à franchir, et qu’il n’est pas naturel qu’un sexe doux et timide en vienne là sans d’excellentes raisons. Mon hypothèse est-elle fausse? L’épouse seule est-elle coupable? Eh! qu’importe au mari? Qu’il serait dupe de mettre là sa tranquillité! Éprouve-t-il, des sottises de sa femme, quelques peines physiques? Hélas! non; elles sont toutes imaginaires; il ne se fâche que d’une chose qui l’honorerait à cinq ou six cents lieues de Paris. Qu’il foule aux pieds le préjugé! Pense-t-on aux torts de l’hymen au sein des plaisirs de la luxure? Voilà les plus sensuels de tous, qu’il s’y livre, et toutes les fautes de sa femme seront bientôt oubliées.
C’est donc ce fruit… ce fruit qu’il n’a point semé, et qu’il lui faut pourtant recueillir, voilà donc ce qui fait sa désolation? Quelle enfance! Deux choses se présentent ici: ou vous vivez avec votre femme, quoique infidèle, de manière à vous donner des héritiers, ou vous n’y vivez pas; ou vous y vivez comme certains époux libertins, de manière à être sûr que le fruit n’est pas de vous. N’ayez point de frayeur dans ce dernier cas-ci: votre femme est assez fine pour ne pas vous donner d’enfants; laissez-la faire, vous n’en aurez pas; une telle gaucherie ne sera jamais hasardée par une femme assez adroite pour conduire une intrigue. Dans l’autre cas, dès que vous travaillez comme votre rival à la multiplication de l’espèce, qui peut vous assurer que le fruit ne vous appartient pas? Il y a autant à parier pour que contre, et c’est une extravagance à vous de ne pas adopter le parti rassurant. Ou cessez entièrement de voir votre femme, sitôt que vous lui soupçonnez une intrigue, ce qui est la plus sûre et la meilleure façon de la jouer; ou, si vous continuez à cultiver le même jardin que son amant, n’accusez pas celui-ci, plutôt que vous, d’avoir semé le fruit qui germe. Voilà donc les deux objections répondues: ou vous n’aurez sûrement point d’enfants; ou, si vous en avez, il y a autant à parier qu’ils vous appartiennent qu’à votre rival; il y a même, en faveur de cette dernière opinion, une probabilité de plus: c’est l’envie que votre femme doit avoir de couvrir son intrigue par une grossesse, ce qui, soyez-en bien sûr, lui fera faire tout au monde pour y parvenir avec vous, parce qu’il est constant qu’elle ne sera jamais plus tranquille que quand elle vous aura vu mettre le baume sur le mal, et qu’elle retirera de ce procédé la certitude de pouvoir désormais tout hasarder avec son amant. Votre inquiétude sur cela est donc une folie: l’enfant est à vous, soyez-en certain; votre femme a le plus grand intérêt à ce qu’il vous appartienne, vous y avez d’ailleurs travaillé. Eh bien! de ces deux raisons réunies, arrive à vous la certitude de ce que vous désirez savoir: l’enfant est à vous, cela est clair, et il y est par le même calcul qui doit faire parvenir au but celui de deux coureurs payé pour y arriver le premier, lorsque son camarade ne gagne rien à la même course. Mais supposons un instant qu’il ne soit pas de vous: que vous importe dans le fait? Vous voulez un héritier, le voilà: c’est l’éducation qui donne le sentiment filial, ce n’est pas la nature. Croyez que cet enfant, désabusé par rien d’être votre fils, accoutumé à vous voir, à vous nommer, à vous chérir comme son père, vous révérera, vous aimera tout autant, et peut-être plus, que si vous aviez coopéré à son existence. Il n’y aura donc plus en vous que l’imagination de malade: or, rien ne se guérit facilement comme ces maux. Donnez à cette imagination une secousse plus vive, agitez-la par quelque chose qui ait plus d’empire, plus d’activité sur elle, vous l’assouplirez bientôt à ce que vous voudrez, et sa maladie se guérira. Dans tous les cas, ma philosophie vous offre un moyen. Rien n’est à nous autant que nos enfants; on vous donne celui-là, il vous appartient encore mieux; il n’y a rien de si bien à nous que ce qu’on nous donne. Usez de vos droits, et souvenez-vous qu’un peu de matière organisée, soit qu’elle nous appartienne ou qu’elle soit la propriété des autres, est bien peu chère à la nature, qui nous donna dans tous les temps le pouvoir de la désorganiser à notre gré.
A vous maintenant, épouses charmantes, à vous la leçon, mes amies. J’ai tranquillisé l’esprit de vos maris, je leur ai appris à ne se fâcher de rien avec vous; je vais à présent vous instruire dans l’art de les tromper adroitement. Mais je veux vous faire frémir avant: je veux exposer à vos yeux le tableau sinistre de toutes les peines imposées à l’adultère, autant pour vous faire voir qu’il faut que le prétendu délit donne de grands plaisirs, puisque tous les peuples le traitèrent avec tant de rigueur, que pour que vous ayez à rendre grâce au sort du bonheur que vous avez d’être nées sous un gouvernement doux, qui, s’en rapportant de votre conduite à vous-mêmes, ne vous impose d’autres peines, si cette conduite n’est pas bonne, que la honte frivole de vous déshonorer les premières… Charme de plus, convenez-en, pour la plus grande partie d’entre vous.
Une loi de l’empereur Constance condamnait l’adultère à la même peine que le parricide, c’est-à-dire à être brûlée vive, ou cousue dans un sac et jetée dans la mer: il ne laissait pas même à ces malheureuses la ressource de l’appel, quand elles étaient convaincues.
Un gouverneur de province avait exilé une femme coupable d’adultère; l’empereur Majorien, trouvant la punition trop légère, chassa cette femme de l’Italie et donna la permission de la tuer à tous ceux qui la rencontreraient.
Les anciens Danois punissaient l’adultère de mort, tandis que l’homicide ne payait qu’une simple amende: ils le croyaient donc un bien plus grand crime.
Les Mogols fendent une femme adultère en deux avec leur sabre.
Dans le royaume de Tonkin, elle est écrasée par un éléphant.
A Siam, c’est plus doux: on la livre à l’éléphant même; il en jouit dans une machine préparée exprès et dans laquelle il croit voir la représentation de sa femelle. La lubricité pourrait bien avoir inventé ce supplice-là.
Les anciens Bretons, en cas pareils, et peut-être dans les mêmes vues, la faisaient expirer sous les verges.
Au royaume de Louango, en Afrique, elle est précipitée avec son amant du haut d’une montagne escarpée.
Dans les Gaules, on les étouffait dans la boue et on les couvrait de claies.
A Juida, le mari lui-même condamnait sa femme; il la faisait exécuter sur-le-champ, devant lui, s’il la trouvait coupable: ce qui devenait extrêmement commode pour les maris las de leurs femmes.
Dans d’autres pays, il reçoit des lois le pouvoir de l’exécuter de sa propre main, s’il la trouve en faute. Cette coutume était principalement celle des Goths[10].
Les Miamis coupaient le nez à la femme adultère; les Abyssins la chassaient de leurs maisons, couverte de guenilles.
Les sauvages du Canada lui cernaient la tête en rond, et lui enlevaient une bande de peau.
Dans le Bas-Empire, la femme adultère était prostituée aux passants.
A Diarbeck, la criminelle était exécutée par sa famille assemblée, et tous ceux qui entraient devaient lui donner un coup de poignard.
Dans quelques provinces de Grèce où ce crime n’était pas autorisé comme à Sparte, tout le monde pouvait impunément tuer une femme adultère.
Les Gaux-Tolliams, peuples d’Amérique, amenaient l’adultère au pied du cacique, et là, elle était coupée en pièces, et mangée par les témoins.
Les Hottentots, qui permettent le parricide, le matricide et l’infanticide, punissent l’adultère de mort; l’enfant lui-même devient, sur un tel fait, le délateur de sa mère[11].
Ô femmes voluptueuses et libertines! si ces exemples ne servent, ainsi que je l’imagine, qu’à vous enflammer davantage, parce que l’espoir que le crime est sûr est toujours un plaisir de plus pour des têtes organisées comme les vôtres, écoutez mes leçons, et profitez-en; je vais dévoiler à vos yeux lascifs toute la théorie de l’adultère.
Ne cajolez jamais tant votre mari que quand vous avez envie de le tromper.
S’il est libertin, servez ses désirs, soumettez-vous à ses caprices, flattez toutes ses fantaisies, offrez-lui, même, des objets de luxures. Ayez, d’après ses fantaisies, ou de jolies filles, ou de jolis garçons près de vous, fournissez-les-lui. Enchaîné par la reconnaissance, il n’osera jamais vous faire de reproches: que vous objecterait-il, d’ailleurs, que vous ne puissiez à l’instant rétorquer contre lui?
Vous avez besoin d’une confidente; vous risquez de vous perdre, en agissant seule: prenez avec vous une femme sûre, et ne négligez rien pour la lier à vos intérêts et au service de vos passions; payez-la bien surtout.
Faites-vous satisfaire plutôt par des gens à gages que par un amant; les premiers vous serviront bien, et secrètement; les autres tireront vanité de vous et vous déshonoreront, sans vous donner du plaisir.
Un laquais, un valet de chambre, un secrétaire, tout cela ne marque pas dans le monde; un petit-maître affiche, et vous voilà perdues, souvent pour n’avoir été que ratées.
Ne faites jamais d’enfants, rien ne donne moins de plaisir; les grossesses usent la santé, gâtent la taille, flétrissent les appas, et c’est toujours l’incertitude de ces événements qui donne de l’humeur à un mari. Il est mille moyens de les éviter, dont le meilleur est de foutre en cul; faites-vous branler le clitoris pendant ce temps, et cette manière de jouir vous donnera bientôt mille fois plus de plaisir que l’autre: vos fouteurs y gagneront sans doute, le mari ne s’apercevra de rien, et vous serez tous contents.
Peut-être votre époux vous proposera-t-il la sodomie de lui-même; alors faites-vous valoir: il faut toujours avoir l’air de refuser ce qu’on désire. Si, dans la frayeur des enfants, vous êtes obligée de l’y amener vous-même, excusez-vous sur la crainte où vous êtes de mourir en accouchant; soutenez qu’une de vos amies vous a dit que son époux s’y prenait ainsi avec elle. Une fois faite à ces plaisirs, n’employez qu’eux avec vos amants: voilà, dès lors, la moitié des soupçons dissipée, et votre tranquillité bien établie sur tout ce qui tient aux grossesses.
Faites épier les démarches de votre tyran; il ne faut jamais avoir de surprises à craindre, quand on veut jouir avec délices.
Si jamais, pourtant, vous étiez découverte, au point de ne pouvoir plus nier votre conduite, jouez le remords, redoublez de soins et d’attentions avec votre mari- Si vous avez préalablement gagné son amitié par des complaisances et des égards, il reviendra bientôt. S’il s’obstine, plaignez-vous la première; il n’est pas que vous ne possédiez son secret: menacez-le de le divulguer; et c’est pour avoir toujours sur lui cet empire que je vous recommande d’étudier ses goûts et de les servir dès le commencement de votre union. Enfin, le prenant de cette manière, vous le verrez infailliblement revenir: composez alors avec lui, et passez-lui tout ce qu’il voudra, pourvu qu’il pardonne à son tour, mais n’abusez pas de cette composition; redoublez l’épaisseur des voiles: une femme prudente doit toujours craindre d’irriter par trop son époux.
Jouissez, tant que vous ne serez pas découverte: gardez-vous bien alors de vous rien refuser.
Fréquentez peu de femmes libertines; leur commerce ne vous procurera pas beaucoup de plaisirs, et pourrait vous donner de grandes peines; elles affichent plus que les amants, parce qu’on sait qu’il faut toujours se cacher avec un homme et qu’on ne le croit pas nécessaire avec une femme.
Si vous vous permettez des parties carrées, que ce soit avec une amie sûre: examinez bien les chaînes qu’elle doit respecter; ne vous hasardez pas, si vous n’avez à peu près les mêmes devoirs, parce qu’alors elle s’observera moins que vous et vous perdra par ses imprudences.
Ayez toujours quelque moyen d’être sûre de la vie des autres; et si un homme vous trompe, ne le ménagez pas. Il n’y a aucune comparaison entre la vie de cet homme et votre tranquillité; d’où je conclus qu’il vaut cent fois mieux s’en défaire, que de vous afficher, ni de vous compromettre: ce n’est pas que la réputation soit une chose essentielle, elle sert seulement à consolider les plaisirs. Une femme que l’on croit sage jouit toujours infiniment mieux qu’une dont l’inconduite trop connue a fait évanouir la considération.
Respectez cependant la vie de votre époux, non qu’il y ait aucun individu dans le monde dont les jours doivent l’être, sitôt que notre intérêt parle; mais c’est que, dans ce cas, cet intérêt personnel se trouve à ce que vous ménagiez les jours de cet homme. C’est une étude longue et fatigante pour une femme, que d’apprendre à connaître son mari: faite avec le premier, qu’elle ne se donne pas une peine de plus avec le second; peut-être même n’y gagnerait-elle pas. Ce n’est pas un amant qu’elle veut dans son époux, c’est un personnage commode, et la longue habitude, dans ce cas, est plus sûre du succès que la nouveauté.
Si la jouissance antiphysique, dont je vous ai parlé tout à l’heure, ne réussit pas à vous enflammer, foutez en con, je le veux bien; mais videz le vase aussitôt qu’il se remplit; ne laissez jamais arriver l’embryon à terme: c’est de la plus grande importance, si vous ne couchez pas avec votre mari, et cela l’est encore si vous y couchez, parce que de l’incertitude naissent, comme je vous l’ai dit, tous les soupçons, et de ces soupçons presque toujours et les ruptures et les éclats.
N’ayez surtout aucun respect pour cette cérémonie civile ou religieuse qui vous enchaîne à un homme ou que vous n’aimez point, ou que vous n’aimez plus, ou qui ne vous suffit pas. Une messe, une bénédiction, un contrat, toutes ces platitudes sont-elles donc assez fortes… assez sacrées, pour vous déterminer à ramper sous des fers? Cette foi donnée, jurée et promise, n’est qu’une formalité qui donne à un homme le droit de coucher avec une femme, mais qui n’engage ni l’un ni l’autre: encore moins celle qui, des deux, a le moins de moyens de se délier. Vous qui êtes destinée à vivre dans le monde, me dit la supérieure en me fixant, méprisez, ma chère Juliette, foulez aux pieds ces absurdités, comme elles méritent de l’être; ce sont des conventions humaines, où vous êtes forcée d’adhérer malgré vous: un charlatan masqué qui fait quelques tours de passe-passe auprès d’une table, en face d’un grand livre, et un coquin qui vous fait signer dans un autre, tout cela n’est fait ni pour contraindre, ni pour en imposer. Usez des droits que vous a donnés la nature; elle ne vous dictera que de mépriser ces usages et de vous prostituer au gré de vos désirs. C’est votre corps qui est le temple où elle veut être adorée, et non l’autel où ce prêtre imbécile vient de brailler sa messe. Les serments qu’elle exige de vous ne sont pas ceux que vous venez de faire à ce méprisable jongleur, ou que vous avez signés dans les mains de cet homme lugubre: ceux que la nature veut sont de vous livrer aux hommes, tant que vos forces vous le permettront. Le dieu qu’elle vous offre n’est pas le morceau de pâte ronde que cet arlequin vient de faire passer dans ses entrailles, mais le plaisir, mais la volupté; et c’est en ne servant pas exactement l’un et l’autre que vous outrageriez cette mère tendre.
Quand vous aurez le choix dans vos amours, préférez toujours des gens mariés: l’intérêt au mystère étant alors le même, vous aurez moins à craindre des indiscrétions. Mais à ceux-ci préférez encore les gens à gages: je vous l’ai dit, cela vaut infiniment mieux; on change de cela comme de linge, et la variation… la multiplicité, sont les deux plus puissants véhicules de la luxure. Foutez avec le plus d’hommes qu’il vous sera possible: rien n’amuse, rien n’échauffe la tête comme le grand nombre; il n’y en a pas qui ne puisse vous donner des plaisirs nouveaux, ne fût-ce que par le changement de conformation, et vous ne savez rien, si vous ne connaissez qu’un vit. Dans le fait, c’est absolument égal à votre époux: vous conviendrez qu’il n’est pas plus déshonoré au millième qu’au premier, moins même, car il semble que l’un efface l’autre. D’ailleurs le mari, s’il est raisonnable, excuse toujours beaucoup plutôt le libertinage que l’amour: l’un offense personnellement, l’autre n’est qu’un tort de votre physique. Lui peut fort bien ne pas en avoir, et voilà son amour-propre en paix. C’est donc égal vis-à-vis de lui; quant à vos principes, ou vous n’êtes pas philosophe, ou vous devez bien sentir que, quand le premier pas est fait, on ne pèche pas plus au dix-millième qu’au premier. Reste donc le public; or, ceci vous appartient entièrement; tout dépend de l’art de feindre et de celui d’en imposer; si vous possédez bien l’un et l’autre, et ce doit être votre unique étude, vous ferez du public et de votre mari absolument tout ce que vous voudrez. Ne perdez jamais de vue que ce n’est pas la faute qui perd une femme, mais l’éclat, et que dix millions de crimes ignorés sont moins dangereux que le plus léger travers qui saute aux yeux de tout le monde.
Soyez modeste dans vos habits: l’étalage affiche plutôt une femme que vingt amants; une coiffure plus ou moins élégante, une robe plus ou moins riche, tout cela ne fait rien au bonheur; mais de foutre souvent et beaucoup y fait étonnamment. Avec un air prude ou modeste, on ne vous soupçonnera jamais de rien: l’osât-on un instant, mille défenseurs rompraient aussitôt des lances pour vous. Le public, qui n’a pas le temps d’approfondir, ne juge jamais que sur les apparences: il n’en coûte guère pour se revêtir de celles qu’il veut. Satisfaites-le donc, afin qu’il soit à vous dans le besoin.
Quand vous aurez de grands enfants, écartez-les de vous: on ne les a que trop souvent vus les délateurs de leur mère. Dussent-ils vous tenter, résistez au désir: la disproportion d’âge établirait un dégoût dont vous seriez victime. Cet inceste-là n’a pas grand sel, et il peut nuire à des voluptés bien plus grandes. Il y a moins de risques à vous branler avec votre fille, si elle vous plaît; faites-lui partager vos débauches, afin qu’elle ne les éclaire pas.
Il est, je crois, maintenant nécessaire d’ajouter une conclusion à tous ces conseils: c’est que la sagesse des femmes est une perte, un fléau pour la société, et qu’il devrait y avoir des punitions dirigées contre les créatures absurdes qui, par quelque motif que ce puisse être, croient, en conservant leur ridicule virginité, et s’illustrer dans ce monde-ci, et se préparer des couronnes dans l’autre.
Jeunes et délicieux objets de notre sexe, poursuivit Delbène avec chaleur, c’est à vous que je me suis adressée jusqu’à présent, c’est à vous que je dis encore: Foulez aux pieds cette vertu sauvage, de laquelle des sots osent vous composer un mérite; renoncez à l’usage barbare de vous immoler aux autels de cette ridicule vertu dont les jouissances fantastiques ne vous dédommageront jamais de tous les sacrifices que vous lui feriez. Et de quel droit les hommes exigent-ils de vous tant de retenue, quand ils en ont si peu de leur côté? Ne voyez-vous pas bien que ce sont eux qui ont fait les lois, et que leur orgueil ou leur intempérance présidaient à la rédaction?
Ô mes compagnes, foutez, vous êtes nées pour foutre! C’est pour être foutues que vous a créées la nature. Laissez crier les sots, les bégueules et les hypocrites; ils ont leurs raisons pour vous blâmer de cette délicieuse intempérance qui fait le charme de vos jours. Ne pouvant plus rien obtenir de vous, jaloux de tout ce que vous pouvez donner aux autres, ils ne vous blâment que parce qu’ils n’attendent plus rien, et qu’ils sont hors d’état de vous rien demander; mais consultez les enfants de l’amour et du plaisir, interrogez la société tout entière: tout se réunira pour vous conseiller de foutre, parce que foutre est l’intention de la nature, et que l’abstinence en est le crime. Que le nom de putain ne vous effraye pas: bien dupe est celle qui s’en effarouche. Une putain est une créature aimable, jeune, voluptueuse, qui, sacrifiant sa réputation au bonheur des autres, rien que par cela seul mérite des éloges. La putain est l’enfant chérie de la nature, la fille sage en est l’exécration; la putain mérite des autels, et la vestale des bûchers. Et quel plus sensible outrage une fille peut-elle faire à la nature, que de garder en pure perte, et malgré tout ce qui peut en résulter de dangereux pour elle, une virginité chimérique dont toute la valeur ne consiste que dans le préjugé le plus absurde et le plus imbécile? Foutez, mes amies, je vous le répète, narguez effrontément les conseils de ceux qui veulent vous captiver sous les fers despotiques d’une vertu qui n’est bonne à rien! Abjurez à jamais toute pudeur et toute retenue; pressez-vous de foutre: il n’est qu’un âge pour décharger, profitez-en. Si vous laissez flétrir les roses, vous vous préparerez des regrets bien amers, et quand, peut-être encore avec le désir de les effeuiller, vous ne trouverez plus d’amants qui en veuillent, vous ne vous consolerez pas alors d’avoir perdu les instants de les présenter à l’amour. Mais, vous dit-on, une telle fille se rend infâme, et le poids de cette infamie est insupportable… Quelle objection! Osons le dire, c’est le préjugé seul qui fait l’infamie: que d’actions passent pour telles, et qui n’ont cependant que le préjugé pour base de cette opinion sur leur compte! Les vices du vol, de la sodomie, de la poltronnerie, par exemple, ne sont-ils pas notés d’infamie? Et vous m’avouerez cependant qu’au microscope de la nature, ils n’ont rien que de légitime, ce qui est contradictoire à l’idée d’infamie; car il est impossible qu’une chose conseillée par la nature puisse n’être pas légitime, et il est absurde de dire qu’une chose légitime puisse être infâme. Or, sans approfondir ces vices dans ce moment-ci, n’est-il pas certain qu’il est inspiré à tous les hommes de devenir riches? Si cela est, le moyen qui y conduit devient donc aussi naturel que légitime. N’est-il pas, de même, donné à tous les hommes de rechercher dans leurs plaisirs la plus grande dose de volupté possible? Or, si la sodomie y conduit infailliblement, la sodomie n’est plus une infamie. Chacun enfin n’éprouve-t-il pas le désir de se conserver? La poltronnerie en est un des plus sûrs moyens: la poltronnerie n’est donc pas infâme; et quels que puissent être nos ridicules préjugés sur l’un et sur l’autre de ces objets, il est clair que jamais aucun de ces trois vices ne saurait être regardé comme infâme, puisque tous trois sont dans la nature. Il en est de même du libertinage des individus de notre sexe. Puisque rien ne sert autant la nature, il est impossible qu’il puisse être infâme. Mais supposons un instant la réalité de cette infamie: en quoi pourrait-elle arrêter une femme d’esprit? Que lui importe qu’on la regarde comme infâme? Si, dans le fait, elle ne l’est pas aux yeux de la raison, et s’il est impossible que l’infamie puisse exister dans le cas où elle se trouve, elle rira de l’injustice et de la folie de ses semblables, n’en cédera pas moins aux impulsions de la nature, et toujours avec bien plus de tranquillité qu’une autre; car tout arrête, tout fait trembler celle qui craint de perdre sa réputation: au lieu que celle qui l’a perdue, n’ayant plus rien à risquer et se livrant à tout sans appréhension, doit être nécessairement plus heureuse.
Allons plus loin. La chose à laquelle cette femme se livre, l’habitude où son penchant l’entraîne fût-elle vraiment infâme, eu égard aux lois et aux principes du gouvernement sous lequel elle vit, si cette chose, telle qu’elle puisse être, tient tellement à sa félicité qu’elle ne puisse l’abandonner sans devenir malheureuse, ne serait-elle pas une folle d’y renoncer, quelle que soit l’infamie dont elle se couvre en s’y livrant? Car le poids de cette imaginaire infamie ne la gênera, ne l’affectera jamais autant que le sacrifice de son habitude; cette première souffrance ne sera qu’intellectuelle, capable d’affecter seulement certains esprits, et ce dont elle se prive est un plaisir à la portée de tout le monde. Ainsi, entre deux maux indispensables comme il faut nécessairement prendre le moindre, la femme dont nous parlons doit incontestablement braver l’infamie et continuer de vivre comme elle faisait en la risquant; car elle ne perdra que fort peu de chose en encourant cette infamie, et beaucoup en renonçant à ce qui doit la lui mériter. Il faut donc qu’elle s’y apprivoise, il faut qu’elle la brave, il faut qu’elle se mette au-dessus de ce fardeau imaginaire, qu’elle s’accoutume dès l’enfance à ne plus rougir de rien, à fouler aux pieds la pudeur et la honte, qui ne feraient que nuire à ses plaisirs sans rien ajouter à son bonheur.
Une fois là, elle éprouvera une chose singulière et pourtant très vraie: c’est que les pointes de cette infamie qu’elle redoutait se métamorphoseront en voluptés, et qu’alors, bien loin d’en éviter les blessures, elle enfoncera d’elle-même les dards, elle doublera la recherche des choses qui pourront les mieux introduire, et poussera bientôt l’égarement de l’esprit sur ce point jusqu’à désirer de mettre sa turpitude à découvert. Observez-la, cette délicieuse coquine: elle voudrait se libertiner aux yeux du monde entier; la honte ne lui fait plus rien, elle la brave, elle ne se plaint plus que du peu de témoins de ses erreurs. Et ce qu’il y a de singulier, ce n’est que de cette époque qu’elle connaît vraiment le plaisir, enveloppé jusque-là pour elle dans le nuage de ses préjugés; elle ne se trouve transportée dans le dernier degré de l’ivresse que depuis qu’elle a détruit radicalement tous les obstacles que ces aiguillons éprouvaient à venir chatouiller son cœur. Mais, vous dit-on quelquefois, il y a des choses horribles, des choses qui choquent toutes les lumières du bon sens, toutes les lois apparentes de la nature, de la conscience et de l’honnêteté, des choses qui paraissent faites, non seulement pour inspirer généralement de l’horreur, mais pour ne pouvoir même jamais procurer de plaisir… Oui, aux yeux des sots; mais il est de certains esprits qui, ayant débarrassé ces mêmes choses de ce qu’elles ont d’horrible en apparence, et les en ayant dégagées en foulant aux pieds le préjugé qui les avilit et les condamne, ne voient plus dans ces choses que de très grandes voluptés, et des délices d’autant plus piquantes que ces procédés s’écartent le plus des usages reçus, qu’ils outragent le plus grièvement les mœurs, et qu’ils deviennent le plus sévèrement défendus. Essayez de guérir une telle femme, je vous en défie; les secousses qu’elle a éprouvées, en montant son âme à ce ton, deviennent si voluptueuses et si vives, qu’elle n’entrevoit plus rien de préférable à la route divine qu’elle a prise. Plus la chose est épouvantable alors, plus elle lui plaît, et vous ne l’entendrez jamais se plaindre que de manquer des moyens de braver cette infamie qu’elle chérit et dont le poids augmente ses plaisirs. Voilà qui vous explique pourquoi les scélérats recherchent toujours les excès, et pourquoi nul plaisir n’est piquant pour eux s’il n’est assaisonné du crime: ils en ont écarté tout ce qu’il y a de répugnant aux yeux du vulgaire, il ne reste plus pour eux que les attraits. L’habitude de tout franchir leur fait incessamment trouver tout simple ce qui d’abord leur avait paru révoltant! et, d’écart en écart, ils parviennent aux monstruosités à l’exécution desquelles ils se trouvent encore en arrière, parce qu’il faudrait des crimes réels pour leur donner une véritable jouissance, et qu’il n’existe malheureusement de crime à rien. Ainsi, toujours au-dessous de leurs désirs, ce ne sont plus eux qui manquent aux horreurs, ce sont les horreurs qui leur manquent. Gardez-vous de croire, mes amies, que la délicatesse de notre sexe nous mette à couvert de ces écarts: plus sensibles que les hommes, nous ne nous plongeons que plus vite dans tous leurs travers. On n’imagine pas alors les excès où nous nous portons; on n’a pas d’idée de ce que l’on fait, quand la nature n’a plus de frein, la religion plus de voix, et les lois plus d’empire.
On déclame contre les passions, sans songer que c’est à leur flambeau que la philosophie allume le sien, que c’est à l’homme passionné que l’on doit le renversement total de toutes les imbécillités religieuses qui, si longtemps, empestèrent le monde. Le seul flambeau des passions consuma cette odieuse chimère de la Divinité, au nom de laquelle on s’égorgeait depuis tant de siècles; lui seul osa l’anéantir et consumer ses indignes autels. Ah! les passions n’eussent-elles rendu à l’homme que ce service, n’en serait-ce point assez pour faire oublier leurs écarts? Ô mes chères filles, sachez donc braver l’infamie et, pour apprendre à la mépriser comme elle doit l’être, familiarisez-vous avec tout ce qui la mérite, multipliez vos petites erreurs: ce sont elles qui, peu à peu, vous accoutumeront à tout braver… qui étoufferont dans vous le germe des remords! Adoptez pour base de votre conduite et pour règle de vos mœurs ce qui vous paraîtra de plus analogue à vos goûts, sans vous inquiéter si cela s’accorde ou non à nos coutumes, parce qu’il serait injuste que vous vous punissiez, par la privation de cette chose, de n’être pas nées dans le pays où elle se permet. N’écoutez que ce qui vous flatte ou vous délecte le plus: c’est cela seul qui vous convient le mieux. Que les mots de vice et de vertu soient nuls à vos regards; ces mots n’ont aucune signification réelle, ils sont arbitraires et ne donnent que des idées purement locales. Encore une fois, croyez que l’infamie se change bientôt en volupté. Je me souviens d’avoir lu quelque part, dans Tacite, je pense, que l’infamie était le dernier des plaisirs pour ceux qui se sont blasés sur tous les autres par l’excès qu’ils en ont fait, plaisir bien dangereux, sans doute, puisqu’il faut trouver une jouissance, et une jouissance bien vive, à cette espèce d’abandon de soi-même, à cette sorte de dégradation de sentiments d’où naissent à la fois tous les vices… qu’elle flétrit l’âme, et ne lui permet plus d’autre amorce que celle de la plus entière corruption, et cela, sans laisser le moindre jour au remords, absolument éteint dans un être qui n’estime plus que ce qui en donne, qui ne se plaît qu’à les faire revivre pour avoir le plaisir de les vaincre, et qui parvient ainsi, par degrés, aux excès les plus monstrueux, avec d’autant plus de facilité que les freins qu’elle lui fait rompre, ou les vertus qu’elle lui fait mépriser, deviennent comme autant d’épisodes voluptueux, souvent plus piquants encore pour sa perfide imagination que l’écart même qu’il avait conçu. Ce qu’il y a de fort singulier, c’est qu’il se croit heureux alors, et qu’il l’est. Si, réversiblement, l’individu vertueux l’est aussi, le bonheur n’est donc plus une situation que chacun puisse saisir en se conduisant bien: il ne dépend donc uniquement que de notre organisation, et peut donc se rencontrer également dans le triomphe de la vertu et dans l’abîme du vice… Mais que dis-je? dans le triomphe de la vertu… Ah! ses chatouillements alors seraient-ils aussi piquants? Quelle est l’âme froide qui pourrait s’en contenter? Non, mes amies, non, jamais la vertu ne sera faite pour le bonheur. Il ment, celui qui se flatte de l’avoir trouvé dans elle, il veut nous faire prendre pour le bonheur les illusions de notre orgueil. Pour moi, je vous le déclare, je la foule aux pieds de toute mon âme, je la méprise autant que j’avais la faiblesse de la chérir autrefois, et je voudrais joindre aux délices de l’outrager sans cesse la volupté suprême de l’arracher de tous les cœurs. Que de fois, dans mes illusions, ma maudite tête s’échauffe au point de vouloir être couverte de cette infamie que je viens de peindre! Oui, je voudrais être déclarée infâme; je voudrais qu’il fût décidé, affiché que je suis une putain; je voudrais rompre ces indignes vœux qui m’empêchent de me prostituer publiquement, de m’avilir comme la dernière des femmes! J’en suis, je l’avoue, à désirer le sort de ces divines créatures qui satisfont, au coin des rues, les sales lubricités du premier passant; elles croupissent dans l’avilissement et l’ordure; le déshonneur est leur lot, elles ne sentent plus rien… Quel bonheur! et pourquoi ne travaillerions-nous pas à nous rendre toutes ainsi? L’être le plus heureux de la terre n’est-il pas celui dans lequel les passions ont endurci le cœur… l’ont amené au point de n’être plus sensible qu’au plaisir? Et quel besoin a-t-il d’être ouvert à d’autre sensation qu’à celle-là? Eh! mes amies, en fussions-nous à ce dernier degré de turpitude, nous ne nous paraîtrions pas encore viles, et nous aimerions mieux diviniser nos erreurs que de nous mésestimer nous-mêmes! Voilà comment la nature sait nous ménager à tous du bonheur.
Mais, foutre, ils bandent! poursuivit chaleureusement Delbène, ils sont en l’air, ces vits que je palpe en discourant; les voilà durs comme de l’airain, et mon cul les désire. Tenez, mes amis, foutez-le, ce derrière insatiable; faites couler au fond de ce cul libertin de nouveaux jets de sperme qui rafraîchissent, s’il est possible, la brûlante ardeur qui le dévore. Viens, Juliette, je veux te sucer ton con pendant qu’on m’enculera; Volmar, accroupie sur ton nez, te présentera tous ses charmes; tu les lécheras, tu les dévoreras, pendant que ta main droite branlera Flavie et que ta gauche claquera les fesses de Laurette.
Cette nouvelle scène est encore exécutée. Les deux amants de la Delbène la sodomisent tour à tour. Inondée du foutre de Volmar, le mien coule très abondamment dans la bouche de la supérieure, et l’on procède enfin à la défloration de Laurette.
Destinée à jouer le rôle de grand prêtre, on me revêt d’un membre postiche. Par les ordres barbares de l’abbesse, c’est le plus gros que l’on préfère; et tel est l’arrangement de cette séance à la fois lubrique et cruelle:
Laurette est liée sur un tabouret, en telle sorte que son croupion, soulevé par un coussin fort dur, repose seul sur ce petit siège; ses jambes, très écartées, sont contenues de même à des anneaux, par terre, et ses bras, pendants de l’autre côté, le sont également. En cette attitude, la victime présente dans la plus belle position l’étroite et délicate partie de son corps où doit pénétrer le glaive. Assis en avant d’elle, Télème doit soutenir sa jolie tête… exhorter à la patience; et cette idée de la mettre entre les mains du confesseur, à peu près comme si elle eût été au supplice, amuse infiniment la cruelle Delbène, dont je m’aperçois que les passions sont aussi féroces que mes goûts me paraissent libertins. Pendant que je dépucellerai le con de cette Agnès, Ducroz doit m’enculer. L’autel qui se trouve là, et qui, par sa position, couronne celui où la jeune personne doit être immolée, va servir de sofa à notre voluptueuse abbesse. C’est là qu’entre Volmar et Flavie, la coquine va se délecter libidineusement, et de l’idée du crime qu’elle fait commettre, et du spectacle délicieux de sa consommation.
Avant que de m’enculer, Ducroz facilite l’introduction que je dois faire; il humecte les bords du vagin de Laurette et mon godemiché d’une essence onctueuse qui le fait pénétrer presque tout de suite. Cependant le déchirement est affreux: Laurette n’a pas encore dix ans, et mon membre postiche a huit pouces de tour sur douze de long. Les encouragements qu’on me donne, l’irritation dans laquelle je suis, l’extrême désir que j’ai de consommer cet acte libertin: tout me fait mettre à l’opération la même activité, la même chaleur qu’eût employées l’amant le plus vigoureux. La machine pénètre, mais les flots de sang qui jaillissent du déchirement de l’hymen, les cris terribles de la victime, tout nous annonce que l’ouvrage entrepris ne s’est pas fait sans péril; et la pauvre petite, en effet, vient d’être assez cruellement blessée pour donner de l’inquiétude même sur ses jours. Ducroz, qui s’en aperçoit, l’apprend par un signe à l’abbesse, qui, voluptueusement branlée par ses tribades, ordonne d’aller en avant.
— La garce est à nous, s’écrie-t-elle, ne l’épargnons pas; je n’ai de comptes à en rendre à qui que ce soit!
Vous imaginez facilement à quel point ces propos m’enhardirent. Bien sûre du malheur qu’avait occasionné ma maladresse, je n’en redoublai que plus nerveusement mes secousses: tout entre, Laurette s’évanouit, Ducroz m’encule, et Télème, enchanté, se branle sur le joli visage de la moribonde, dont il comprime rudement la tête dans ses jambes…
— Il faudrait des secours, madame, dit-il à Delbène, tout en se secouant…
— C’est du foutre qu’il faut, répond l’abbesse, oui, du foutre! Voilà les seuls secours que je veuille donner à cette garce.
Cependant je continue de limer, électrisée par le vit de Ducroz, tellement enfoncé dans le trou de mon cul, qu’il n’en reste pas deux lignes au-dehors; je ne ménage pas plus ma victime que je ne suis ménagée moi-même. L’extase nous saisit presque tous à la fois: les trois tribades placées sur l’autel déchargent comme gueuses, pendant que les parois du godemiché, que j’enfonce dans Laurette évanouie, se mouillent de mon foutre, que Ducroz m’en remplit l’anus, et que Télème mêle le sien aux pleurs de la victime, en lui déchargeant sur le visage.
Notre épuisement, la nécessité de rappeler Laurette à la vie, si nous voulons en tirer d’autres plaisirs, tout nous oblige à lui donner quelques soins. On la détache; Laurette environnée, nasardée, tripotée, souffletée, redonne bientôt signe de vie.
— Qu’as-tu? lui demande cruellement Delbène; es-tu donc si faible qu’une aussi légère attaque t’envoie déjà aux portes de l’enfer?
— Hélas, madame, je n’en puis plus, dit cette pauvre petite malheureuse dont le sang continue de couler en abondance; on m’a fait une douleur bien sensible, j’en mourrai.
— Bon! dit froidement la supérieure, de plus jeunes que toi ont soutenu ces attaques sans risque; poursuivons.
Et sans prendre d’autres soins que ceux d’étancher le sang, la victime est rattachée sur le ventre, comme elle vient de l’être sur le dos; et le trou de son cul bien à ma portée, la Delbène remise sur l’autel avec ses deux tribades, je m’apprête à remonter à l’assaut par une autre brèche.
Rien n’était luxurieux comme la manière dont la supérieure se faisait branler par Volmar et Flavie. Cette dernière, étendue sur Mme Delbène, lui faisait sucer son con en lui branlant le clitoris, et, lui chatouillant les tétons, Volmar, un peu au-dessous, instrumentait d’une main notre lubrique abbesse en lui enfonçant trois doigts dans le cul, de manière que la tribade n’avait pas une seule partie de son corps qui ne fût soumise au plaisir. Les yeux, pendant ce temps, fixés sur mon opération, la putain m’encourageait à la terminer: je me présente; c’est Télème qui, cette fois, doit m’enculer pendant que je sodomiserai Laurette; et Ducroz, placé près de moi, doit préparer l’introduction en me branlant le clitoris. Les difficultés sont insurmontables; mon instrument, déjà trois ou quatre fois repoussé, ou s’est dérangé, ou s’est malgré moi reniché dans le con, ce qui ne s’est pas fait sans occasionner de nouvelles douleurs à la malheureuse victime de notre libertinage. Delbène, impatientée de ces délais, charge Ducroz de préparer les voies en enculant lui-même la petite fille, et, comme vous l’imaginez aisément, cette commission ne lui déplaît pas. Moins effrayant que la poutre dont je suis affublée, n’ayant pas à craindre les vacillations qui me dérangent, le libertin, en un instant, est au fond du cul de la pucelle; il en refoule l’étron virginal, il est prêt à l’arroser de foutre, lorsque l’exigeante abbesse lui ordonne de se retirer et de me céder la place.
— Sacredieu! dit l’abbé en sortant son vit écumant de luxure et tout couvert des marques de sa victoire, ah! double foutu Dieu! j’obéis, mais je me vengerai sur le cul de Juliette.
— Non, dit Delbène, qui, malgré les plaisirs dont elle s’enivre, ne s’occupe pas moins des nôtres, non, le cul de ma Juliette appartient à Télème, c’est à lui d’en jouir cette fois-ci, et je ne souffrirai pas qu’il perde ses droits. Mais, scélérat, puisque tu bandes si fort, encule Volmar; vois son fessier superbe offert à tes désirs; encule-la, te dis-je, elle m’en branlera mieux.
— Oui, foutredieu! oui, dit Volmar, voilà mon cul; qu’il l’enfile, le bougre: jamais je n’eus tant de besoin d’être sodomisée.
Tout s’arrange; et la brèche préparée chez Laurette laissant mon instrument pénétrer sans trop de difficultés, la pauvre petite en une minute le sent au fond de son rectum. C’est alors que ses cris redoublent; elle en pousse d’affreux; mais Télème, bien enclavé dans mon cul, et Delbène, qui nage dans le foutre, m’encouragent l’un et l’autre avec tant d’énergie, que Laurette éprouve bientôt par-derrière ce que je lui ai fait sentir par-devant: le sang coule, et la pauvre enfant s’évanouit pour la seconde fois. C’est ici où je m’aperçois bien du caractère féroce de Delbène.
— Continue, continue! s’écrie-t-elle en me voyant prête à sortir; ne la lâche pas que nous n’ayons déchargé.
— Mais elle se meurt, réponds-je.
— Bon, bon, ce sont des simagrées! Et que m’importe, d’ailleurs, l’existence de cette putain? Elle n’est ici que pour nos plaisirs, et, foutre, elle y servira!
Enhardie par cette mégère, et ne me sentant déjà pas trop portée moi-même à des sentiments pusillanimes de commisération dont la nature ne m’a point abondamment pourvue, je poursuis, et ne prends pour signal de ma retraite que les témoignages certains du délire général que j’entends bientôt retentir de toutes parts à mes oreilles; j’en étais à ma troisième émission quand j’abandonnai le poste.
— Voyons tout ceci, dit l’abbesse en se rapprochant, est-elle morte?
— Elle n’est pas plus mal qu’aux premières attaques, dit Ducroz, et si l’on veut, en l’enconnant, je vais bientôt la rappeler à la vie.
— Il faut la mettre entre nous deux, dit Télème; pendant que j’enculerai, Delbène me branlera le cul, et je gamahucherai celui de Volmar; Juliette socratisera de même Ducroz, qui langotera le con de Flavie.
Le projet est mis en action, et les mouvements rapides de nos deux fouteurs, leur fougueuse luxure, ne tardent pas à rendre une seconde fois cette pauvre Laurette à la lumière.
— Ma chère bonne, dis-je alors à l’abbesse en m’approchant d’elle, comment vas-tu raccommoder tout le dommage qui vient d’être fait?
— Celui que tu as éprouvé le sera bientôt, mon ange, répondit Delbène: demain je te frotterai d’une pommade qui remettra tellement les choses en leur entier, qu’on ne pourra pas même se douter des amants qu’elles auront reçus. Pour Laurette, oublies-tu donc qu’on la croit échappée du couvent?… Elle est à nous, Juliette, elle ne reparaîtra de ses jours.
— Et qu’en ferez-vous? dis-je tout étonnée.
— La victime de nos luxures. Ah! Juliette, que tu es novice encore! tu ne sais donc pas qu’il n’y a de bon que les jouissances criminelles, et que plus on les environne d’horreurs, plus on leur prête de charmes!
— En vérité, ma chère, je ne vous entends pas.
— Patience, ce sera bientôt par des faits que je me ferai comprendre. Soupons.
On passe dans un petit caveau, voisin de celui dans lequel venaient de se célébrer nos orgies. Là se trouvent préparés avec profusion les mets les plus exquis, les vins les plus délicieux. Nous nous mettons à table. Laurette nous servait. Je m’aperçus bientôt, au ton que la société prenait avec elle, aux brusqueries qu’elle éprouvait, que la pauvre petite malheureuse n’était déjà plus regardée que comme une victime. Plus les têtes s’échauffaient, plus elle était maltraitée: elle ne rendait pas un service qu’elle ne reçût une claque, un pinçon, un soufflet, et la plus légère inattention se trouvait souvent bien plus sévèrement punie. Je passerai sous silence, mes amis, et les actions et les propos de ces luxurieuses bacchanales. Qu’il vous suffise de savoir qu’elles égalèrent en horreurs, en exécrations, tout ce que j’ai vu, depuis, de plus libertin dans le monde.
Il faisait très chaud, nous étions nues; les hommes dans le même désordre, et mêlés parmi nous, se livraient sans aucune gêne à tout ce que le délire pouvait leur inspirer de plus sale et de plus crapuleux. Télème et Ducroz, se disputant mon cul, semblaient vouloir se battre, pour en obtenir la jouissance, et, courbée sous tous deux, j’attendais humblement l’issue de ce combat, quand Volmar déjà grise, et plus belle que Vénus même dans cet état d’ivresse, s’empare des deux vits et veut les branler dans une jatte de punch qu’elle vient de préparer, afin, dit-elle, d’avaler le foutre.
— Je n’y consens, dit l’abbesse à peu près aussi étourdie des fumées de Bacchus que tout ce qui l’environne, je n’y consens qu’aux conditions que Juliette y mêlera son urine…
Je pisse; les putains boivent, les hommes les imitent, et, le délire étant à son comble, l’extravagante abbesse, qui ne sait plus qu’inventer pour réveiller en elle des désirs épuisés par le libertinage, annonce qu’elle veut passer dans le caveau où reposent les cendres des femmes de cette maison, qu’elle veut choisir là le cercueil de l’une de celles qu’immola dernièrement sa lubrique rage, et se faire foutre cinq ou six coups sur le cadavre de sa victime. L’idée paraît plaisante; on remonte, les bougies se placent sur les cercueils voisins entourant celui de la jeune novice qu’avait depuis trois mois empoisonnée l’abbesse, après l’avoir idolâtrée. L’infernale créature s’étend sur ce cercueil, et, présentant son con aux deux ecclésiastiques, elle les défie tour à tour, Ducroz l’enfile le premier. Nous étions spectatrices, et notre unique emploi, pendant cette scène lugubre, était de la baiser, de lui branler le clitoris et de nous prêter à ses attouchements. Delbène, dans le délire, se repaissait d’horreurs, lorsqu’un sifflement affreux se fait entendre, toutes les lumières s’éteignent à la fois.
— Ô ciel! qu’est, ceci? s’écrie l’intrépide abbesse, la seule de nous qui conserve son courage au milieu du bouleversement dans lequel nous sommes. Juliette!… Volmar!… Flavie!…
Mais tout est sourd, tout est interdit, personne ne répond; et sans les détails que je reçus de notre supérieure le lendemain, évanouie moi-même, j’ignorerais peut-être encore l’origine de tout ce fracas. Un chat-huant, caché dans ce caveau, en était la seule cause: effrayé des lumières auxquelles ses yeux n’étaient pas accoutumés, il avait pris son vol, et l’air, agité de ses ailes, avaient éteint ce qui l’affectait. Quand je repris l’usage de mes sens, je me retrouvai dans mon lit, et Delbène, qui vint m’y voir dès qu’elle sut que j’étais mieux, m’apprit qu’après avoir rassuré les deux hommes presque aussi effrayés que nous, c’était avec leur aide qu’elle nous avait fait porter dans nos chambres et que tout s’était éclairci.
— Je ne crois point aux événements surnaturels, me dit Delbène; il n’y a jamais de cause sans effet, et le premier soin, quand un effet me surprend, est de remonter sur-le-champ à la cause. J’ai promptement trouvé celle de notre aventure d’hier, et, les lumières rallumées, les hommes et moi nous avons promptement mis ordre à tout.
— Et Laurette, madame?
— Elle est dans le caveau, ma bonne, nous l’y avons laissée.
— Quoi! vous l’auriez…?
— Pas encore, ce sera le sujet de notre prochaine assemblée; elle y passait hier sans la catastrophe.
— En vérité, Delbène, vous êtes d’une débauche… d’une cruauté.
— Non, rien de tout cela: j’ai des passions fort vives, je n’écoute qu’elles et comme je suis persuadée que ce sont les plus fidèles organes de la nature, je me rends à ce qu’elles m’inspirent, sans frayeur comme sans remords. Te voilà mieux, Juliette, lève-toi, viens dîner dans mon appartement; nous jaserons.
— Assieds-toi, mon enfant, me dit-elle, dès que nous fûmes hors de table. Je vois que tu es surprise de me voir aussi calme dans le crime: je veux que les réflexions que j’ai à te communiquer sur cet objet te rendent bientôt aussi apathique que moi. Hier, je le vis, tu te surprenais de ma tranquillité au milieu des horreurs que nous commettions, et tu m’accusais de manquer de pitié pour cette pauvre Laurette, sacrifiée à nos débauches.
Ô Juliette, sois-en bien certaine, tout est arrangé par la nature pour être dans l’état où nous le voyons. A-t-elle donné la même force, les mêmes beautés, les mêmes grâces, à tous les êtres qui sortent de ses mains? Non, sans doute. Puisqu’elle veut des nuances dans les constitutions, elle en exige donc dans les sorts et dans les fortunes. Les malheureux que le hasard nous offre, ou que font nos passions, sont dans les plans de la nature comme les astres dont elle nous éclaire, et l’on fait un mal aussi sûr en troublant cette sage économie, qu’on en pourrait faire à troubler le cours du soleil, si ce crime était en notre puissance…
— Mais, interrompis-je ici, si tu étais malheureuse, Delbène, ne serais-tu pas bien aise qu’on te soulageât!…
— Je saurais souffrir sans me plaindre, me répondit cette stoïque créature, et je n’implorerais les secours de personne. Suis-je à l’abri des maux de la nature, et si je n’ai pas la misère à craindre, n’ai-je pas la fièvre, la peste, la guerre, la famine, les secousses d’une révolution imprévue, et tous les autres fléaux de l’humanité? Qu’ils viennent et je les recevrai courageusement. Crois, Juliette… oui, persuade-toi bien que lorsque je consens à laisser souffrir les autres sans les soulager, c’est que j’ai appris à souffrir moi-même sans l’être. Abandonnons-nous à la nature; ce ne sont pas des secours mutuels que son organe nous indique: il ne fait retentir dans nous que le seul besoin d’acquérir pour nous seules toute la force nécessaire à endurer les maux qu’elle nous réserve, et la commisération, loin d’y préparer notre âme, l’énerve, l’amollit et lui ôte le courage qu’elle ne peut plus retrouver ensuite, quand elle en a besoin pour ses propres douleurs. Qui sait s’endurcir aux maux d’autrui devient bientôt impassible aux siens propres, et il est bien plus nécessaire de savoir souffrir soi-même avec courage, que de s’accoutumer à pleurer sur les autres. Ô Juliette, moins on est sensible, moins on s’affecte, et plus on approche de la véritable indépendance. Nous ne sommes jamais victimes que de deux choses, ou des malheurs d’autrui, ou des nôtres: commençons par nous endurcir aux premiers, les seconds ne nous toucheront plus, et rien, de ce moment, n’aura le droit de troubler notre tranquillité.
— Mais, dis-je, il résultera nécessairement des crimes de cette apathie.
— Qu’importe? ce n’est ni au crime, ni à la vertu spécialement, qu’il faut s’attacher, c’est à ce qui rend heureux; et si je voyais qu’il n’y eût de possibilité pour moi d’être heureuse que dans l’excès des crimes les plus atroces, je les commettrais tous à l’instant, sans frémir, certaine, ainsi que je te l’ai déjà dit, que la première loi que m’indique la nature est de me délecter, n’importe aux dépens de qui. Si elle a donné à mes organes une constitution telle, que ce ne soit qu’au malheur de mon prochain que ma volupté puisse éclore, c’est que, pour parvenir à ses vues de destruction… vues tout aussi nécessaires que les autres, elle a cru urgent de former un être comme moi qui la servît dans ses projets.
— Voilà des systèmes qui peuvent aller bien loin.
— Eh! qu’importe! répondit Delbène; je te défie de me montrer un terme où ils puissent devenir dangereux; on s’est réjoui, c’est tout ce qu’il faut.
— Le peut-on aux dépens des autres?
— La chose du monde qui m’occupe le moins, c’est le sort des autres; je n’ai pas la plus petite foi à ce lien de fraternité dont les sots me parlent sans cesse, et c’est pour l’avoir bien analysé que je le réfute.
— Ô ciel! douteriez-vous de cette première loi de la nature?
— Écoute-moi, Juliette… Il est inouï le besoin que tu as d’être formée…
Nous en étions là de notre conversation, lorsqu’un laquais, arrivant de la part de ma mère, vint apprendre à Mme l’abbesse les affreux malheurs de notre maison et la maladie dangereuse de mon père; on demandait ma sœur et moi, il fallait partir sur-le-champ…
— Ô ciel! dit Mme Delbène, j’ai oublié de raccommoder ton pucelage! Attends, mon ange, attends, prends ce pot, c’est un extrait de myrtes dont tu te frotteras matin et soir, seulement pendant neuf jours: tu peux être sûre que le dixième tu te retrouveras aussi vierge que s’il ne te fût jamais rien arrivé.
Puis, envoyant chercher ma sœur, elle nous remit, l’une et l’autre, à la personne qui venait nous prendre, en nous recommandant de revenir le plus tôt que nous pourrions. Nous l’embrassâmes et nous partîmes.
Mon père mourut. Vous savez quels désastres suivirent cette mort: celle de ma mère qui eut lieu au bout d’un mois, et l’abandon dans lequel nous nous trouvâmes. Justine, qui ne connaissait pas mes liaisons secrètes avec l’abbesse ignora la visite que je fus lui faire quelques jours après notre ruine; et comme les sentiments que je lui découvris alors achèvent de dévoiler le caractère de cette femme originale, il est bon, mes amis, que je vous en parle. Le premier trait de dureté de la Delbène envers moi fut de me refuser la porte de l’intérieur et de ne consentir à me parler qu’un instant à la grille.
Lorsque, surprise du froid qu’elle me témoignait, je voulus faire valoir nos liaisons:
— Mon enfant, me dit-elle, toutes ces misères-là doivent s’oublier dès qu’on ne vit plus ensemble, et, pour moi, je vous assure que je ne me rappelle pas la moindre circonstance des faits dont vous me parlez. Quant à l’indigence qui vous menace, rappelez-vous le sort d’Euphrosine; elle se jeta sans besoin dans la carrière du libertinage: imitez-la par nécessité. C’est l’unique parti qui vous reste, le seul que je vous conseille; mais quand vous l’aurez pris, ne me voyez plus: peut-être cet état ne vous réussirait point, vous auriez besoin d’argent, de crédit, et je ne pourrais vous offrir ni l’un ni l’autre.
A ces mots, la Delbène lève le siège et me laisse dans un étonnement… qui, sans doute, eût été moins vif avec un peu plus de philosophie; mes réflexions furent cruelles… Je partis sur-le-champ avec la ferme résolution de suivre les conseils de cette méchante créature, tout dangereux qu’ils fussent. Je me ressouvenais heureusement du nom et de l’adresse de la femme dont Euphrosine nous avait parlé, dans un temps, hélas! où j’étais loin de prévoir le besoin de cette cruelle ressource: j’y volai. La Duvergier me reçut à merveille. L’excellence du remède de la Delbène, en abusant ses yeux connaisseurs, la mit à même d’en tromper bien d’autres. Ce fut deux ou trois jours avant que d’entrer dans cette maison que je me séparai de ma sœur, pour suivre une carrière bien différente de la sienne.
Mon existence, après les malheurs qui m’étaient arrivés, dépendant uniquement de ma nouvelle hôtesse, je me résignai à tout ce qu’elle me recommanda. Mais à peine fus-je seule, que je me mis néanmoins à réfléchir de nouveau sur l’abandon et sur l’ingratitude de Mme Delbène. Hélas! me disais-je, pourquoi mon malheur la refroidit-il? Juliette pauvre ou Juliette riche formait-elle deux créatures différentes? Quel est donc ce caprice bizarre qui fait aimer l’opulence et fuir la misère? Ah! je ne concevais pas encore que l’infortune dût être à charge à la richesse, j’ignorais combien elle la craint… à quel point elle la fuit, et que de la frayeur qu’elle a de la soulager résulte l’antipathie qu’elle a pour elle. Mais, poursuivais-je dans mes réflexions, comment cette femme libertine… criminelle même, ne redoute-t-elle pas l’indiscrétion de ceux qu’elle traite avec tant de hauteur? Autre enfantillage de ma part; je ne connaissais pas l’insolence et l’effronterie du vice étayé par la richesse et par le crédit. Mme Delbène était supérieure d’une des plus célèbres abbayes de Paris, elle jouissait de soixante mille livres de rente, elle tenait à toute la cour, à toute la ville: à quel point devait-elle mépriser une pauvre fille comme moi qui, jeune, orpheline et sans un sou de bien, ne pouvait opposer à ses injustices que des réclamations qui se fussent bientôt anéanties, ou des plaintes qui, traitées sur-le-champ de calomnies, eussent peut-être valu à celle qui eût eu l’effronterie de les entreprendre, l’éternelle perte de sa liberté!
Étonnamment corrompue déjà, cet exemple frappant d’une injustice dont j’avais pourtant à souffrir me plut au lieu de me corriger. Eh bien! me dis-je, je n’ai qu’à tâcher d’être riche à mon tour, je deviendrai bientôt aussi impudente que cette femme, je jouirai des mêmes droits et des mêmes plaisirs. Gardons-nous d’être vertueuse, puisque le vice triomphe sans cesse; redoutons la misère, puisqu’elle est toujours méprisée… Mais, n’ayant rien, comment éviterais-je l’infortune? Par des actions criminelles, sans doute. Qu’importe? les conseils de Mme Delbène ont déjà gangrené mon cœur et mon esprit: je ne crois de mal à rien, je suis convaincue que le crime sert aussi bien les intentions de la nature que la sagesse et que la vertu. Élançons-nous dans ce monde pervers, où ceux qui trompent le plus sont ceux qui réussissent le mieux; qu’aucun obstacle ne nous borne, il n’y a de malheureux que celui qui reste en chemin. Puisque la société n’est composée que de dupes et que de fripons, jouons décidément le dernier: il est bien plus flatteur pour l’amour-propre de tromper que d’être trompée soi-même.
Rassurée par ces réflexions, qui vous paraîtront prématurées peut-être à quinze ans, mais qui devenaient pourtant toutes simples d’après l’éducation que j’avais reçue, j’attendis avec résignation les événements que la providence m’offrirait, bien décidée à profiter de tous ceux qui se présenteraient pour améliorer ma fortune, à tel prix que ce pût être.
J’avais sans doute un rude apprentissage à faire; ces malheureux débuts devaient achever de corrompre mes mœurs, et, pour ne pas alarmer les vôtres, peut-être ferais-je bien, mes amis, de vous soustraire des détails qui vont dévoiler à vos yeux des écarts plus étonnants que ceux où vous vous livrez journellement…
— J’ai peine à le croire, madame, dit le marquis en interrompant Juliette, et après ce que vous savez de nous, il est même singulier qu’une telle crainte puisse un instant vous alarmer.
— C’est qu’il s’agit ici de la corruption des deux sexes, dit Mme de Lorsange; car la Duvergier fournissait également des sujets aux fantaisies de l’un et de l’autre.
— Vos tableaux, ainsi mélangés, n’en seront que plus agréables, dit le chevalier; nous savons à peu près tous les écarts dont le nôtre est capable; il sera délicieux pour nous d’apprendre de vous-même tous ceux où peut se porter le vôtre.
— Soit, dit Mme de Lorsange. J’aurai soin cependant de ne tracer que les débauches les plus singulières, et, pour éviter la monotonie, je passerai sous silence celles qui me paraîtront trop simples…
— A merveille, dit le marquis, en faisant voir à la société un engin déjà tout gonflé de luxure; mais songez-vous à l’effet que ces récits peuvent produire en nous! Voyez l’état où me met leur simple promesse…
— Eh bien, mon ami, dit cette femme charmante, ne suis-je pas tout entière à vous? Je jouirai doublement de mon ouvrage, et comme l’amour-propre est toujours pour beaucoup chez les femmes, vous me permettrez d’imaginer que, dans l’embrasement que j’aurai produit, si quelque chose est pour mes tableaux, bien plus encore sera pour ma personne.
— Il faut que je vous en convainque tout de suite, dit le marquis très ému, en entraînant Juliette dans un arrière-cabinet, où tous deux restèrent assez de temps pour se livrer aux plus doux plaisirs de la luxure.
— Pour moi, dit le chevalier, que cet arrangement laissait tête à tête avec Justine, j’avoue que je ne bande point encore assez pour avoir besoin de perdre du foutre. N’importe, approchez mon enfant, mettez-vous à genoux et sucez-moi; mais avancez, je vous prie, les choses, de manière à ce que je voie infiniment plus de cul que de con. Bien, bien, dit-il en voyant Justine, accoutumée à toutes ces turpitudes, saisir, on ne saurait mieux, quoique à regret, l’esprit de celle-ci… Oui, c’est cela.
Et le chevalier, singulièrement bien sucé, allait peut-être s’abandonner mollement aux douces et moelleuses sensations d’une décharge ainsi provoquée, lorsque le marquis, rentrant avec Juliette, engagea celle-ci à poursuivre le fil de ses aventures, et son ami à remettre à un autre instant, s’il le pouvait, le dénouement où il semblait toucher.
Tout étant ainsi convenu, Mme de Lorsange reprit en ces termes:
— Mme Duvergier n’avait que six femmes chez elle, mais plus de trois cents étaient à ses ordres; deux grands laquais de cinq pieds huit pouces, membrés comme Hercule, et deux jockeys de quatorze ou quinze ans, d’une céleste figure, se fournissaient de même aux libertins qui voulaient mêler l’un à l’autre, ou qui préféraient l’antiphysique à la jouissance des femmes; et dans le cas où ce léger détachement masculin n’eût pas suffi, Duvergier pouvait y suppléer par plus de quatre-vingts sujets du dehors, tous prêts à se porter où leur service était nécessaire.
La maison de Mme Duvergier était délicieuse. Située entre cour et jardin, et ayant deux issues opposées, les rendez-vous s’y donnaient avec un mystère qu’on n’eût pas obtenu de toute autre position; ses meubles étaient magnifiques, ses boudoirs aussi voluptueux que décorés; son cuisinier fort bon, ses vins délicieux et ses filles charmantes. Tant d’agréments devaient s’acheter fort cher. Rien en effet ne l’était autant que les parties de ce local divin, où les plus simples tête-à-tête ne se payaient pas moins de dix louis. Sans mœurs comme sans religion, parfaitement soutenue à la police, fournissant les plus grands seigneurs, Mme Duvergier, à l’abri de tout, entreprenait des choses que n’eussent jamais imitées ses compagnes, et qui faisaient à la fois frémir la nature et l’humanité.
Pendant six semaines, cette adroite coquine vendit mon pucelage à plus de cinquante personnes, et, chaque soir, se servant d’une pommade à peu près semblable à celle de Mme Delbène, elle raccommodait avec soin ce que déchirait impitoyablement le matin l’intempérance de ceux auxquels son avarice me livrait. Comme tous ces dévirgineurs s’y prirent assez lourdement, je vous ferai grâce des détails, et ne m’arrêterai qu’au duc de Stem, dont la manie fut plus singulière.
Le plus simple costume flattant le mieux la lubricité de ce libertin, ce fut en petite poissarde que je me présentai chez lui. Après avoir traversé un grand nombre d’appartements somptueux, je parvins au fond d’un cabinet de glaces, où m’attendait le duc avec son valet de chambre, grand jeune homme de dix-huit ans, fait à peindre, et de la plus intéressante figure. Bien pénétrée de l’esprit de mon rôle, je ne restai courte sur aucune des questions de ce paillard. Assis sur le canapé de son boudoir et branlant le vit de son valet de chambre, pendant que j’étais debout en face de lui:
— Est-il vrai, me demanda-t-il, que vous soyez dans la plus extrême misère, et que la démarche que vous faites n’ait pour objet que de pourvoir aux premiers besoins de la vie?
— Cette vérité est si grande, monsieur, qu’il y a trois jours que ma mère et moi mourons de faim.
— Ah! bon, répondit le duc en prenant une des mains de son homme pour se faire branler par lui; cette circonstance était nécessaire; je suis fort aise que votre état soit tel que je le désirais. Et c’est votre mère qui vous vend?
— Hélas! oui.
— Avez-vous des sœurs?
— Une, monsieur.
— Et pourquoi ne me l’a-t-on pas envoyée?
— Elle n’est plus à la maison, la misère l’a fait fuir; nous ignorons ce qu’elle est devenue.
— Ah! foutre, je veux qu’on me trouve cela! quel âge?
— Treize ans.
— Il est affreux que, connaissant mes goûts, on imagine de me soustraire cette créature!
— Mais on ne sait pas où elle est, monsieur.
— Il fallait la chercher… Ah! je la trouverai… je la trouverai. Allons, Lubin, qu’on déshabille pour vérifier!
Et pendant que l’ordre s’exécute, le duc, continuant l’ouvrage de son Ganymède, se met à secouer avec complaisance un engin noir et mou qui ne s’apercevait qu’à peine. Dès que je suis nue, Lubin m’examine avec la plus grande attention et proteste à son maître que tout est dans le meilleur ordre.
— Faites-moi voir cela par-derrière, dit le duc.
Et Lubin, me courbant sur le canapé, entr’ouvrit mes cuisses, et convainquit son maître, non pas de l’inexécution d’aucun assaut, mais que les brèches, occasionnées par eux, avaient été assez bien refermées pour qu’il fût impossible de s’en apercevoir.
— Et là, dit Stern en écartant mes fesses et touchant d’un doigt le trou de mon cul…
— Non, non, sûrement, répondit Lubin.
— C’est bon, dit le paillard en me prenant dans ses bras et m’asseyant sur une de ses cuisses; mais tu vois, mon enfant, que je suis hors d’état de faire la besogne moi-même… Touche ce vit; tu sens comme il est mou: possédasses-tu les grâces de Vénus, tu ne le ferais pas durcir. Considère ce hochet redoutable, poursuivit-il en me faisant empoigner le vit superbe de son valet de chambre: avoue que ce beau membre te dépucellera beaucoup mieux que le mien. Place-toi donc, je te servirai de maquereau. Ne pouvant faire le mal, j’aime à le faire faire: cette idée me console…
— Oh, monsieur! répondis-je, effrayée de la grosseur du vit qui m’était présenté, ce monstre va me déchirer, je n’en pourrai soutenir les assauts!….
Et comme j’essayais de m’esquiver:
— Allons, allons, point de cérémonie! je n’aime que la docilité dans les filles; celles qui en manquent avec moi sont sûres de ne pas me plaire longtemps… Approchez… Je voudrais qu’avant tout vous baisassiez le cul de mon Lubin.
Et me le présentant:
— Voyez comme il est beau…
J’obéis.
— Autant sur le vit, dit le duc.
J’obéis encore.
— Placez-vous, maintenant…
Il me tient; son valet se présente, et met à l’opération tant d’adresse et tant de vigueur, que son engin monstrueux touche en trois tours de reins le fond de ma matrice. Je pousse un cri terrible; le duc, qui me captive et qui branle le trou de mon cul pendant ce temps-là, recueille avec soin dans sa bouche et mes soupirs et mes larmes. Le nerveux Lubin, maître de moi, n’a plus besoin du secours de son maître qui, s’établissant aussitôt près du postérieur de mon amant, l’encule pendant qu’il me dépucelle. Je m’aperçois bientôt, au redoublement des secousses du valet, de celles qu’il reçoit de son patron; mais, seule pour supporter le poids de ces deux attaques, j’allais succomber sous leur violence, quand la décharge de Lubin me tira d’affaire.
— Ah! sacredieu, dit le duc qui n’avait pas fini, tu te presses trop aujourd’hui, Lubin; faut-il donc qu’un foutu con te fasse toujours faire des folies?
Et cet événement ayant dérangé les attaques du duc, il nous fit voir un petit vit mutin qui, furieux d’être déplacé, semblait n’attendre qu’un autel pour consommer le sacrifice.
— Venez ici, petite fille, me dit le duc en déposant son outil dans mes mains, et vous Lubin, couchez-vous à plat ventre sur ce lit; conduisez vous-même, petite pécore, cet engin furieux au trou qui vient de le rejeter, puis, vous campant derrière moi pendant que j’agirai, vous favoriserez mes projets en m’enfonçant deux ou trois doigts dans le cul.
Tout répond aux désirs du paillard: l’opération s’achève, et le capricieux libertin paye trente louis des prémices dont il ne s’est seulement pas douté.
De retour à la maison, Fatime, celle de mes compagnes que j’aimais le mieux, âgée de seize ans et belle comme le jour, se divertit beaucoup de l’aventure. Elle y avait passé, mais, plus heureuse que moi, elle avait, disait-elle, volé une bourse de cinquante louis sur la cheminée du duc, pour se dédommager de tout ce qu’elle en avait souffert.
— Comment! dis-je, tu te permets de pareilles choses?
— Le plus souvent que je le puis, ma chère, me répondit ma compagne, et sans aucun scrupule, en honneur. C’est pour nous qu’est fait l’argent de ces coquins-là, et nous serions bien dupes de ne pas nous en emparer quand nous le pouvons. Serais-tu donc encore assez dans les ténèbres de l’ignorance pour soupçonner le moindre mal au vol!
— Assurément, j’y en crois beaucoup.
— Eh bien, mon ange, me répondit Fatime, je veux te faire revenir de cet absurde préjugé. Je dîne demain à la campagne chez mon amant; j’obtiendrai de Mme Duvergier la permission de te mettre de la partie: tu entendras Dorval raisonner sur cette matière.
— Ô scélérate, répondis-je, tu achèveras de me corrompre: je ne me sens déjà que trop de dispositions à toutes ces horreurs. J’accepte, va, tu n’auras pas grand-peine à faire une excellente écolière de moi… Mais la Duvergier permettra-t-elle?…
— Ne t’inquiète de rien, dit Fatime, je me charge de tout.
Le lendemain de bonne heure, un fiacre nous conduisit à la Villette. Nous entrons dans une maison reculée, mais d’assez bonne apparence; un valet nous reçoit, et, nous ayant introduites dans un appartement fort bien meublé, il se retire et va renvoyer notre voiture. Ce fut alors que Fatime s’ouvrit à moi.
— Sais-tu chez qui tu es? me dit-elle en souriant.
— Non, en vérité, répondis-je.
— Chez un homme fort extraordinaire, reprit ma compagne. Je te trompais en le faisant passer pour mon amant: c’est un homme chez lequel j’ai souvent fait des parties à l’insu de Mme Duvergier; ce que je gagne alors n’appartient qu’à moi seule; mais l’opération n’est pas sans danger…
— Explique-toi, repris-je vivement, tu excites ma curiosité…
— Tu es ici, me dit Fatime, chez un des plus célèbres voleurs de Paris; le vol dont le coquin tire sa subsistance compose aussi ses plus doux plaisirs. Il t’expliquera ses principes, il te mettra à même de les pratiquer. Nul avec nous jusqu’après son expédition, ce ne sera qu’au feu qu’embrasera dans lui cette action, selon toi, criminelle, qu’il allumera le flambeau de ses lubricités; et comme il veut que l’image de sa passion favorite se retrouve au moins dans tout ce qui l’accompagne, ce ne sera qu’en volant qu’il cueillera nos faveurs, et ces faveurs il nous les escroquera; nous aurons l’air de n’en rien retirer, quoique j’en sois payée d’avance. En voilà la preuve, Juliette: ces dix louis t’appartiennent, j’en ai autant.
— Et la Duvergier?
— N’en sait rien, je te l’ai dit; j’escroque notre chère maman: t’en repens-tu?
— Non, en vérité, répondis-je; au moins ici tout ce que nous gagnons est à nous; il n’est plus question de ce maudit partage qui me désespère. Mais achève au moins de m’instruire: qui, et comment allons-nous voler?
— Êcoute-moi, me dit ma compagne. Cet homme-ci, par la multitude d’espions qu’il a dans Paris, est chaque jour au fait de tous les étrangers, de tous les nigauds qui y débarquent; il fait connaissance avec eux, il les accueille, il leur donne à dîner avec des femmes de notre espèce qui les volent pendant l’acte de la jouissance; on lui rend tout, et, de quelque nature que soit le vol, les femmes en ont toujours un quart, indépendamment de leur paiement particulier.
— Mais, dis-je, un tel métier ne fera-t-il pas bientôt arrêter ce coquin?
— De longtemps, sois-en sûre: ses précautions sont trop bien prises pour cela.
— Et sa maison?
— Il en a trente. Nous voilà maintenant dans celle-ci; de six mois il n’y reviendra. Remplis ton rôle avec intelligence. Deux ou trois étrangers vont se trouver à dîner: dès après le repas, nous amuserons ces messieurs dans des cabinets différents; vole le tien avec adresse, je te promets de ne pas manquer le mien. Dorval, caché, nous examinera. L’opération faite, au moyen d’un breuvage les dupes s’endormiront; nous passerons la soirée avec le maître du lieu, qui s’en retournera quelques heures après nous pour aller ailleurs, et avec d’autres femmes, exercer les mêmes infamies; et nos imbéciles, demain réveillés, ne trouvant plus personne au logis, seront trop heureux de pouvoir s’évader la vie sauve.
— Mais puisque nous sommes payées d’avance, répondis-je à ma compagne, quel besoin avons-nous de nous prêter aux goûts de ce fripon?
— Ce serait un mauvais calcul, nous ne le reverrions plus; et, en le servant bien, il peut nous faire faire par an douze ou quinze parties semblables; ne perdrions-nous pas d’ailleurs, avec ta manière de penser, absolument tout ce qui nous reviendra du vol?
— Ah, bon! car, sans la première partie de ta réponse, je t’aurais encore objecté, peut-être, qu’il me paraissait inutile de lui rendre un compte aussi exact de ce que nous volerons chez lui.
— J’aime ta réflexion tout en la désapprouvant, me dit Fatime; elle me prouve en toi des dispositions qui me feront espérer que tu te tireras bien de l’aventure.
A peine avions-nous fini que Dorval entra. C’était un homme de quarante ans, d’une fort belle figure, et qui me parut plein d’esprit et d’amabilité; il était doué surtout de ce don de séduire, si nécessaire au métier qu’il faisait.
— Fatime, dit-il à ma compagne, je suppose que cette jeune et jolie personne est au fait; il ne me reste donc plus qu’à vous prévenir que nous avons pour convives deux vieux Allemands, à Paris depuis un mois, et qui brûlent du désir de connaître quelques jolies filles. L’un d’eux a pour vingt mille écus de diamants sur lui: Fatime, je te le recommande. L’autre, qui désire acheter une maison dans ce village, et à qui j’ai persuadé que je lui en trouverais une à très bon marché s’il apportait de quoi la payer comptant, aura sûrement plus de quarante mille francs dans sa poche, soit en or, soit en lettres à vue: Juliette, ce sera votre lot; acquittez-vous bien de la mission et je vous ferai souvent faire de semblables parties.
— Eh quoi! dis-je, monsieur, de telles horreurs peuvent exciter vos sens?
— Charmante fille, me répondit Dorval, vous ignorez, je le crois, l’histoire du choc des impressions criminelles sur la masse des nerfs. Vous avez besoin d’être instruite de ces phénomènes de la lubricité: nous y viendrons; passons dans cette salle en attendant; nos Germains vont paraître; souvenez-vous de mettre tout votre art à les séduire… à les enchaîner: c’est de là seul que j’attends tout.
Nous entrâmes. Scheffner, celui des deux Allemands qui devait me revenir, était un bon baron de quarante-cinq ans, bien laid, bien bourgeonné, et bête, à ce qu’il me parut, comme l’Allemagne en masse, si l’on en excepte Gessner. Conrad était le nom de la poule que devait plumer mon amie; il nous parut en effet couvert de diamants; son esprit, sa figure et son âge le rendaient fort semblable à son compagnon, et sa lourdeur, tout aussi complète, assurait, des succès à Fatime pour le moins aussi faciles que les miens.
La conversation, d’abord générale, se particularisa fort vite. Fatime, aussi adroite que jolie, eut bientôt fait tourner la tête du pauvre Conrad; et mon air d’innocence et de timidité m’enchaîna promptement Scheffner. On dîna. Dorval eut soin de faire distiller dans les verres de nos convives les boissons les plus délicieuses, et le dessert fut à peine servi que tous deux témoignèrent le plus extrême désir de nous entretenir en secret.
Dorval, qui voulait examiner chacune de ces opérations en particulier, sous le prétexte qu’il n’avait qu’un boudoir où l’on pût sacrifier à Vénus, calma, du mieux qu’il put, les désirs de Conrad, et me fit passer avec Scheffner. Le bon Allemand, tout enthousiasmé, ne pouvait se rassasier de caresses. Il faisait chaud, je l’invitai à se mettre nu, j’en fis de même pour l’enflammer avec plus d’énergie, et, plaçant ses habits sous ma main droite, pendant que l’honnête baron m’enfilait, pendant que, pour le mieux duper, je serrais amoureusement sa tête sur mon sein, bien plus occupée de mon opération que de ses plaisirs, je fouillai lestement dans toutes ses poches. Une bourse très mince renfermait tout son numéraire; je me doutai que le trésor était au portefeuille, et, le saisissant adroitement dans la poche droite de son habit, je le cachai fort vite sous le matelas du canapé qui nous servait d’autel.
Le coup fait, n’ayant plus besoin de rien ménager avec un animal lourd et puant qui me faisait horreur, je sonne; une femme paraît, aide au baron allemand à se rajuster, lui présente un verre de liqueur dosé comme il faut, et le conduit dans une chambre où il s’endort d’un si profond sommeil, qu’il ronflait encore plus de huit heures après.
A peine est-il disparu que Dorval entre.
— Vous êtes délicieuse, mon ange! s’écrie-t-il en m’embrassant, je n’ai rien perdu de votre manœuvre; voyez, poursuivit-il en me montrant un vit plus dur qu’une barre de fer, voyez l’état où votre procédé m’a mis.
Et se précipitant avec moi sur le canapé, je vis que la manie de ce libertin était de dérober avec sa bouche le foutre qui venait de m’être lancé dans le con. Il le pompa avec tant d’art, frétilla si délicieusement avec sa langue sur tous les bords, et jusqu’au fond de ma matrice, que je l’inondai moi-même… mille fois plutôt peut-être en raison de la singulière action où je venais de me livrer, en raison du personnage qui venait de me la faire commettre, qu’à cause du plaisir que je recevais de lui; car, à quelque point qu’elles affectassent mon physique, mon moral, je ne puis le cacher, était encore bien plus ému de l’horreur gratuite que les séductions de Fatime et de Dorval me faisaient aussi délicieusement entreprendre.
Dorval ne déchargea point. Je lui remis et la bourse et le portefeuille; il prit l’un et l’autre, sans aucun examen, et je cédai la place à Fatime. Dorval m’emmena, et pendant qu’il examinait par un trou la manière dont ma camarade s’y prenait pour en venir au même but, le libertin se fit branler; il me le rendait; de temps en temps, sa langue s’enfonçait au fond de mon gosier, il paraissait dans une extase réelle. Sublimes effets de la réunion du crime et de la luxure, combien vous prêtez d’énergie au délire des passions! La façon leste dont Fatime opère détermine enfin l’éjaculation de Dorval; se serrant alors contre moi, il m’enconne jusqu’à la matrice, et m’inonde des preuves non équivoques de l’extase qu’il vient de goûter.
Dorval, vigoureux, retourne à ma compagne. Comme il m’avait laissée au trou, rien ne m’échappe: il se courbe de même entre les cuisse de Fatime, et va pomper de la même manière le foutre perdu par Conrad; il s’empare du vol et, les deux bons Germains dans leur lit, nous passons dans un cabinet délicieux où Dorval, après avoir déchargé une seconde fois dans le con de Fatime en me gamahuchant, nous expose de la manière suivante l’apologie de ses goûts singuliers.
— Une seule distinction, mes amies, différencie les hommes dans l’enfance des sociétés: c’est la force. La nature leur a donné à tous un sol à habiter, et c’est de cette force, qu’elle leur a inégalement départie, que va dépendre le partage qu’ils en feront. Mais ce partage sera-t-il égal, pourra-t-il l’être, dès que la force seule va le diriger? Voilà donc déjà un vol établi; car l’inégalité de ce partage suppose nécessairement une lésion du fort sur le faible, et cette lésion, c’est-à-dire le vol, la voilà donc décidée, autorisée par la nature, puisqu’elle donne à l’homme ce qui doit nécessairement l’y conduire. D’une autre part, le faible se venge, il met l’adresse en usage pour rentrer dans des possessions que lui ravit la force, et voilà l’escroquerie, sœur du vol, également fille de la nature. Si le vol avait offensé la nature elle aurait formé des hommes égaux de force et de caractère; l’égalité de partages, née de l’égalité de forces, fruit de sa main, évitait alors toute envie de s’enrichir aux dépens des autres: de ce moment le vol devenait impossible. Mais quand l’homme reçoit des mains de cette nature qui le crée une conformation qui nécessite, et l’inégalité des partages, et le vol, effet certain de cette inégalité, comment pouvoir s’aveugler au point de croire que le vol puisse l’offenser! Elle nous prouve si bien que le vol est sa loi la plus chère, qu’elle en compose l’instinct des animaux. Ce n’est que par des vols perpétuels qu’ils parviennent à se conserver, que par des usurpations sans nombre qu’ils soutiennent leur vie. Et comment l’homme qui n’est lui-même qu’un animal, a-t-il pu croire que ce que la nature imprégnait au fond du cœur des animaux pût chez lui devenir un crime?
Lorsque les lois se promulguèrent, lorsque le faible consentit à la perte d’une portion de sa liberté pour conserver l’autre, le maintien de ses possessions fut incontestablement la première chose dont il désira la paisible jouissance, et le premier objet des freins qu’il demanda. Le plus fort consentit à des lois auxquelles il était sûr de se soustraire: elles se firent. On promulgua que tout homme posséderait son héritage en paix, et que celui qui le troublerait dans la possession de cet héritage éprouverait une punition. Mais là il n’y avait rien à la nature, rien qu’elle dictât, rien qu’elle inspirât; tout était l’ouvrage des hommes, divisés pour lors en deux classes: la première, qui cédait le quart pour obtenir la jouissance tranquille du reste; la seconde, qui, profitant de ce quart, et voyant bien qu’elle aurait les trois autres portions quand elle voudrait, consentait à empêcher, non que sa classe dépouillât le faible, mais que les faibles ne se dépouillassent point entre eux, pour qu’elle pût seule les dépouiller plus à l’aise. Ainsi le vol, seule institution de la nature, ne fut point banni de dessus la terre, mais il exista sous d’autres formes: on vola juridiquement. Les magistrats volèrent en se faisant payer pour une justice qu’ils devaient rendre gratuitement. Le prêtre vola en se fanant payer pour servir de médiateur entre l’homme et son Dieu. Le marchand vola en accaparant, en faisant payer sa denrée un tiers de plus que la valeur intrinsèque qu’elle avait réellement. Les souverains volèrent en imposant sur leurs sujets des droits arbitraires de taxes, de tailles, etc. Toutes ces voleries furent permises, toutes furent autorisées sous le précieux nom de droits, et l’on n’imagina plus de sévir que contre les plus naturelles, c’est-à-dire contre le procédé tout simple d’un homme qui, manquant d’argent, en demandait, le pistolet à la main, à ceux qu’il soupçonnait plus riches que lui, et cela sans songer que les premiers voleurs, auxquels on ne disait mot, devenaient l’unique cause des crimes du second… la seule qui le contraignît à rentrer, à main armée, dans des propriétés que ce premier usurpateur lui ravissait si cruellement. Car, si toutes ces voleries ne furent que des usurpations qui nécessitaient l’indigence des êtres subalternes, les seconds vols de ces êtres inférieurs, rendus nécessaires par ceux des autres, n’étaient plus des crimes: ils étaient des effets secondaires nécessités par des causes majeures; et, dès que vous autorisiez cette cause majeure, il vous devenait légalement impossible d’en punir les effets; vous ne le pouviez plus sans injustice. Si vous poussez un valet sur un vase précieux, et que de sa chute il brise ce vase, vous n’êtes plus en droit de le punir de sa maladresse: vous ne devez vous en prendre qu’à la cause qui vous a contraint de le pousser. Lorsque ce malheureux cultivateur, réduit à l’aumône par l’immensité des taxes que vous lui imposez[12], abandonne sa charrue, s’arme, et va vous attendre sur le grand chemin, si vous punissez cet homme, certes, vous commettez une grande infamie; car ce n’est pas lui qui a manqué, il est le valet poussé sur le vase: ne le poussez pas, il ne brisera rien; et si vous le poussez, ne vous étonnez pas qu’il brise. Ainsi ce malheureux, en allant vous voler, ne commet donc point un crime: il tâche à rentrer dans des biens que vous lui avez précédemment usurpés, vous ou les vôtres; il ne fait rien que de naturel; il cherche à rétablir l’équilibre qui, en morale comme en physique, est la première des lois de la nature; il ne fait rien que de juste. Mais ce n’est point là ce que je voulais démontrer; il ne faut point de preuves, il n’est pas besoin d’arguments pour prouver que le faible ne fait que ce qu’il doit en cherchant à rentrer dans des possessions envahies: ce dont je veux vous convaincre, c’est que le fort ne commet lui-même ni crime, ni injustice, en tâchant de dépouiller le faible, parce que c’est ici le cas où je me trouve; c’est l’acte que je me permets tous les jours. Or, cette démonstration n’est pas difficile, et l’action du vol, dans ce cas, est assurément bien mieux dans la nature que sous l’autre rapport; car ce ne sont pas les représailles du faible sur le fort qui véritablement sont dans la nature; elles y sont au moral, mais non pas au physique, puisque, pour employer ces représailles, il faut qu’il use de forces qu’il n’a point reçues, il faut qu’il adopte un caractère qui ne lui est point donné, qu’il contraigne en quelque sorte la nature. Mais ce qui, vraiment, est dans les lois de cette mère sage, c’est la lésion du fort sur le faible puisque, pour arriver à ce procédé, il ne fait qu’user des dons qu’il a reçus. Il ne revêt point, comme le faible, un caractère différent du sien: il ne met en action que les seuls effets de celui qu’il a reçus de la nature. Tout ce qui résulte de là est donc naturel: son oppression, ses violences, ses cruautés, ses tyrannies, ses injustices, tous ces jets divers du caractère imprimé dans lui par la main de la puissance qui l’a mis au monde, sont donc tout simples, sont donc purs comme la main qui les grava; et lorsqu’il use de tous ses droits pour opprimer le faible, pour le dépouiller, il ne fait donc que la chose du monde la plus naturelle. Si notre mère commune eût voulu cette égalité que le faible s’efforce d’établir, si elle eût vraiment désiré que les propriétés fussent équitablement partagées, pourquoi aurait-elle créé deux classes, une de forts, l’autre de faibles? N’a-t-elle donc pas suffisamment prouvé, par cette différence, que son intention était qu’elle eût lieu dans les biens comme dans les facultés corporelles? Ne prouve-t-elle pas que son dessein est que tout soit d’un côté et rien de l’autre, et cela précisément pour arriver à cet équilibre, unique base de toutes ses lois? Car, pour que l’équilibre soit dans la nature, il ne faut pas que ce soient les hommes qui l’établissent; le leur dérange celui de la nature: ce qui nous paraît le contrarier à nos yeux est justement ce qui l’établit aux siens, et cela par la raison que, de ce défaut d’équilibre, selon nous, résultent les crimes par lesquels l’ordre s’établit chez elle. Les forts s’emparent de tout: voilà le défaut d’équilibre, eu égard à l’homme. Les faibles se défendent et pillent le fort: voilà des crimes qui établissent l’équilibre nécessaire à la nature. N’ayons donc jamais de scrupules de ce que nous pourrons dérober au faible, car ce n’est pas nous qui faisons le crime, c’est la défense ou la vengeance du faible qui le caractérise: en volant le pauvre, en dépouillant l’orphelin, en usurpant l’héritage de la veuve, l’homme ne fait qu’user des droits qu’il a reçus de la nature. Le crime consisterait à n’en pas profiter: l’indigent, qu’elle offre à nos coups, est la proie qu’elle livre au vautour. Si le fort a l’air de troubler l’ordre en volant celui qui est au-dessous de lui, le faible le rétablit en volant ses supérieurs, et tous les deux servent la nature.
En remontant à l’origine du droit de propriété, on arrive nécessairement à l’usurpation. Cependant le vol n’est puni que parce qu’il attaque le droit de propriété; mais ce droit n’est lui-même originairement qu’un vol: donc la loi punit le vol de ce qu’il attaque le vol, le faible de ce qu’il cherche à rentrer dans ses droits, et le fort de ce qu’il veut ou établir ou augmenter les siens, en profitant de ce qu’il a reçu de la nature. Peut-il exister au monde une plus affreuse inconséquence? Tant qu’il n’y aura aucune propriété légitimement établie (et il ne saurait y en avoir aucune), il sera très difficile de prouver que le vol soit un crime, car ce que le vol dérange d’un côté, il le rétablit de l’autre, et la nature ne s’intéressant pas plus au premier de ces côtés qu’au second, il est parfaitement impossible qu’on puisse constater l’offense à ses lois, en favorisant l’un de ces côtés plus que l’autre.