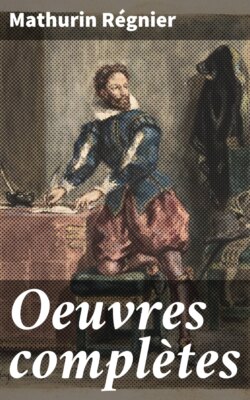Читать книгу Oeuvres complètes - Mathurin Régnier - Страница 9
A MONSIEUR
LE MARQUIS DE CŒUVRES
SATYRE III
ОглавлениеMARQUIS, que doy-je faire en ceste incertitude?
Dois-je, las de courir, me remettre à l’estude,
Lire Homère, Aristote, et, disciple nouveau,
Glaner ce que les Grecs ont de riche et de beau,
Reste de ces moissons que Ronsard et Desportes
Ont remporté du champ sur leurs espaules fortes,
Qu’ils ont comme leur propre en leur grange entassé,
Esgallant leurs honneurs aux honneurs du passé?
Ou si, continuant à courtiser mon maistre,
Je me doy jusqu’au bout d’esperance repaistre,
Courtisan morfondu, frenetique et resveur,
Portrait de la disgrace et de la defaveur;
Puis, sans avoir du bien, troublé de resverie,
Mourir dessus un coffre en une hostellerie,
En Thoscane, en Savoye, ou dans quelque autre lieu,
Sans pouvoir faire paix ou trefve avecques Dieu?
Sans parler je t’entends: il faut suivre l’orage;
Aussi bien on ne peut où choisir avantage.
Nous vivons à tastons, et dans ce monde icy
Souvent avecq’ travail on poursuit du soucy:
Car les dieux, courroussez contre la race humaine
Ont mis avec les biens la sueur et la peine.
Le monde est un berlan où tout est confondu:
Tel pense avoir gagné qui souvent a perdu,
Ainsi qu’en une blanque où par hazard on tire,
Et qui voudroit choisir souvent prendroit le pire.
Tout despend du destin, qui, sans avoir esgard,
Les faveurs et les biens en ce monde depart.
Mais puis qu’il est ainsi que le sort nous emporte,
Qui voudroit se bander contre une loy si forte?
Suivons donq’ sa conduite en cet aveuglement.
Qui pèche avecq’ le Ciel pèche honorablement.
Car penser s’affranchir, c’est une resverie
La liberté par songe en la terre est cherie.
Rien n’est libre en ce monde, et chaque homme depend,
Comtes, princes, sultans, de quelque autre plus grand.
Tous les hommes vivants sont icy bas esclaves;
Mais suivant ce qu’ils sont ils different d’entraves;
Les uns les portent d’or et les autres de fer;
Mais, n’en desplaise aux vieux, ny leur philosopher
Ni tant de beaux escrits qu’on lit en leurs escoles,
Pour s’affranchir l’esprit ne sont que des paroles.
Au joug nous sommes nez, et n’a jamais esté
Homme qu’on ait veu vivre en plaine liberté.
En vain, me retirant enclos en une estude,
Penseroy-je laisser le joug de servitude;
Estant serf du desir d’apprendre et de sçavoir,
Je ne ferois sinon que changer de devoir.
C’est l’arrest de nature, et personne en ce monde
Ne sçauroit controller sa sagesse profonde.
Puis, que peut-il servir aux mortels icy bas,
Marquis, d’estre sçavant ou de ne l’estre pas,
Si la science, pauvre, affreuse et mesprisée,
Sert au peuple de fable, aux plus grands de risée;
Si les gens de latin des sots sont denigrez,
Et si l’on est docteur sans prendre ses degrez?
Pourveu qu’on soit morgant, qu’on bride sa moustache,
Qu’on frise ses cheveux, qu’on porte un grand panna
Qu’on parle barragouyn et qu’on suive le vent, [che,
En ce temps du jourd’huy l’on n’est que trop sçavant.
Du siècle les mignons, fils de la poulie blanche,
Ils tiennent à leur gré la fortune en la manche
En credit eslevez, ils disposent de tout,
Et n’entreprennent rien qu’ils n’en viennent à bout.
Mais quoy! me diras-tu, il t’en faut autant faire:
Qui ose a peu souvent la fortune contraire.
Importune le Louvre et de jour et de nuict.
Perds pour t’assujettir et la table et le lict;
Sois entrant, effronté, et sans cesse importune:
En ce temps l’impudence eslève la fortune.»
Il est vray; mais pourtant je ne suis point d’avis
De desgager mes jours pour les rendre asservis,
Et souz un nouvel astre aller, nouveau pilotte,
Conduire en autre mer mon navire qui flotte,
Entre l’espoir du bien et la peur du danger
De froisser mon attente en ce bord estranger.
Car, pour dire le vray, c’est un pays estrange
Où, comme un vray Prothée, à toute heure on se
Où les loix, par respect sages humainement, [change,
Confondent le loyer avecq’ le chastiment;
Et pour un mesme fait, de mesme intelligence,
L’un est justicié, l’autre aura recompence.
Car selon l’interest, le credit ou l’appuy
Le crime se condamne et s’absout aujourd’huy.
Je le dy sans confondre en ces aigres remarques
La clemence du Roy, le miroir des Monarques,
Qui, plus grand de vertu, de cœur et de renom,
S’est acquis de Clement et la gloire et le nom.
Or, quant à ton conseil qu’à la cour je m’engage,
Je n ’en ay pas l’esprit non plus que le courage.
Il faut trop de sçavoir et de civilité,
Et, si j’ose en parler, trop de subtilité.
Ce n’est pas mon humeur; je suis melancolique;
Je ne suis point entrant; ma façon est rustique,
Et le surnom de bon me va-t-on reprochant,
D’autant que je n’ay pas l’esprit d’estre meschant.
Et puis, je ne sçaurois me forcer ny me feindre;
Trop libre en volonté, je ne me puis contraindre;
Je ne sçaurois flatter, et ne sçay point comment
Il faut se taire, accort, ou parler faussement,
Benir les favoris de geste et de parolles,
Parler de leurs ayeux au jour de Cerizolles,
Des hauts faits de leur race, et comme ils ont acquis
Ce titre avecq’ honneur de ducs et de marquis.
Je n’ay point tant d’esprit pour tant de menterie;
je ne puis m’adonner à la cageollerie;
Selon les accidents, les humeurs ou les jours,
Changer comme d’habits tous les mois de discours.
Suivant mon naturel, je hay tout artifice:
Je ne puis desguiser la vertu ni le vice,
Offrir tout de la bouche, et d’un propos menteur,
Dire: «Pardieu, Monsieur, je vous suis serviteur;»
Pour cent bonadiez s’arrester en la rue,
Faire sus l’un des pieds en la sale la grue,
Entendre un marjollet qui dit avec mespris:
«Ainsi qu’asnes, ces gens sont tous vestus de gris;
Ces autres, verdelets, aux perroquets ressemblent;
Et ceux cy, mal peignez, devant les dames tremblent.»
Puis au partir de là, comme tourne le vent,
Avecques un bonjour amis comme devant.
Je n’entends point le cours du ciel ny des planettes;
Je ne sçay deviner les affaires secrètes,
Connoistre un bon visage, et juger si le cœur,
Contraire à ce qu’on voit, ne seroit point mocqueur.
De porter un poullet je n’ai la suffisance,
Je ne suis point adroit, je n’ay point d’eloquence
Pour colorer un fait ou destourner la foy,
Prouver qu’un grand amour n’est suject à la loy,
Suborner par discours une femme coquette,
Luy conter des chansons de Jeanne et de Paquette,
Desbaucher une fille, et par vives raisons
Luy monstrer comme Amour fait les bonnes maisons,
Les maintient, les eslève, et, propice aux plus belles,
En honneur les avance et les fait damoyselles;
Que c’est pour leurs beaux nez que se font les balets:
Qu’elles sont le subject des vers et des poullets;
Que leur nom retentit dans les airs que l’on chante;
Qu’elles ont à leur suite une troupe béante
De langoureux transis; et, pour le faire court,
Dire qu’il n’est rien tel qu’aymer les gens de Court,
Alegant maint exemple en ce siècle où nous sommes
Qu’il n’est rien si facile à prendre que les hommes,
Et qu’on ne s’enquiert plus s’elle a fait le pourquoy,
Pourveu qu’elle soit riche et qu’elle ait bien dequoy.
Quand elle auroit suivy le camp à la Rochelle,
S’elle a force ducats, elle est toute pucelle.
L’honneur estropié, languissant et perclus,
N’est plus rien qu’un idole en qui l’on ne croit plus.
Or pour dire cecy il faut force mistère,
Et de mal discourir il vaut bien mieux se taire.
Il est vray que ceux-là qui n’ont pas tant d’esprit
Peuvent mettre en papier leur dire par escrit,
Et rendre par leurs vers leur muse maquerelle;
Mais, pour dire le vray, je n’en ay la cervelle.
Il faut estre trop prompt, escrire à tous propos,
Perdre pour un sonnet et sommeil et repos.
Puis ma Muse est trop chaste, et j’ay trop de courage,
Et ne puis pour autruy façonner un ouvrage.
Pour moy, j’ai de la Court autant comme il m’en faut;
Le vol de mon dessein ne s’estend point si haut:
De peu je suis content, encore que mon maistre,
S’il luy plaisoit un jour mon travail reconnoistre,
Peut autant qu’autre prince, et a trop de moyen
D’eslever ma fortune et me faire du bien.
Ainsi que sa nature, à la vertu facile,
Promet que mon labeur ne doit estre inutile,
Et qu’il doit quelque jour, mal-gré le sort cuisant,
Mon service honorer d’un honneste presant,
Honneste et convenable à ma basse fortune,
Qui n’abaye et n’aspire, ainsi que la commune,
Après l’or du Pérou, ny ne tend aux honneurs
Que Rome departit aux vertus des seigneurs.
Que me sert de m’asseoir le premier à la table,
Si la faim d’en avoir me rend insatiable,
Et si le faix leger d’une double evesché,
Me rendant moins contant, me rend plus empesché;
Si la gloire et la charge, à la peine adonnée,
Rend soubs l’ambition mon âme infortunée?
Et quand la servitude a pris l’homme au colet,
J’estime que le prince est moins que son valet.
C’est pourquoy je ne tends à fortune si grande:
Loin de l’ambition, la raison me commande,
Et ne pretends avoir autre chose sinon
Qu’un simple benefice et quelque peu de nom,
Afin de pouvoir vivre avec quelque asseurance,
Et de m’oster mon bien que l’on ait conscience.
Alors, vrayment heureux, les livres feuilletant,
Je rendrois mon desir et mon esprit contant;
Car sans le revenu l’estude nous abuse,
Et le corps ne se paist aux banquets de la Muse.
Ses mets sont de sçavoir discourir par raison
Comme l’âme se meut un temps en sa prison,
Et comme, delivrée, elle monte, divine,
Au ciel, lieu de son estre et de son origine;
Comme le ciel mobile, eternel en son cours,
Fait les siècles, les ans, et les mois et les jours,
Comme aux quatre elemens les matières encloses
Donnent, comme la mort, la vie à toutes choses.
Comme premierement les hommes dispersez,
Furent par l’armonie en trouppes amassez,
Et comme la malice en leur ame glissée
Troubla de nos ayeux l’innocente pensée,
D’où nasquirent les loix, les bourgs et les citez,
Pour servir de gourmette à leurs meschancetez;
Comme ils furent enfin reduicts sous un empire,
Et beaucoup d’autres plats qui seraient longs à dire;
Et quand on en sçauroit ce que Platon en sçait,
Marquis, tu n’en serois plus gras ny plus refait;
Car c’est une viande en esprit consommée,
Legère à l’estomach ainsi que la fumée. [voir?
Sçais tu, pour sçavoir bien, ce qu’il nous faut sça-
C’est s’affiner le goust de cognoistre et de voir,
Apprendre dans le monde et lire dans la vie
D’autres secrets plus fins que de philosophie,
Et qu’avecq’ la science il faut un bon esprit.
Or entends à ce point ce qu’un Grec en escrit:
Jadis un loup, dit-il, que la faim espoinçonne,
Sortant hors de son fort rencontre une lionne,
Rugissante à l’abort, et qui monstroit aux dents
L’insatiable faim qu’elle avoit au dedans.
Furieuse elle approche, et le loup, qui l’advise,
D’un langage flateur luy parle et la courtise:
Car ce fut de tout temps que, ployant sous l’effort,
Le petit cède au grand, et le foible au plus fort.
Luy, di-je, qui craignoit que faute d’autre proye
La beste l’attaquast, ses ruses il employe.
Mais enfin le hazard si bien le secourut,
Qu’un mulet gros et gras à leurs yeux apparut.
Ils cheminent dispos, croyant la table preste,
Et s’approchent tous deux assez près de la beste.
Le loup, qui la cognoist, malin et deffiant,
Luy regardant aux pieds, luy parloit en riant:
«D’où es-tu, qui es-tu? quelle est ta nourriture,
Ta race, ta maison, ton maistre, ta nature?»
Le mulet, estonné de ce nouveau discours,
De peur ingénieux, aux ruses eut recours;
Et, comme les Normans sans lui respondre voire:
«Compère, ce dit-il, je n’ay point de memoire;
Et comme sans esprit ma grand mère me vit,
Sans m’en dire autre chose au pied me l’escrivit.»
Lors il leve la jambe au jarret ramassée,
Et d’un œil innocent il couvroit sa pensée,
Se tenant suspendu sur les pieds en avant.
Le loup qui l’aperçoit se leve de devant,
S’excusant de ne lire avecq’ ceste parolle,
Que les loups de son temps n’alloient point à l’écolle.
Quand la chaude lionne, à qui l’ardente faim
Alloit précipitant la rage et le dessein,
S’approche, plus savante, en volonté de lire.
Le mulet prend le temps, et du grand coup qu’il tire
Luy enfonce la teste, et d’une autre façon,
Qu’elle ne sçavoit point, lui aprit sa leçon.
Alors le loup s’enfuit, voyant la beste morte,
Et de son ignorance ainsi se reconforte:
«N’en desplaise aux docteurs, Cordeliers, Jacobins,
Pardieu, les plus grands clercs ne sont pas les plus fins.»
FIN.