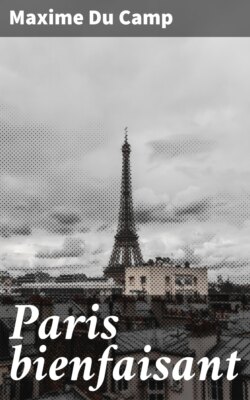Читать книгу Paris bienfaisant - Maxime du Camp - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LE VESTIAIRE.
ОглавлениеSouvenir de Mme Roland. — Toujours l’affluence de la province. — Statistique de Saint-Lazare. — Le placement des libérées. — Balayage et députés. — Villers-Cotterets. — Rapatriement. — Sauver le mari pour sauver la femme. — Vêtements masculins. — La couronne funéraire. — La mendiante. — Déception. — Le Dépôt près la préfecture de police. — Humanité de la police. — Les suites d’un engagement au mont-de-piété. — Intervention de l’œuvre. — Action préventive. — L’arrivée à Paris. — La faute. — La Bourbe. — L’asile maternel de la Société philanthropique. — L’intervention près de la famille. — Pardon. — Relations de l’œuvre avec l’Hospitalité du travail.
Le vestiaire est situé place Dauphine, n° 28, dans une vieille maison où fut élevée Mme Roland; c’est là, dans l’atelier de son père, que lui arriva une aventure qu’elle eût mieux fait de ne point raconter. L’escalier est étroit, gondolé, sans sécurité et s’arrête au troisième étage; trois ou quatre chambrettes carrelées servent de bureau; il se peut qu’il y fasse chaud en été, mais au mois de janvier on y gèle; en revanche, la vue y découvre le Pont-Neuf, la Seine et les quais. Ouvert tous les jours de huit à dix heures du matin, les mardis et vendredis de deux à quatre heures de l’après-midi, le secrétariat est souvent visité par les pauvres femmes qui sortent de prison ou ne savent que devenir. 1,412 malheureuses s’y sont présentées pendant l’année 1886. Le personnel qui frappe à la porte hospitalière varie bien peu; il est fourni par le vol, l’escroquerie, le vagabondage et la mendicité ; moralement, il est débile; physiquement, il est misérable.
Pour l’accueillir, le réconforter, s’en occuper avec persévérance, il faut quelque courage et savoir conserver ses illusions quand même. On n’y parvient pas du premier coup; il est nécessaire de passer par un certain stage, car tout s’apprend, même la pitié. Dans ce monde multiple par ses variétés, uniforme dans sa conduite, qu’entraîne le dérèglement de l’imagination et que fait osciller l’absence de volonté, la province fournit un contingent considérable. Là, comme partout où il s’agit de délits et de misère, je constate, une fois de plus, que Paris est en minorité ; les départements lui envoient leurs mendiants, leurs voleurs, leurs filles, leurs déclassés de toute sorte, qui y vivent comme en terre conquise et lui valent sa mauvaise réputation. Le crime, la débauche, l’émeute de Paris se recrutent parmi les provinciaux, qui mettraient sans scrupule la civilisation à sac, parce qu’ils n’ont point rencontré dans «la capitale», dans l’eldorado de leur rêve, la fortune, la situation, les jouissances qu’ils s’étaient promises. Ils s’imaginent qu’ils sont des incompris et des persécutés, alors qu’ils sont des incapables que l’on ne réussit pas à utiliser, quoiqu’ils se croient aptes à tout, précisément parce qu’ils ne sont propres à rien. Dès qu’une fille de campagne sait démêler ses cheveux et faire son lit, elle se figure qu’elle est femme de chambre; dès qu’elle a fait bouillir des pommes de terre dans de l’eau salée, elle se croit cuisinière. Alors elle part pour Paris, où l’on gagne de si gros gages; bien souvent c’est Saint-Lazare qui recueille ces pauvres créatures que leur ignorance et leur sottise ont entraînées loin du pays natal.
Les statistiques officielles dénoncent cette énorme proportion provinciale. En 1883, les prévenues et les condamnées gardées à Saint-Lazare sont au nombre de 4,768, sur lesquelles on compte 494 étrangères, 925 Parisiennes et 5,318 femmes venues des départements. A ceci nul remède: celles que l’on rapatrie de force reviennent; celles qui se font rapatrier volontairement s’ennuient au village, ne peuvent plus se plier aux travaux des champs, espèrent que la malchance ne les poursuivra plus; elles émigrent encore vers Paris et y cherchent une condition qu’elles ne découvrent pas plus que la première fois; en revanche, elles trouvent la charité et les secours sans lesquels elles périraient au milieu de la multitude, comme un voyageur égaré dans le désert.
Pour ces malheureuses, perdues, découragées dans les dédales de la ville immense, le vestiaire de la place Dauphine est une maison de bienfaisance, car on n’y reçoit pas que des jupes et des souliers. Toute femme qui s’y présente et qui donne preuve de quelque velléité d’énergie est certaine de s’y pouvoir appuyer sur une sympathie active. Lorsqu’une femme sort de Saint-Lazare — prévenue ayant bénéficié d’une ordonnance de non-lieu, ou détenue ayant purgé sa condamnation — elle est presque toujours réduite à n’avoir en perspective que les chemins de la misère qu’elle a déjà parcourus et qui l’ont menée à la sinistre maison qu’elle vient de quitter. Le plus pressé est de la vêtir et de lui assurer un gîte pour quelques jours, afin, comme l’on dit, qu’elle ait le temps de se retourner. Dans le vestiaire, suffisamment garni de hardes offertes par les sociétaires, on fait choix de la robe, du jupon, des bas, du châle de tricot qui peuvent la recouvrir décemment; puis on l’adresse, avec un mot de recommandation, au dortoir des femmes que la Société philanthropique a ouvert rue Saint-Jacques; là, elle sera hospitalisée pendant trois nuits au moins et nourrie à l’aide de «bons» fournis par l’Œuvre des Libérées.
Les conseils dont on a essayé de la fortifier sont très simples: «Si vous vous conduisez bien, vous pourrez probablement vivre de votre travail; si vous vous conduisez mal, vous retournerez en prison et, comme vous serez en état de récidive, vous serez punie sévèrement et votre vie sera compromise à jamais.» On ne se contente pas de bons avis, car on sait que le moindre grain de mil ferait mieux son affaire; on l’aide et, selon les aptitudes que l’on a pu découvrir en elle, on lui cherche une condition: fille de service, bonne à tout faire, récureuse de vaisselle dans les restaurants médiocres. Autant que possible on s’adresse à des particuliers; il en est de miséricordieux qui, de cette façon, s’associent à l’œuvre et n’y sont pas les moins utiles. Lorsqu’il s’agit de faire obtenir une place rétribuée à une des libérées ou même simplement à une malheureuse, on évite de solliciter le concours des administrations publiques, qui semblent actuellement ne plus s’appartenir. Dernièrement on a demandé de faire employer au balayage des rues une femme digne d’intérêt; la réponse est à retenir: «Faites appuyer la pétition par quelques députés influents, sans cela vous n’obtiendrez rien.»
Lorsque la prévenue est vieille ou déformée par la maladie, réduite, par sa faiblesse même, au vagabondage et à la mendicité, on s’en va au second bureau de la première division de la préfecture de police, où l’on trouve des hommes que le contact permanent avec les gens de mauvais monde a rendus plus compatissants que sévères. On obtient d’eux, sans trop de peine, une entrée — c’est presque une faveur — au dépôt de Villers-Cotterets. Là du moins la pauvre vieille aura la nourriture et le logement; elle aura de vastes dortoirs et de larges préaux; deux fois par semaine, elle pourra aller se promener dans la forêt, et comme, pour sortir, elle aura besoin de vêtements convenables, c’est le vestiaire de l’œuvre qui les lui enverra. Pendant l’année 1886, le nombre des femmes reçues en hospitalité à Villers-Cotterets, par l’intermédiaire de la Société des Libérées, s’est élevé au chiffre de dix-huit.
Parfois on est en présence d’une femme qui, par ses relations et quoiqu’elle ait été emprisonnée, trouve en province une place où elle ramassera son pain; on l’habille et on lui donne, non pas ses frais de route, mais le billet du chemin de fer qui la conduira à destination. On ne sera pas surpris dès lors qu’en 1886 le vestiaire ait distribué 1,143 pièces de vêtements et qu’une somme de 912 francs ait été employée à payer le prix des places en wagon de troisième classe. Les compagnies de chemin de fer, avec lesquelles l’œuvre s’est mise en relations, accordent généreusement une réduction de moitié, ce qui est participer à la bonne action dans une large mesure.
J’ai visité le vestiaire, je m’y suis assis à côté de la secrétaire, à la fois douce et ferme, auprès de Mme Bogelot, qui mène l’instruction avec la sagacité d’un juge bienveillant prêt à tout sacrifice utile, mais habile à ne point se laisser duper. Sur la table, au milieu des paperasses, un gros registre: c’est le livre d’enquête, suivi d’un répertoire qui facilite les recherches. Là, chacune des femmes dont l’œuvre s’est occupée a son nom et son état civil, accompagnés d’une courte notice qui est, en quelque sorte, le résumé de sa vie, ou du moins de ce que l’on en peut connaître. Un seul coup d’œil jeté sur le livre d’enquête permet de savoir immédiatement les antécédents de «la cliente». J’ai pu constater là combien l’œuvre se dilate, naturellement, par le seul fait de son existence et combien son action s’est étendue, tout en restant circonscrite autour de son but primitif, qui est le relèvement et l’amélioration de la femme.
Une jeune femme est entrée, vêtue de noir, de bonne tenue et de façons accortes; c’est une ouvrière en lingerie qui, à la condition de travailler dix ou douze heures de suite, parvient à gagner de 1 fr. 25 à 1 fr. 50 par jour. Elle est mariée; son mari a fait je ne sais quelle sottise et a été condamné à un an d’emprisonnement; il en est résulté une gène extrême, sinon la misère pour le ménage. Le sort de la femme périclitait, l’œuvre est intervenue et, à force de démarches et de sollicitations, a obtenu une diminution de la peine imposée au coupable. Celui-ci avait été récemment rendu à la liberté, et sa femme venait remercier la directrice de la Société qui l’avait libérée, en lui rendant le mari dont le gain journalier est indispensable à l’existence d’une famille. Dans ce cas, en ramenant plus tôt qu’on ne pouvait l’espérer un homme au domicile conjugal, l’œuvre n’a point forcé l’esprit de ses statuts, elle a fait acte de protection en faveur de la femme. L’ouvrière en lingerie était heureuse et ne le cachait pas; comme pour venir elle avait perdu une demi-journée de travail et qu’elle avait pris l’omnibus, car elle demeure loin de la place Dauphine, on lui remit une petite somme équivalant à sa dépense et à son manque à gagner.
Un fait qui n’est pas sans analogie avec celui-ci se produisit presque immédiatement. Un détenu qui a fini son temps est revenu chez sa femme; il a bonne envie de travailler et espère être agréé dans une des grandes usines de l’ancienne banlieue de Paris, mais pour tout vêtement il n’a qu’un pantalon usé jusqu’à la trame et un tricot de laine percé aux coudes; s’il se présente aux contremaîtres dans ce costume délabré, il est certain de n’être pas embauché, par conséquent il ne gagnera rien et retombera de tout son poids sur sa femme. On fouille dans les nippes, on fait un paquet de bonnes hardes, et la situation de la femme sera améliorée, parce que l’homme proprement vêtu trouvera place à la fabrique.
Si l’on s’empresse à secourir l’homme afin de soulager la femme, on peut penser que l’on ne s’épargne pas lorsqu’il s’agit des enfants, que l’on se plaît à rendre «braves», comme disent les paysans, dans l’espérance souvent justifiée de ramener la femme au devoir et de l’y maintenir en développant chez elle l’amour-propre de la maternité. Aussi le vestiaire est plein de petits vêtements que bien des mères envieraient. J’y ai vu une couronne funéraire ornée de pendeloques de perles blanches: à quoi bon? Une ancienne détenue, en bonne place aujourd’hui, doit venir la chercher dimanche pour la porter sur la tombe de sa fille, morte depuis peu. Est-ce excessif? Non pas; celle qui n’oublie pas d’honorer le tombeau de son enfant garde un souvenir dont peut-être elle sera préservée.
Pendant que j’étais là, écoutant avec un vif intérêt les explications que Mme de Barrau voulait bien me donner, une dame sociétaire de l’œuvre est arrivée, suivie d’une femme qui s’est assise dans l’antichambre, et a pris une pose attendrissante. La dame a raconté que, passant sur le Pont-Neuf, elle avait été accostée par une mendiante qui paraissait fort misérable et que, se trouvant à proximité du vestiaire, elle l’y amenait, afin que l’on vît si l’on pouvait lui faire quelque bien. On fit approcher la femme, qui se plaça sur un banc de bois, assez semblable à la sellette des anciennes juridictions criminelles, et se mit à verser de vraies larmes glissant le long de ses joues ridées.
On l’interrogea. — Elle est restée six semaines à l’hôpital pour un mal de jambe qui «lui retentit jusque dans la tête»; puis elle a été envoyée à la maison de convalescence du Vésinet, dont elle est sortie le 24 décembre 1886, ainsi qu’en fait foi le bulletin qu’elle présente; depuis ce moment, elle est sans domicile. «Où logiez-vous auparavant? — En garni. — Depuis quel âge? — A peu près depuis l’âge de quinze ans. — Aujourd’hui, quel âge avez-vous? — le viens d’entrer dans ma soixante-quatrième année. — Ainsi vous n’avez jamais eu de domicile? — Jamais. — Pourquoi? — Je ne sais pas. — Quel est votre métier? — Je travaille dans les chaussures d’hommes; mais maintenant on n’a pas d’ouvrage, et puis j’ai mal à la main.» Elle montra sa main droite, assez propre, peu fatiguée, dont un doigt était infléchi. «Depuis votre sortie du Vésinet, vous mendiez? — Oui, je ne peux faire que cela. — Avez-vous mangé ce matin?» Elle secoua la tête avec un geste négatif. Je me tournai vers la personne qui l’interrogeait et, à voix basse, je dis: «Elle sent l’eau-de-vie.» Il me fut répondu: «C’est de tradition populaire que l’eau-de-vie calme la faim mieux qu’un morceau de pain; c’est peut-être parce qu’elle n’avait rien à se mettre sous la dent qu’elle a bu un petit verre; du moins nous devons le supposer.»
On se préparait à l’adresser au dortoir des femmes de la rue Saint-Jacques, lorsque quelqu’un proposa de l’envoyer à l’Hospitalité du travail à Au feuil, munie d’une lettre de recommandation qui lui assurerait le logis et les repas pendant trois mois. La bonne femme s’exclama de reconnaissance. On la conduisit jusqu’à l’omnibus, où sa place fut payée et où on l’installa. On était satisfait au vestiaire. On disait: «Dans l’espace de trois mois, elle pourra se refaire, ça donnera du moins le temps d’aviser, et, au pis aller, nous aurons Villers-Cotterets.» Deux jours après, on acquérait la certitude qu’elle ne s’était même pas présentée à la maison de l’Hospitalité du travail. Est-ce à dire que l’on a eu tort de s’apitoyer sur une paresse qui se déguisait en misère? Nullement; s’il n’y avait pas de mécomptes en charité, ce serait trop beau.
Cette vieille femme, qui a si bien joué son rôle, et dont les grimaces ne lui ont valu qu’une promenade en omnibus, est-elle une ancienne pensionnaire de Saint-Lazare? On peut le croire, car elle a fait preuve d’une habileté où l’on reconnaît le résultat de l’expérience. Si elle y a été, elle y retournera, et sa comédie n’empêchera point l’œuvre de venir à son aide; car là, plus que partout ailleurs, on est indulgent. Le champ d’opération, qui était limité à la prison même de Saint-Lazare, s’est élargi, et les directrices de l’œuvre ont actuellement leur entrée au Dépôt, ce qui est un progrès considérable, parce qu’alors l’action, au lieu d’être simplement réparatrice, devient préventive et préservatrice.
Pour bien me faire comprendre, je dois expliquer ce que c’est que le Dépôt près la préfecture de police. Lorsqu’un individu est arrêté, il est conduit au Dépôt, il y est interné et y resle jusqu’à ce que l’administration ait ordonné son transfert à Mazas si c’est un homme, à Saint-Lazare si c’est une femme. Dans le cas de certaines peccadilles constatées en flagrant délit, pour lesquelles le tribunal de simple police est incompétent et le tribunal correctionnel trop sérieux, — mendicité, vagabondage, — le petit parquet fait comparaître immédiatement les délinquants et prononce sur leur sort. Il est facile de conclure que, si l’on peut intervenir au Dépôt même avant que la préfecture de police ait livré le prévenu à justice, ainsi qu’elle dit, il sera quelquefois possible d’empêcher une malheureuse de comparaître devant des juges et de porter pour sa vie une note de flétrissure. J’ai hâte de dire qu’en certaines circonstances excusables, en présence d’une première faute qui dénote plus d’étourderie que de perversité, certain bureau administratif, situé quai des Orfèvres, fait preuve de sentiments d’humanité que l’on ne saurait trop louer. L’Œuvre des Libérées est alors avertie qu’une «espèce» intéressante est au Dépôt, et on accourt. Voici un fait qui s’est produit récemment.
Une ouvrière en confections reçoit d’une couturière des étoffes taillées qu’elle doit rendre sous forme de robe dans un délai déterminé. L’ouvrière se hâte, termine son ouvrage et, comme elle est sans argent, mais qu’elle compte en toucher bientôt, elle engage la robe au mont-de-piété pour la somme de quatre francs. Lorsque le jour de la livraison est arrivé, elle n’a pas la somme qu’elle attendait, n’a pu retirer son nantissement, pleure et fait l’aveu de sa faute. La patronne couturière dépose une plainte chez le commissaire de police; l’ouvrière est arrêtée et enfermée au Dépôt. Elle a vingt-deux ans, elle est de bonne conduite; elle est pauvre et vit de son travail. Elle n’est pas l’objet d’une poursuite judiciaire; elle est sous les verrous en vertu d’une plainte particulière portée contre elle par une personne dont elle a lésé les intérêts. Si cette personne consent à retirer sa plainte, l’action, qui n’est encore qu’administrative, cesse et la pauvrette est mise en liberté. Tout de suite on court chez la patronne, on lui offre de dégager la robe qui est au mont-de-piété et on l’adjure de ne point laisser traduire en justice une jeune fille dont l’existence va être contaminée à jamais pour une faute que la pauvreté seule a provoquée et devrait faire pardonner. La négociation fut longue, car la couturière était rétive; on en eut raison cependant, et je crois que l’éloquence ne put la convaincre qu’en s’appuyant sur des arguments un peu plus solides. L’ouvrière fut relaxée, et je me figure que la leçon lui profitera. Sans l’intelligente bonté d’un chef de bureau, sans l’intervention rapide et pénétrante de l’Œuvre des Libérées, elle était perdue et peut-être pour toujours lâchée à travers les hasards du vice.
L’action, pour ainsi dire officielle, de l’Œuvre des Libérées est considérable, on vient de le voir; son action officieuse n’est pas moins importante et est tout entière faite de conciliation. Les jeunes filles de province qui accourent à Paris avec dix francs dans la poche et quelques millions d’illusions en tête, ne courent pas que le risque de mourir de faim et d’être réduites à retourner à pied au village, subsistant de compassion et dormant dans les granges. Aux gares d’arrivée des chemins de fer on les guette; les commis-voyageurs de la débauche, les placiers de la dépravation s’en emparent, les guident sous prétexte de les conduire à un hôtel bon marché, leur recommandent de se méfier des voleurs dont Paris abonde, et abusent d’une naïveté qui s’étonne de trouver tant de bonne grâce chez un inconnu. Si elles en sont quittes pour la perte d’une malle ou pour une mésaventure sans conséquence, elles peuvent remercier les dieux immortels, qui sans doute ont veillé sur elles.
D’autres fois, on est allé chez «une payse», chez une amie; par elle on a été conduite au bal, on s’est amusé, on a fait «une connaissance», on a négligé le travail, et, sans trop le vouloir, on a glissé dans le monde de la fainéantise et du plaisir, d’où l’on ne sort que diminué, sinon perdu. On n’en est plus à compter les fautes qui deviennent apparentes. Si on est au service, on est mis à la porte et l’on s’entend dire: Je ne veux pas de gourgandine chez moi. Si l’on est à l’atelier, les compagnes se moquent, se détournent en feignant l’indignation; on est montrée au doigt; on croit entendre la parole de Lisette à Marguerite dans Faust: «Quelle horreur! quand elle boit et mange, c’est pour deux!» Si la terreur et la honte ne vont pas jusqu’au crime, on peut en être étonné, car le cauchemar où l’on vit est épouvantable. Le malheur revêt bien des formes pour frapper la femme, mais celle-ci est la plus cruelle, car elle est contradictoire à l’hypocrisie des mœurs: c’est pourquoi elle entraîne la déchéance; et cependant... il y aurait tant à dire sur ce sujet, que je ne dirai rien, sinon que de toutes les misères sociales celle-là m’inspire la plus profonde commisération.
- Elles souffrent, elles sont dans l’angoisse d’un présent détestable et d’un avenir perdu; donc elles appartiennent à l’Œuvre des Libérées, qui ne les morigène pas et dirait volontiers: «Que celui qui est sans péché jette la première pierre! «C’est alors que l’on fait les démarches pour obtenir l’accès des hôpitaux, et surtout de la maison spéciale que le langage populaire a nommée: la Bourbe. Parfois quelques difficultés surgissent que l’on n’a pas le temps de combattre ou de résoudre. Il ne manque pas de sages-femmes à Paris, et, si pauvre que soit la caisse de l’œuvre, on y sait toujours découvrir de quoi secourir une pauvre femme réduite aux abois, pendant, que le vrai coupable, celui qui seul est responsable devant la justice des âmes, reste indifférent à tant d’infortune ou s’en console en faisant d’autres victimes.
Les heures sont périlleuses après le grand travail de la nature, surtout pour des femmes qu’une vie de privations a mal façonnées pour cet effort souvent mortel. L’hôpital est avare du temps qu’il accorde, car, s’il le prolonge, d’autres en pâtiraient; à peine remise de l’ébranlement, mal réparée, au bout de dix jours il faut partir. Où aller? Au logis? on n’en a que bien rarement; dans un garni? c’est presque la promiscuité, en cette période troublée où l’on a tant besoin de recueillement. L’Œuvre des Libérées est là : comme un gourmet de bienfaisance, elle connaît les bons endroits où la charité est au labeur, cette charité de Paris qui s’ingénie et brille d’un éclat magnifique au milieu de nos turpitudes, semblable à une fleur merveilleuse poussée sur un tas de fumier.
La Société philanthropique, dont j’ai déjà signalé l’énergie, a profité de son expérience pour agrandir son cercle d’action et l’étendre à des misères que jusqu’à présent l’on avait trop négligées. Elle a remarqué que dans sa maison de la rue Saint-Jacques le dortoir des femmes était surtout fréquenté par de pauvres filles encore chancelantes, sortant de la Maternité, et auxquelles, par pitié, on permettait de prolonger un séjour qui leur donnait un repos dont elles ont besoin. La maison, qui n’est qu’un refuge temporaire, devenait ainsi une sorte d’hospice de convalescence où la débilité venait reprendre des forces. D’une part, c’était un inconvénient; d’autre part, les dortoirs n’étaient ni disposés ni outillés pour cette catégorie de malheureuses. Mue par ce sentiment de charité dont elle a fourni tant de preuves depuis qu’elle existe, la Société philanthropique a fondé, avenue du Maine, n° 201, un asile maternel où les berceaux sont placés à côté des grands lits et où dix jours-pleins d’hospitalité sont accordés aux femmes qui arrivent de la Bourbe. C’est un grand bienfait, qui neutralise les maladies futures qu’engendre souvent trop de précipitation dans la reprise de la vie active.
L’Œuvre des Libérées est en rapport fréquent avec l’asile maternel, elle y fait admettre ses clientes, qui, grâce à elle, deviennent parfois de bonnes nourrices sur lieu, avec gages solides et bonnets pomponnés. Quelques-unes ont témoigné d’un tel dévouement, qu’elles ont été conservées en qualité de servantes, après avoir terminé leur office auprès du poupon. Ce n’est vraiment pas tout que d’avoir aidé la jeune fille pendant ces jours où sa faute est payée plus cher qu’il ne convient; il y a là-bas, dans la province, la famille qui a tout appris, qui se voile la face et se refuse d’accorder un pardon qu’elle sait devoir ne pas être gratuit. Si par malheur le père est entré, un soir, au théâtre de la ville voisine, s’il a lu quelques romans-feuilletons, s’il a vu la Closerie des Genêts ou la Grâce de Dieu, il sait qu’en pareil cas il est d’usage de maudire, et il maudit. C’est alors que l’Œuvre des Libérées s’efforce d’amener un rapprochement entre une fille trop durement battue par le sort et des parents dont la sévérité est plus intéressée que réelle. J’ai parcouru quelques lettres .échangées à ce sujet; il me semble qu’elles pourraient se résumer en cette formule finale: Je consens à pardonner, pourvu que ça ne me coûte rien. — Non, bonhomme, vous ne débourserez rien, et si l’on vous renvoie votre fille, on payera le voyage. — Malgré quelque mauvaise humeur d’un côté et un peu de honte de l’autre, la réconciliation se fait, et l’imprudente qui est venue se perdre à Paris pourra retourner au village, où elle se sauvera, si elle doit être sauvée.
L’œuvre n’est pas seulement en relations avec l’asile maternel, elle est en communication permanente avec l’Hospitalité du travail, qui a pu abandonner sa masure de la rue d’Auteuil et s’établir, avenue de Versailles, n° 52, dans une ancienne usine que la supérieure, tenace dans son rêve, a transformée en blanchisserie. L’Hospitalité du travail semble être un réservoir où l’Œuvre des Libérées verse les malheureuses qu’elle a repêchées pendant la prévention ou après l’emprisonnement. Les services que ces deux œuvres de salut et de préservation se rendent mutuellement sont considérables et la progression en est à remarquer. Dans l’espace de cinq ans, le nombre des femmes ayant touché Saint-Lazare qui ont été accueillies par l’Hospitalité du travail a presque triplé : 210 en 1881, 627 en 1885. Toutes ne sont pas à jamais préservées, cela va sans dire, mais à toutes on a accordé le repos pendant trois mois, à toutes on a donné le relais sur le mauvais chemin, et toutes ont pu choisir une route meilleure. Ce n’est que cela que l’on peut demander à la charité : elle ramasse les faibles, les fortifie, leur montre la bonne voie et les guide, mais elle ne refait point les âmes.