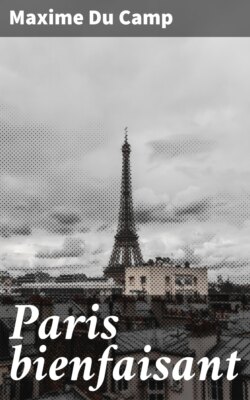Читать книгу Paris bienfaisant - Maxime du Camp - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LES PETITS ASILES.
ОглавлениеLa maison de convalescence morale. — L’esprit de famille. — A Billancourt. — La maisonnette. — Enseignement élémentaire. — Une fille de paysan. — Les boucles d’oreilles. — Plainte retirée. — Sans ressources. — «Rendue» au poste. — Le jeune ménage. — Dîner gratuit. — Au Dépôt. — Sauvés par l’œuvre. — Utilité des petits asiles. — Opinion du maire de Billancourt sur les libérées. — Les alcooliques. — Laissées en dehors de l’œuvre. — Les bonnes âmes. — Les mauvaises maîtresses. — Statistique de l’œuvre. — La sécurité publique. — L’intérêt de l’œuvre est de se limiter aux prévenues et aux détenues.
Il est dans la nature d’une œuvre de bienfaisance intelligemment conçue, répondant à un des nombreux desiderata de notre société compliquée, de se développer par elle-même, sur elle-même, comme le figuier des Banians, dont les branches deviennent des arbres en touchant terre. Si petitement commencée par Mlle de Grandpré, qui habille une femme demi-nue, l’Œuvre des Libérées a pris les proportions que j’ai fait connaître. Ce n’est pas assez; de même que les hôpitaux de Paris ont un hospice de convalescence au Vésinet, elle rêvait depuis longtemps de posséder une maison de convalescence morale où, entre la claustration pénitentiaire et les périls de la vie libre, on pût faire une sorte d’apprentissage qui permît d’affronter la responsabilité de soi-même sans la laisser tomber en défaillance. Ce rêve, elle est en train de le réaliser d’une façon ingénieuse et nouvelle.
Tout asile qui abrite de nombreux pensionnaires prend les apparences, sinon le caractère, d’une caserne ou d’un couvent, selon que l’on y reçoit une direction laïque ou religieuse. La règle est uniforme, elle s’impose aux natures les plus diverses, aux habitudes les moins semblables; l’indulgence peut la tempérer, mais le bon ordre exige qu’elle soit maintenue. Là rien ne rappelle l’esprit de famille, et c’est ce que l’œuvre cherche surtout à susciter et à entretenir chez les pauvres femmes sans appui dont elle a accepté la charge. Elle veut leur donner le repos intermédiaire qui leur permettra de secouer le souvenir de la prison et néanmoins leur laisser une liberté dont leur initiative profitera pour faire des démarches en vue de découvrir, d’obtenir une condition en rapport avec leurs aptitudes. Plutôt que de laisser ces malheureuses sur le pavé avec les quelques sous qui leur ouvriront les portes d’un garni, l’œuvre les recueille, les loge et les nourrit, non pas dans une maison, mais dans des maisonnettes. Elle vient de créer, sans peut-être s’en douter, les petits asiles, où la misère trouvera l’étape du réconfort, de la confiance, de la dignité, si la charité les adopte.
De Paris à Saint-Cloud ce n’est plus qu’une grande rue, très peuplée, qui se divise en plusieurs communes, dont Billancourt est la plus importante. Là, sur des voies nouvellement ouvertes, on a loué deux maisons, dont le loyer, — 500 francs par an, — indique l’exiguïté. On pourrait les appeler des infirmeries temporaires, car on y dépose pendant quelques jours, et au besoin pendant quelques semaines, les blessés du vice et de la pauvreté. On n’y souffre pas. Je les ai visitées par un temps glacial; un feu de coke brûlait dans la grille de la cheminée, l’air y était tiède et l’on y travaillait de bon cœur. C’est la maison comme il en existe tant aux environs de Paris, la maison de l’ouvrier qui a fait des économies et dont le plaisir consiste, pour se défatiguer le dimanche, à se donner une courbature en travaillant à son jardin.
Tout est petit: le couloir d’entrée, la maison, l’escalier, la cuisine, les chambres, le jardinet muni d’un puits et où s’élève l’inévitable gloriette tapissée de vigne vierge. C’est propret, d’apparence modeste et garni un peu à la diable, de meubles, d’ustensiles, de tableaux même donnés par quelque bienfaiteur qui déménageait. Quatre lits dans une chambre, c’est le dortoir des femmes; trois couchettes dans une autre pièce, c’est le dortoir des enfants. Dans la salle à manger, une fillette de seize ans à peine faisait «une page d’écriture», qu’elle copiait dans un livre d’histoire. C’est Mme de Barrau qui exige que les libérées illettrées — et elles sont nombreuses — soient, autant que possible, assidues à s’instruire, c’est-à-dire acquièrent quelques notions de lecture, d’écriture et de calcul. Elle a raison; c’est un outil de plus qu’elle place entre les mains de la femme qui devra son existence à son travail.
La jeune fille qui commence si tard son apprentissage scolaire et qui, chose rare, écrit mieux qu’elle ne lit, est de celles dont on dit volontiers: elle n’a pas de défense. Assez grande, de visage allongé, avec les pleines joues de l’adolescence, bien faite et de regard timide, elle a je ne sais quoi de faible et d’amolli qui indique une volonté flottante. La main longue a des doigts en fuseau, bien séparés, de forme fine, qui doivent être naturellement adroits et habiles aux ouvrages délicats; là sera peut-être le salut. Elle est sortie de la prévention de Saint-Lazare avant de comparaître devant la justice; donc sur elle nulle flétrissure. Son histoire est des plus simples et c’est celle de bien des pauvres filles que le diable a tentées, parce que, dans le milieu misérable où elles avaient toujours vécu, elles n’avaient jamais eu à repousser de tentations.
Née dans un hameau, elle est la plus âgée de six enfants; son père et sa mère, paysans pauvres, cultivent quelque lopin de terre dans un des départements maritimes du nord-ouest de la France. Quand elle eut quinze ans et demi, on l’envoya à Paris: «Va! Bon vent de fortune, tu es dans la ville où l’or ruisselle; tu n’auras qu’à te baisser pour en ramasser.» Elle ne savait rien que traire lés vaches et sarcler le sillon; elle savait aussi distinguer l’avoine du froment, science peu appréciée des Parisiens. Elle se plaça comme bonne à tout faire; c’est le lot de celles qui ignorent tout. Elle était soumise, ne regimbait point contre les rebuffades, était peu payée et admirait les robes de soie que, de la fenêtre de sa cuisine, elle voyait passer dans la rue.
Un jour, sur une table de toilette, elle aperçut des boucles d’oreilles qui valaient peut-être 15 ou 20 francs la paire; elle les regarda avec convoitise, les essaya, trouva qu’elles lui allaient bien et les garda. On chercha les boucles d’oreilles, on interrogea la servante, qui se mit à pleurer et avoua son larcin: «Ç’a été plus fort que moi.» On la traita de voleuse et on la fit arrêter. Conduite au Dépôt, ahurie, ne se rendant pas compte de ce qui lui arrivait, terrifiée, répondant à peine aux questions qu’on lui adressait, elle n’y resta pas longtemps et fut transférée comme prévenue à Saint-Lazare. C’est là que l’Œuvre des Libérées la découvrit.
Le cas était grave, car si la faute était minime, les conséquences pouvaient en être redoutables: vol domestique; article 586 du Code pénal: reclusion. La pauvre fille n’avait pas encore seize ans accomplis; on admettrait qu’elle a pu agir sans discernement, et alors, — par grâce, — elle sera enfermée jusqu’à sa majorité dans une maison de correction paternelle. Entre ces deux maux quel est le moins cruel? Il serait difficile de le dire. Les dames de l’œuvre curent pitié de cette enfant; un tel sauvetage à opérer, le salut d’une existence entière à assurer, il y avait là de quoi les tenter, et elles se mirent en rapport avec la «bourgeoise» qui avait déposé la plainte. C’était une femme rèche et dure; à tout ce qu’on lui disait, elle répondait: «Tant pis pour elle, ça lui servira de leçon!» Il ne fallut pas moins de deux mois d’objurgations et de prières avant d’obtenir que cette femme, vertueuse pour les autres jusqu’à la barbarie, consentît à retirer sa plainte. Les dames de l’œuvre furent enfin victorieuses; elles emportèrent la petite fille à Billancourt, où je l’ai vue apprenant à écrire. Dès à présent, si elle est vaillante, son sort est assuré ; aussitôt qu’elle sera remise des émotions qu’elle a subies et qui l’ont quelque peu ébranlée, elle entrera en qualité d’apprentie dans une industrie de luxe où l’agilité de ses doigts ne lui sera pas inutile. L’œuvre la suivra des yeux, l’encouragera, fera acte de maternité vis-à-vis d’elle et au besoin lui conservera sa place dans la maisonnette où elle a trouvé asile. Si celle-là n’est pas sauvée à toujours, je serai bien surpris.
La seconde maison ressemble à la première; j’y vois trois femmes occupées à ravauder des bas, un peu maladroitement, comme si leurs mains avaient perdu l’habitude de l’aiguille. Deux d’entre elles sont marquées moins par l’âge peut-être que par les privations ou les excès; le doigt brutal de la misère ou de la débauche a modelé leur visage: lèvres flétries, joues pendantes, paupières lourdes; elles semblent envahies par une sorte de somnolence qui donne du vague à leurs regards et de la lenteur à leurs gestes. Toutes deux ont commis le même délit: vagabondage. Sans ressource, n’ayant même pas deux sous pour avoir place à la paille dans le plus infime des garnis, l’estomac vide, grelottant de froid, l’une au boulevard Sébastopol, l’autre sur le boulevard Montparnasse, elles sont entrées dans un poste de police en disant: «Je n’en puis plus, arrêtez-moi.» L’expression dont elles se servent est celle du soldat qui a trop longtemps soutenu un combat inégal, qui jette ses armes et est fait prisonnier; elles disent: «Je me suis rendue. «Dans ce cas-là, les sergents de ville sont très bons; ils font place auprès du poêle, afin que la malheureuse puisse se réchauffer, ils lui donnent à manger et bien souvent font entre eux une collecte, afin de lui remettre ce qu’au régiment on appelle le sou de poche.
La troisième femme est tout autre. Elle vient d’avoir dix-huit ans. Elle est grande et d’ossature vigoureuse. Des cheveux blonds encadrent le front bombé, le visage est très pâle, le regard est inquiet, les lèvres sont minces avec une expression amère. Elle a quelque chose de l’animal qui a été chassé et qui sursaute, croyant toujours entendre l’aboi des chiens derrière lui. Elle n’est pas laide; mais la beauté du diable, cette fleur de jeunesse dont les joues sont veloutées, lui fait défaut; elle est hâve, comme si pendant longtemps elle n’avait vécu que de privations. Elle est mariée; son mari a vingt-deux ans; ils s’aimaient, et courageusement, — imprudemment, — ont accroché leur pauvreté l’une à l’autre. Sans doute ils ont chanté ce couplet d’un ancien vaudeville:
Unissons nos deux infortunes,
Nous en ferons peut-être du bonheur!
La misère fut pesante; point d’ouvrage: on en cherchait et l’on n’en trouvait pas; successivement tout ce qui représentait une valeur quelconque fut engagé au mont-de-piété.
Un soir que ces deux malheureux n’avaient point mangé depuis vingt-quatre heures, ils entrèrent dans un restaurant de bas étage et se firent servir à dîner. Le total de la dépense s’élevait à quarante-deux sous; lorsqu’il fallut payer, l’homme fit mine de fouiller dans ses poches, parut surpris et déclara qu’il avait oublié son porte-monnaie. On appela les sergents de ville, et les deux affamés, après une nuit passée au «violon», furent écroués au Dépôt, où l’Œuvre des Libérées les aperçut. Le gargotier fut immédiatement désintéressé et, sans hésitation, fit mettre à néant la plainte qu’il avait déposée. La femme fut conduite à l’asile, où elle restera jusqu’à ce qu’elle soit un peu «refaite», pendant qu’on lui cherche une condition; quant à son mari, on espère le faire admettre promptement dans une des usines de Billancourt, car il est de principe chez les dames de l’œuvre de rapprocher autant que possible les personnes appartenant à la même famille.
Les petits asiles sont placés sous la direction de femmes choisies par l’œuvre; logées, éclairées, chauffées, elles reçoivent un franc par jour et par pensionnaire, mais elles sont chargées de pourvoir à la nourriture. Dans la cuisine, j’ai soulevé le couvercle d’une casserole et j’ai découvert un ragoût de veau aux carottes qui mijotait en dégageant un fumet de bon aloi. L’utilité de ces maisons de refuge sera appréciée, lorsque l’on saura qu’en 1886 on y a fait 1,504 journées de présence, sans compter que pendant 250 nuits on a donné l’hospitalité à des femmes qui, travaillant le jour au dehors, venaient y dormir. Ce monde, qui de sa vie passée a dû garder au moins quelques oscillations, est-il tout à coup devenu irréprochable? J’ai voulu, comme l’on dit, en avoir le cœur net, et je m’en suis allé trouver le maire de la commune.
C’est un homme fort expert en matière administrative et de cœur charitable; la crèche, l’école maternelle, l’hospice des vieillards de Billancourt peuvent servir de modèle sous le triple rapport de l’installation, de la bonne tenue et de l’économie. A ma question: Quelle est la conduite des femmes protégées par l’Œuvre des Libérées de Saint-Lazare, il a répondu: «Jamais elles n’ont donné lieu à aucune plainte; vous entendez, jamais; je les aide, en leur accordant des bons de pain, de viande, de chauffage; des bons de lait, si elles ont des enfants; c’est à cela que se borne mon intervention, car, je vous le répète, non seulement je n’ai pas eu à sévir, mais je n’ai même pas eu d’observation à adresser à une seule d’entre elles.»
Un fait prouve que le maire ne s’est point trompé : plusieurs pensionnaires des petits asiles ont été pourvues de conditions à Billancourt même, y restent et ne sont point mécontentes de leur sort. Une seule catégorie de femmes est résolument mise en dehors de l’action de l’œuvre: c’est la catégorie des femmes qui boivent; celles-là sont ingouvernables, puisqu’elle s ne se possèdent plus, et elles sont incorrigibles, car l’alcoolisme est une maladie chronique avec accès aigus. Une dame patronnesse me disait énergiquement: «On guérit du vol, on ne guérit pas de l’eau-de-vie.» On est donc forcé de les abandonner; plus tard, l’Assistance publique les recueillera et les internera à la Salpêtrière, dans la section des aliénées. Quant aux coupables qui ont passé ou qui auraient pu passer devant la police correctionnelle pour des délits de droit commun, on n’en désespère pas. Il est rare que celles qui se donnent de plein cœur à l’œuvre réparatrice n’en soient pas récompensées et ne parviennent pas à se redresser tout à fait. Il leur faut du courage, de la résignation, et bien souvent savoir se vaincre à force d’humilité.
Les maîtresses, — bourgeoises ou patronnes d’atelier, — chez qui vont servir ces malheureuses, ne sont point toutes des créatures angéliques, tant s’en faut. Les âmes charitables et pénétrées de noblesse ne sont point rares, je le sais; beaucoup de femmes qui acceptent des libérées de Saint-Lazare, dont on ne leur a point laissé ignorer les antécédents, sont bonnes dans l’acception large du mot; elles s’associent de leur mieux aux efforts tentés par l’œuvre et à force de patience, de douceur, essayent de ramener des esprits que le vice a mal conseillés, que la punition a affaissés et qui, malmenés par le sort ou par leur faiblesse, restent méfiants des autres et d’eux-mêmes. Presque toujours c’est la mansuétude qui triomphe et fait naître des dévouements dont parfois on reste surpris. L’ancienne détenue en accomplissant tous ses devoirs a reconquis tous ses droits.
Malheureusement, il n’en est pas toujours ainsi. Plus d’une femme, de caractère dur et de calcul parcimonieux, va prendre une servante parmi ces déclassées de la prison, parce qu’elle sait qu’elle «aura barre sur elle», lui donnera des gages dérisoires, l’accablera de besogne et la tiendra à merci par l’abjection même de son passé. Celles que leur mauvaise fortune pousse chez de telles maîtresses deviennent des souffre-douleur et peuvent se croire aux travaux forcés. A la moindre étourderie, à la moindre erreur de service, la litanie des reproches commence et recommence: «Vous savez, ma fille, il ne faut point oublier où je vous ai ramassée, et que sans mon bon cœur vous seriez encore dans le ruisseau; ce n’est pas tout que d’avoir été voleuse et d’être reprise de justice, il faut obéir et tâcher d’être moins bête.» La malheureuse courbe la tête comme un chien battu et ne souffle mot; il lui semble que l’on va venir la chercher pour la reconduire en prison. Les avanies se renouvellent; elle les supporte encore, elle les supporte toujours et finit par en prendre l’habitude; à moins qu’un jour l’exaspération ne la saisisse et qu’avec une maladresse calculée elle ne laisse tomber une lampe alimentée d’huile de pétrole qui met le feu à la maison où l’on s’est plu à la faire souffrir.
Le nombre des femmes que l’Œuvre des Libérées de Saint-Lazare parvient à retirer du bourbier où elles croupissaient est-il considérable? Des chiffres officiels peuvent répondre: 1,412 femmes, je l’ai dit, ont passé au vestiaire pendant le cours de l’année 1886; sur cette quantité, 216 y sont retournées, réclamant l’intervention, les conseils de la Société, ou venant lui apporter témoignage de gratitude; celles-là sont en volonté de bien faire et y réussissent. Plus du sixième, c’est beaucoup; c’est de la charité placée à beaux intérêts; de tels résultats sont pour encourager et prouvent combien cette œuvre de salut est utile.
Les femmes de bien qui s’y consacrent, sans marchander leur temps ni leur peine, n’ont d’autre but que de secourir des malheureuses et de leur enseigner à nouveau l’exercice du devoir qu’elles ont oublié, en admettant qu’elles l’aient jamais connu. Ce but a été singulièrement dépassé, car elles font acte de préservation sociale: en protégeant l’individu, elles sauvegardent la collectivité ; en arrachant les prévenues, les anciennes détenues à la circulation du vice, elles neutralisent dans une certaine mesure les dangers qui sans cesse menacent l’agglomération parisienne. La sécurité publique leur doit quelque reconnaissance; lier le mal, l’enfermer dans le bien, l’empêcher d’en sortir, c’est une action méritoire que l’Œuvre des Libérées accomplit avec énergie.
Que les dames sociétaires me permettent, en terminant, de leur adresser un conseil; c’est celui d’un homme qui a sondé certaines plaies sociales et qui, de son étude, a rapporté une conviction que ni les polémiques intéressées, ni l’hypocrisie des doctrines préconçues, ni les illusions des esprits enthousiastes n’ont jamais ébranlée. L’œuvre n’agit à Saint-Lazare que sur les prévenues et sur les détenues, c’est-à-dire sur les femmes coupables ou innocentes que la justice attend et que la justice a punies ou acquittées. Qu’elle s’en tienne là. Il est une section de la vieille geôle où l’œuvre ne doit jamais apparaître: elle n’y rencontrerait que la déception même, la déception faite de lâcheté, de mensonge et de perversion inconsciente. Celles que l’on rassemble là, comme un troupeau de brebis galeuses, sont atteintes d’un mal plus invétéré, plus grave, plus incurable que l’alcoolisme; il est possible que le corps en vive, mais, à coup sûr, l’âme en meurt. Sur cette catégorie de créatures que nul mot honnête ne peut désigner, l’administration chargée du soin de la salubrité publique a seule qualité pour agir, comme elle a qualité pour faire enlever les ordures de la voie publique, prescrire des mesures préventives en cas d’épidémie, arrêter les malfaiteurs et faire jeter à la rivière les vins frelatés. A Saint-Lazare, il y a plusieurs prisons: que l’Œuvre des Libérées reste résolument confinée dans celle où elle a déjà rendu tant de services.
Depuis que ce chapitre est écrit, d’importantes modifications ont été apportées au régime de Saint-Lazare, sur l’initiative de M. Herbette, directeur des établissements pénitentiaires au ministère de l’intérieur. Seules les femmes de mauvaise vie punies par voie administrative resteront dans la vieille prison; les prévenues seront internées à la maison de répression de Nanterrc; les détenues jugées seront transportées dans une division spéciale de la maison centrale de Doullens; les jeunes filles en correction paternelle seront placées à la Conciergerie, dans l’ancien quartier des cochers, que l’on est en train d’aménager pour elles. Ces mesures sont excellentes et l’on ne saurait trop y applaudir.