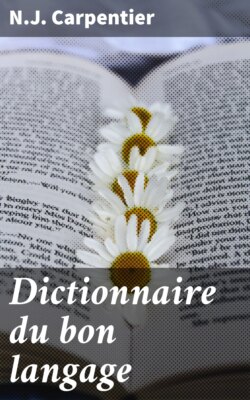Читать книгу Dictionnaire du bon langage - N.J. Carpentier - Страница 12
D
ОглавлениеD.—C'est à tort que l'on prononce souvent le d des syllabes en de comme un t: timite, timitement, raite, ronte, corte, humite, Enéite, au lieu de timi-de, timi-de-ment, rai-de, ron-de, cor-de, humi-de, Enéi-de. Cependant à la fin d'un adjectif, suivi immédiatement de son substantif commençant par une voyelle ou une h muette, d a le son de t: un grand ignorant, la grande armée; prononcez gran-t-ignorant, la gran-te-armée. Il en est de même, lorsque cette lettre est à la fin d'un verbe suivi de il, elle: répond-il, entend-elle? (répon-t-il, enten-t-elle.)
2. On ne prononce pas le d final dans les adjectifs qui ne sont pas suivis immédiatement de leur substantif. Un abîme profond effraie (profon effraie). On ne le prononce pas non plus dans les substantifs, même lorsqu'ils sont suivis de leur adjectif: on dira donc un froid (froi) excessif, un bord (bor) escarpé, sans aucune liaison. Mais il faut excepter le d final dans les locutions suivantes: de pied en cap, de fond en comble, où le d prend le son de t.
3. Prononcez les deux d dans addition, additionnel, additionner, adducteur, adduction et reddition.
4. D'à moi, d'à toi, d'à lui, etc.; les personnes peu instruites disent seules: ce livre est d'à moi, d'à toi, d'à lui, etc.; il faut dire, ce livre est à moi, à toi, à lui, etc.
D'abord que, ne peut pas s'employer pour, puisque ou aussitôt que; ne dites donc pas: d'abord que je suis innocent, je ne dois pas être puni; d'abord que vous aurez fini vos devoirs, vous apprendez vos leçons; dites, puisque je suis innocent...; aussitôt, dès que vous aurez fini vos devoirs... (Wall.)
Dada, est un terme enfantin qui signifie cheval; mais il ne faut pas le confondre avec dadais, dandin, qui veulent dire niais: c'est un grand dadais, un vrai dandin.
Dahlia, s. m., plante d'ornement; prononcez dalia.
Daigner, ne doit jamais être suivi de la préposition de; ainsi ne dites pas: daignez de m'accorder votre protection, mais, daignez m'accorder...—Prononcez dai-gner et non dai-gne-ner; il en est de même de dédaigner, enseigner, etc. Voyez gne.
Daim, s. m., bête fauve qui tient le milieu entre le cerf et le chevreuil; la femelle s'appelle daine, que l'on prononce dine.
Daler, Thaler, Taler, s. m., monnaie d'Allemagne; prononcez dalère, thalère, talère; on dit plus souvent thaler que taler ou daler.
Damas, ville de Syrie; prononcez Damâce; damas, s. m., étoffe, fruit, acier; prononcez damâ.
Dame: voyez monsieur et époux.
Damner, Damnation, Damnable; prononcez dâner, dânation, dânable, en supprimant l'm et en allongeant l'a: voyez condamner.
Danger.—Ne dites pas: il n'y a pas de danger que j'aille jouer, car mes parents me l'ont défendu; dites, je me garderai bien; je n'ai garde; je ne veux pas aller jouer;—ne pouvoir mal, dans ce sens, est également un wallonisme.
Dangereux et dangereusement, employés pour probable, vraisemblable et probablement, vraisemblablement, apparemment, sont de véritables barbarismes. Ainsi ne dites pas: cela est bien dangereux; cela arrivera dangereusement demain; mais dites, cela est bien probable, vraisemblable; cela arrivera probablement, vraisemblablement demain—Prononcez danj'reux et non danchereux ni dangéreux, dangèreux; item, dangereusement.
Dank.—C'est une expression qu'il faut laisser aux flamands, puisque nous pouvons dire merci.
Dans.—Ne dites pas: j'ai beaucoup voyagé dans les flamands, dans les wallons; dites, chez les flamands, chez les wallons, ou dans le pays flamand, dans le pays wallon.
2. Ne dites pas: je vais m'asseoir dans le soleil; je me promène dans le soleil; il est agréable de se réchauffer dans le soleil; mais dites, je vais m'asseoir au soleil; je me promène au soleil; il est agréable de se réchauffer au soleil.
3. Ne dites pas: je suis dans un grand mal de tête; dites, j'ai un grand mal de tête.
4. Ne dites pas: s'il était dans mon pouvoir ou dans ma puissance de vous rendre service; mais dites, s'il était en mon pouvoir, en ma puissance...
5. Ne dites pas: il a fait ce voyage dans deux heures; dites, en deux heures.
6. Ne dites pas: il y a dans les quarante ans; dites, il y a à peu près ou environ quarante ans. (Wall.)
7. Ne dites pas: cela coûte dans les trois cents francs; dites, environ, à peu près trois cents francs. (Wall.)
8. Ne dites pas: je me trouvais dans la place Saint-Lambert; dites, sur la place... (Fland.)
9. Ne dites pas: j'étais dans la fenêtre, dans la pluie; dites, à la fenêtre, à la pluie; on dit, se tenir, se mettre à la fenêtre, à la pluie, au vent.
10. Ne dites pas: je serai, j'irai dans l'hôtel d'Angleterre à 4 heures; dites, à l'hôtel d'Angleterre...
11. Ne dites pas: l'un dans l'autre; mais, l'un portant l'autre: les différents vols qu'on m'a faits, m'ont causé, l'un portant l'autre, une perte de mille francs. (Wall.)
Dante, célèbre poète italien, auteur de la Divine Comédie: on dit Dante, et non le Dante; mais on dit le Tasse et non Tasse.
Dartre, s. f., maladie de peau; écrivez et prononcez dar-tre, et non dar-te ni dar-tère.
Date (époque), dater, datif.—Gardez-vous bien de marquer l'a d'un accent circonflexe: une vieille date (et non dâte); ce décret est daté de telle ville (et non dâté). On prononce pourtant dâte, (â long).—Ne confondez pas date, époque, avec datte, fruit du dattier.
Davantage, adv. (et non d'avantage), s'emploie toujours sans complément; ainsi on ne dira pas: il a davantage de livres; il en a davantage que son frère; mais il faudra dire: il a plus de livres; il en a plus que son frère.
2. Il ne faut pas le confondre avec plus: celui-ci s'emploie pour exprimer directement une comparaison: votre sœur est plus âgée que vous; mais on dira fort bien: elle a vingt ans, vous en avez davantage. Davantage ne doit pas non plus être suivi d'un adjectif; on ne doit pas dire: il est davantage âgé, davantage estimé; il faut dire plus âgé, plus estimé.
3. Les grammairiens prétendent que davantage ne doit jamais être suivi de la préposition de ni de la conjonction que. Cette règle est vraie, si de ou que forment, avec ce qui les suit, un complément de l'adverbe davantage: il a davantage de livres; il en a davantage que son frère. Mais si de ou que et les mots qui suivent, sont un complément du verbe de la proposition, il n'y a point de faute à les placer après davantage. Ainsi la phrase suivante est correcte: ne nous étonnons donc pas et ne nous effrayons pas davantage des reproches que nous avons encourus: dans cette phrase, des reproches sont le complément des verbes étonnons et effrayons.
4. Les bons grammairiens condamnent l'emploi de davantage dans le sens de le plus; ne dites donc pas: de tous les jeux celui des barres est celui qui me plaît davantage: dites le plus. En général, davantage ne doit se placer que là où le sens permet l'emploi des locutions équivalentes à de plus, en outre, de surcroît et toutes les fois qu'il n'a pas de complément.—Voyez Soulice et Sardou, Dictionnaire, etc.
De, syllabe muette, dans le corps ou au commencement d'un mot; doit se prononcer de et non ne: command'-ment, man-d'-ment, ma-d'-moiselle, len-d'-main, je lui ai d'-mandé; panier d'-noix, etc., et non comman-n'-ment, man-n'-ment, ma-n'-moiselle, len-n'main; je lui ai n'-mandé; panier n'noix, à moins toutefois qu'on ne veuille faire sentir l'e de de et prononcer: comman-de-ment, ma-de-moiselle; je lui ai de-mandé, j'irai de-main, lendemain, etc.—Prononcez de même ad-mettre, ad-ministrer, ad-mission, ad-ministration, etc.
2. Ne dites pas: j'ai rêvé de la nuit, du jour, dites: j'ai rêvé la nuit, le jour.
3. Faut-il dire: quel est le plus habile de cet homme-ci ou de celui-là? ou bien: quel est le plus habile, cet homme-ci ou celui-là? L'Académie adopte la première orthographe; elle ne partage donc pas l'opinion des grammairiens qui suppriment de.
4. Dites: le livre de mon frère, la maison de mon cousin, et non, le livre à mon frère ou d'à mon frère; la maison à mon cousin ou d'à mon cousin.
5. On dit, le deux janvier, le trois février, etc., et le deux de janvier, le trois de février, etc. (Acad.) Cependant la première manière de s'exprimer nous paraît plus usitée.
6. Ne dites pas: il est le quart de huit heures; dites, il est huit heures moins un quart. Voyez quart.
7. Ne dites pas: mon frère est le 5e de 36 dans sa classe; dites, ... sur 36...
8. Ne dites pas: d'un coup de massue il cassa la tête de son ami; dites, il cassa la tête à son ami.
9. Ne dites pas: cela ne me fait de rien, ne m'est de rien; dites, cela ne me fait rien, ne m'est rien.
10. Ne dites pas: j'y penserai de la nuit, j'y travaillerai du matin, du jour; dites, ... pendant la nuit, dans la matinée, pendant la journée.
11. La particule de, devant les noms propres de noblesse, s'écrit avec un petit d et non avec le D majuscule: de Montmorency, de Ligne, d'Oultremont, d'Orléans. On écrit De avec une majuscule, lorsque ces noms ne sont pas nobles, alors même qu'on sépare la particule du nom.
12. Après les verbes espérer, souhaiter, désirer, on peut exprimer ou sous-entendre la préposition de devant l'infinitif: j'espère réussir ou de réussir; je désire aller ou d'aller avec vous, etc.—Compter, dans le sens de, se proposer, croire, ne prend point la préposition de devant un infinitif; ainsi vous direz: il compte partir demain et non de partir. (Acad.)
13. Dans la conversation et le style familier, de se supprime souvent après les prépositions hors, près, vis-à-vis, lorsqu'elles sont suivies d'un nom de chose: il est logé hors la barrière, il demeure près la porte Saint-Antoine, vis-à-vis l'église. (Acad.) Mais devant un nom de personne ou un pronom, on doit employer de: il était près de Paul, vis-à-vis de vous, et non près Paul, vis-à-vis vous.
14. L'emploi de la préposition de est vicieux dans cette phrase: la moitié de huit est de quatre; dites, est quatre.
15. On peut exprimer ou sous-entendre la préposition de devant un infinitif après c'est... que, mieux... que, plutôt que: ainsi vous pouvez dire: c'est quelque chose que faire ou que de faire un beau rêve; il vaut mieux étudier que de ou que jouer; plutôt que de ou que m'exposer à une correction, je préfère faire mes devoirs. Néanmoins l'usage général est d'exprimer la préposition de.
16. Il ne fait que sortir, signifie, il sort à chaque instant; il ne fait que de sortir, veut dire, il vient de sortir.
17. L'usage permet également de dire: on dirait un fou, et on dirait d'un fou.
18. Ne dites pas: si j'étais toi, si j'étais lui, si j'étais vous; si j'étais à la place de, etc., je ferais telle chose; mais dites, si j'étais que de toi, de lui, etc., et mieux, si j'étais de toi, de lui, etc.
19. On emploie ordinairement la préposition de, devant un participe passé précédé d'un adjectif numéral ou d'un nom collectif; on dit: il y eut cent hommes de tués et un grand nombre de femmes de blessées, plutôt que: il y eut cent hommes tués et un grand nombre de femmes blessées;—mais on doit la supprimer devant un adjectif qualificatif: dans cette ville il n'y a pas quatre monuments remarquables. Cependant lorsque le nom qui précède le participe ou l'adjectif, est représenté par le pronom en, on exprime la préposition: sur mille hommes, il y en eut cent de tués; parmi tant de monuments, il n'y en a pas un de remarquable.
Débâcle, rupture et descente de glaces, est féminin; prononcez débâ-cle.
Déballer.—Ne dites pas: ce marchand est déballé à l'hôtel de l'Europe; dites, ... a déballé, car il n'a déballé que ses marchandises, et il ne s'est pas déballé lui-même.
Débine, s. f.—Être dans la débine, c'est-à-dire, dans la gêne; cette expression est triviale et même tout-à-fait populaire. Voyez blaguer.
Débiser.—Ne dites pas: j'ai les mains et les lèvres toutes débisées; dites, toutes gercées par la bise, par la gelée, par le froid; le froid gerce les lèvres, les mains.
Débit, s. m., vente, trafic; le t ne se prononce pas.—Ne dites pas: vendre en gros et en débit; dites, ... en détail.
Débiteur, qui doit, fait au féminin débitrice.
Débours, argent qu'on a avancé pour le compte de quelqu'un; ce mot a vieilli; dites déboursés (au plur.) et non débourses. (Acad.)
Décaméron, s. m., ouvrage contenant le récit des événements de dix jours; prononcez décamérone.
Décanat, Doyenné.—Le décanat est la dignité du doyen: ce curé a été promu à un décanat. Le doyenné est le pays qui ressortit à un doyen: le doyenné de Sprimont se compose de vingt paroisses.
Décéder, v. n., prend le verbe être dans ses temps composés. Ce mot n'est guère usité, dit l'Académie, qu'en termes de jurisprudence et d'administration, et en parlant des personnes; il s'emploie aussi au participe passé dans les inscriptions; dans tout autre cas on se sert du verbe mourir. Ces observations s'appliquent également au substantif décès.
Décemment, adv., d'une manière décente; prononcez déçaman; prononcez de même, apparemment, prudemment, négligemment.
Décemvir, s. m., l'un des dix magistrats de Rome; prononcez décèm'vir, décèm'virat.
Décennal, adj., qui dure dix ans: prononcez décèn'nal.
Décesser, n'est plus en usage; il faut dire cesser, discontinuer.
Décider, devant un infinitif, demande la préposition à: cette raison m'a décidé à partir (et non de partir); je me suis décidé à rester. Cependant lorsqu'il signifie, prendre une résolution, déterminer ce que l'on doit faire, il prend de: nous nous décidâmes de partir sur-le-champ.
Décime (pièce de dix centimes), centime, cents, sont masculins: un décime, un centime, un cents. Voyez centime et cents.
Déclicher, est un mot wallon: dites, lever la clenche, le loquet.
Décombres, débris, est un substantif masculin pluriel sans singulier: il faut faire enlever ces décombres.
Décommander, révoquer un ordre, n'est pas français; dites contremander.
Décorum, s. m., bienséance; il n'est guère usité que dans ces phrases: garder, observer le décorum, garder les bienséances; blesser le décorum, choquer les bienséances; prononcez décorome; il n'a point de pluriel.
Découcher (se), n'est pas français; dites se lever.—Découcher, v. n. et a., signifie, coucher hors de chez soi, ou être cause que quelqu'un quitte le lit où il couche: depuis huit jours, il a découché trois fois; le maître de la maison m'avait offert son lit, mais je n'ai pas voulu le découcher.
Décrémer le lait, ôter la crème de dessus le lait; ce mot n'est pas français; il faut dire écrémer. Voyez chrême et crémer.
Décret, s. m., loi, ordonnance; prononcez décrè et non decrè.
Décrottoir, s. m., est une lame de fer destinée à décrotter la chaussure; décrottoire, s. féminin, est une brosse ronde pour décrotter la chaussure.
Dedans, adv. de lieu, ne prend pas de complément; ainsi ne dites pas, dedans la maison, dedans ma chambre, mais, dans la maison, dans ma chambre.
2. Donner dedans, c'est se laisser tromper comme un sot; mettre quelqu'un dedans, c'est le tromper: ces locutions sont populaires. (Acad.)
Défaufiler et Défiler, (défaire un tissu fil à fil) ne sont pas français; dites éfaufiler et effiler.
Déficeler, ôter la ficelle, n'est pas français.
Déficit, s. m., ce qui manque; prononcez déficite. Quoique l'Académie dise qu'il est invariable au pluriel, nous pensons que déficit, qui a un accent sur l'e, est un mot tout-à-fait français, et qu'il doit par conséquent être soumis aux règles de la grammaire; ainsi nous écririons plutôt des déficits, avec une s que sans s.
Défier, v. actif: je l'en défie et non, je lui en défie.
Définitive (en), loc. adv., en résumé; ne dites pas et ne prononcez pas en définitif.
Dégommer, v. a., dans le sens de destituer, ruiner, déconsidérer, est français, mais il est populaire.
Dégouttant, signifie qui dégoutte: ce linge n'est pas sec, il est encore tout dégouttant. Ne confondez pas ce mot avec dégoûtant, qui donne du dégoût: malpropreté dégoûtante; prononcez oû long dans dégoûtant et ou bref dans dégouttant.
Dégrafer, détacher une agrafe; ne dites pas désagrafer.
Dégriffer, n'est pas français; c'est égratigner qu'il faut dire.
Déguisé.—Ce mot ne s'emploie pas comme substantif; ne dites donc pas: j'ai vu plus de trente déguisés pendant le carnaval; dites, plus de trente masques.
2. Ne dites pas: la petite vérole l'a déguisé; dites, l'a défiguré.—Déguiser signifie masquer, travestir.
Déhonté, adj., éhonté; ce mot, rejeté par quelques grammairiens, est admis par l'Académie: un homme déhonté, une femme déhontée.
Dehors, adv. de lieu, opposé à dedans, comme hors est opposé à dans; dehors doit toujours être employé sans complément: restez dedans, j'irai dehors.
2. Il est ridicule de mettre dehors après les verbes boire, aller, tomber, etc.; ainsi ne dites pas: buvez votre verre dehors; le feu va dehors; la bouteille est dehors; dites tout simplement, buvez, videz votre verre; le feu s'éteint; la bouteille est vide.
3. Ne dites pas non plus: je sais ma leçon dehors; dites, je sais ma leçon par cœur. (Fland.)
4. Ne dites pas: quelques historiens racontent qu'il tomba autrefois des pluies de sang dehors le ciel; dites, qu'il tomba du ciel... (Fland.)
5. Ne dites pas: on a sonné dehors que le pain est baissé; dites, on a annoncé au son de la clochette que... (Fland.)
6. Ne dites pas: il m'a donné cela dehors; j'ai eu ma carte dehors (t. de jeu de cartes); dites, il m'a donné cela; j'ai eu ma carte (en retranchant dehors). (Fland.)—Prononcez dehors et non déhors.
Déjà, adv.: prononcez déjà (é fermé) et non dejà ni dèjà.
Déjeter.—Ce verbe ne s'emploie que pronominalement et signifie se courber, se contourner: le bois de cette table s'est déjeté; sa colonne vertébrale s'est un peu déjetée.
2. Mais il ne faut pas l'employer dans le sens de bouleverser, déranger, mettre en désordre, bousculer, agiter, secouer: bouleverser tout dans une chambre; on a bousculé mes livres; nous fûmes horriblement bousculés dans la foule. Se déjeter ne doit pas non plus s'employer au lieu de, se débattre, s'agiter: se débattre comme un possédé; un oiseau qui se débat quand on le tient; ce malade s'agite continuellement.—Prononcez déj'ter et non déch'ter.
Déjeuner, Dîner, Souper, Goûter.—Ces verbes veulent la préposition de devant le nom de la chose dont on déjeune, dîne, soupe, etc.: déjeuner de chocolat, dîner de cotelettes, souper de fruits. Cependant on peut aussi employer avec: il déjeune tous les matins avec du chocolat; déjeuner avec du beurre et des radis. (Acad. aux mots matin et radis.) Nous ferons remarquer du reste que de bons écrivains n'ont pas craint de dire déjeuner avec, etc., devant le nom de la chose mangée.
2. Il est à remarquer que l'u de déjeuner, s. ou v., n'est pas marqué d'un accent circonflexe, quoiqu'il soit formé de la particule de et du verbe jeûner. Prononcez déjeuner et non d'jeuner.
Délabrement, s. m., état délabré; l'a est long de même que dans encadrement et dans tous les autres mots où se retrouvent les syllabes abre, adre, avre. Voyez abre.
Délibérer, v. a.—Ne dites pas: ce soldat est délibéré du service; dites, est quitte, délivré, libéré du service.
Délice et Orgue sont masculins au singulier et féminins au pluriel: un grand délice, de grandes délices; un bon orgue, de bonnes orgues. Cependant ils sont masculins au pluriel lorsque dans une même phrase, ils s'emploient au singulier et au pluriel: un de mes plus grands délices était d'étudier; cet orgue est un des meilleurs que j'aie entendus et un des plus beaux que j'aie jamais vus.
Déloger et Découcher.—Déloger signifie quitter le logement, décamper; découcher veut dire, coucher hors de chez soi: il déloge à la fin du mois; je vous ferai bien déloger de là; depuis huit jours il a découché trois fois. Voyez découcher.
Demain.—On peut dire demain au matin et demain matin; mais cette dernière locution est préférable. (Acad.)
Demander, v. a.—Demander excuse est une expression incorrecte; dites, je vous fais, je vous offre, je vous présente mes excuses.
2. Ne dites pas: mon maître vous demande de venir; dites, vous prie de venir ou d'aller le trouver.
3. Ne dites pas: demander après quelqu'un ou après quelque chose; mais, demander quelqu'un, demander quelque chose.
4. Après demander, il faut que et non à ce que: je demande qu'on répare mon honneur, et non, à ce qu'on répare....
5. Demander, suivi d'un infinitif, régit les prépositions à et de, suivant le sens: la prép. à, lorsque l'action, exprimée par chacun des deux verbes est faite par la même personne: il demande à entrer; Philoclès demanda au roi à se retirer.—La prép. de, dans le cas contraire: je vous demande de m'écouter.
Déméfier (se), barb.; dites, se défier ou se méfier.
Démêler, v. a.—On ne dit pas, démêler les cartes, mais, mêler ou battre les cartes.
Demeurer, prend avoir quand il signifie: 1o habiter: il a demeuré trois ans à Bruxelles; il demeure dans telle rue (plutôt que, il reste); 2o tarder: il a demeuré longtemps en chemin; 3o employer plus ou moins de temps à quelque chose: il n'a demeuré qu'une heure à faire cela.—Rester prend également avoir dans le sens de séjourner: il a resté deux jours à Lyon. (Acad.) Dans tout autre sens, demeurer et rester prennent l'auxiliaire être: il est demeuré, il est resté mille hommes sur la place; elle est demeurée, elle est restée court, seule, veuve, etc.
Demi, ie, placé devant un substantif, reste invariable: une demi-heure, des demi bouteilles; il reste également invariable lorsqu'il entre dans la composition d'un mot: des demi-heures, des demi-lunes, des demi-tons, des demi-dieux, des demi-frères.—Placé après son substantif, il en prend le genre, mais il s'écrit toujours au singulier: deux kilo et demi, deux livres et demie.—Demi, demie s'emploient substantivement, le premier pour désigner une moitié d'unité, le second pour signifier demi-heure: quatre demis valent deux unités; cette pendule sonne les heures et les demies. (Acad.) Prononcez demi et non démi ni dèmi.
2. Deux heures et demie, deux heures et un quart; ne faites pas la liaison de l's finale du mot heures avec le mot suivant. Voyez liaisons affectées.
Demi-frère, s. m., celui qui n'est frère que du côté paternel ou du côté maternel; les expressions frère germain, frère consanguin et frère utérin ne sont guère usitées qu'en jurisprudence. (Acad.)
Démission, s. f.—Ne dites-pas: dès que j'aurai ma démission, je me retirerai à la campagne; dites, dès que j'aurai ma retraite, ma pension... La démission est l'acte par lequel on se démet d'une dignité, d'un emploi: démission volontaire, démission forcée; donner sa démission.
2. N'employez pas non plus le mot démission, dans le sens de destitution, qui est la privation forcée d'une charge, d'un emploi, etc.: prononcer la destitution d'un fonctionnaire.
Demoiselle.—Une dame, faisant allusion à ses jeunes années, dit ordinairement: quand j'étais demoiselle; il serait mieux de remplacer demoiselle par le mot fille; mais il est encore mieux de dire avant mon mariage, ou d'employer quelque tour analogue à celui-là. Voyez monsieur et époux.
2. Ne dites pas: comment se porte votre demoiselle (en parlant à son père ou à sa mère)? dites, comment se porte mademoiselle votre fille ou mademoiselle N.? Il en est de même des mots dame, madame, quand on s'adresse au mari.
Denier, s. m., petite monnaie; ne dites pas dernier à Dieu, mais denier à Dieu: prononcez de-nié et non dé-nié ni degnier.—Voyez ni.
Dénouement, dénouer, déjouer, jouer, etc.; prononcez dénoû-ment, dénou-er, déjou-er, jou-er, et non dénou-we-ment, denou-wer, déjou-wer, jou-wer.
Dent, s. féminin: une dent, de belles dents.
2. On dit très-bien d'un enfant, qu'il fait ses dents, qu'il fait des dents, pour signifier que les dents lui viennent. (Acad.)
3. Ne dites pas: j'ai les dents longues quand je mange du fruit vert; dites, j'ai les dents agacées, quand... ou bien, ces fruits m'agacent les dents... Voyez long.
4. Ne dites pas: se laisser tirer une dent; dites, se faire arracher une dent. (Fl.)—Prononcez dan et non dante.