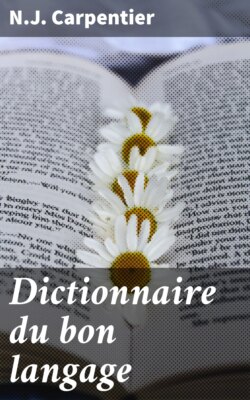Читать книгу Dictionnaire du bon langage - N.J. Carpentier - Страница 8
ОглавлениеAsme, Aspe, Asque (terminaisons en): faites sentir l's et l'm: cataplas-me, spas-me, enthousias-me, asth-me (as-me), jas-pe, cas-que, etc., et non cataplasse, spasse, enthousiasse, asse, jasse, casse, ni cataplam-se, enthousiam-se, am-se, ni cataplame, spame, enthousiame, etc. Il en est de même des terminaisons en isme: catéchisme, schisme, barbarisme.
Aspect, s. m.—Prononcez aspek; prononcez de même respect, suspect (respèk, suspek); abject se prononce abjekte. Voyez ct.
Aspergès, s. m., goupillon, prononcez aspergèce.
Aspic, s. m., petit serpent venimeux: prononcez aspik et non aspi. Voyez c final et broc.
Aspiral, pour la spirale ou le ressort spiral est une faute grossière; vous direz donc: la spirale de cette montre est cassée et non l'aspiral.
Aspirer.—On dit aspirer à quelque chose et non après quelque chose; il aspire aux honneurs et non après les honneurs.
Assassiner, Assassin, Assassinat:—prononcez assaciner, assacin, assacinat et non assaziner, assazin, assazinat, ni azaziner, azazin, azazinat.
2. Assassineur, pour assassin, n'est pas français.
Asseoir, v. a.—Indicatif présent: je m'assieds, tu t'assieds, il s'assied, nous nous asseyons, vous vous asseyez, ils s'asseyent; imparf.: je m'asseyais, etc.; fut.: je m'assiérai, etc.; je m'assiérais; assieds-toi, etc.; que je m'asseye, etc.; s'asseyant, etc. L'Académie reconnaît aussi pour bonne la conjugaison suivante: Je m'assois, tu t'assois, il s'assoit, nous nous assoyons, vous vous assoyez, ils s'assoient; je m'assoyais, etc.; je m'assoirai, etc.; je m'assoirais, etc.; assois-toi, assoyons-nous, assoyez-vous; que je m'assoie, etc.; s'assoyant.—Il s'ensuit que l'expression assoyez-vous est très-française.
Assez, doit toujours être placé devant le mot qu'il modifie; ne dites donc pas: j'ai mangé assez, j'ai du papier assez, je suis malheureux assez; dites: j'ai assez mangé, j'ai assez de papier, je suis assez malheureux. (Wall.)
2. Ne dites pas: il a eu assez avec cela; dites: il a eu assez de cela ou il en a eu assez.
3. Ne dites pas: il a été assez sot de se fâcher; dites: pour se fâcher. (Wall.)
4. Assez capable pour n'est pas français; dites capable de. Assez ne va pas bien avec capable, excepté quand cet adjectif n'est suivi de rien et qu'il est employé pour habile, intelligent, etc.: ainsi l'on dit: il est assez capable, c'est-à-dire assez habile.
5. On ne dit pas non plus capable pour, mais capable de; il est capable de tenir tête à trois hommes.
6. Assez suffisant, pour suffisant, est un pléonasme ridicule, ne dites donc pas: ce repas est assez suffisant pour dix personnes; le mot suffisant rend tout à fait l'idée; assez est de trop; dites ce repas est suffisant.
Assiette à soupe, signifie assiette propre à contenir de la soupe; assiette de soupe signifie une assiette qui contient actuellement de la soupe; il en est de même de verre à vin, pot à fleur, etc., et verre de vin, pot de fleur.—Prononcez a-ciette et non achette ni agette.
Assis.—Ne dites pas: soyez assis, mais asseyez-vous ou assoyez-vous; ne dites pas non plus se mettre assis pour s'asseoir.
Assister signifie donner quelques secours, secourir, par exemple, à un mendiant; mais il ne se dit pas dans le sens d'aider quelqu'un à faire quelque chose; vous ne direz donc pas: assistez-moi à porter ce fardeau, mais aidez-moi à...
Assomption, s. f., fête catholique: prononcez le p, assomp'cion et non assom'-cion.
Assujettir, Assujettissement: prononcez as'sujétir, as'sujétissement.
Assurer, v. a.—Assurer une chose à quelqu'un, c'est affirmer, certifier cette chose: il leur assura que le fait était vrai. Vous ne direz donc pas: je les ai assurés que mon père était malade, mais je leur ai assuré...—Assurer quelqu'un d'une chose, c'est engager quelqu'un à regarder cette chose comme certaine, à y croire; assurez-le de mon respect, de mon dévouement; vous pouvez l'assurer que je prendrai en mains ses intérêts.
2. S'assurer, avec les prépos. dans, en, signifie établir sa confiance: il faut s'assurer en Dieu; malheur à celui qui ne s'assure que dans ses richesses. (Acad.)
3. S'assurer de quelqu'un, c'est s'assurer de sa protection, de son suffrage; il signifie aussi arrêter, emprisonner: assurez-vous de cet homme.
4. S'assurer d'une chose, c'est s'en procurer la certitude ou simplement se procurer cette chose, s'en rendre maître.
Astérisque (étoile qui indique un renvoi) est masculin et se prononce astériske et non astérisse: un astérisque indique un renvoi. Voyez t final.
Asthme, s. m., maladie de poitrine, courte haleine: prononcez asme et non amse;—asthmatique, prononcez asmatique. Voyez asme.
At (terminaison en): voyez t final.
Ation (terminaison en): voyez asion.
Atlas, s. m.: prononcez atlâce: le mont Atlas, un atlas de géographie. V. s finale.
Atmosphère est un subst. féminin: atmosphère chargée de vapeurs.
Atome, s. m. (o sans accent circonflexe), corpuscule: prononcez atôme (ô long).
Atteindre, v. a.—Si le complément de ce verbe est un nom de personne, ce complément est toujours direct: atteindre son ennemi; atteindre ceux qui marchent devant; il osait se flatter d'atteindre Racine.—Si c'est un nom de chose, le complément est direct ou indirect, suivant le sens du verbe.—1o Atteindre, signifiant parvenir à un terme dont on était plus ou moins éloigné: nous atteindrons ce village dans la nuit; nous partîmes en même temps, mais j'atteignis le but avant lui; et au figuré: nous atteignons enfin le terme de nos souffrances; atteindre l'âge de raison; atteindre son but, réussir dans ce que l'on s'est proposé.—2o Atteindre, signifiant toucher à une chose assez éloignée pour qu'on ne puisse y arriver sans effort: atteindre au plancher; atteindre au but; et au figuré: atteindre à la perfection; atteindre au sublime.
Atteinte, s. f.—Ne dites pas une atteinte d'apoplexie, mais une attaque d'apoplexie.
Attelée, s. f., n'est pas français; dites un attelage: il lui manque un cheval à son attelage.
Atteler, v. a.—Ne dites pas: il faut atteler le chien; dites il faut attacher... Atteler signifie attacher à une voiture.
Attendre après quelqu'un se dit très-bien. (Acad.)
Attention, s. f.—Dites avoir, faire, prêter attention, et non prendre, donner attention. (Fland.)
Au.—Au a le son de o bref devant la lettre r: j'aurai, tu sauras, il aura, nous saurons, aurore, Aurillac, Centaure, Laure, etc.; prononcez j'orai, tu soras, il ora, nous sorons, orore, Orillac, Centore, Lore. Il n'y a point d'exception à cette règle: vaurien se prononce vôrien, parce que ce mot doit être pris pour une contraction de vaut rien; Beaurevoir, Beauregard, Maurepas, et autres noms propres semblables, n'ont aussi l'au long que pour une raison analogue.—Au a le son de o bref au commencement des mots devant g guttural ou la syllabe to: augmenter, augurer, augural, autographe, autocrate, autorité, autoriser, Auguste, etc.—Il en est de même devant l'articulation composée st: austral, austère, austérité, holocauste, causticité, caustique, Austerlitz, Austrasie, etc.—Enfin il est encore bref, par exception, dans les mots suivants: auberge, aubergiste, audace, audience, aulique, aumône, auspice, autel, authentique, auxiliaire, cauchemar, cauchois, fauteuil, glauber, mauvais, mauviette, naufrage, paupière, rauque, épaulette (mais non épaule); ajoutons les noms propres Sainte-Aulaire, Ausche, Auvergne, Caulaincourt, Paul, Waux-Hall; les dérivés suivent la même prononciation.—Pourceaugnac a aussi l'au bref. (Hennebert.)
Auberge est du féminin: une bonne auberge.
Aucun et Nul se mettent au pluriel: 1o lorsqu'ils sont joints à un nom qui n'a pas de singulier: aucuns frais, nuls frais; 2o lorsque le substantif auquel ils sont joints, a, au pluriel, une signification particulière: on ne lui a rendu aucuns devoirs, c'est-à-dire, on ne lui a fait aucunes funérailles; vous n'avez aucuns soins, nuls soins pour vos parents, c'est-à-dire point d'attentions pour eux; ce domestique ne reçoit aucuns gages, nuls gages, c.-à-d., ce domestique ne gagne aucun salaire, n'a point de gages.—Aucuns, d'aucuns s'emploient dans le style naïf et badin pour quelques-uns: aucuns ou d'aucuns croient que je l'ai fait de propos délibéré. (Acad.)
Augmenter. Ne dites pas: les grains, les vins augmentent tous les jours, pour exprimer qu'ils sont à la hausse; dites: le prix des grains, des vins, augmente, s'élève, etc. Voyez diminuer.
Aujourd'hui.—On peut dire: on a remis l'affaire à aujourd'hui; jusqu'aujourd'hui ou jusqu'à aujourd'hui. (Acad.) Prononcez aujourd'hui et non aujourd'houi ni aujord'hui.
Aumône, s. f. Prononcez ômône (les deux ô longs). Plusieurs grammairiens prononcent omône (le 1er o bref).
Aune, arbre (quelques-uns écrivent aulne), est du masculin; aune, mesure, est du féminin.
Auparavant est adverbe: il ne peut donc avoir de régime comme avant, qui est préposition. Ne dites donc pas: auparavant de partir; je suis arrivé auparavant les autres, mais, avant de partir; je suis arrivé avant les autres. Mais vous direz très-bien: il avait reçu auparavant des lettres de son père; je suis arrivé longtemps auparavant, parce qu'ici il est adverbe.
Auprès de, Au prix de, Près de: voyez prix.
2. Ne dites pas: je demeure auprès de la place St-Lambert; dites ... près de la place St-Lambert.
Auspice, présage, protection, est du masculin; j'ai commencé sous d'heureux auspices: prononcez ospice (o bref).
Aussi... Comme, pour aussi... que: cette maison-ci est pour le moins aussi belle comme la vôtre; dites: aussi belle que la vôtre. (Fland.)
2. Aussi pas.—Vous n'êtes pas riche et moi aussi pas; je ne l'ai pas fait aussi; dites: ni moi non plus; je ne l'ai pas fait non plus. (Fland.)
Aussitôt, adv.: Ne dites pas: il est parti aussitôt vous; je partirai aussitôt la diligence arrivée, votre lettre reçue; dites: il est parti aussitôt que vous; je partirai dès que la diligence sera arrivée, dès que j'aurai reçu votre lettre ou aussitôt après l'arrivée de la diligence, après la réception de votre lettre.
Automne est du masc. et du fém., mais plus souvent du masculin: un automne sec; prononcez otone; mais dans autom-nal, faites sentir l'm.
Autour, prép.: voyez alentour.
Autre.—Rien d'autre est une locution vicieuse; dites: rien autre, rien autre chose, pas autre chose.
2. Monsieur est-il ici?—Oui.—N'y a-t-il personne d'autre? c'est encore une mauvaise locution; dites: n'y a-t-il point d'autre personne, personne autre, nul autre, aucun autre.
3. Ne dites pas non plus: quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre; dites: quelque autre, quelque autre chose; adressez-vous à quelque autre personne ou à quelque autre;—c'est autre chose que j'exige.
4. Ne dites pas: je l'ai trouvé tout autre que je pensais; dites ... que je ne pensais.
5. Nous autres, vous autres. En espagnol, nous et vous sont toujours suivis de autres, même dans la conjugaison: nous autres aimons; vous autres aimez; nous autres parlerons, vous autres parlerez, etc. Il en est à peu près de même en wallon où l'on fait également, surtout dans certains dialectes, un trop fréquent usage de ces expressions. Le génie de la langue française n'autorise l'usage de ces expressions que dans des cas assez rares, et seulement lorsqu'on veut exprimer une opposition à d'autres personnes dont on vient de parler, ou insister particulièrement sur les mots nous, vous: Je m'en vais me promener; vous autres, vous irez étudier; nos professeurs nous ont recommandé de bien étudier; nous autres (les élèves paresseux), nous préférons de nous amuser; les anciens ont cru que le soleil tournait autour de la terre; nous autres, nous croyons que c'est la terre qui tourne autour du soleil.—Les Wallons ne sauraient trop se mettre en garde contre l'usage impropre ou vicieux de ces locutions.
Auxiliaire, s. m., prononcez okcilière, (o bref) et non augziliaire.
2. Plusieurs verbes prennent tantôt avoir et tantôt être, selon qu'ils expriment principalement une action ou principalement un état, en d'autres termes, selon que l'on peut faire les questions: qu'a-t-il fait? ou bien qu'est-il devenu, qu'est-il, où est-il maintenant? Ainsi on dit avec avoir et avec être: sa fortune a augmenté rapidement et sa fortune est augmentée du double;—le prix du pain a encore baissé hier et le prix du pain est baissé;—la fièvre a cessé à minuit et la fièvre est cessée depuis hier;—le vent a changé tout à coup et le vent est changé;—les eaux ont crû rapidement et les eaux sont crues;—ce billet a échu hier et ce billet est échu depuis hier;—sa maladie a beaucoup empiré en peu de temps et sa maladie est bien empirée;—son bail a expiré à la St-Jean et son bail est expiré;—cet enfant a bien grandi en un an et cet enfant est bien grandi;—le baromètre a monté lentement et le baromètre est monté;—il a monté quatre fois à sa chambre pendant la journée et il est monté à sa chambre depuis une heure;—son fusil a parti tout à coup (Acad.) et il est parti pour Paris;—la procession a passé dans notre rue et la procession est passée depuis une heure;—il a sorti mais il vient de rentrer (Acad.) et il est sorti mais il va rentrer;—les poètes disent que Vulcain a tombé du Ciel pendant un jour entier (Acad.) et elle releva son enfant qui était tombé.—Les exemples que nous citons ici de l'Académie, ne sont pas à imiter, attendu qu'ils nous paraissent être de véritables exceptions.—On construit également avec avoir ou être les verbes camper, débarquer, décroître, dégénérer, diminuer, échouer, embellir, enlaidir, grossir, hausser, vieillir, etc.
Avant, Devant.—Avant, se dit du temps: je suis parti avant vous;—devant se dit du lieu, de la situation: placez-vous devant votre condisciple, devant cette porte.
2. Ne dites pas: avant que je parte, j'irai vous voir; dites: avant de partir...
3. Avant que, d'après l'Académie, n'est jamais suivi de la négative: j'irai le voir, avant qu'il parte; sauvons-nous avant que l'orage vienne; et non avant qu'il ne parte, avant que l'orage ne vienne.
4. Ne dites pas: avant que faisiez-vous; dites auparavant, autrefois, avant cette époque, etc.: avant, étant préposition, doit toujours être suivi d'un complément.
Avant de, Avant que de.—On dit avant de ou avant que de: avant de venir, ou avant que de venir, (Acad.); les athlètes se frottaient d'huile, avant que de lutter. (Id.) Ajoutons pourtant que avant de est préférable, et que avant que de nous paraît suranné.
Avant-hier.—Beaucoup de personnes prononcent mal ce mot: l'h d'hier étant muette, on doit faire sonner le t, et prononcer avan-t-hier, et non avan-hier, encore moins avan-z-hier; prononcez de même dès hier, (dè zière); cependant dans la conversation on peut dire avan-hier.
Avec, est une préposition qui demande un régime; c'est donc une faute de dire: Je m'en vais à Liége, venez avec; dites: venez avec moi.—Cependant l'Académie admet dans le langage familier avec sans régime: il prit mon manteau et partit avec.
2. C'est encore à tort que l'on donne à avec le sens de aussi; ne dites donc pas: mon frère a bien réussi dans ses concours et moi avec; dites: et moi aussi. (Wall.)
3. Avec ne peut pas non plus s'employer pour de: ne dites pas: que puis-je faire avec ces livres; dites: de ces livres. (Wall.)
4. Ne dites pas: avec qui parliez-vous? dites: à qui parliez-vous? (Wall.)
5. Ne dites pas: j'ai eu une maladie de cœur, j'ai beaucoup souffert avec; dites: j'en ai beaucoup souffert.
6. Ne dites pas: il est dur avec les pauvres, mais ... envers les pauvres.
7. Ne dites pas: vous vous ferez des ennemis avec vos plaisanteries; mais ... par vos plaisanteries. (Wall.)
8. Ne dites pas: je suis ami avec lui; dites: je suis son ami. (Wall.)
9. Ne dites pas: voilà les compagnons que je suis venu avec; dites ... avec lesquels je suis venu. (Wall.)
10. Ne dites pas: j'ai bien ri avec cet homme, avec cette aventure;—il vit avec le produit de sa ferme;—il est parti avec le premier convoi, avec la diligence;—dites: j'ai bien ri de cet homme, de cette aventure;—il vit du produit de sa ferme;—il est parti par le premier convoi, par la diligence. (Wall.)
11. Ne dites pas: cet élève est entré au séminaire avec une année de philosophie; dites ... après une année. (Wall.)
12. Content avec cela; fâché avec cela; dites: je suis content de cela, fâché de cela, ou bien, j'en suis content, j'en suis fâché.
13. Ne dites pas: il est parti avec une pluie battante; dites ... par une pluie battante.—On dit également: par le temps qui court.
14. Ne dites pas: il va avec ceci comme avec cela; dites: il en est de ceci comme de cela. (Fland.)
15. Ne dites pas: je ne me mêle pas avec cela, dites ... de cela. (Fland.)
16. Ne dites pas: prendre quelqu'un avec le collet; dites ... au collet, par le collet. (Fland.)
17. Avec ce temps-là: ne dites pas: vous serez enrhumé avec ce temps-là; dites ... par ce temps-là. (Fland.)
18. Ne dites pas: j'ai fait acheter ce livre avec le messager; dites ... par le messager. (Fland.)
19. Notez cependant que l'on peut dire indifféremment: déjeuner, dîner, souper d'un poulet ou avec un poulet; de radis ou avec des radis. (Académie, aux mots matin et radis.)
20. Prononcez avek et non avè; avec nous (avèk' nous) et non avè nous.
Aveine, Avoine.—On dit l'un et l'autre; avoine, (prononcez avo-anne), est plus en usage.
Aveuglement, s. m., cécité.—Aveuglément, (avec accent aigu) adverbe, à l'aveugle ou en aveugle: qui agit aveuglément ne peut pas voir; il est frappé d'aveuglement.—Aveuglement, perte de la vue, ne s'emploie plus aujourd'hui au sens propre; on dit cécité: il a été frappé de cécité par la foudre.
Avis, s. m.—Prononcez avi et non avice devant une consonne, et avize devant une voyelle: avis au public.
Avoir.—Il y a. Évitez de le multiplier, au commencement des mots, à la manière des enfants: il y a Pierre qui m'a frappé; il y a Paul qui m'a poussé, etc.; dites simplement: Pierre m'a frappé, Paul m'a poussé.—Prononcez comme c'est écrit et non igna, ignia.
2. Ne dites pas: mes frères veulent avoir que cet événement soit arrivé telle année; dites: mes frères prétendent, soutiennent... (Wall.)
3. Ne dites pas: mon maître en a toujours sur moi ou à moi; dites: mon maître m'en veut, me gronde toujours. (Wall.)
4. Ne dites pas: j'ai eu ce livre à un tel; dites: d'un tel.
5. Avoir bon.—Voyez le mot bon.
6. Avoir, impersonnel, s'emploie mal avec un verbe impersonnel; ne dites pas: il n'y a qu'à pleuvoir, qu'à neiger, etc.; dites: s'il vient à pleuvoir, à neiger. (Wall.)
7. Ne dites pas: quelle heure avons-nous? nous avons trois heures; dites: quelle heure est-il? il est trois heures.—Mais on dira bien: quelle heure avez-vous? pour demander quelle heure il est à votre montre.
8. Ne dites pas: nous avons aujourd'hui le dix; dites: c'est aujourd'hui le dix.
9. Avoir peu de chose à dire chez soi: dites: avoir peu d'autorité, peu de pouvoir. (Wall.)
10. Ne dites pas: je vous redois dix centimes.—Oh! je les aurai bien une autre fois; dites: vous me les donnerez une autre fois.
11. Ne dites pas: l'élève qui n'aura pas eu ses devoirs, sera puni; dites: qui n'aura pas fait, qui n'aura pas apporté ses devoirs.
12. Avoir une chose dans l'œil, pour: voir une chose, est un flandricisme; dites: j'ai l'œil sur lui, là-dessus, je le surveille.
13. Ne dites pas: voilà une jolie montre; combien vous coûte-t-elle?—Je l'ai eue; dites: on m'en a fait cadeau.
14. Pour l'emploi de l'auxiliaire avoir et être, voyez le mot auxiliaire.
15. Avoir de quoi, être riche ou dans l'aisance. (Acad.)
16. Vous en aurez, vous serez châtié, maltraité. (Acad.)
17. Je l'aurai, je saurai bien l'avoir, se dit en parlant d'une personne dont on espère se venger; cette manière de parler vieillit. (Acad.)—Voyez ravoir.
18. Contre qui en a-t-il, en avez-vous? c'est-à-dire, contre qui est-il, êtes-vous fâché, en colère? On dit aussi: à qui en a-t-il? (Acad.)
19. Mais à qui en a-t-il, à qui en avez-vous, en avez-vous à moi, dans le sens de: à qui parlez-vous, etc., sont des barbarismes.
Avoir l'air.—L'adjectif ou le participe qui suit avoir l'air, s'accorde avec air ou avec le sujet de la proposition.—Il s'accorde avec air, si la qualité qu'il exprime peut convenir au mot air: la tuile a l'air plus gai que le chaume; cette fille a l'air hardi; cette femme a l'air hardi; cette femme a l'air méprisant: on peut dire d'un air, d'un extérieur, qu'il est gai, hardi, méprisant.—Mais il s'accorde avec le sujet de la proposition, lorsqu'il exprime une qualité qui ne peut convenir au mot air; on dit: elle a l'air contente; ils ont l'air fâchés; cette viande a l'air d'être fraîche; ces légumes n'ont pas l'air d'être cuits. (Acad.) Parce qu'on ne peut pas dire d'un air qu'il est content, fâché, frais, cuit.
Avre, Avrer ont toujours l'a long: cadavre, navrer.
Avril, 4e mois de l'année: prononcez avrille (l mouillée); prononcez de même baril, péril. Voyez l mouillée.
Ayant, part. prés.—Prononcez, ai-iant et non a-yan: l'y ici représente deux i qu'il faut faire sentir comme dans: royal, moyen, citoyen, etc.
Aye, que j'aye: écrivez avec un i simple: on ne met pas d'y devant un e muet. Voyez ai, aie.
Axiome (o sans accent circonflexe), s. m., vérité, maxime évidente par elle-même; prononcez axiôme (ô long). Voyez o.