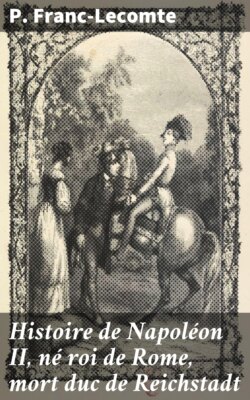Читать книгу Histoire de Napoléon II, né roi de Rome, mort duc de Reichstadt - P. Franc-Lecomte - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
ОглавлениеTable des matières
Jusqu’ici la vie du fils de l’empereur s’est trouvée liée à notre histoire; désormais, cachée au fond du labyrinthe de la politique autrichienne, elle ne pourra nous être révélée que par le zèle opiniâtre de quelques Bonapartistes, demeurés fidèles au souvenir de notre gloire et de notre puissance nationale. Je m’aiderai surtout de renseignements précieux: ils me seront fournis par un capitaine de la vieille garde, parvenu, après des efforts inouïs et grâce à une généreuse patience, à se fixer non loin de la prison dans laquelle on devait ensevelir la plus grande espérance de l’empire. Son récit commence au moment où il vient d’apprendre qu’une nièce de Napoléon Ier est arrivée à Vienne, deux mois après la révolution de juillet 1830. A cette époque, malgré l’avénement au trône d’un membre de l’ancienne famille des Bourbons, tout espoir ne s’était pas encore éteint dans les cœurs des patriotes: pouvaient-ils donc rêver la liberté sans la gloire impériale? On s’était souvenu du vote universel qui avait investi le père de l’autorité souveraine, et de la proclamation spontanée qui avait, lors des revers et des mécomptes de 1815, appelé Napoléon II à s’asseoir à son tour sur le trône constitutionnel. Ce vote et cette proclamation revivaient dans la mémoire d’un grand nombre, et le fils de l’empereur n’était pas mort... La Fayette, ce malencontreux agitateur des cent jours, allait sans doute faire amende honorable de toutes ses erreurs politiques. On semblait enfin comprendre en France que la dynastie nouvelle demandait un nom nouveau, mais déjà bien cher par de glorieux antécédents.
Écoutons le récit de ce vétéran de l’empire, aussi distingué par sa haute instruction que par son fidèle courage. En apprenant à la comtesse Napoleone Camerata toutes les particularités de la vie douloureuse du prince, son bien-aimé cousin, il nous révèlera l’étendue de son dévouement et une partie du mystère dont la politique a trop longtemps entouré le malheureux successeur de Napoléon-le-Grand:
— «Le 2 septembre 1850, vers six heures du soir, comtesse, vous traversiez le parc de Schœnbrunn. Je travaillais non loin de l’allée que vous parcouriez, en face de la Gloriette. Je crus, au milieu de votre conversation fugitive, entendre prononcer un nom qui a toujours agité les fibres de mon âme. Je regarde, et je suis vivement frappé de l’expression de votre figure....... Quelle ressemblance avec le fils, et surtout avec le père!!... Je suis pourtant loin de soupçonner que je vois la fille d’Élisa Bacciochi. J’avais fait la part de l’illusion toujours attachée à des souvenirs magiques. Mais les quelques mots recueillis par mon avide curiosité m’ont trop ému, pour que je ne cherche pas à connaître les personnes qui semblent prendre intérêt à une malheureuse famille... — Au moment où je quittais mes travaux, vous quittiez aussi le parc impérial. Mon parti n’est pas douteux: je prends à l’instant la résolution de vous suivre jusqu’à votre demeure, autant que le permettrait la rapidité de vos chevaux. Vingt fois je perds de vue votre calèche, vingt fois assez heureux je me retrouve sur votre passage. Enfin je vous vois entrer rue de Carinthie, hôtel du Cygne. Le lendemain je reviens avec le costume dont je me sers quand je veux déjouer la police; j’entre, je m’informe, je parviens, le soir, jusque dans votre appartement. Vous étiez seule quand je fus introduit auprès de vous. Je suis toujours frappé de la même ressemblance; je ne doute plus que je ne sois en présence de l’une des nobles filles de la famille Bonaparte; et, sans plus calculer les suites de ma démarche, je vous adresse la parole en français. Je savais que ce talisman devait me perdre ou me recommander à votre faveur. Je ne m’étais pas trompé. A mon accent, vous vous retournez, vous vous précipitez vers moi: Oh! vous êtes de la patrie des braves! vous écriez-vous..... Je vois en vous un serviteur dévoué à la cause nationale.
— » Maintenant, madame, vous voulez savoir ce qui se rattache à une existence justement chère à tous. Je dois comprendre votre impatient empressement, et pourtant, avant de vous parler de lui, il est nécessaire que je vous entretienne de moi: instruite de mon passé, vous pourrez du moins savoir jusqu’où vous devez compter sur mon dévouement pour l’avenir.
— » Vous étiez encore bien jeune, quand, deux fois trahi par quelques lâches, Napoléon Ier se crut forcé d’abdiquer deux fois le pouvoir, au grand mécontentement de l’armée, qui aurait voulu, qui pouvait encore avantageusement combattre pour l’empire. Lorsque, foulant aux pieds toute bonne foi, l’Angleterre lui donna des fers au lieu de l’hospitalité demandée et promise, j’aurais été fier de partager la captivité de notre empereur; mais, hélas! j’ai été, comme tant d’autres, privé de cet insigne bonheur! Je ne voulais pas consacrer mes services à la royauté de l’étranger: je pris aussitôt le parti de quitter la France, pour servir la patrie; car la patrie des braves n’était plus désormais que sur le rocher de Sainte-Hélène, ou dans la prison de Schœnbrunn. Mais comment m’établir à Vienne sans éveiller les soupçons?
» Aux jours heureux de l’empire, une de mes sœurs s’était mariée dans le Tyrol à un sujet de l’Autriche. Désirant ne pas me séparer d’elle, j’avais fait consentir son mari à se rapprocher de moi: il s’était établi à Strasbourg. En 1814, après le départ de Napoléon Ier pour l’île d’Elbe, ma sœur était veuve, quand j’apprends que le jeune prince doit être élevé à la cour de François. II. Je n’avais pu suivre l’empereur, personne désormais ne m’empêchera d’accompagner son fils. Mon beau-frère était mort des suites de plusieurs blessures qu’il avait reçues dans une lutte violente avec des soldats de l’armée étrangère, lors du retour. Je couvre son cadavre de mes habits d’officier; et, dans le tumulte de l’invasion, il m’est facile de faire consigner mon décès sur les registres de l’état civil. Ma sœur a compris ma pensée. Grâce à ce stratagème, je passe facilement pour son mari et pour le père de sa fille encore au berceau. Je demande à rentrer en qualité de sujet tyrolien dans les états de l’empereur d’Autriche. Des passe-ports me sont accordés; toutefois, au lieu de retourner dans la ville natale de mon beau-frère, je fixe d’abord ma demeure dans un village sur les bords du Tagliamente. J’aurais pu dès les premiers jours de ma transmigration me diriger du côté de Vienne; mais n’y aurais-je pas attiré bientôt les regards de la police sur moi?
» Mon beau-frère, avant de passer en France, avait exercé le métier de jardinier: je devais donc pour ma sûreté acquérir un peu d’habileté dans cette nouvelle profession que j’embrassais. J’avais des connaissances en botanique; il ne me fut pas difficile, grâce à mon habitude de supporter la fatigue, de parvenir au but de mes désirs.
» Cette résolution n’a rien d’extraordinaire. Je connais un grand personnage de l’empire qui fut obligé, malgré son immense fortune, de se faire ouvrier imprimeur, pour se soustraire aux inquisitions de la Sainte-Alliance, pendant les premières années de la Restauration. A vingt-quatre ans il était ambassadeur du roi Louis XVI dans cette même Allemagne où il s’est vu longtemps soumis à une dure nécessité... — Incarcéré par la terreur, il avait failli périr victime de l’anarchie, comme plus tard il se dérobait avec peine aux poursuites de l’absolutisme.....
» En 1817 je quitte les états vénitiens pour passer dans la Carniole, où je vais tenter de m’établir à Trieste. J’étais assez riche pour acquérir une petite propriété ; mais je ne voulais pas me lier au sol. Je cherchai à me placer dans la maison d’un seigneur autrichien; ce qui ne me fut pas difficile en ma qualité de sujet tyrolien.
» J’étais toujours loin de Vienne: je voulais y entrer sous la protection de quelque grand de la cour; je ne pouvais mieux réussir qu’en restant au service de mon premier maître. Il devait, après deux ans de séjour à Trieste, retourner dans la capitale des états autrichiens, pour ne plus la quitter. C’était bien long; mais j’avais depuis des années fait l’apprentissage de la patience....... Enfin, dans le mois de mai 1819, le comte N*** est rappelé à la cour, où il doit occuper une place importante. Quelle ne fut pas ma joie quand j’appris notre prochain départ!... Je pourrais bientôt sinon voir le fils de mon empereur, du moins en avoir des nouvelles positives!
Me voilà donc, moi ancien capitaine de la vieille garde, installé dans un château de Meidling, jardinier aux gages d’un comte autrichien!..... Pouvais-je même songer à la plainte? Quels plus grands maux ne devaient pas souffrir d’autres victimes!....
» Ma vie de dévouement obtenait déjà une douce récompense: je vivais entouré des soins et de l’amitié de ma sœur, dont je voyais grandir la fille, depuis longtemps habituée à aimer en moi son père: j’en avais tout l’amour pour elle; aussi me chérissait-elle comme elle eût fait de l’auteur de ses jours. Je ne devais pas rester longtemps sans inquiétude sur mon avenir, sur celui de la petite famille que je m’étais donnée. Soit dérangement dans sa fortune, soit une autre cause, le comte N*** fut obligé de vendre ses propriétés et de congédier tout son domestique. Cependant cette nouvelle épreuve devait amener pour moi un heureux changement: en me congédiant, le comte N***, content de mon zèle et de ma fidélité , me recommande au jardinier du château de Schœnbrunn, où j’entre aussitôt en qualité d’ouvrier. Dès ce moment je fus heureux; j’avais le certitude de voir de près le fils de mon empereur.
» Je travaillais depuis plusieurs mois dans le parc impérial, et je n’avais pas encore eu le bonheur de contempler les traits du duc de Reichstadt, qui était toujours pour moi le roi de Rome, l’héritier de la couronne de France..... Je n’ai jamais été maître de mon imagination sur ce point.
» Je n’osais pas questionner les autres ouvriers, dans la crainte de me trahir par mon émotion. D’ailleurs on parlait quelquefois en ma présence, trop peu, il est vrai, selon mes désirs, assez néanmoins pour me fournir d’utiles renseignements sur ce prince bien-aimé.
» Nous étions au mois d’avril 1820; il avait accompli sa neuvième année. On ne saurait s’imaginer ce qui fut tenté pour l’isoler de tout souvenir de France; sa mémoire opiniâtre avait triomphé des efforts. En vain la Sainte-Alliance avait éloigné, un à un, les Français attachés à sa personne; en vain elle avait essayé de lui faire oublier jusqu’à sa langue maternelle; ce caractère, d’une énergie étonnante dans un enfant, avait désespéré ceux qui voulaient, soit amour, soit politique, le détacher de tout sentiment, de toute sympathie pour le pays qu’il était destiné autrefois à gouverner. Il n’était bruit dans Vienne que de l’assassinat du duc de Berri. Cette nouvelle était même parvenue aux oreilles du prince, auquel on n’avait pas craint de la redire, toujours dans le but d’exciter sa haine contre ces Français indignes de son attachement. Son amour fut encore plus fort.
— » Ceux qui ont tué le duc de Berri, s’était-il écrié, sont les mêmes qui ont trahi mon père!...»
» Cette exclamation avait dû surprendre les gouverneurs qu’on lui avait donnés. Le comte de Dietrichstein, auquel François Il avait confié la direction de son éducation, en fut aux abois, et sa bonhomie germanique en demeurait alarmée. M. de Foresti, son gouverneur militaire, et M. Collin, chargé spécialement de l’instruction littéraire, avaient partagé l’étonnement et les appréhensions du noble seigneur. On en référa à l’empereur, qui aimait tant son petit-fils, et au prince de Metternich, le dernier et le plus ferme soutien de la monarchie absolue en Europe. C’en était donc fait. on ne pouvait plus conserver l’espoir d’imposer au fils de Marie-Louise l’oubli de sa glorieuse naissance: il fallait désormais se résigner. On prit dès lors le parti de répondre à son avide curiosité sur tout ce qui se rapportait à cette époque: on fit plus, on alla au-devant de ses questions: on lui traça l’histoire de Napoléon, à la manière de Metternich.
— » Ce sont les mêmes qui ont trahi mon père!..... Quelle vérité profonde sortie de la bouche de cet enfant! Non, le coup n’avait pas été porté par une main patriote. L’assassin n’avait pas été recruté dans ces braves et nobles phalanges de la vieille armée. Des bouches intéressées n’ont pas craint d’accuser les libéraux; et ici le mensonge n’était pas aussi flagrant peut-être, pour nous surtout, hommes de 1830, qui avons pu apprécier la composition de ce qu’on appelait le libéralisme. Là se trouvaient deux partis bien distincts: les francs libéraux, c’est-à-dire les vrais patriotes, ceux qui ne voulaient ni les orgies de 93, ni l’infamie de 1814 et 1815, et les faux libéraux, c’est-à-dire cette horde d’obscurs hypocrites qui avaient, dans l’ombre et dans tous les temps, conspiré contre le malheureux héritier de Louis XV et de son trône corrompu; contre la révolution, pour la faire tourner au profit de leurs passions; contre le consulat, contre l’empire, dans la rage que leur inspiraient la gloire consulaire et la puissante majesté impériale; contre la restauration, dans le désespoir d’un égoïsme trompé, d’une ambition qui voyait ajourner, peut-être pour longtemps encore, l’accomplissement d’antiques désirs. Mais laissons toutes ces distinctions devenues presque inutiles, grâce aux sévères enseignements livrés à nos méditations par l’histoire de chaque jour. La Restauration régnait appuyée sur le crime et la honte: l’assassinat commençait à l’ébranler..., l’assassinat, auquel le patriotisme français n’a jamais eu recours. — L’enfant exilé du trône jugeait donc bien le peuple dont il fut toujours aimé.
» Dès les premiers jours de son exil, le roi de Rome a protesté partout, comme aux Tuileries, contre la force brutale qui le dépouillait de sa couronne. Lors même du voyage de Rambouillet à Vienne, son imagination de trois ans se reportait aux souvenirs de l’empire. En vain entendait-il dans les états autrichiens les acclamations qui l’accueillaient lui et sa mère, rien ne pouvait le distraire de sa pensée dominante.—«Tout cela est fort beau; mais
» je vois bien que je ne suis plus le roi de Rome... Je n’ai
» plus de pages»
» Toute la France sait qu’après le retour de l’île d’Elbe, une conspiration s’était formée pour enlever le jeune prince à la politique de la Sainte-Alliance, et le rendre à l’amour des Français et aux embrassements de son père. Ce projet, après avoir échoué comme tant d’autres, par la trahison, encore trop enracinée dans les mœurs de l’Europe, fut démenti par le gouvernement du prince de Metternich. — «C’était une fiction calomnieuse, disait-on: jamais on n’avait découvert un pareil complot: il n’avait existé que dans l’imagination des Bonapartistes exagérés.» —Malgré ces dénégations si positives, il n’en reste pas moins avéré que la séparation du prince et de madame de Montesquiou coïncide parfaitement avec cette époque. Cette découverte est confirmée par le renvoi successif des fidèles serviteurs français. Nul d’entre eux n’aurait jamais voulu quitter le malheureux mais bien-aimé duc de Reichstadt. On ne niera pas la douleur de la noble gouvernante du roi exilé, quand il fallut lui dire un éternel adieu... Et cependant madame de Montesquiou retournait en France, au sein de sa famille, qui la chérissait! On attribue ce sentiment au seul amour que l’enfant-roi avait inspiré par son amabilité et surtout par son malheur: — oui, le dévouement doit aussi honorer cette femme et ces serviteurs; mais, je le répète, tous furent forcés de quitter le royal orphelin, sur lequel leur sollicitude aurait voulu veiller bien longtemps encore.
» A quatre ans et demi, on l’entoure d’un rempart vivant: sous le prétexte de lui donner des gouverneurs, on impose à son enfance des geôliers titrés, des gardiens vieillis dans le métier des armes. Son éducation, ou plutôt sa surveillance, est dès lors confiée au noble comte de Dietrichstein, ancien adjudant général dans les campagnes de Belgique, d’Allemagne et d’Italie, et au capitaine de Foresti, qui était sorti de l’Académie du génie à Vienne, en qualité d’enseigne. On leur adjoignit, comme gouverneur, Matthieu Collin, frère du célèbre poëte Henri Collin. Ces noms, s’il faut en croire les rapports parvenus jusqu’à nous, n’avaient rien que d’honorable; cette mesure n’en était pas moins prématurée. Donner à un enfant de quatre ans et demi un conseil d’instruction, étayer ses premiers pas de la haute surveillance d’un vieux guerrier, forcer ce dernier d’abandonner les fonctions de chambellan du roi de Saxe, c’était assez justifier les bruits de complot. On avait craint de les accréditer en imposant au prince une gouvernante autrichienne à la place de madame de Montesquiou: s’imagine-t-on les avoir atténués en devançant l’âge auquel les enfants de la famille impériale reçoivent une instruction sérieuse?
» On prétexte la précoce intelligence du jeune duc, et plus tard, tout en reconnaissant ses grandes facultés, on semble douter de la vivacité de son esprit..... C’est que plus tard on a besoin d’oublier; aujourd’hui il faut colorer une mesure extraordinaine, et on lui a trouvé fort à propos des dispositions au-dessus de son âge..... Les gouverneurs n’en continuèrent pas moins le même mode d’instruction: le capitaine de Foresti remplace de point en point madame de Montesquiou (honneur à lui!) — et M. Collin continue les entretiens et les lectures que madame Soufflot et sa fille savaient si bien mettre à la portée de sa compréhension. Ces deux dames, fort instruites toutes deux, convenaient encore aux fonctions que l’on confiait à d’autres. La jeune demoiselle se distinguait surtout par un caractère doux et aimable, par une imagination vive et pénétrante. C’est elle qui le plus ordinairement cultivait l’esprit de son jeune élève, en lui racontant des histoires proportionnées à son âge, et en lui faisant des lectures dont le choix l’intéressait toujours. Mais ces sortes d’exercices se faisaient en langue française: or il fallait dès lors familiariser le fils de Napoléon avec la langue allemande, pour parvenir aux fins qu’on se proposait.
MADEMOISELLE SOUFFLOT DONNE LES PREMIERES LEÇONS
AU DUC DE REICHSTADT.
Page 73,
» L’éloignement de tous serviteurs français était donc une mesure purement politique, puisque les études classiques ne commencèrent qu’à l’époque où il eut atteint sa huitième année. «Jusque-là, dit M. de Foresti dans une de ses confidences, nous nous contentions de l’exercer assidûment, par le moyen de nombreuses lectures, à la connaissance des langues française, allemande, italienne.»
Je suis obligé d’interrompre ici la narration du capitaine. Il ne se trompe pas lorsqu’il attribue l’éloignement des Français à la politique; toutefois il n’indique pas assez la véritable cause. Il ignorait ce que j’ai appris depuis le commencement de cette histoire, il ignorait les ramifications du vaste complot formé vers la fin de 1815 pour rétablir le roi de Rome sur le trône de France. Un grand nombre de départements étaient initiés à la conspiration; plusieurs régiments, toutes les gardes nationales de l’Est, attendaient le signal de l’action. L’empereur d’Autriche avait promis, en secret, le concours d’une armée. Je ne sais comment l’entreprise vint à échouer. Fut-ce une nouvelle trahison? Fut-ce pusillanimité du faible François II? Comment la Sainte-Alliance et Metternich avaient-ils découvert la trame?...—Des mémoires inédits (puisse le ciel en reculer la publication, puisqu’ils ne paraîtront qu’après la mort de l’auteur!), des mémoires inédits devront seuls jeter un grand jour sur ce mystère...
— «A l’époque où Napoléon, roi de Rome, devenu par une bizarrerie de la fortune, prince autrichien, duc de Reichstadt, venait d’être remis entre les mains de ses nouveaux gouverneurs, sa beauté était remarquable; ses mouvements avaient de la grâce et de la gentillesse. Il parlait déjà le français avec une grande facilité, et avait l’accent particulier aux habitants de Paris. Il était nécessaire, pour le but qu’on se proposait, de l’habituer de bonne heure au langage allemand. Ce n’était point seulement, comme on a voulu le faire croire ici, pour qu’il ne restât pas étranger à ce qu’on pourrait dire en sa présence; ce n’était pas seulement pour lui faciliter dans l’avenir les moyens d’instruction: on voulait encore arriver au point de lui faire oublier la langue de son pays..... Alors on retrouva dans cet enfant abandonné de tous une résistance au-dessus de son âge. On avait pu le dépouiller de ses titres, de ses honneurs; on avait pu retrancher de ses noms celui de Napoléon, pour n’en faire que le prince François-Charles-Joseph duc de Reichstadt. N’était-il pas impuissant contre ces petitesses politiques? Mais là où sa volonté était quelque chose, on l’a vu opposer une violente énergie de caractère, une force négative déterminée, comme une résistance désespérée. Il fut d’abord impossible de lui faire prononcer un seul mot d’allemand: pour lui c’eût été abdiquer sa qualité de Français.— «Non, jamais! jamais!» — Et il n’avait pas cinq ans!... Toute la dignité nationale semblait s’être réfugiée dans cette jeune âme. Il soutint longtemps cette résolution; on crut devoir employer la ruse pour le gagner plus tard. — «Eh bien! oui, je cède; ce n’est pas à vos raisons: j’apprendrai l’allemand; mais je veux toujours, et avant tout, parler la langue de mes anciens pages.»
» Des renseignements obtenus par mes recherches, madame la comtesse, il résulte que votre malheureux cousin fit preuve de la plus grande aptitude. Il suivit d’abord avec assez de docilité les leçons de lecture que lui donna M. de Foresti; mais souvent il glissait entre les jambes de son gouverneur, et échappait ainsi au dégoût et à l’ennui des leçons..... Pour stimuler son émulation, on eut la pensée de lui donner un compagnon d’études, un jeune enfant de son âge, Emile Gobereau, le fils d’un valet de chambre de Marie-Louise!.....
» C’était un peu s’éloigner de la pensée de Napoléon, qui voulait former à Saint-Cloud une institution où il aurait réuni, pour étudier avec son fils, des fils de rois et de souverains! Des empereurs auraient sans doute recherché l’honneur de faire élever leurs héritiers avec l’héritier du grand empire; dans l’exil, on ne lui trouva pas de plus noble émule que le fils du valet de chambre de sa mère!... Ne reconnaît-on pas dès lors la main invisible qui déchire fil à fil la trame de cette belle existence? Plus tard, pour mieux étouffer leur victime, ils lui jetteront un Don Miguel, cette hideuse araignée de la monarchie absolue. Si Marie-Louise n’était pas, hélas! trop connue maintenant du monde entier, concevrait-on aujourd’hui sa conduite à l’égard de son fils? Elle était déjà flétrie comme mère et comme épouse! Puisse le ciel lui rendre légère l’improbation universelle qui pèse sur sa tête dégradée! Abandonnons un moment cette femme, pour nous occuper de l’objet de notre affectueux dévouement.
» Dès son enfance, le duc de Reichstadt montra les qualités qui le distinguent toujours. Bon pour ses serviteurs, bienveillant avec ses gouverneurs, mais défiant, il cédait aux seuls raisonnements. Il commençait presque toujours par opposer de la résistance. Des personnes mal informées prétendent qu’il aimait à produire de l’effet: il agissait ainsi, disent-elles, pour être remarqué. C’est un mensonge ou une erreur. Le fils de Napoléon, quoique enfant, était soupçonneux, parce qu’il avait assez d’intelligence pour comprendre ses malheurs et l’injustice de la politique. Du reste, cette défiance s’adressait non point à ses gouverneurs, mais bien aux événements qui les lui avaient imposés. S’il éprouvait du mécontentement, sa rancune ne passait jamais la journée: il était toujours le premier à tendre une main amie, en priant qu’on oubliât ses torts.
» Il avait dès lors une telle énergie de caractère, qu’il se corrigeait aussitôt qu’il pouvait connaître une faute ou un défaut. Ses résolutions étaient irrévocables. On en cite un exemple. Afin de donner plus de force à ses assertions, il avait l’habitude de prononcer le mot vrai avec un air presque solennel, et en levant sa petite main avec beaucoup de grâce pour faire un geste affirmatif.
» Le 12 décembre 1815, il devait adresser un compliment à sa mère pour l’anniversaire de sa naissance. On lui fit quatre vers que je ne citerai pas (j’ai plusieurs raisons de les passer sous silence); le mot vrai entrait dans la composition du quatrain. Quand il l’eut appris, on le lui fit remarquer. «Il était là, avait-on ajouté, parce qu’il avait l’habitude, la manie de se servir de ce mot, s’il voulait donner quelque poids à ses paroles.» Il devint sérieux; mais il n’ajouta aucune observation; et au moment de réciter ses vers, il ne fut jamais possible de l’y faire consentir. Il n’en dit pas la raison; il fut facile de la deviner. Depuis ce jour, il n’affirma jamais par le mot vrai.
» Ces détails pourraient paraître légers aux personnes indifférentes; pour nous qui aimons, ce qui a rapport à ce cher prince ne peut manquer de nous intéresser bien vivement. Depuis mon séjour à Vienne, je recherche avec avidité, néanmoins avec prudence, tout ce qui doit me parler de lui. Quand il m’est impossible de le voir, j’aime à entendre énumérer ses éminentes qualités; les traits de son enfance me plaisent toujours, et j’ai du bonheur seulement à me les rappeler.
— «Je veux être soldat (disait-il un jour à M. Hummel, chargé de le peindre. Il avait alors cinq ans ). Je me battrai bien..... je monterai à l’assaut.....
— » Mais, prince, les baïonnettes des grenadiers vous repousseront, vous tueront peut-être.....
— » N’aurai-je pas une épée pour les écarter?» répondit-il avec fierté.
» Quand le portrait fut terminé, le peintre demanda de quel ordre il fallait décorer le jeune duc. — «De l’ordre de Saint-Étienne, répondit le comte de Dietrichstein. —Monsieur le comte, j’en avais beaucoup d’autres..... — Oui, prince; mais vous ne les portez plus.»
» Il garda le silence; et pour cette raison, on prétend qu’il se contenta de cette réponse. — Non, madame, cet enfant de cinq ans mesurait toute la profondeur du mal que le sort lui avait fait: il comprenait aussi combien il lui importait de se taire, et il se taisait..... Il remettait à l’avenir le soin de le venger du présent et du passé !... Se contente-t-il aussi de la réponse suivante, faite un jour par l’empereur? Ose-t-on se l’imaginer? Le duc lui disait:
— «Mon grand-papa, n’est-il pas vrai, quand j’étais à Paris, j’avais des pages?
— » Oui, je crois que vous aviez des pages.
— » N’est-il pas vrai aussi qu’on m’appelait le roi de Rome?
— » Oui, on vous appelait le roi de Rome.
— » Mais, mon grand-papa, qu’est-ce donc être roi de Rome?
— » Mon enfant, à mon titre d’empereur d’Autriche, roi de Hongrie, je joins celui de roi de Jérusalem, sans jamais avoir joui de ce royaume..... Eh bien, vous étiez roi de Rome comme je suis roi de Jérusalem.»
» Le prince sentait bien les torts de la fortune, et il dévorait dans le secret de sa jeune âme toute espèce d’humiliation, tant il savait déjà souffrir! Il fut toujours tourmenté par une extrême curiosité sur sa position passée, sur l’histoire de son père, sur les causes de sa chute. Quoi qu’on ait dit, les réponses évasives n’ont jamais pu le satisfaire. Si, dans la suite, ses gouverneurs furent autorisés à lui parler de la vie de l’empereur, c’est que le ministre Metternich crut trouver le moyen de rendre sa curiosité inutile, favorable même aux vues de la politique. Nous verrons comment il réussit. On s’étonne souvent à la cour des Césars de n’entendre jamais le duc exprimer un seul regret sur le bonheur passé : on attribue ce silence à la dissimulation — Les bourreaux ont-ils la délicatesse d’apprécier toute la résignation de leurs victimes? Non, ministres de la Sainte-Alliance; et malgré vos efforts répétés, vous n’avez rien obtenu: le fils n’oublie pas le père; il ne condamne point sa mémoire. S’il ne vous en parle jamais, c’est parce que vous, ses humbles courtisans, ses rampants adulateurs d’autrefois, vous êtes trop au-dessous de l’homme que vous avez trahi, que vous avez aidé à charger d’injustes chaînes, que vous avez envoyé, que vous avez peut-être fait aussi mourir sur le rocher de Sainte-Hélène....
» Où me suis-je laissé entraîner? Pardon, madame; je vous parle de l’enfance du royal captif, sans vous dire le jour où j’ai eu le bonheur de le voir pour la première fois. C’était peu de temps après l’assassinat du duc de Berri. Je travaillais non loin de Tyroler-Haus (c’est le nom d’une chaumière construite dans la forme des chalets de la Suisse; elle se trouve sur les hauteurs qui dominent Schœnbrünn, à droite des élégantes arcades de la Gloriette, au fond d’une allée sombre, dans une enceinte séparée par des arbres épais de la vue de Vienne et des bords du Danube. De là on n’aperçoit que les montagnes qui s’élèvent jusqu’aux cimes du Schneeberg). J’avais remarqué dans cette espèce de solitude une caverne nouvellement creusée, dans l’intérieur de laquelle on avait réuni un grand nombre de petits outils, plutôt faits pour un enfant que pour un homme. Bientôt je vois arriver un grave personnage en costume noir: il semblait accompagner avec toutes les marques du respect un jeune prince de la famille impériale. A peine arrivé dans ce nouveau désert, l’enfant se met au travail: ses tendres mains continuent de creuser avec une activité énergique la retraite rustique qu’il se ménageait sans doute pour les moments de contemplation. J’entends, au milieu de ces occupations, le grand homme noir lui parler de Robinson et de son île déserte..... Ma curiosité est vivement excitée: je me rapproche... Quelle ne fut pas ma joie, mon ravissement, de reconnaître, dans la figure de cet admirable enfant, les traits héroïques de notre empereur! Cependant je puis assez me commander pour ne pas me trahir par des démonstrations intempestives; mais je m’arrête longtemps à contempler ce cher prince. — Je le retrouvais enfin après des années d’attente! Le résultat de ma muette admiration me navra cruellement le cœur. Il devint dès lors évident pour moi que, ne pouvant comprimer entièrement ni la force de son âme, ni l’énergie de son imagination, on s’efforçait de détourner cet enfant du but auquel ses vœux tendirent toujours, en dépit de la politique européenne... Les infâmes! Ils voulaient en faire un Robinson Crusoë ! Pensaient-ils au rocher de son père? Quelques personnes ont voulu ne voir là qu’une innocente distraction..... — Pourquoi l’attirer seul dans ce désert? Pourquoi ne lui pas donner des compagnons pour le jeu, comme on en avait trouvé pour la lecture? — Emile Gobereau n’était plus là !..... N’aviez-vous plus de fils de valets de chambre, à défaut de princes?...
» Pardonnez-moi mon indignation, madame..... Quand vous saurez tout ce qu’ils lui ont fait souffrir, vous trouverez mon excuse dans ma douleur.....»