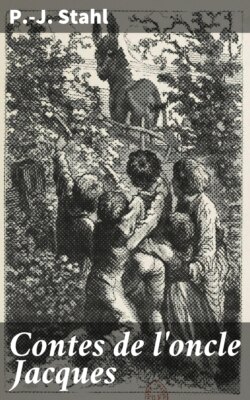Читать книгу Contes de l'oncle Jacques - P.-J. Stahl - Страница 4
LES ENFANTS N’OUBLIENT PAS
ОглавлениеOn parle de la légèreté des enfants, du peu de souvenir qu’ils semblent garder des impressions les plus douloureuses, de la perte d’un frère, d’une sœur, d’un père, d’une mère même. Encore un peu on les taxerait, non de mobilité seulement, mais d’insensibilité, parce que le rire leur revient plus vite sur les lèvres. Mais, en vérité, de ce don heureux qu’ils ont d’être vivement et rapidement frappés d’impressions diverses, doit-on inférer qu’ils oublient, qu’ils ne se souviennent pas et que le fond de leur cœur ne puisse rien conserver de ce qui devrait y rester? Si l’on avait raison de le prétendre, de quoi seraient donc faits nos souvenirs d’enfance, à nous autres hommes, souvenirs si précis, si opiniâtres, si vivaces, qu’ils demeurent pour nous, en dépit de leur plus grand éloignement, plus précis, plus opiniâtres, plus vivaces que tous nos souvenirs de l’adolescence et de la maturité?
Tient-on assez compte, aux premières années de l’enfance, de l’incroyable quantité de révélations successivement nouvelles, de sentiments successivement nouveaux qui assiègent à la fois la jeune âme et le jeune esprit de l’enfant, de toutes les sensations qui ont à se classer dans son cerveau pendant le temps si court dont se compose l’enfance et qu’il lui faut débrouiller, comprendre, s’assimiler? A quelle période de la vie, s’il vous plaît, faisons-nous preuve d’une plus incroyable faculté d’absorption, d’intuition, de compréhension? et ne serait-il pas plus juste de s’étonner que cet âge, que l’on dit inattentif, suffise à l’énorme travail intellectuel qu’exige de tout enfant son apprentissage de la vie, travail décuple de celui dont nous sommes capables dans les années que l’on considère comme celles de la force et de la réflexion? Non, on n’admire pas assez ce prodigieux développement qui se fait, d’une façon en apparence instantanée, dans l’enfant obligé d’aller en même temps à la découverte de tous les problèmes et de toutes les conditions de sa petite existence.
Qu’on se demande ce que serait pour l’homme un si formidable labeur, où le moral et le physique n’ont pas un instant de répit, où tout est à deviner, tout à distinguer, tout à connaître et à reconnaitre presque sans secours extérieur, où les progrès sont à faire sur tous les points à la fois!
On s’étonne que l’œil d’un enfant de six mois soit souvent si pensif, si profond; on s’étonnerait moins si l’on songeait à tout ce que, dès cet âge, l’enfant se trouve déjà avoir à faire.
En vérité, si l’œuvre de Dieu, dans l’homme fait, est bien grande, elle est cent fois plus grande encore dans l’enfant.
Au lieu donc d’imputer à mal dans les enfants leur merveilleuse flexibilité, bénissons-la! Si le don de récréation soudaine dans la joie, dans la douleur, dans le sérieux, dans l’encombrement des expériences et des travaux qu’il leur faut accomplir, ne venait pas en aide à l’immensité de leur tâche, il n’en serait pas un qui ne pérît à la peine.
Que les pères et les mères trop portés à l’inquiétude se rassurent donc; les enfants ont dès le berceau, pour suffire à leur métier d’enfant, toutes les facultés de la mémoire: les nouveau-nés sont, à l’heure même où ils ouvrent les yeux à la lumière, en proie au travail de la vie, et l’une des plus indispensables de leurs facultés, celle dont ils ont le plus besoin tout de suite, c’est précisément la mémoire. Tout enfant naît armé au complet sur ce point-là, et il n’a pas plutôt atteint trois ou quatre ans qu’il est apte à mesurer l’usage qu’il doit faire de cette arme.
Je connais un père à qui, dès longtemps, il n’est plus permis d’en douter. Si le récit que je vais vous faire du fait touchant qui justifie sa conviction donne à penser à quelques incrédules qu’à aucun moment de la vie une impression–je parle de celles qui ont leur racine dans le cœur–n’est aussi ineffaçable que dans l’enfance, je n’aurai pas perdu mon temps.
Cela remonte à18.... Nous sommes dans une maison en deuil. Le deuil est d’hier. Le père, seul, dans la maison, a eu la force de conduire sa fille, une exquise enfant de treize ans, à sa dernière demeure. Oui, oui! Il a suivi son cercueil jusqu’au cimetière. Il l’a vu disparaître dans la terre. C’est là dedans, c’est là-dessous qu’est à jamais enfoui son trésor. Le cœur brisé, il vient de rentrer dans la maison vide. La mère est folle de douleur, on craint pour sa raison. Un gentil petit garçon de quatre ans, à la fois grave et effaré, guette le retour de son père.
«Papa, alors. alors, tu ne ramènes pas Marie?.
–Non, répond le père, non.
–Papa, maman pleure; elle a dit à son Jujules que Marie était partie, partie pour très loin.
–Très loin, répond le père.
–Papa, pourquoi est-elle partie, Marie, puisque maman la soignait, et Jujules aussi, et toi aussi? Faut pas sortir quand on est malade, faut pas aller loin pour revenir bien vite.
–Marie ne reviendra plus, mon enfant; c’est pour toujours qu’elle est partie.»
Le petit frère se taisait, essayant de comprendre, de mesurer ce «pour toujours» et n’y parvenait pas.
Le père le prit entre ses genoux, et, fixant son triste regard sur les grands yeux bleus inquiets de l’enfant, il lui dit:
«Nous ne reverrons plus ta sœur, mon Jules; d’où elle est on ne revient pas. Nous ne la reverrons que quand, à notre tour, nous partirons pour le voyage qu’elle vient de faire.
–Partons, dit le petit Jules, papa, partons!»
Le père serra l’enfant sur son cœur:
«Nous ne pouvons pas partir, lui dit-il, avant que, comme elle, Dieu nous rappelle.»
Les yeux de l’enfant se remplirent de larmes.
Le père embrassa le pauvre petit. Les regards de l’enfant ne quittaient pas les yeux du père, et, à travers ses larmes, il cherchait sur son visage l’explication de ce terrible mystère qui ne pouvait encore s’éclaircir pour lui.
«Allons voir maman,» dit-il à son père.
Sans doute le pauvre enfant pensait qu’auprès de sa mère la lumière se ferait en lui.
«Tout à l’heure, répondit le père; avant, il faut que je te parle, et que tu m’écoutes si bien, mon Jules, qu’après tu n’oublies jamais ce que je t’aurai dit.»
L’enfant se plaça bien en face de son père.
«Jujules écoute son papa, lui dit-il.
–Mon Jules chéri, dit le père, ce départ de Marie fait tant de peine à ta maman, tant de peine, qu’il ne faut plus rien lui dire qui le lui rappelle. Tu penseras à ta Marie, à notre Marie qui t’aimait tant, tu y penseras toujours, toujours. Mais tu ne parleras plus d’elle à ta maman, tu ne prononceras jamais son nom devant elle, tu ne la lui redemanderas jamais, car elle ne peut pas te la rendre, et cela redoublerait son chagrin, cela la ferait pleurer encore plus, cela la rendrait encore plus malade.
«Comprends-tu, mon Jules bien-aimé? Toujours penser à Marie, mais n’en jamais parler!»
L’enfant fondit en larmes. Il se jeta dans les bras de son père, en lui criant:
«Oh! papa, ne pleure pas, toi aussi!»
Et, ayant approché ses petites lèvres de son oreille, il ajouta tout bas, pensant bien que c’était ainsi qu’il faut parler des secrets:
«Jujules sait tout ce que son papa lui a dit.»
Comme beaucoup d’enfants, le petit Jules parlait souvent de lui à la troisième personne.
Le père vit bien que l’accord était fait. Il essuya doucement les yeux et le visage de son fils, lui dit comme il l’aurait fait à un homme: «Je compte sur toi,» et l’ayant pris dans ses bras:
«Maintenant, nous allons voir ta maman. Aime-la, aime-la mieux encore si tu peux, mon chéri, car elle est bien malheureuse; toi seul pourras avec le temps la consoler.»
Un instant après, le père, la mère et le petit enfant pleuraient tous les trois ensemble. Le nom de Marie n’était pas prononcé, mais c’était elle que tous les trois pleuraient.
Pour fuir la maison où Marie n’était plus, on quitta le pays; on alla habiter sur le bord de la mer. Pendant des journées entières, le père et la mère regardaient sans parler l’eau sans fin, sans fin comme leur douleur. Le petit garçon, quand il les voyait ainsi muets, absorbés, cherchant au loin celle qui était plus loin encore, interrompait ses jeux, laissait là sa pelle, et son trou de sable commencé, et ses coquillages amassés, puis il allait à eux les bras tendus. Ses bons et tendres regards disaient assez qu’il savait bien ce qu’il faisait en leur portant tant de baisers. Il se rendait compte, bien sûr, qu’il avait à les embrasser non pour lui seulement, mais pour sa Marie qui était trop loin pour venir les embrasser à son tour.
Cependant le temps se passa: «Un an, deux ans même; et un jour, le père, injuste en cela peut-être, se répéta ce qu’à part lui, ce que malgré lui, mais bien souvent depuis plus d’une année déjà, il se disait: «Notre pauvre petit a suivi trop à la lettre la recommandation que je lui avais faite de ne pas prononcer le nom de sa sœur. Quoi! pas une fois, pas une seule, ce nom de Marie qu’il répétait tant que durait le jour alors que sa sœur vivait, pas une fois il ne s’est échappé de ses lèvres! J’ai eu grand tort, je l’ai aidé à oublier sa sœur. Soutenu par ma défense, plus facilement le temps a fait son œuvre. A l’heure qu’il est, hélas! ce ne sont plus ses lèvres seulement qui se taisent, c’est son cœur lui-même qui est muet: l’ingrat ne se souvient plus de Marie!»
Le père désolé essayait de se consoler en se disant un triste: «Tant mieux!» ou encore: «Après tout, c’est ma faute et non la sienne.»
Néanmoins, parfois, du fond de son cœur, montait quelque chose d’amer contre cette puissance d’oubli de son fils. Obsédé par cette pensée, il avait un jour fait part de son chagrin à sa femme et, bien entendu, il lui avait, à la décharge du petit Jules, confessé la scène que j’ai racontée plus haut.
«Que pour ce qui me concernait alors, lui avait répondu sa femme, vous ayez eu tort ou raison, je ne saurais le dire. Pendant trois mois, je ne sais vraiment pas comment j’ai vécu. Je n’avais qu’un désir: c’était d’aller rejoindre Marie; qu’un étonnement: c’est que la terre ne me fît pas la grâce de s’ouvrir sous mes pieds pour m’engloulir à mon tour. Mais votre intention était si bonne, mon ami, que je ne puis que vous en savoir grand gré.
«Pour ce qui regarde notre Jules, outre que, remarquant son silence, j’ai soupçonné la défense que vous aviez pu lui faire, je me le suis expliqué surtout par son caractère même. De quoi cet enfant s’est-il jamais plaint? Quelle est la douleurphysique ou morale qui lui ait jamais arraché plus d’un cri? Votre fils, mon ami, est un stoïque de six ans. C’est une petite âme très fière, et vous n’êtes pas juste quand vous lui faites un tort des mérites d’un mutisme que vous lui aviez recommandé. Dans l’état de santé où j’étais depuis un an quand nous avons perdu Marie, elle était devenue pour lui une seconde mère. Notre Jules n’a rien oublié; soyez assuré que dans son cœur il se sent orphelin de sa sœur.»
Le père aurait voulu être convaincu; sa femme voyait bien que, cependant, il ne l’était pas.
«Mais j’ai des preuves, des preuves morales et même matérielles de ce que je vous affirme, lui dit-elle avec quelque vivacité. Tenez! Tout ce que sa sœur lui a laissé lui est sacré. Il a tout placé, non en tas pour s’en débarrasser, mais avec un ordre qu’il n’a pas pour le reste, sur les tablettes de son étagère. Il a défendu à sa bonne de jamais y toucher. Il veille lui-même et seul sur tout cela. Il n’est pas de jour qu’il ne l’inspecte.
–Êtes-vous bien sûre, répondit le père, que c’est le frère et non le petit propriétaire qui a soin de ces trésors?
–N’en doutez pas, dit la mère, c’est le frère pieux qui veut seul être le gardien de ce qu’il considère comme des reliques de sa sœur.
–Dieu vous entende! répondait le père. Mais que ne donnerais-je pas pour qu’un beau jour il sortît de lui-même de ce cruel silence dont, à mon éternel regret, j’ai eu l’imprudence de lui faire une loi.»
L’obsession devint telle pour le père du petit Jules, sur ce point douloureux, que cela en était arrivé à l’idée fixe, cette idée que l’on voudrait en vain chasser. Tout ce que le père pouvait faire vis-à-vis de son fils, c’était de se contenir et de ne pas provoquer un retour sur Marie qui ne pouvait avoir de prix à ses yeux que s’il provenait d’un mouvement spontané de l’enfant.
Cependant un jour,–un matin,–au moment où la famille se préparait à traverser le grand jardin attenant à leur maison pour gagner la porte qui donnait sur la campagne et aller faire une de ces longues promenades à travers bois où les suivait le souvenir de l’absente, le père, toujours prêt le premier, avait devancé la mère, qui avait à mettre la dernière main à la toilette de son fils avant de terminer la sienne. Ce jour, dis-je, tout entier à l’idée qui n’avait pas cessé de l’obséder, le père suivait à pas lents la grande allée qui conduisait à la porte de sortie où il avait coutume de les attendre, et où d’ordinaire l’enfantd’abord, puis la maman, venaient le rejoindre l’un après l’autre. La vue de cette allée sablée de sable fin, que le jardinier avait ratissée le matin même avec soin, lui inspira une idée à laquelle il ne put résister: «Ah! se dit-il, cette fois j’en aurai le cœur net, et je saurai enfin si le silence de ce malheureux enfant sur sa sœur est de la volonté, c’est-à-dire du souvenir qui se condamne héroïquement à être muet, comme le croit sa mère, ou de l’oubli, comme je le crains.»
Et, du bout de sa canne, en grandes lettres lisibles comme celles des livres dans lesquels son fils lisait déjà très couramment, il traça le nom de
MARIE
Ce nom occupait toute la largeur de l’allée par laquelle le petit Jules, qui précédait toujours un peu sa mère, devait nécessairement passer le premier pour le rejoindre. Cela fait, et très ému de l’épreuve, peut-être dangereuse, qu’il allait tenter, il se cacha derrière un taillis d’où il pouvait tout voir sans être vu.
Comme l’avait prévu le père, l’enfant sortit le premier de la maison. Il était armé d’un cerceau et le faisait courir dans la longue allée propice à son jeu. Tout à coup, le père le vit d’un geste brusque jeter son bâton, abandonner son cerceau.
L’enfant avait vu, il avait lu avec stupeur, avec une sorte d’effroi ce nom de MARIE qui lui barrait le chemin, et s’était arrêté un instant, hésitant. Mais soudain, prenant son parti, il s’était jeté à genoux, et de ses petites mains, utilisées pour la circonstance comme balai, il s’était mis à effacer avec une agitation fébrile ce nom chéri qu’il ne fallait pas prononcer. Cela fait, et bien sûr que derrière lui on ne pourrait plus rien lire, il s’était relevé le visage bouleversé, avait repris sa course pour retrouver son père qui avait quitté sa retraite, et, arrivé près de lui, il s’était jeté à corps perdu dans ses bras et, le visage inondé de larmes: «Ah! père, lui dit-il, tu avais donc oublié que maman allait passer là?»
Son cœur battait à se rompre dans sa poitrine. Son père le reçut tout palpitant dans ses bras; les plus tendres caresses eurent de la peine à le calmer; tout ce trésor de larmes contenues dans ces deux années de silence voulu avait besoin de se faire jour. Son père avait envie de lui demander pardon.
«Quand je pense, dit-il à l’enfant, que je croyais que Jules avait oublié sa Marie!
–Oh! père! lui dit l’enfant, répondant par un nouveau déluge de larmes à l’aveu d’une si grande injustice, oh! père!»
Le père, à la fois heureux et malheureux, trouva pourtant le moyen de rendre au petit Jules toute sa sérénité: «Maintenant, mon Jules, lui dit-il, nous pourrons parler de Marie.
–Ah! dit l’enfant, merci, papa!» Et un instant après: «Est-ce que nous pourrons aussi en parler devant maman?
–Oui! oui! répondit le père, oui, mon enfant.»
Un soupir, un long soupir sortit de la poitrine, du cœur enfin dégagé, enfin desserré de l’enfant. Il fit une fête de caresses charmantes à son père de ce retour si attendu, évidemment tant désiré par lui du nom de sa sœur entre eux, et quand sa mère arriva, voyant le père et l’enfant radieux: «Qu’y a-t-il? leur dit-elle. Est-ce que c’est un secret?
–Il y a, répondit le père, que nous allons faire aujourd’hui toute notre promenade avec Marie.
–Oui, dit l’enfant, avec Marie, maman; tu veux bien, dis?
–Si je le veux!» s’écria la mère en serrant son petit garçon dans ses bras.
Cette promenade, qui était la promenade favorite de l’enfant, il ne la nomma plus que la promenade de Marie.
«Ah! dit la mère avec orgueil à son mari, quand, chemin faisant, il lui eut fait sa confession, je le savais bien, moi, que notre Jules était un cœur fidèle entre tous.» Et, après un instant de silence:
«Tel il est enfant, dit-elle, tel il sera en tout et pour tout, aussi longtemps qu’il vivra. Dieu veuille qu’il ne rencontre jamais d’autres incrédules que son père!»
Ne défiez pas la mémoire des enfants: tout y reste; et, si parfois tout s’en échappe, tout y revient.