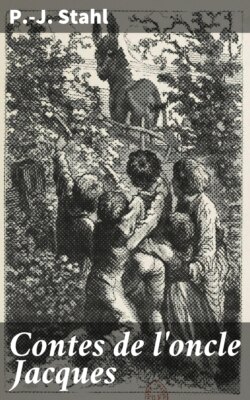Читать книгу Contes de l'oncle Jacques - P.-J. Stahl - Страница 5
CONTRE LES MOUCHES
ОглавлениеAimez-vous les mouches en été,–ces petits êtres terribles, opiniâtres et têtus, sots et fantasques, agaçants et insupportables, qui, ayant l’univers entier où poser leurs imperceptibles personnes, s’obstinent à faire du bout de votre nez le siège et le but préféré de leurs attaques?
Pythagore refusait à l’homme le droit de mort sur tout ce qui vit, depuis le ciron jusqu’à l’hippopotame. Je me suis dit plus d’une fois qu’il fallait donc que, par une exception unique, jamais mouche n’eût choisi le nez de Pythagore pour objectif, car à coup sûr ce n’eût pas été une mouche sur le nez que le grand philosophe eût pu concevoir son beau rêve de clémence universelle. Non, si humain qu’on soit, fût-on un saint, je dis un saint de pierre, il est impossible qu’on se sente capable de charité ou seulement de pitié pour ces misérables insectes qui, cent fois chassés, reviennent cent fois à la charge, que rien ne lasse, pas même la patience, que rien ne désarme ni ne décourage pourvu qu’ils vous excèdent, dont toute la joie est de vous porter sur les nerfs, dont le plaisir est de vous troubler dans vos travaux les plus nécessaires, de vous arracher à vos recueillements les plus intimes,– qui se font une volupté de vos plus cruelles impatiences, des extases de vos seules fureurs,–qui ne chantent victoire et ne sonnent des fanfares que quand ils vous ont mis hors de vous,–qui, à la fois féroces et étourdis, légers et barbares, mèneraient un sage même à la démence par le chatouillement et l’irritation, si Dieu n’avait fait d’eux des éphémères, –qui, indomptables dans leurs malfaisants caprices, n’entendent rien, ni prières ni imprécations, parce que rien ne les attendrit, et qui, pour tout dire, ne semblent satisfaits que si, prenant enfin leurs attaques au sérieux, vous vous décidez à les considérer, en dépit de leur faiblesse apparente, comme les pires ennemis du genre humain, à lever contre eux toutes vos forces, et à leur déclarer une de ces guerres qui ne peuvent finir que par leur écrasement.
Où est-il, l’être longanime qui, de sa vie, n’a rêvé un massacre général de toutes les mouches, moucherons, cousins et moustiques de la création? Où est-il celui qui n’a jamais souhaité voir toutes ces bêtes maudites pilées et repilées ensemble dans un mortier? J’en demande pardon à Dieu; mais qui pourrait songer à l’indulgence pour une engeance qui gâte à l’homme jusqu’aux joies du beau temps et lui fait regretter décembre en août?...
J’en étais là de mon imprécation quand un de mes bons amis entra chez moi.
«Qu’avez-vous? me dit-il. Je vous trouve bien surexcité.
–J’ai, lui dis-je, que je deviens enragé, que tout travail m’est impossible, que mon cabinet est plein d’ennemis acharnés, et que je suis tout près d’une de ces colères qui d’un agneau feraient un tigre. Tenez, lisez. Ces pages vous diront la centième partie de ma misère. J’ai essayé d’utiliser mon supplice et de l’écrire, mais cela ne suffit pas à ma vengeance, c’est trop doux.»
Mon ami prit les feuillets que je lui présentais et après les avoir lus se mit à rire.
«Vous riez! lui dis-je. Quoi! vous riez!.
–Ma foi oui, me dit-il, et de grand cœur encore; vous êtes à peindre, mon cher Jacques, avec vos colères! Et d’abord ne blasphémez pas: rien ne peut gâter l’été. L’été, c’est le soleil, c’est la moisson, c’est la vie, rien ne gâte ça; et quant aux mouches, permettez-moi de les défendre. Elles sont jolies à voir, en somme, ces petites bêtes-là. C’est malice et non pas méchanceté qui les pousse de votre côté. C’est l’ennui de la solitude, l’effroi des grands espaces, le besoin de sociabilité et comme une sorte d’espièglerie maladive qui leur fait préférer le nez de l’homme aux roses mêmes du jardin.
«Vous prenez trop au tragique leurs entreprises folâtres contre certaines parties de votre personne. Votre repos les agace, il ne concorde pas avec leur besoin de mobilité. Quand elles font à votre nez l’honneur d’une visite, qu’est-ce qu’elles veulent? Forcer votre attention, vous arracher un geste qui les mette en gaieté, qui leur montre que vous savez qu’elles sont là, et leur prouve qu’elles ne sont pas seules sur la terre. Votre calme les blesse, il leur paraît indifférence et même dédain. Votre nez perdu dans vos livres, c’est l’oubli de ce qui leur est dû; elles sont coquettes, elles aiment le monde, elles veulent que le monde les aime et s’occupe d’elles comme elles s’occupent de lui.
«C’est un spectacle presque burlesque que de voir le roi de la création, l’homme, ne pouvoir supporter les inoffensives plaisanteries de ces faibles insectes; leur trompe n’est pas un aiguillon, que je sache, elle n’a jamais tué personne. Ce ne sont ni guêpes ni frelons, vos mouches. Chatouiller le nez des gens, ce n’est pas vouloir leur mort, et vos fureurs ne sauraient s’expliquer que si, au lieu d’être devant une demi-douzaine de mouches, vous aviez devant vous une armée de rhinocéros et de panthères.
«Quoi! vous alliez dormir sur votre encrier; une bonne petite mouche étourdie vous a fait une farce, elle a voulu jouer avec vous, elle vous a gratté délicatement le nez de l’extrémité de ses petites pattes innocentes, elle vous a rendu le service de vous éveiller en douceur, et vous criez à l’assassin, et vous voulez la tuer, et rien ne vous apaiserait que d’exterminer sa race tout entière!.. Mais c’est vous qui êtes féroce, mon ami.
«Puisque je vous trouve sur le chapitre des mouches, je m’en vais vous conter une petite histoire qui n’est pas vieille, car elle n’est que d’hier, et qui viendra à point à la fin de votre chapitre pour en corriger les excès.
«Vous connaissez la petite Marie, ma filleule? Celle qui dit si bien: «Parrain», que cela vous va au cœur, comme si elle vous appelait sa grand’mère.
–Si je la connais! lui dis-je. C’est un amour d’enfant.
–Comme vous le dites, fit mon ami en se rengorgeant. (Les vieux garçons, c’est les meilleurs parrains.)
«Eh bien, reprit-il, voilà. Ma petite Marie était hier, comme vous aujourd’hui, en proie auxmouches, mais elle ne prenait pas pour cela, ainsi que vous, des attitudes de martyr et de gladiateur. Elle était fort calme au milieu de ses mouches. Elle avait une énorme leçon à apprendre, la pauvre mignonne, tout un verbe, et pas plus de temps qu’il n’en fallait pour absorber cette grosse tâche. Afin de ne pas la gêner dans son étude, je m’étais retiré discrètement au fond de la chambre, sur le canapé. J’avais emporté un journal, mais je ne le lisais pas. Je regardais par-dessus pour admirer cette jolie chose: une aimable enfant qui travaille. C’était charmant d’entendre le gentil murmure qui sortait des lèvres roses de ma petite Marie: «J’aime, tu aimes, il aime, nous aimons», quand elle lisait et relisait à mi-voix pour les bien faire entrer dans sa mémoire les temps de son verbe; et c’était amusant lorsque, croyant tenir un de ses temps, ses grands yeux se fermaient pour ne pas tricher en regardant sur le livre pendant qu’elle se récitait tout bas à elle-même et comme en dedans ce qu’elle venait d’apprendre.
«Cela allait très bien. Nous en étions au subjonctif: que j’aimasse, que tu aimasses, etc. (je n’aime pas ce temps-là), quand je m’aperçus que Marie était inquiète et comme agitée.
«Qu’est-ce qu’il t’arrive, ma fillette? lui dis-je.
–C’est une mouche, dit-elle, une mouche qui n’a pas de subjonctif à apprendre, et qui vient toujours sur mon verbe et même sur mon nez pour m’empêcher d’étudier.
–Chasse-la…
–Elle est très obstinée, dit Marie, elle n’est pas contente quand je la renvoie, et.»
«Marie s’était interrompue. Sa petite main avait attrapé la mouche.
«Qu’est-ce que tu crois qu’elle en fit, de sa mouche?
–Je n’en sais rien, répondis-je, mais si la mouche de ta petite Marie eût été ma mouche, je sais bien ce que j’en aurais fait. Je l’aurais attachée à la gueule d’un canon, et, sans broncher, j’y aurais mis le feu.
–Je crois que Marie a trouvé mieux, reprit Jacques. D’une main délicate, elle avait saisi sa petite prisonnière par les deux ailes, et ouvrant de l’autre la fenêtre, elle allait pour toute punition lui donner la clef des champs, quand elle s’aperçut qu’il pleuvait. C’était une grosse pluie d’orage. C’eût été grave pour une mouche qui n’avait pas de parapluie. Marie le comprit, elle eut un moment d’embarras; mais bientôt, prenant son parti, elle referma la fenêtre et réintégra son ennemie dans la place «en attendant qu’il fit beau,» me dit-elle.
«Après quoi elle se remit tranquillement à sa leçon.
«Qu’est-ce que vous auriez dit de son action à Marie, vous, monsieur l’ennemi des mouches? Vous lui auriez dit, car vous êtes rude quand vous vous y mettez, qu’elle venait d’être une petite bête pour en sauver une autre, et ci, et ça; vous auriez plaidé en faveur de la peine de mort et même contre les circonstances atténuantes. Vous n’auriez pas manqué de rappeler le mot d’Alphonse Karr: Que Messieurs les assassins commencent!.
«Eh bien, je ne lui ai rien dit du tout, moi, car j’étais tout juste assez attendri pour ne pas avoir envie de bavarder.
«Mais j’ai pensé: «Marie, ma chérie, s’il y a une superbe poupée et un livre splendide dans Paris, je connais un parrain qui te les offrira, et sans te dire pourquoi encore, car il est des petites choses de bon cœur qu’il ne faut pas gâter par des récompenses.»
«La morale de mon histoire, mon cher Jacques, c’est que l’exemple de l’enfant est quelquefois bon pour l’homme.
«Ergo: soyons patients, tâchons-y du moins.
–Soyons patients, répondis-je à mon ami, c’est à quoi on doit viser en effet; mais il me semble que la tâche des patients deviendrait plus facile si de leur côté les êtres impatientants s’efforçaient de l’être moins à l’encontre de ceux qu’ils impatientent. Karr n’a pas tort, au fond, avec sa recommandation aux assassins.
«Les prêcheurs de patience en parlent vraiment trop à leur aise. Il n’y a peut-être pas de mouches dans leur maison. Si, au lieu de mon nez, c’étaient les leurs, leurs nez à eux, qu’elles poursuivissent, mes mouches, à moi, celles dont je parle, celles dont j’ai à me défendre, je voudrais bien les y voir! Non, qu’on ne me parle pas de l’innocence de ces êtres pervers qui semblent n’avoir d’autre fonction que de harceler l’humanité; je ne crois pas à l’innocence de ceux qui se plaisent au mal.&
«Si le plus grand éloge qu’on puisse faire de la bonté et de la douceur d’un homme est de dire qu’il ne tuerait pas «une mouche», c’est donc qu’on reconnaît que la mouche est une créature si odieuse que ce qu’il y a de plus magnanime au monde c’est de lui faire–grâce de la mort qu’elle mérite si souvent.
«Voyons: si au lieu d’une mouche c’eût été un tigre qui se fût jeté sur le nez de votre petite Marie, lui auriez-vous conseillé de le prendre délicatement par les deux ailes, de le mettre à la porte par la croisée, et de le faire rentrer poliment en cas de pluie?
–Non.
–Eh bien, est-ce que l’action de la mouche n’est pas la même qu’eût été celle du tigre? Pour être moins grosse et moins forte, est-elle moins coupable? Devons-nous lui savoir gré de sa faiblesse, de son impuissance relative? Le crime est-il moindre dans l’intention de la petite bête ou de la grosse? Tout bien considéré, je dis que la mouche hargneuse n’est pas plus digne de pitié que le tigre terrible, et que ni devant Dieu ni devant les hommes elle n’a droit à l’indulgence que ses avocats réclament pour elle.»
Mon ami venait de hausser les épaules.
«Le paradoxe ne sera jamais la vérité, dit-il. Toute peine doit être proportionnée au délit. Avoir le bout du nez chatouillé n’étant pas l’équivalent de l’avoir mangé et la tète avec,–non, non, Jacques, je ne comprends pas que devant l’attaque d’une mouche aussi bien que devant celle d’un tigre on ait le droit de s’écrier: «Où est mon fusil?»
Après cette jolie conclusion, d’où il résultait que deux braves gens obstinés dans une discussion pouvaient en arriver, chacun à son tour, à l’absurde, mon ami se mit à rire.
Quand sa gaieté se fut calmée:
«Revenons-en cependant à nos mouches, mon cher Raymond, reprit-il.
«Votre diatribe contre elles contient un germe de vérité qui vaut de n’être pas perdu. Sans doute, la mouche ne mérite pas la colère d’un homme sensé parce qu’elle est une pauvre petite bête inconsciente de ses actes, et que, par suite, elle n’en peut être responsable. Mais supposons qu’il y ait parmi les hommes et les enfants, à qui Dieu a donné mieux que l’instinct des bêtes, «la raison pour se conduire», supposons, dis-je, qu’il y ait parmi eux des êtres aussi insupportables que la mouche; je dis que tout ce qui est exagéré s’il ne s’agit que de la mouche, dans le début de votre chapitre, ne serait que juste contre eux.
«Eh bien, et très malheureusement, la mouche a son analogue dans l’homme et plus souvent encore dans l’enfant. Le taquin, c’est votre mouche. C’est donc contre le taquin qu’il convient de retourner tout ce que vous avez dit contre l’insecte, parce que, mis par la poste à l’adresse du taquin, tout en est vrai. Mais au fait, je suis peut-être naïf, moi, s’écria mon ami. C’est le taquin que vous aviez en vue dans ce chapitre. et non la mouche, et vous venez, comme on dit, de faire poser votre ami.»
Ce fut à mon tour de sourire.
«Vraiment! m’écriai-je, vraiment, vieil ami, ce n’est qu’après une demi-heure de discussion en règle que vous en êtes arrivé à me faire l’honneur de soupçonner que ce n’était peut-être pas pour de bon que j’avais livré bataille aux mouches, et que, sous la taquinerie des mouches, je visais celle des hommes!–Ma foi, c’est bien heureux!
«Eh bien oui, je crois en effet, comme vous et comme la petite Marie, qu’on peut être clément pour les mouches. Mais pour les taquins, pour la taquinerie, ce défaut affreux qui a comme un ongle au bout de la langue, qui, armé de cet ongle, se met à la recherche de l’endroit le plus sensible du cœur, de l’esprit, ou de la personne de celui qu’il taquine, celui-là fût-il son meilleur ami, et qui, une fois cet endroit découvert, en fait sa cible, pour la taquinerie, je reste inexorable, et je crierai jusqu’à mon dernier souffle: «Guerre au taquin, sinon aux mouches.» Ce qu’on peut dire en effet de moins dur du taquin, c’est qu’il est un de ces insectes malfaisants que tout le monde n’écrase pas, mais que tout le monde abhorre et a envie d’écraser, et dont les plus longanimes ont à cœur de purger leur maison.»
Nous étions d’accord. Le procès que je voulais faire aux taquins se trouvait complété par ma discussion avec mon ami. Je me contentai d’en écrire l’analyse, et c’est à cette analyse, que je renvoie toutes les mouches, moucherons, cousins et moustiques de la création, sans oublier le pire de tous ces insectes: «le taquin!»
MELASIA
CONTE UKRAINIEN
Dans un champ près de la forêt se trouvait le rucher d’un certain Cosaque. Il faut supposer que vous connaissez bien ce que veut dire le mot rucher. Peut-être parfois avez-vous tenté de découvrir le miel parfumé et n’avez-vous attrapé que les piqûres des abeilles; peut-être, plus heureux, quelquefois êtes-vous parvenu à goûter le doux miel. Le rucher, dont nous parlons à présent, était entouré d’une haie de branches entre-croisées qui formaient une grande enceinte, au milieu de laquelle s’élevaient sept grands chênes au tronc séculaire, au feuillage épais.
A côté de ces chênes verdoyait, hiver comme été, un grand buis touffu.
Quand on voyait le buis, chacun se disait: «Quelle idée a-t-il eue, lui si simple et si gai, de rechercher la société de ces chênes majestueux?»
Le buis semblait répondre qu’il s’y plaisait très bien. A chaque printemps il donnait de ses nouvelles, croissant librement et sans effort, sans s’inquiéter de la hauteur de ses voisins.
Il croissait plus rapidement encore que Michel, le petit-fils du Cosaque. J’ai soin de dire Michel et de bien prononcer son nom, car il n’aime pas qu’on l’appelle petit Michel.
Quand cela arrive à quelque mauvais plaisant, il n’entend pas cet appel-là; le criât-on dix fois et à tue-tête, il reste muet. Mais, si vous l’appelez avec déférence «Michel», il apparaît tout de suite comme s’il sortait de dessous la terre; il apparaît devant vous avec sa blanche chemise aux vastes manches, en pantalon large illimité, en ceinture rouge, cette même ceinture qu’il s’est achetée à la foire de Krolevetz. C’est là aussi qu’il a fait emplette de ses magnifiques bottes aux revers écarlates et de ce chapeau sombre, pour lequel il se passionna si fort et qu’il porte avec tant de précaution. Quand il le met, ce chapeau-là, le père-grand rit toujours un peu, en disant:
«Prends donc garde, Michel! prends donc garde à ton beau chapeau: les abeilles industrieuses vont te l’emporter pour y faire le miel. Ce serait une ruche toute trouvée pour elles, Michel.»
La blanche, la blonde petite fille aux pieds nus, la sœur de Michel, Mélasia, dès qu’elle voit le père-grand en humeur de plaisanter, se met à rire de si bon cœur, que sa gaieté fait vibrer sa voix argentine.
Mais Michel est philosophe; il ne s’émeut pas de l’inoffensive raillerie; il enfonce de plus belle son chapeau noir sur ses sourcils noirs, et il se promène sans broncher de long en large, comme un hetman en vue du camp ennemi. J’ai dit, que dès qu’on appelle Michel avec déférence, tout de suite il apparaît comme s’il sortait de terre. Secouant alors sa chevelure brune et bouclée, il vous regarde de son bon regard, et vous demande avec civilité: «Que désirez-vous?» Et si vous désirez voir le père-grand, il court à l’instant et vous amène le vieux, toujours très occupé dans son rucher. Si c’est sa petite sœur Mélasia que vous voulez voir, il vous présentera bien vite aussi la petite sœur Mélasia. Parfois Mélasia, qui est timide avec les étrangers et même un peu sauvage, au lieu de se montrer, se cache dans l’herbe ou bien derrière une ruche.
Mélasia est mignonne, petite comme un tout petit nœud de ruban rose; elle peut se cacher partout; ajoutez encore à cela que Mélasia croit fermement, si elle ferme un œil, que personne ne la trouvera jamais. Pour les deux yeux, jamais de la vie elle ne voudrait les fermer à la fois; il faut bien qu’elle en garde un ouvert pour voir ce qui se passe.
Mais Michel, qui connaît toutes les cachettes, la déniche toujours, et s’il ne parvient pas à lui persuader de venir se présenter de bonne volonté (Mélasia a sa volonté à elle), eh bien! il la prend sans façon dans ses bras, en riant, quoique peut-être Mélasia le pince malicieusement en route. Vous êtes étonné? Ah! tout est possible.
Une douce et charmante petite fille m’a mordu un jour jusqu’au vif, parce que je l’avais soulevée dans mes bras sans lui en demander la permission. C’est mal de mordre, il n’y a pas à dire, c’est mal et peu gentil, mais il n’est pas non plus gracieux ni bon d’obliger quelqu’un à faire ce qu’il ne veut pas sans lui donner de bonnes petites raisons.
Michel ne contrarierait pas sa petite sœur, bien sûr, si elle pouvait s’offenser ou se fâcher sérieusement. Non, Mélasia ne se défend pas ainsi par colère, mais par confusion, car c’est terrible comme Mélasia devient facilement confuse et honteuse. Dès qu’elle aperçoit un étranger, eh bien! je ne dis pas seulement son visage frais, mais ses pieds mignons même paraissent se colorer vivement d’une rougeur subite, et elle s’enfuit, et vous, vous ne pouvez pas préciser ce qui s’est enfui à votre approche. Était-ce le petit lièvre qui bondit? Était-ce un oiseau qui s’envole, ou la petite fille qui s’enfuit et disparaît? Vous ne pouvez pas vous-représenter son image exacte ni distincte à vous-même, ni la décrire aux autres. Et si vous entendiez comme, vous, vous êtes dessiné et dépeint par Mélasia! Et votre habillement, et votre démarche, et votre air, et votre regard!
Elle, elle réussit à vous voir et à vous examiner, avec un demi-regard, et elle vous décrira si bien après par ses paroles, qu’une autre fois tout le monde de la maison vous reconnaîtra dès que vous entrerez, sans vous avoir jamais vu: «Ah! voilà ce monsieur ou cette dame dont Mélasia nous a parlé!»
Quoique cela soit très difficile d’après ce que vous voyez, je vais vous conseiller de faire connaissance avec Mélasia, parce que c’est une petite fille très intelligente, qui sait beaucoup de choses et qui est si caressante et si affable, qu’elle vous apprendra volontiers tout ce qu’elle sait. Que de belles chansons elle chante! Que de contes amusants elle raconte! Et ce n’est pas assez qu’elle connaisse le chemin menant à Kiew, elle peut aussi vous indiquer la route qu’on prend pour aller à Cherson.
Voilà que le vieux Cosaque, il s’appelait Zahayny, ayant donc fait une haie de branches entortillées, mit dans l’enceinte un grand nombre de ruches. Je crois qu’il y avait là des ruches, autant que sur un champ fertile il y a des gerbes. Et maintenant, je pense qu’on ne pourrait même les compter, tant il y en a. Il doit y en avoir une multitude, parce que les essaims s’essaiment là si bien, que je crains seulement de le dire dans un moment où vous n’aimeriez pas à me croire.
Je me souviens que ce n’était qu’un cri continuel: «L’essaim! l’essaim! De la forêt, des champs, voilà qu’il approche!» Tantôt, c’est Michel qui s’écrie: «L’essaim!» et Mélasia le répète mille fois de sa voix claire; on croirait entendre sonner dans des petites clochettes ce mot répété par elle: «L’essaim! l’essaim! l’essaim!» Tantôt c’est Mélasia qui avertit et fait entendre son mot d’ordre: «Approche! approche!» et Michel accourt pour vérifier si cela est bien vrai ainsi. Tantôt c’est le père-grand qui, en faisant ses paniers de paille, soudain aura vent, comme inspiré, que l’essaim n’est pas loin, et il s’empresse d’aller le couvrir. Il y avait terriblement d’occupation dans le rucher, et quelle attention il fallait avoir!
Dans un coin du rucher le père-grand avait tressé une hutte de branches vertes, et Michel la couvrit de paille, et je vous assure que Michel le fit en maître habile. Et Mélasia balaya devant la porte, minutieusement, et dit avec contentement: «Voilà! c’est fait, et tout est prêt maintenant!»
Le père-grand et Michel plantèrent dans le rucher l’aubier, et le sureau, et les belles roses, et Mélasia sema toute chose en fait de fleurs et légumes, et tout prit racine, poussa, fleurit pèle-mêle, comme le font des gens pendant la fête. Cela étonnait grandement Mélasia, car, assurait-elle, elle semait tout à sa place, avec une régularité rigoureuse, et voilà que pareille mêlée avait pu croître! Oh! que c’est étonnant!
Michel reste silencieux et ne dit mot en réponse à ce discours de la petite sœur, parce qu’il ne veut pas engager une discussion avec une petite fille; il reste silencieux et ne fait que regarder, parfois très ironiquement, comment la rose, se penchant sur sa tige, a l’air de demander à quel propos l’humble mauve devient sa proche voisine, à elle, si belle et si splendide; et l’humble mauve, sans faire attention à cette question, épanouit hardiment son armée de petites fleurs, sans perdre courage et sans s’inquiéter des autres mauves, ses parentes, que sépare d’elle une barrière de mille-feuilles insolentes. La livèche aux larges feuilles fait amitié avec une touffe de chanvre, et le chanvre pénètre entre les pavots superbes, et le pavot se précipite dans les pois de senteur, et partout se glissent les épis de blé, un ici, là deux, et plus loin toute une famille. Et où il y a une famille d’épis, on est sûr qu’elle entraîne avec elle la rouge ivraie et les bleus bluets.
Et d’herbes, de plantes qui n’étaient ni semées, ni invitées, ni soignées, et qui pénétrèrent dans le rucher du père-grand en envahisseurs, quelle quantité, bon Dieu! Et au-dessus de tout cela les abeilles qui sortent et bourdonnent, les oiseaux qui gazouillent.
Qu’il fait bon dans ce rucher! On y respire avec une telle ivresse, un tel bonheur! On y est si libre! On s’y sent si léger! Portez vos regards où il vous plaira: de tous côtés vous voyez les champs vastes, immenses, et dans les champs vous apercevez par-ci par-là des chênes qui s’élèvent à distance l’un de l’autre comme des tentes dressées contre les rayons ardents du soleil. Vous voyez un chemin qui serpente, c’est le chemin du village, mais on n’aperçoit pas du tout le village lui-même derrière le grand tombeau au sommet pointu. De l’ouest on voit la grande forêt si sombre et si massive.
Que c’était agréable pour Michel de passer l’été dans le rucher du père-grand! Et la petite Mélasia, abandonnant sa mère avec la sœur aînée, et les laissant mener la maison comme elles veulent, s’installe, cajolante, chez le père-grand, pour mettre ordre, elle aussi, dans le rucher. Elle s’occupait à sa façon du ménage! Cela veut dire qu’elle chantait toute espèce de chansons, allait aux champs pour chercher des fraises, sans compter qu’un jour elle brisa deux pots au lait, très fragiles, disait-elle, et une soupière, fragile aussi. Mais bah!. Elle soignait si bien les abeilles! Elle les soignait à tel point que ces abeilles ingrates la piquaient quelquefois et transformaient même son visage charmant de telle sorte que, si on la regardait d’un côté, c’était Mélasia qu’on voyait, c’était sa joue rosée, son œil pétillant; mais, si vous regardiez de l’autre côté, vous voyiez je ne sais quoi de bouffi, qui ne lui ressemblait plus du tout. Mélasia se levait le matin avant tout le monde et elle se couchait après tout le monde, puisque, comme je l’ai déjà dit, tout en soignant le ménage du père-grand, elle avait encore une telle quantité d’affaires que. Aïe! aïe! aïe! que d’affaires elle avait!
Voilà qu’un soir Michel, fatigué, était couché sur l’herbe, dans le rucher, et regardait le ciel. Déjà les étoiles luisaient et brillaient, et un mince croissant scintillait au-dessus d’un chêne. On l’eût dit accroché à la cime. Mélasia, fatiguée aussi, était couchée non loin de son frère, et se tournant et se retournant, elle sommeillait et se demandait: Pourquoi donc le père-grand tarde-t-il tant à revenir? Quelle raison pouvait le retenir si tard? Et le père-grand ne revenait pas, non, il ne revenait pas! Et dans le lointain on ne pouvait le voir!
Le père-grand est allé ce soir-là au village, et cette fois il était en retard! Voilà qu’il fait déjà nuit close et noire; les étoiles étincellent, le croissant monte bien haut, Michel s’est endormi et le père-grand n’est pas de retour! On ne l’entend même pas, tout est tranquille!
Soudain la terre parut rendre un son prolongé du côté de la forêt profonde, et quelque chose d’énorme et de lourd s’approche du rucher. Tellement lourd, tellement lourd, qu’on n’aurait pu le peser sur aucune balance! Le voilà! le voilà! Voilà que cette chose extraordinaire fait tomber la haie, se jette à travers les ruches et les renverse! Voilà que cette masse sombre écrase les fleurs suaves, brise et casse les rosiers et les aubiers, et secoue en passant le chêne lui-même, si vigoureux et si puissant! Oh! Dieu des dieux!
Et que pensez-vous que c’était?
Un ours! un ours énorme, velu, ébouriffé, terrible! Un ours qui vient épouvanter le rucher de sa visite nocturne!
Que doit faire Mélasia? Le sommeil s’est envolé comme un oiseau effrayé, et ses mains mignonnes se joignent dans la terreur etdans le désespoir. Oh! le terrible, le terrible visiteur! Pas de salut! Cher frère bien-aimé! Comment sauver le frère chéri? Oh! comment?
Michel dormait d’un doux sommeil tout près de la hutte, tout près de la porte, et voilà qu’il sent des bras, des petits bras tremblants qui l’entourent comme une branche de houblon, et une douce voix qui balbutie tout bas, tout bas:
«Frère! frère!
–Eh quoi? demanda-t-il sans ouvrir ses yeux appesantis par le doux sommeil.
–Viens! viens ici, frère! Oh! mais viens donc! Viens dans la hutte! Je suis seule ici. J’ai peur. Viens, frère! Oh, viens! viens ici!»
Et les bras mignons le tiraient tout sommeillant, encore endormi, et l’entraînaient de toute leur petite force, et de chaudes larmes de terreur et d’émotion cruelle tombaient sur la tête nonchalamment penchée du dormeur, et le petit cœur, le petit cœur fidèle et dévoué palpitait près de lui. Et lui, dans son sommeil, fit deux pas vers la hutte, sans conscience, machinalement, puis se laissa retomber de nouveau sur la terre, accablé par le calme et délicieux sommeil. Il ne sentait même pas comme les petits bras tremblants se martyrisaient en vain et craquaient douloureusement en voulant le soulever, et il n’entendait pas les sanglots étouffés de Mélasia épuisée.
Et l’ours? En vrai maître gourmand il s’avance et jette ses regards de tous côtés, comme s’il cherchait la meilleure ruche, le miel le plus friand, et dès qu’une ruche digne de son choix lui saute aux yeux, tout de suite il tend sa patte velue, il enlève le miel, et il le déguste en se dandinant.
Oh Dieu! oh Dieu! si maintenant Michel pouvait rester endormi! Qu’arriverait-il s’il se réveillait? Il ne voudrait pas écouter la petite sœur, il irait lutter avec l’ours! Depuis longtemps il désire ardemment rencontrer un ours, il l’a dit maintes fois! Les hommes sont si hardis!
Oh Dieu! oh Dieu! voilà que l’ours regarde de son côté, c’est elle qu’il va dévorer…, la pauvre Mélasia…, il va la dévorer, oui! oui! Sera-t-il content après, du moins? Sera-t-il rassasié? Oh! fasse le bon Dieu qu’elle lui suffise et qu’il ne touche pas au frère chéri! Eh bien! oui, qu’il la dévore, pourvu qu’il ne touche pas au frère!
Les petits bras se joignaient toujours plus étroitement, et les pleurs coulaient et ruisselaient toujours plus chauds et plus abondants des doux yeux de la petite fille.
«EH QUOI?» DEMANDA-T-IL SANS OUVRIR SES YEUX APPESANTIS PAR LE
DOUX SOMMEIL.
Et le terrible gourmet velu revenu à son souper dévorait le miel tout à son aise et avec bonheur. Parfois il interrompt son repas; parfois, il jette un regard sur le croissant brillant, comme pour dire: «Tu éclaires bien, petit croissant, je suis content de toi!» Parfois il semble écouter comme s’il pensait: «Je crois entendre quelque part ici une petite fille qui pleure!» Malheur! malheur! comment ne se brisa-t-il pas en éclats, le petit cœur, ayant battu et tremblé si longtemps et si vite dans ces horribles angoisses!
Voilà que l’ours se mit à tousser. On n’a qu’à se préparer à entendre son rugissement. Mais non, il se laisse tomber par terre et puis il commence à se rouler et à se vautrer dans l’herbe épaisse; le monstre perfide a ses heures de gaieté!
Alors les petits bras de nouveau s’emparèrent du frère endormi, et le saisirent avec force. Ce fut à grand’peine que les pauvres petits bras, tendus à se rompre, parvinrent par un effort démesuré à soulever le corps alourdi et à le traîner dans la hutte pour l’y mettre, lui du moins, en sûreté!
«Mais qu’y a-t-il donc?» s’écria Michel en s’éveillant enfin et en se trouvant prisonnier sans savoir comment cela était arrivé dans l’obscurité complète. Il secoue la porte de la hutte: «Ouvrez donc! Qu’y a-t-il? Mais ouvrez donc!
–Frère! frère chéri., c’est moi!. c’est moi!.» lui répondit du dehors une petite voix tremblante. Mélasia dans son trouble était restée dehors. Dans son empressement à mettre son frère à l’abri, elle s’était oubliée elle-même.
«Ouvre donc, Mélasia! s’écria Michel de nouveau. Pourquoi m’as-tu enferme? Veux-tu que j’enfonce la porte? Ouvre-moi donc!»
Et de nouveau il ébranle violemment la porte.
«Frère! lui dit du dehors la petite sœur, frère!.» Mais sa voix se meurt dans son gosier, elle a vu l’ours se lever. Il écoute, il épie et suit ses mouvements. Il fait claquer ses blanches dents. comme une personne qui rit du mal qu’elle va faire.
Cependant:
«Laisse-moi sortir d’ici!» cria encore Michel, inquiet et impatient, et la porte sauta sous son effort puissant.
La petite sœur, qui était devant, tomba du choc à la renverse, comme une gerbe frappée de la foudre. L’ours fit claquer de nouveau ses dents blanches.
En ce moment elle jeta un cri tellement sonore, si perçant et aigu, que Michel, quoiqu’il n’eût rien vu, recula en arrière. «Pourquoi criait-elle?» L’ours, entendant ce cri surhumain, s’arrête, regarde, flaire indécis, inquiet à son tour, puis soudain, pris à son tour d’une subite épouvante, il fait volte-face, il prend la fuite et se met à courir vers la forêt, enfonçant la terre sous sa fuite lourde et pourtant rapide.
Quand Michel rassembla ses esprits et releva sa petite sœur, quand il apprit d’elle enfin ce qui était arrivé, on ne voyait, on n’entendait plus rien. C’était en vain que tous deux retenaient leur respiration et tendaient leurs oreilles, écoutant et se tenant tout près l’un de l’autre. Tout était tranquille. La lune luisait et les étoiles brillaient.
Le cri suprême de Mélasia les avait sauvés l’un et l’autre.
«Conte-moi, Mélasia, conte-moi donc tous les détails de ce qui est arrivé, dit Michel à sa petite sœur.
–Non! non! oh! pas encore! J’ai encore trop peur! Je suis toute saisie encore, répondait Mélasia.
–Que tu es donc poltronne, Mélasia! disait Michel en souriant.
–Tais-toi, tais-toi!» répondait Mélasia, et elle se pressait contre l’épaule de son frère toujours plus fortement et plus étroitement, comme on se presse contre un trésor retrouvé.
«Chère petite sœur, disait Michel, quel dur sommeil! Je neveux plus dormir. Mais toi, petite sœur, n’aurais-tu pas rêvé?
–Rêvé!» s’écria Mélasia!
La lune ne projetait qu’une lumière faible et les étoiles luisaient à peine, quand ils entendirent une chanson cosaque, qui vibrait comme une cloche fêlée, et ils virent au loin une figure humaine. C’était le père-grand qui revenait en chantant.
Ils se précipitèrent à sa rencontre, et le père-grand de rire et de leur demander:
«Eh bien, petits! vous vous êtes ennuyés sans le vieux père? Bien sûr, hein? Il m’a été impossible de revenir plus tôt! Impossible! J’ai rencontré un ancien ami et. et. et je suis en retard.»
Et le père-grand se remet à fredonner de nouveau la chanson cosaque:
«Quand nous étions, nous autres, en pleine mer, quand nous étions en pleine liberté, nous avions l’habitude de visiter le Turc infidèle.»,
Tout en allant le père-grand branlait sa tête avec une dignité tant soit peu chancelante, et de sa voix fêlée, sa chanson tantôt renversait les Cosaques dans la pleine mer, tantôt les laissait en liberté, pour les envoyer après à la rencontre des Turcs infidèles.
«Père-grand! père-grand! lui dit Mélasia, l’ours est venu chez nous!
–Voilà, père-grand, dit Michel. Mélasia assure que l’ours est venu dans notre rucher. Je dormais si profondément quand elle m’a saisi que ne pouvant me réveiller elle m’a jeté dans la hutte et enfermé. J’ai crié: «Ouvre-moi! laisse-moi sortir!» Elle ne m’a pas obéi. J’ai été obligé d’enfoncer la porte. Je me suis alors élancé. Mélasia alors a jeté un cri, mais quel cri, père-grand! un cri qui me fit voir toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. C’était comme un coup de poignard enfoncé dans mon oreille! J’ai alors rassemblé mes idées, et j’ai vu la pauvre Mélasia étendue à mes pieds. L’ours n’était plus là, mais les ruches sont renversées, l’herbe toute foulée, les arbrisseaux brisés et écrasés. Mélasia affirme, jure que l’ours est venu... A-t-elle rêvé? Cependant un ennemi est venu. Le dégât le prouve.»
Le père-grand avait commencé par écouter en fredonnant et en souriant, ne prêtant qu’une légère attention au récit et tout entier encore probablement au souvenir de sa rencontre avec l’ancien ami; mais quand le récit aboutit aux «ruches roulées par terre» et aux «arbrisseaux écrasés», le père-grand murmura: «Aïe! aïe!» et il alla d’un pas plus rapide vers le rucher. Quand il vit le désastre:
«Fusses-tu mort sans jamais goûter au miel, monstre velu! murmurait le père-grand, en relevant les ruches et en les remettant à leur place. Quelle misère et quel dommage!»
Michel, en aidant le père-grand, donnait le conseil de se pourvoir d’un bon fusil pour l’avenir, et dans son idée il visait déjà le terrible ours et le punissait de son méfait.
Le petite Mélasia, en marchant derrière eux, contait pour la dixième fois comme le velu avait tout brisé et foulé, tout écrasé, comme il s’était roulé et vautré par terre, comme il faisait claquer ses blanches dents, comme il avait dévoré le bon miel et comme il s’approchait, s’approchait toujours plus près, toujours plus près.
Et Mélasia avait les yeux qui brillaient et étincelaient d’une lumière plus vive que les étoiles du ciel, dont la lumière commençait à faiblir et à s’éteindre, parce que le jour allait poindre. Bientôt une bande rose flamboya au levant.
«Vive Mélasia! vive la petite fille! vive la plus délicieuse merveille du bon Dieu! dit le père-grand souriant et regardant le frais visage de sa bienaimée Mélasia illuminé par la joie triomphante et par l’angoisse soufferte. Quoique tu sois pâle encore, tu es une vraie fille des héros! N’est-il pas surprenant qu’un tel bouton de rose ait. eu la hardiesse de défendre et de délivrer son frère des pattes et des dents d’un ours? N’est-il pas merveilleux qu’une si faible et si frêle petite fille ait chassé et effrayé le terrible ours?»
La première chose ne semblait pas une merveille à Mélasia, tant le frère lui était cher et précieux. Comment ne pas le défendre, comment ne pas mourir pour lui avec joie? Quant à la seconde chose, Mélasia la mettait aussi au nombre des miracles du bon Dieu, car en se souvenant de la fuite subite de l’ours, après son grand cri, elle se prenait à rire de bon cœur, non sans un peu de fierté bien permise.
«Petite sœur Mélasia! quand donc pourrai-je te défendre, moi?» demandait parfois Michel, sentant frémir en lui son courage trompé. Il se tournait de tout côté, cherchant quelque chose de terrible à affronter et de difficile à faire. «Quand trouverai-je une occasion de te délivrer, à mon tour, d’un danger?»
Et maintes fois Michel se coucha avec un vague espoir de voir revenir l’ours, et alors il ne dormait pas de la nuit, et il touchait au fusil qu’il s’était acheté, mais jusqu’à présent il n’a pas eu la satisfaction de revoir le visiteur velu et ébouriffé!
«Oh, s’il revenait! s’il revenait!» demande Michel avec passion et véhémence.
«Frère! frère! que le bon Dieu nous garde! que la bonne Vierge nous protège! dit la petite sœur Mélasia quand elle entend de telles paroles? Que le bon Dieu te tienne sous son regard, frère chéri et bien-aimé!»
Et la petite sœur Mélasia se sent, rien que par la pensée, si alarmée, qu’elle pâlit et tremble de terreur.
Et voilà la fin. Ce qui arriva plus tard ou ce qui doit arriver, je ne le sais pas, donc je ne puis le conter ne le sachant pas, ni vous inventer des choses à mon plaisir. Excusez mon impuissance, je ne puis pas mentir pour ajouter à la vérité, mais acceptez un souhait sincère: Que le bon Dieu vous fasse la grâce de vous donner une brave petite sœur telle que Mélasia, prête à mourir pour vous défendre et assez fine dans sa faiblesse pour vous délivrer, sans coup férir, de l’ours terrible et affamé.
(D’après MARKO WOVCZOK.)
S’AGITER N’EST PAS AVANCER
Rien de plus vrai que le joli vers d’une des fables de S. Lavallette qui sert de titre à ce chapitre. Il ne faut pas plus confondre le mouvement avec la marche, l’agitation avec l’activité, que le bruit avec la besogne, que le tapage avec la musique.
On peut remuer beaucoup sans avancer d’un pas; le pauvre écureuil tournant, toujours captif, dans sa cage en est l’exemple. La turbulence n’a jamais mené personne à aucun but. Quand on remue avec trop de précipitation les bras et les jambes en nageant, savez-vous ce qui arrive? On enfonce. Le bon nageur est celui qui mesure ses mouvements et laisse à chacun d’eux le temps de produire son effet.
Le cheval qui piaffe le plus n’est pas celui qui gagne le prix de la course; de même l’enfant qui piétine au moral et au matériel devant sa tâche n’est pas celui qui l’accomplit le plus vite et le mieux; être affairé, être effaré, n’est pas être laborieux.
Il ne manque pas de gens qui, tant que dure le jour, sont en l’air. Ils n’ont pas pris une minute de repos: le soir venu, ils n’ont rien fait. Le chaos est toujours autour d’eux et dans leurs têtes, leur seul ouvrage est le désordre. Ils ne réussissent à rien, sinon à être les mouches de leur propre coche.
Quand on parle trop vite, on bredouille. Celui qui ne dirige pas sa course, qui la précipite trop, qui, comme le lièvre de la fable, court, s’arrête ou se détourne oublieux du but, la tortue elle-même le devance. La patience arrive où l’impatience échoue.
Se croire des bottes de sept lieues parce qu’on a du vif-argent dans les pieds, c’est croire aux fictions des contes de fées, sans les comprendre.
Il ne faut pas viser à tous les résultats à la fois; en chercher un, et puis un autre après, c’est déjà bien faire. Celui-là n’excelle en rien qui dépense ses forces sur toutes choses. Chasser deux lièvres à la fois, c’est s’exposer à rentrer capot. L’abeille qui ne choisit pas sa fleur n’a jamais fait de bon miel; dans un grand dîner vouloir manger de tout, c’est se gâter l’estomac. Il faut toujours en revenir au vieux dicton: «Qui trop embrasse mal étreint.»
L’économie des forces peut donc seule en assurer l’effet; tout effort est récompensé qui est proportionné avec le but à atteindre; tout effort démesuré, au contraire, est stérile.
Dans les combats de l’esprit comme dans tous autres, il n’est pas sage de lutter un contre tous. Il faut s’arranger pour défaire ses ennemis un à un, comme fit le dernier Horace avec les trois Curiaces. Mettre de l’ordre, mettre de la méthode dans l’attaque, c’est s’assurer la victoire. Mais se précipiter comme un fou sur l’ennemi, c’est perdre la tête, c’est lui livrer le gain du combat.
Vous avez tant à faire, dites-vous? Raison de plus pour ne pas entreprendre de faire tout à la fois. Quand un ingénieur est chargé de supprimer une montagne, d’en faire une plaine, croyez-vous qu’il doive se proposer d’enlever la montagne tout d’un bloc? Non. Vous savez bien que c’est pelletée à pelletée, coup de pioche à coup de pioche seulement qu’il y parviendra. Faites donc comme lui et vous verrez sous vos efforts constants et répétés la montagne de vos travaux disparaître. De même que vous ne pouvez lire toutes les pages d’un livre à fois, que vous savez du reste que vous n’y parviendrez que ligne à ligne et feuillet par feuillet, de même vous ne viendrez à bout de la multiplicité de vos diverses études qu’en les coordonnant.
Il n’est œuvre si menue que le défaut de plan ne puisse faire avorter. Il n’est œuvre si gigantesque que l’effort persévérant et bien réglé ne puisse mener à fin. La dent d’un rat suffirait à mettre en poussière le cèdre du Jardin des plantes, si la longueur de sa vie pouvait égaler la durée de la tâche.
L’esprit de l’homme est une sorte d’estomac moral. Le gros morceau qui, avalé tout d’un coup, le suffoquerait, l’étoufferait, le mènerait à la mort par l’indigestion, ce morceau absorbé bouchée par bouchée le mène à la vie; où le glouton succombe, celui qui sait manger reprend force et vigueur.
Non, cette tâche, non, cette leçon n’est pas trop longue; non, ces devoirs ne dépassent vos forces ni par leur multiplicité ni par leur étendue, si, au lieu de les aborder avec impatience, avec trouble, avec furie et sans méthode, vous les abordez tranquillement, c’est-à-dire patiemment. La patience dans l’ordre c’est la force invincible.
La première ligne de votre leçon est-elle plus longue que les autres? Non. Vous ferait-elle peur, cette ligne-là, si elle était toute seule? Non; eh bien, supposez qu’elle est toute votre leçon, apprenez-la, c’est bientôt fait, et voilà déjà votre leçon diminuée. Après la première viendra la seconde, puis la troisième, puis succcessivement toutes les autres; et quand vous en serez à la dernière, vous verrez bien que cette terrible dernière ligne n’était ni si éloignée de la première qu’elle vous avait semblé tout d’abord, ni plus difficile à retenir.
Résumons-nous: pour un paresseux, pour un étourdi, pour un turbulent, pour un impatient, toute tâche est énorme. Mais l’élève studieux, qui ne s’exagère aucune difficulté, celui-là ne s’effraye de rien, il commence par examiner sa tâche. Il veut la connaître d’abord dans son ensemble pour s’en donner l’intelligence générale, et, ce premier travail fait, il la divise. La sage division d’un travail, c’est le procédé qui mène les plus faibles eux-mêmes à l’accomplir.
L’ORDRE ET LA MÉMOIRE
C’est mal comprendre l’utilité de la mémoire que de croire qu’elle peut remplacer l’ordre. Quand on compte trop sur sa mémoire, on en arrive forcément à produire le contraire de l’ordre et à mettre à la place ou la confusion elle-même, ou, ce qui relativement est déjà du désordre, l’apparence de la confusion. Il faut que l’ordre soit matériel aussi bien que moral; il faut qu’il soit visible. Il ne suffit pas que vos livres, vos propos, vos affaires, que vos idées même soient bien rangés dans votre cerveau, il faut que tout cela soit bien rangé sur votre table, dans votre bibliothèque, dans votre bureau, dans vos discours et dans vos actions; il faut, en un mot, que l’ordre soit en vous et autour de vous, évident, non pas seulement pour vous-même, mais pour les autres.
Que diriez-vous d’un écrivain dont les pensées, se tenant bien dans son esprit, seraient présentées au public sans suite, sans méthode et pêle-mêle?– «Mais je m’y retrouve!» répondrait cet écrivain. Qu’il s’y retrouve, c’est bon pour lui, mais non pour nous; et encore!–Se retrouver dans un fouillis, c’est en somme s’être perdu. N’avoir point à se retrouver, n’avoir pu s’égarer, n’avoir pu se perdre, n’avoir point à rechercher sa voie, c’est là l’ordre. D’ailleurs, la mémoire toute seule, comme la boussole, peut être un guide trompeur; aux jours de tempête elle peut avoir ses heures d’affolement. Il ne suffit donc pas de savoir où l’on va, il faut encore que chacun puisse vous suivre de l’œil sur la route, pour vous rejoindre, pour vous remettre dans le bon chemin si vous vous trompez, et vous remplacer au besoin si vous êtes hors d’état d’achever votre course. Il faut que l’ordre que vous avez mis dans vos travaux, dans la direction imprimée par vous soit à vos affaires, soit à celles des autres, soit tel que, si vous êtes un jour interrompu, fût-ce subitement, dans votre emploi, un autre puisse, en le reprenant, reprendre sans difficulté, sans embarras, votre tâche commencée, la trouver claire et bien réglée et la parfaire. Le savant, l’inventeur, le chef d’État, le chef de maison qui emportent le secret de leurs affaires avec eux, qui laissent une tâche impossible à leurs successeurs, ceux-là ont été de mauvais administrateurs, d’exécrables gérants soit de leurs propres affaires, soit de celles d’autrui. Le meilleur administrateur, en un mot, est celui qui, par l’ordre qu’il laisse dans son administration, a rendu la tâche plus facile à son successeur. Si donc vous entendez dire d’un homme: «C’est un administrateur admirable, c’est un chef sans pareil; il a tout dans sa tête, son cerveau contient tout et ne perd rien; s’il mourait, personne ne pourrait le remplacer: ce serait la fin de tout ce qu’il a fondé,» dites-vous que celui-là n’a pas mérité les éloges que vous en avez entendu faire et que ce qu’on loue en lui est ce qu’il faudrait au contraire blâmer. Qu’il soit maudit, celui qui, dans son égoïsme, et pour se rendre indispensable, fait son secret personnel de l’ordre nécessaire à la bonne gestion des affaires qui lui ont été confiées.