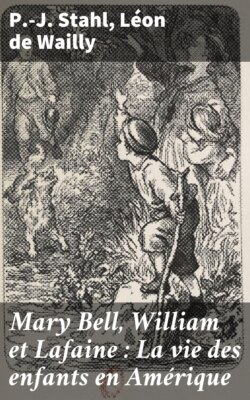Читать книгу Mary Bell, William et Lafaine : La vie des enfants en Amérique - P.-J. Stahl - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LE RÉCIT DE WILLIAM
Оглавление«Mon histoire, dit William, est plutôt je crois, pour des garçons que pour des filles, ou du moins la morale, si morale il y a, s’applique mieux à des garçons qu’à vous, mesdemoiselles. En outre, je crains qu’en lui-même ce récit, ne vous semble pas bien, intéressant; ce n’est absolument que la description d’une certaine nuit que je passai sans pouvoir rentrer à la maison, et de mes aventures pendant que je cherchais à me loger dans un hôtel.
— Ce sera très intéressant,» s’écria une des petites filles.
William commença:
«Je revenais de la campagne, où j’avais été passer la belle saison. Tout le reste de la famille était absent, et l’on n’avait laissé qu’un seul domestique à la garde de la maison. J’avais précédé mon père, ma mère et Madeleine de quelques jours, afin de tout préparer pour les recevoir.
«Le train que j’avais pris devait arriver à neuf heures; je savais que Jean ne fermait jamais la maison avant dix: je pensais donc arriver à temps.
— Qui était Jean? demanda la petite Marianne.
— C’était le domestique qui gardait la maison.
— Tu aurais pu deviner cela, ajouta Caroline; il ne faut pas interrompre l’histoire en faisant des questions qu’un peu de réflexion rendra inutiles.
— Je croyais arriver, reprit William, avant que Jean eût fermé la maison, et je me disais que, si même j’étais en retard, ce ne serait qu’un petit malheur, car j’avais un passe-partout.
— Qu’est-ce que c’est que cela? demanda Caroline.
— C’est une clef avec laquelle on entre chez soi sans déranger personne, expliqua William.
— Vous auriez pu deviner cela, dit la petite Marianne, et puis il ne faut pas interrompre l’histoire en faisant des questions.»
Tous les enfants rirent, et Caroline peut-être plus que les autres.
«Ah! petit démon, tu te moques de moi, de moi, la reine; je vais te faire mettre en prison.»
Caroline prit bien la plaisanterie; c’était ce qu’il y avait de mieux à faire. Elle était pleine de tact, et comprenait qu’elle n’avait que ce moyen de se tirer de la position délicate où l’avait placée Marianne. Si, au contraire, elle avait pris un air de dignité offensée, elle n’aurait fait qu’empirer les choses et se rendre ridicule.
«Nous n’étions plus qu’à dix ou douze lieues de New-York, quand notre train dut s’arrêter à cause d’un accident.
— Et quel accident? demanda Riquet. Aviez-vous écrasé une vache?
— Non, ce n’était pas une vache; à vrai dire, je n’ai pas su au juste ce que c’était. Quelque chose s’est dérangé dans la locomotive, et nous avons dû attendre une heure entière, pendant qu’on allait nous en chercher une autre. Ensuite, à presque toutes les stations, nous avons été obligés de nous arrêter pour laisser passer d’autres trains; et quand enfin nous sommes arrivés à New-York, j’ai regardé ma montre et j’ai vu qu’il était onze heures cinq minutes. Il n’y avait pas à en douter, Jean devait être couché.
«Je me décidai néanmoins à aller à la maison, où je comptais entrer au moyen de mon passe-partout, et Jean n’aurait su mon arrivée que le lendemain malin. J’avais déjà tout combiné en imagination pour me procurer de la lumière et tout ce qu’il me faudrait sans éveiller le domestique. Plus tard, je vous dirai quelles étaient ces combinaisons. Dès que j’eus quitté le train, je pris un cab et je donnai mes numéros au cocher.
— Quels numéros? demanda Sarah qui, n’avait jamais voyagé en chemin de fer. et qui ne comprenait pas ce que voulait dire William.
— Les numéros de mon bagage, dit celui-ci. Dans nos chemins de fer, les hommes chargés du bagage ont des jetons en métal avec des numéros gravés dessus; ils sont tous par paires, et le même chiffre se trouve répété sur chacun d’eux. Au départ, l’employé du bagage en prend une paire; il en attache un à votre malle, à l’aide d’une petite courroie, et vous donne l’autre. De cette façon, votre malle se trouve numérotée et vous en avez le numéro sur le jeton qui vous a été donné. On en met ainsi sur chacun des colis.
— C’est une bien bonne idée, déclara Riquet. Et quels étaient tes numéros?
— Je ne me souviens que d’un, c’était le numéro 1 066.
— Oh! quelle quantité de malles, dit Riquet. Tout ça dans le même train?
— Non, peut-être pas, mais il part beaucoup de trains dans une journée, et les employés au bagage sont obligés d’avoir un grand nombre de jetons. Comme je vous l’ai déjà dit, je donnai les miens au cocher, afin qu’il allât réclamer ma malle et mon sac de nuit. Il y a toujours tant de foule, que les voyageurs laissent généralement ce soin aux cochers. L’arrivée d’un train dans une grande ville, surtout la nuit, est une des scènes les plus bruyantes et les plus agitées que l’on puisse voir. La gare est remplie d’hommes, de femmes et d’enfants qui courent en tous sens; des centaines de cochers se pressent contre une corde en criant à qui mieux mieux: «Demandez une voiture! Voilà une voiture!» Tandis que d’autres hommes, qui sont envoyés par les hôtels, vous crient aux oreilles le nom de celui qu’ils représentent. Heureusement qu’au-dessus de tout ce tapage on entend la voix claire de l’employé du bagage qui crie les numéros pour aider les cochers à retrouver les colis. Tous ces bruits et ces cris sont quelque chose d’assourdissant.
— Oh! comme je voudrais y être! soupira Biquet.
— Quand le cocher m’eut désigné sa voiture, il retourna chercher mon bagage, et moi je l’attendis dans le fiacre. Bientôt le bruit de ma malle retombant lourdement sur l’impériale m’annonça son retour. Je lui donnai l’adresse et nous partîmes.
«Les rues, éclairées par le gaz, étaient aussi brillantes qu’en plein midi; les trottoirs étaient encombrés de gens qui sortaient des spectacles et des concerts, et les omnibus, chargés de monde, se croisaient bruyamment dans la grande rue de Broadway. Bientôt le cocher s’arrêta à notre porte. Il tira la sonnette, et, en un clin d’œil, il descendit ma malle et la déposa sur les marches, devant la maison. Je lui payai sa course, et il repartit.
«Je savais fort bien que sonner ne m’eût avancé de rien, car la sonnette répondait dans la cuisine, qui était dans le sous-sol, tandis que la chambre de Jean était dans les mansardes. Je pris donc mon passe-partout et j’ouvris la porte; ensuite je tirai ma malle jusque dans le grand vestibule, car nous en avons deux: le premier n’est guère qu’une petite entrée, mais le second est très grand. Je laissai les deux portes ouvertes, et, grâce à un réverbère qui se trouvait sur le trottoir, en face de notre maison, je pus y voir suffisamment pour ouvrir ma malle et y prendre des allumettes.
Cela ne pouvait te servir à rien, observa Riquet, puisque tu n’avais pas de lampe.
— Non, mais je comptais en chercher une dans le cabinet où on les mettait d’habitude. Ce cabinet était dans le sous-sol; j’avais le dessein de prendre un journal que j’avais acheté pour me distraire en route, de le plier très serré, et de m’en servir en guise de torche pour m’éclairer jusqu’à destination. J’en déchirai donc la moitié et je l’allumai avec une de mes allumettes. J’aurais très bien pu, en suivant les murs, me passer de lumière, mais j’avais peur de me promener comme cela dans l’obscurité.
— Oh! fit Riquet, et de quoi avais-tu peur?
— Mais je me disais que Jean pouvait, après touf, être dans la cuisine, et que s’il entendait des pas dans l’obscurité, il pourrait me prendre pour un voleur et...
— Venir te tirer un coup de fusil, n’est-ce pas? dit Riquet.
— Non, je n’ai pas cru qu’il me tuerait, mais j’ai craint que, s’il entendait du bruit, il ne se mît peut-être à la fenêtre et n’appelât la garde. Je gagnai sans peine le cabinet, grâce à ma torche de papier, qui pourtant n’était pas facile à manœuvrer. Si je la tenais tout à fait droite, avec la flamme en l’air, elle brûlait à peine et menaçait de s’éteindre à chaque instant; si, au contraire, je l’inclinais, le vent l’excitait et la faisait brûler si vite que je craignais de lui voir atteindre mes doigts avant que je pusse allumer la lampe. Tout le long de l’escalier tournant qui mène au sous-sol, je gardai donc les yeux fixés sur ma torche, tantôt l’inclinant et tantôt la relevant, selon les besoins du moment. Aussi j’étais dans le cabinet et j’avais allumé une lampe, qu’elle n’était encore qu’à moitié consumée. Je la soufflai et je mis le pied dessus, pour m’assurer qu’elle était complètement éteinte; ensuite, je montai l’escalier qui mène à ma chambre.
«Mais quel fut mon étonnement de trouver ma porte fermée à clef. Je n’y comprenais rien. J’allai aux autres portes, toutes étaient closes. J’étais fort embarrassé, car je n’avais pas de passe-partout pour les portes de l’intérieur, et pourtant si je ne parvenais pas à entrer dans une chambre à coucher, je voyais très clairement qu’il me faudrait passer la nuit dans le vestibule, avec mon sac de huit pour oreiller.
«Je grimpai jusqu’à la chambre de Jean, mais je la trouvai également fermée; je pensai alors à une certaine petite pièce dans le sous-sol, dont le domestique avait fait son salon, et je me dis que, s’il ne s’était pas couché à son heure habituelle, je le trouverais peut-être là.
— Eh bien! est-ce que tu es descendu? interrompit Riquet.
— Non, répondit William, car j’avais réfléchi, dans l’intervalle, que je ferais tout aussi bien d’aller demander l’hospitalité à l’hôtel. Il était certainement un peu tard, à onze heures et demie, pour se mettre à la recherche d’un logement, d’autant plus que je savais qu’à cette heure il n’y a plus d’omnibus, et qu’il me faudrait probablement aller à pied. Cependant je me décidai à faire cette expédition. J’éteignis ma lampe, je la laissai près de la porte, et je sortis. Je rencontrai encore quelques omnibus, mais ils n’allaient pas dans mon sens. Il y avait un grand nombre de voitures revenant des bals et des théâtres, et beaucoup de piétons sur les trottoirs, bien qu’il fût près de minuit.
«Presque tous les grands hôtels se trouvent à l’ouest de la ville, et il me fallut faire une demi-lieue avant d’en trouver un. Les hôtels de New-York sont énormes; ils ont souvent cinq et six étages; l’entrée est en général brillamment éclairée. La première pièce est un très vaste vestibule; au delà, il y a le bureau, où se trouvent des pupitres, la caisse, et une innombrable quantité de tableaux appliqués aux murs, avec quantité de numéros correspondant dans toutes les parties de la maison. Dans ce bureau, il y a toujours des garçons chargés de malles, qui courent à droite et à gauche, et des voyageurs en foule qui se font inscrire, qui paient leurs notes et qui questionnent les commis.
«Au premier hôtel où j’entrai, je demandai une chambre pour la nuit.
— Nous pouvons vous donner un lit dans une chambre avec d’autres personnes, me fut-il répondu, mais nous ne pouvons vous donner une chambre; la maison est pleine.
— Cela ne me convient pas, leur dis-je, et je sortis.
— Pourquoi n’as-tu pas voulu? s’informa Riquet.
— Mais parce que je n’aime pas partager une chambre avec des étrangers, répondit William. Ils peuvent être de très honnêtes gens, comme aussi ils peuvent être des voleurs; et il ne serait pas fort agréable, en se réveillant le matin, de trouver qu’un camarade de chambre est parti avec votre montre et votre argent, et même vos effets.
— Non, en effet, opina Caroline; j’aimerais aussi à avoir une chambre pour moi seule.
. — Je quittai cet hôtel, et bientôt j’en trouvai un autre. Je pénétrai dans le vestibule, qui était encombré de monde, et j’arrivai jusqu’au bureau. Je vis là un énorme plateau couvert de petites lampes que chacun venait prendre avant d’aller se coucher. Je demandai au commis si on pouvait me loger pour la nuit; il me répondit que c’était impossible; tout était plein.
«Je le questionnai sur la cause de cet encombrement dans les hôtels, et il me dit que cela tenait à la réunion des Chambres; c’était là ce qui attirait tout le monde.»
William à ce moment s’aperçut que les yeux de Mary s’étaient fixés sur lui, comme d’ailleurs ceux de toute la société, pendant qu’il racontait les réponses qu’on lui avait faites dans les hôtels. «Continuez donc votre dessin, lui dit-il. Il ne faut pas que l’histoire vous arrête.»
Mary Bell répondit qu’elle ne pouvait deviner ce qu’il allait faire maintenant, et elle reprit son crayon.
«Je m’adressai encore à deux hôtels, et tous les deux étaient pleins. Je commençai à regretter de n’avoir pas accepté le lit qui m’avait été offert d’abord dans la chambre commune, et je me décidai à y retourner. Mais quand j’y arrivai on me dit que plusieurs personnes étaient venues après moi, et qu’il n’y avait positivement plus un seul lit.
— Pour le coup, s’écria Riquet, tu as dû avoir joliment peur?
— Pas du tout, et quand bien même j’aurais eu peur, je t’assure que j’aurais honte de l’avouer devant une si nombreuse société. Cela n’arrange jamais rien d’avoir peur; et puis, vraiment, il n’y avait pas de quoi.
— Comment, reprit Riquet, il me semble que tu ne pouvais plus rien faire?
— Oh! je savais fort bien que si je disais au commis qui j’étais, et comment je me trouvais dans une semblable position, il trouverait moyen de me loger quelque part: il n’y eut jamais d’hôtel si plein qu’on n’y pût trouver place pour quelqu’un, le cas échéant. J’aurais très bien pu, à défaut de lit, me coucher sur un des canapés du salon, ou dans le cabinet de lecture; et même un fauteuil m’aurait suffi pour passer la nuit, ou, pour mieux dire, le reste de la nuit, car il n’y avait guère plus que quatre ou cinq heures d’obscurité. Je n’aurais pas été plus à plaindre que des milliers de pauvres gens qui veillent des malades tous les soirs de leur vie. J’aurais pu aussi rentrer à la maison et dormir dans le vestibule, mon sac sous la tête; j’aurais encore été mieux couché que la moitié du genre humain.
«Je me décidai pourtant à faire une nouvelle tentative, et je continuai ma route en guettant les hôtels. Avant longtemps je fus accosté par une pauvre mendiante qui portait un enfant dans ses bras. Elle me demanda de lui donner quelque chose pour se loger cette nuit. — «Vraiment, lui dis-je, si je vous donne de l’argent, trouverez-vous un endroit où vous loger?
— Oh! dit-elle, il n’en manque pas. Si seulement j’avais une pièce de douze sous! — Eh bien! vous êtes plus heureuse que moi, lui dis-je, car je veux bien donner beaucoup plus de douze sous, et je ne peux pas trouver où me coucher. — Je vous indiquerai un endroit, me dit-elle, si vous voulez venir avec moi.» Je ne répondis rien, mais je lui donnai une pièce de vingt-quatre sous pour se loger cette nuit-là et la nuit suivante, et je continuai ma route.
— Mais, insista Riquet, pourquoi ne l’as-tu pas suivie? elle t’aurait mené quelque part où tu aurais pu trouver à coucher.
— Non, non, cela n’eût pas été prudent; ma mendiante n’avait pas l’air d’une vraie pauvresse, mais plutôt d’une aventurière; elle m’aurait peut-être conduit dans quelque abominable repaire, où j’aurais pu être dévalisé pendant la nuit. Et puis, s’il faut l’avouer, je n’ai pas cru un mot de ce qu’elle me disait.
— Comment, dit Caroline, vous n’avez pas cru qu’elle ne savait où aller coucher?
— Non, dit William, j’ai pensé, sur sa méchante mine, qu’elle avait un abri quelconque, assez misérable sans doute, mais enfin un abri, et que ma pièce de vingt-quatre sous ne changerait en rien son logement cette nuit-là. Ce qu’elle m’avait dit n’était qu’une histoire pour se faire donner de l’argent. C’est quelquefois le cas avec les faux pauvres des rues.
— Et alors, pourquoi lui avez-vous donné de l’argent? demanda Mary Bell.
— Je n’en sais trop rien. Je l’ai fait d’instinct, dans le doute, car je n’étais sûr de rien, et je pensais que peut-être elle était en effet malheureuse, que vingt-quatre sous alors lui feraient plaisir, et je les lui ai donnés. Mais continuez votre dessin.
— Je crois qu’il est fini, dit Mary Bell.
— Voyons! voyons!» s’écrièrent tous les enfants. Et bientôt les aventures de William furent oubliées, et on ne songea plus qu’à voir le télégraphe de Madeleine.
Le dessin fut beaucoup admiré, et Madeleine assura qu’il était très exact.
«Voilà le balcon d’Augusta, et voici ma fenêtre; le fil de fer, et la ficelle qui servait à faire monter et descendre les objets. Voilà même mon vase qui dégringole, et les raisins qui pendent à la fenêtre.»
Les enfants examinèrent le tout jusque dans ses moindres détails. William pria Mary Bell de le lui donner, et aussitôt tout le monde voulut l’avoir. «A moi! criaient les enfants. Donnez-le-moi! C’est pour moi, Mary!» Mary hésitait; elle était très flattée de penser que tant de personnes s’intéressaient à son œuvre, et elle eût été très heureuse que ce fût William qui eût son dessin, mais elle n’osa pas le dire, surtout quand tout le monde le réclamait. Elle déclara donc qu’elle allait le donner à Madeleine, puisque cela représentait son télégraphe. Mais Caro line fit valoir que le dessin ayant été fait par Mary Bell, au lieu de conter une histoire dont tout le monde aurait joui, il devait nécessairement appartenir à toute la société. Elle proposa qu’on le tirât au sort.
Cet avis fut accepté ; seulement William demanda que la loterie fût remise à un peu plus tard.
«C’est cela, appuya Mary Bell, écoutons la fin de l’histoire.»
Chacun reprit sa place et prêta l’oreille.
«Il ne me reste que peu de chose à vous conter, poursuivit William, car, au premier hôtel où je m’adressai, le commis me dit que je pourrais avoir une chambre, si toutefois je consentais à monter un peu haut. Je lui répondis que je n’étais guère en position de faire le difficile. Il m’inscrivit donc sur un registre et dit à un garçon de me conduire au numéro 162; et c’était haut, je vous assure. Nous montâmes des escaliers de toutes les façons; il y en avait de tournants, de droits, de larges, de petits. Je crus que nous n’arriverions jamais. Enfin le garçon s’arrêta devant une porte et me fit entrer dans une pièce bien petite, mais fort agréable, où il y avait un bon lit bien doux. Je fis quelques gambades de joie et je me mis au lit.»
William s’arrêta, et Riquet demanda si c’était fini.
«Mais vous avez annoncé, je crois, qu’il y avait une morale, observa Mary Bell.
— Une morale... tiens, c’est vrai, j’avais pensé à une morale en commençant l’histoire, mais je vous avouerai que je ne sais plus trop ce que c’est.»
Caroline et Mary rirent de bon cœur, et le reste de la société déclara que cela ne faisait rien, car la morale était toujours ce qu’il y avait de moins amusant dans les histoires.
Si William avait demandé qu’on remît la loterie du dessin de Mary Bell, ce n’était pas, comme on pourrait se l’imaginer, pour se donner la satisfaction de finir son récit. Son projet était de s’adresser à chacun des enfants, et de leur proposer de lui vendre leur part dans la loterie. Il leur expliqua donc qu’il y avait dix ou douze chances contre une qu’ils ne gagneraient pas le dessin, et il proposa de leur acheter leur billet moyennant une orange, des fleurs, une pomme, une autre gravure, etc., etc. Ils auraient sûrement les objets, tandis que lui n’aurait le dessin que si l’un d’eux le gagnait. Il leur démontra clairement qu’ils faisaient un excellent marché.
Les négociations de William n’eurent pourtant que peu de succès. Chacun voulait le croquis, et chacun se croyait sûr de le gagner. Il réussit pourtant à acheter deux parts; l’une lui coûta une orange, et l’autre une boîte de carton colorié qu’il alla chercher dans sa chambre. Malgré ces deux chances, et la sienne qui faisait trois, il ne gagna pas; ce fut Sarah que le sort désigna. William savait qu’il était tout à fait inutile, pour l’instant, de proposer à celle-ci de lui acheter son lot; elle était bien trop heureuse de l’avoir gagné ; il se contenta de lui prêter un livre, entre les feuillets duquel il ne risquerait pas de se froisser, et de lui faire dire, un peu plus tard, par Riquet, de ne pas le céder à qui que ce fût, sans le prévenir d’abord.
Vers la fin de la semaine, quand il supposa que le dessin, par le fait même qu’elle en avait eu la complète jouissance, devait avoir baissé dans son estime, il envoya Riquet lui proposer une autre gravure en échange, Sarah accepta, et Riquet rapporta le croquis du télégraphe à William. La gravure qu’il avait donnée en échange était une petite lithographie admirablement coloriée, et qui représentait un château en Angleterre, avec une pelouse verte et entourée de buissons en fleurs.