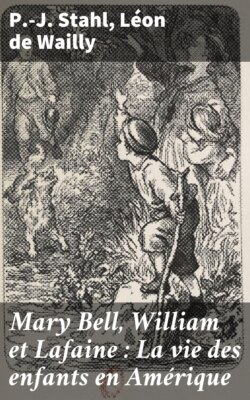Читать книгу Mary Bell, William et Lafaine : La vie des enfants en Amérique - P.-J. Stahl - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеI
Table des matières
LA LECTURE
Par une charmante matinée d’été, William. était assis dans l’alcôve où il étudiait d’ordinaire. Il avait devant lui un gros livre et un cahier, où il écrivait de temps en temps. Le gros livre était un volume d’une encyclopédie dont les autres volumes occupaient plusieurs rayons de la bibliothèque.
William était donc à travailler, la fenêtre ouverte, et les oiseaux chantaient joyeusement au dehors, quand Riquet entra dans la chambre. Il était venu prier William d’aller avec lui à la rivière prendre un bateau et pêcher. Sa cousine Madeleine le suivait. Dès que Riquet eut ouvert la porte, il se retourna et dit à Madeleine:
«Oui, nous pouvons lui parler, les rideaux sont tirés.»
Riquet et Madeleine, se dirigèrent vers la table. Riquet s’accouda dessus et regarda le cahier où écrivait William; il y vit un dessin représentant une machine. Madeleine alla s’asseoir sur le dernier échelon d’un marchepied qui servait à William pour atteindre ses livres.
Quand Riquet vit combien son cousin était occupé à travailler, il désespéra de jamais le faire aller à la pêche.
«Ah! Dieu! dit Riquet en poussant un profond soupir, cela me ferait bien plaisir, William, si tu n’aimais pas tant à étudier.»
William sourit, mais continua à mesurer avec un compas une partie de la machine qu’il copiait.
«Et je pense que cela te ferait plaisir à toi, si, moi, j’aimais un peu plus à étudier, ajouta Riquet.
— Oh! non, dit William, pas du tout, j’ai toujours peur pour la santé d’un trop jeune enfant, quand je le vois trop aimer l’étude.
— Et pourquoi, s’écria Riquet, qui n’en revenait pas d’entendre William exprimer une semblable opinion, pourquoi as-tu peur?
— Parce que l’étude exige le repos du corps, et que la santé exige, au contraire, que le corps se développe par le jeu et l’exercice.
— Je sais que, pour ma part, je préfère infiniment jouer, alors je ne suis pas inquiet de ma santé, dit Riquet.
— Eh bien! j’en suis fort aise, fit William.
— Mais moi, dit timidement Madeleine, j’aime beaucoup à lire des histoires.
— Oh! reprit Riquet, on n’appelle pas cela précisément étudier.
— Le vrai devoir pour un enfant, jusqu’à l’âge de huit ou même de dix ans, dit William, c’est de jouer et de courir; du moins, c’est ce qu’il doit préférer. C’est là ce qui le rendra robuste et fort. Mais dès qu’il a dix ans, il faut qu’il commence à aimer le travail.
— Je compte dire cela à maman, dit Riquet, et alors elle me laissera jouer tout le temps.
— Non, je n’ai pas dit que tu ne devais pas étudier, mais que je ne tenais pas à te voir trop tôt aimer l’étude. Il est bon que les garçons commencent à apprendre longtemps avant d’avoir dix ans, et pour apprendre, il faut étudier; mais je crois que, tant qu’ils sont petits, la récréation sera plus avantageuse pour eux que l’éducation.»
Les yeux de Riquet se fixèrent par hasard sur ce qu’on appelle le titre courant du gros livre que tenait William; il y lut ces mots: «Culture de la canne à sucre. Sucreries.»
«Qu’est-ce que c’est que des sucreries? demanda Riquet.
— Ce sont des propriétés, très nombreuses aux Antilles, où l’on fabrique du sucre. Je lisais cela parce que j’ai envie de savoir tout ce qui s’y rapporte.
— Pourquoi as-tu envie de savoir cela? dit Riquet. Tu ne comptes pas aller fabriquer du sucre sur une propriété aux Antilles, n’est-ce pas?
— Non, dit William, mais je compte être un homme d’affaires, et pour cela il faut que je sache un peu de tout ce qui se fait dans le monde. Cela me servira un jour ou l’autre.
— Je ne vois pas, dit Riquet, à quoi cela pourra te servir, si tu ne dois jamais fabriquer de sucre.
— Mais, dit William, suppose que je sois avocat, et qu’un grand fabricant sucrier vienne me trouver et me remette entre les mains un procès relatif à sa propriété, ne serais-je pas alors bien heureux de savoir quelque chose à ce sujet?
— Je ne vois pas pourquoi tu ne l’apprendrais pas tout aussi bien alors; tu pourrais avoir une encyclopédie dans ton cabinet et la lire..
— Oui, dit William, mais cela me coûterait probablement 100 francs.
— Non, dit Riquet, je crois que cela ne te coûterait rien du tout que la peine de prendre le livre et de le lire.
— A ce compte, dit William, on se contenterait d’acheter des livres, et on ne les ouvrirait jamais qu’au moment même où on aurait besoin de savoir ce qu’ils contiennent. Cependant, s’il faut une réponse prompte au client, s’il n’a pas le temps d’attendre que son avocat s’instruise, qu’est-ce qu’il fera? Il s’en ira et dira partout: «Ne consultez pas l’avocat un tel, il ne sait rien.» Et l’avocat un tel, outre qu’il sera inutile aux autres, sera inutile à lui-même, et ne gagnera pas de quoi payer ses livres trop tard ouverts.»
Il y eut un moment de silence. Riquet réfléchissait à ce que son cousin venait de lui dire.
«Mais, William, je croyais que tu étudiais pour ton plaisir et pas pour de l’argent?
— Certainement, c’est pour mon plaisir dans un certain sens, dit William, et je l’y trouve parce que je sais combien cela me sera utile.
— Sais-tu, William, dit Riquet après un moment de silence, que Madeleine et moi nous savons faire du sucre. N’est-ce pas, Madeleine?
— Oui, une fois nous en avons fabriqué un peu, dit Madeleine.
— Nous avons employé du jus d’érable, dit Biquet.
— Et combien en avez-vous fait? demanda William.
— Voilà ! le premier jour nous l’avons tout mangé en le goûtant pendant qu’il cuisait; mais le lendemain nous en avons fait que nous avons rapporté à la maison.
— Était-il bon? demanda William.
— Oui, dit Riquet, seulement c’était plutôt du candi que du sucre; et puis il était bien un peu amer, parce que nous l’avions laissé brûler.»
Riquet disait tout cela, avec une figure très sérieuse, qui prit même une expression des plus lamentables quand il en vint à se rappeler le désespoir qu’il avait éprouvé en voyant que le candi était brûlé. William fit son possible pour ne pas rire, mais il n’y put réussir.
.. «Aux Antilles, dit-il, on n’obtient pas le sucre au moyen d’incisions dans les arbres, comme ici. On le tire du jus des cannes à sucre, qu’on broie dans de grands moulins.»
Et en même temps, William rechercha dans l’encyclopédie les gravures qui représentaient ces moulins, et les montra à Riquet et à Madeleine. La machine était très compliquée et Riquet n’y comprit pas grand’chose; quant à Madeleine, elle n’y vit absolument rien. Riquet trouva qu’il valait infiniment mieux pratiquer des incisions. S’il vivait, lui, dans les Antilles, et qu’il eût une propriété, il ferait certainement des incisions dans les cannes à sucre, et il attraperait le jus dans des bouteilles, au lieu d’avoir toutes .ces machines que personne ne peut comprendre.
William prit alors son cahier et leur montra les figures qu’il avait exécutées et qui étaient beaucoup plus simples que celles du livre; car elles ne représentaient que les parties les plus essentielles de la machine, telles que les rouleaux entre lesquels les cannes sont broyées, et les roues dentées qui donnent le mouvement à ces rouleaux. Riquet comprit mieux cette fois, mais il dit à William qu’il ne trouvait pas qu’il dessinât très bien.
«Lafaine, ajouta-t-il, sait faire des croquis beaucoup plus jolis que ceux-là.
— Je voudrais bien savoir mieux dessiner, répondit William. J’ai entendu dire en effet que Lafaine s’en tirait très bien. Où a-t-il appris?
— A Paris.
— A Paris, vraiment! Il peut bien dessiner alors, car à Paris ils sont fameux pour leurs dessins. Je voudrais beaucoup en voir; en as-tu?
— Non, dit Riquet, mais je peux lui demander de m’en faire un; veux-tu tout de suite?
— Oui, vas-y; tu me feras plaisir.
— A une condition, dit Riquet.
— Laquelle?
— C’est que tu iras à la pêche avec moi.
— A la pêche! répéta William. Il tira sa montre, réfléchit un instant, et déclara qu’il irait si le dessin était bien fait.
— Mais qui est-ce qui décidera cela? demanda Riquet.
— Ce sera moi, proposa William; ou bien, non, ce sera Madeleine qui décidera. Seulement il faut que Lafaine fasse son dessin sans hésiter, comme il le fait d’habitude; surtout qu’il ne sache pas que c’est pour moi.
— C’est bon, dit Riquet, il est au jardin, je vais le trouver; donne-moi du papier, une plume, un crayon et de l’encre.
— Tu n’as pas besoin d’un crayon et d’une plume; dit William.
— Mais si; il commence toujours par faire une petite esquisse au crayon, qu’il termine ensuite à l’encre.»
William donna à Riquet un morceau de papier blanc, très épais et très lisse, qu’il eut soin de mettre entre les feuillets d’un livre, afin qu’il ne se chiffonnât pas en route; il lui confia également un crayon, une plume et un petit encrier de poche qui se fermait avec un ressort. Madeleine voulut avoir quelque chose à porter, et Riquet lui remit le livre.
Les deux enfants descendirent au jardin avec tout cet attirail. Ils trouvèrent Lafaine ratissant une des allées du parterre. Riquet lui dit qu’il venait le prier de faire un dessin, et Lafaine y consentit à la condition que Madeleine et Riquet continueraient sa besogne. Le pacte fut conclu. Lafaine s’assit sur un banc de pierre, et disposa à côté de lui les objets que les enfants avaient apportés.
«Que faut-il que je vous dessine? demanda Lafaine en taillant son crayon.
— Oh! ce que vous voudrez; inventez-nous quelque chose.»
Lafaine se mit à jouer du crayon tandis que Riquet maniait le râteau. Au bout d’un petit quart d’heure, Lafaine appela les enfants et leur annonça que le travail était fini.
Riquet et Madeleine quittèrent le râteau et accoururent. Le dessin représentait une vieille femme qui portait un panier tout plein d’enfants qu’elle étendait sur une corde, comme elle l’aurait fait d’une lessive. Sous le dessin, Lafaine avait écrit: «Madame Tatillon, » et au-dessous encore le couplet suivant:
Lorsqu’ils étaient débarbouillés,
Elle les mettait en bataille
A sécher contre la muraille,
Pensant que, s’ils restaient mouillés,
Ils s’enrhumeraient à la ronde
Et s’en iraient dans l’autre monde.
Les deux enfants examinèrent la composition très attentivement; puis, ayant lu les vers, ils rirent de tout leur cœur et partirent au galop pour la montrer à William.
Madeleine décida que c’était très réussi, et William dit qu’il irait pêcher. Il mettait le dessin dans son tiroir, quand Riquet le réclama comme lui appartenant.
«Non, dit William, il est à moi, puisque je te le paie en allant pêcher avec toi.
— Non, je n’ai jamais dit qu’il devait t’appartenir; j’ai seulement dit que j’irais le chercher et que je te le montrerais, dit Riquet.
— Eh bien, pour le moment, pendant que nous sommes à la pêche, je le mets dans ce tiroir, dit William; nous déciderons cette question une autre fois.»
Et ils se dirigèrent vers la rivière.