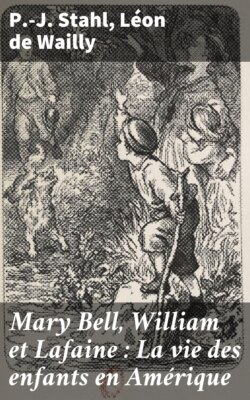Читать книгу Mary Bell, William et Lafaine : La vie des enfants en Amérique - P.-J. Stahl - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA FÊTE
ОглавлениеPendant toute la matinée du lendemain, Madeleine et Biquet furent en proie à la plus vive excitation, préparant tout pour leur fête. On avait dressé une table dans un pavillon qui donnait sur la cour. Il devait y avoir des sandwiches, deux espèces de gâteaux, des fraises, de la crème, et quelques autres friandises du même genre. Tout était arrangé à l’avance; seules, les fraises et la crème ne furent mises dans les plats et les jattes que quand l’heure du goûter fut arrivée. En attendant, on avait placé les fruits dans deux vases d’étain à l’endroit le plus frais du pavillon, sous un banc, et la crème était restée dans la cave.
Des bancs étaient disposés autour de la table. Quand tout fut bien en ordre, on ferma la porte à clef, afin que rien ne fut dérangé jusqu’à l’heure dite.
Vers trois heures, toutes les petites filles arrivèrent. Les deux plus âgées étaient Mary Bell et Caroline. Madeleine n’avait pu deviner pourquoi William n’avait pas voulu écrire une invitation pour Caroline aussi bien que pour Mary Bell, car elle était très gentille, très bien élevée et très aimable. Mary Bell était beaucoup plus silencieuse et plus douce que Caroline. Madeleine aimait beaucoup à entendre causer Celle-ci et à l’avoir à ses fêtes (elle mettait tant d’entrain dans les jeux!) mais, à tout prendre, elle préférait Mary Bell, et elle n’était jamais si heureuse qu’assise tranquillement à son côté.
La première chose que firent les petites filles fut de courir dans toutes les chambres qu’on leur avait laissées ouvertes dans la maison, et de regarder les livres à images et les joujoux que Madeleine et Riquet avaient préparés pour leur amusement. Ensuite elles jouèrent un peu de temps dans le salon. Après cela, Madeleine leur proposa d’aller au jardin apprendre la chanson de Lafaine.
Tous les enfants furent ravis de ce projet qui les faisait descendre au jardin. Ils pensaient beaucoup plus aux fleurs qu’ils allaient voir qu’à la chanson. Madeleine se mit en tête, et tout le monde la suivit jusqu’à la porte de l’enclos.
Mais celle-ci était fermée. Madeleine n’y comprenait rien; elle pria Riquet de passer par-dessus la haie et d’aller l’ouvrir. Mais Riquet pensa que si Lafaine l’avait fermée, c’était avec intention; il se contenta donc de grimper un peu sur une barre et de crier à Lafaine de les faire entrer. Lafaine arriva; mais au lieu d’ouvrir la porte, il s’accouda dessus et regarda les petites filles avec une expression très drôle.
«Nous voulons entrer dans le jardin, dit Caroline.
— Je ne sais pas si je puis laisser entrer tout ce monde dans mon jardin, sans y mettre quelques conditions, dit Lafaine.
— Et lesquelles? demanda Caroline.
— Je vais vous les énumérer, dit Lafaine, et à chacune que vous accepterez, vous direz toutes: «Accepté !»
— Bien, répondit Caroline, commencez.
— D’abord, reprit Lafaine, il faut que vous fassiez bien attention de ne pas marcher sur les corbeilles et les bordures.
— Accepté ! accepté ! crièrent tous les enfants à la fois.
— Ensuite il ne faudra pas cueillir de fleurs.»
Il y eut quelques voix qui crièrent: «Accepté !» mais beaucoup d’autres gardèrent le silence.
«Nous comptons certainement que vous nous en donnerez, alors, insinua Caroline.
— Je n’ai pas dit que je ne vous en donnerais pas; j’ai seulement dit que vous ne deviez pas les cueillir vous-mêmes.
— Eh bien! accepté ! dit Caroline, et tous les enfants répétèrent: «Accepté !»
— Vous pouvez, ajouta Lafaine, vous choisir chacune trois fleurs dans le jardin et je vous les cueillerai, si toutefois ce ne sont pas des fleurs défendues. Celles-là, je ne peux pas vous les donner.
— Quelles sont les fleurs défendues?» demanda Caroline.»
Pendant tout ce temps Madeleine se tenait en arrière avec Mary Bell; elle était très surprise de ce que disait Lafaine, et se penchant vers Mary, elle lui glissa tout bas:
«Je ne crois pas qu’il y ait des fleurs défendues. »
Lafaine n’entendit pas ceci, ou tout au moins n’y fit aucune attention, et il ne répondit qu’à la demande de Caroline.
II
MAIS AU LIEU D’OUVRIR LA PORTE, LAFAINE S’ACCOUDA
«Je ne puis vous dire cela à l’avance, choisissez votre fleur d’abord et puis demandez-moi si elle est défendue ou non; si elle l’est, il faudra que vous fassiez un nouveau choix; si elle ne l’est pas, je vous la cueillerai, mais seulement quand vous quitterez le jardin. Que dites-vous de ces conditions?
— Nous les acceptons! dirent les enfants.
— Encore autre chose, dit Lafaine, avant de vous en aller, il faudra que vous me chantiez une chanson. »
A ceci les petites filles rirent beaucoup, mais ne dirent pas: «Accepté !» Lafaine consentit enfin à ne pas rendre cette clause obligatoire, mais leur annonça que, si elles remplissaient toutes les autres conditions, il leur apprendrait une chanson et leur en jouerait l’air sur son flageolet. Ensuite, ayant autorisé Riquet à passer par-dessus la haie et à ouvrir la porte, il s’éloigna, et tous les enfants se répandirent dans le jardin.
A chaque instant, ils accouraient vers Lafaine lui demander de venir voir si telle ou telle fleur était défendue. Ce n’était, au fond, que pour donner aux enfants une occasion de venir continuellement lui parler, que Lafaine avait inventé l’histoire des fleurs. Il n’y avait, en réalité, pas de fleurs défendues, et il n’avait pas dit qu’il y en eût; il avait seulement déclaré qu’il ne pouvait pas leur en donner de défendues. Il n’avait donc exprimé que la vérité, quoique, pour un temps, il eût trompé les enfants.
Lafaine avait deux raisons pour désirer que les petites vinssent lui parler. D’abord pour son propre agrément; c’étaient toutes de gentilles fillettes, et cela lui faisait plaisir de les voir s’approcher de lui et le questionner avec des figures où se peignaient l’animation et l’ardeur que toutes mettaient à savoir si telle fleur était défendue ou non; ensuite, il voulait qu’elles fissent toutes un peu connaissance avec lui, afin qu’elles ne fussent pas trop intimidées quand il voudrait les faire chanter.
Son moyen réussit admirablement. A tout moment, les petites filles arrivaient vers lui, et quand il leur disait que leurs fleurs étaient défendues, elles prenaient la chose très bien, et allaient en chercher de nouvelles. Caroline seule fit exception; elle se sentit un peu piquée quand Lafaine lui dit qu’une de ses fleurs était défendue, et elle ne voulut pas en chercher une autre pour la remplacer. Elle déclara à une jeune fille qui se promenait avec elle que si Lafaine n’était pas assez poli pour lui donner les fleurs qu’elle désirait, elle n’en voulait pas du tout. Caroline n’était pas habituée à ce qu’on lui refusât quoi que ce soit, et, bien qu’elle fût assez généralement de bonne humeur, tout ce qu’elle prenait pour un manque d’égards la froissait invariablement.
Quand Lafaine crut que les enfants étaient assez apprivoisés pour ne pas craindre de chanter devant lui, il les appela tous sous le berceau; puis il tira son flageolet et joua des airs qui firent le plus grand plaisir aux petites filles; ensuite, il leur répéta deux ou trois fois l’air de la chanson qu’il allait leur apprendre, puis il chanta les paroles, en les leur faisant dire après lui, jusqu’au moment où tout le monde les sut. Alors les enfants chantèrent, et Lafaine joua l’accompagnement sur son flageolet.
Tout le monde, excepté Caroline, fit sa partie de grand cœur. Elle se sentait un peu au-dessus de cela; il est vrai que la chanson, comme air et comme paroles, était faite pour des enfants et non pour des demoiselles de douze et de treize ans. La majorité de la société étant d’un âge très convenable pour l’apprécier, les personnes les plus raisonnables auraient dû s’y joindre de bonne grâce et contribuer ainsi au plaisir des plus petites. Les demoiselles qui sont presque grandes ne devraient pas oublier qu’elles ont été petites et qu’elles trouvaient très bon alors que leurs grandes compagnes voulussent bien prendre part à leurs jeux et les guider à l’occasion. C’est ce que fit Mary Bell. Elle se tenait avec Madeleine à l’entrée du berceau. Elle prit un vrai plaisir à entendre la chanson, bien qu’elle fût destinée à des enfants beaucoup plus jeunes qu’elle, et elle se dit que ce serait une très jolie chose à enseigner à ceux qui venaient souvent la voir chez sa mère.
Caroline, au lieu de prendre part au chant, semblait déclarer par son air de dédain qu’une musique enfantine était tout à fait au-dessous d’elle. Elle se promenait nonchalamment dans l’allée, le long du berceau, laissant errer sa vue sur le jardin en général, Enfin ses yeux se dirigèrent vers la maison, et elle aperçut William qui, de son balcon, regardait dans l’enclos. Elle fit semblant de ne pas l’avoir vu, tout en se dirigeant doucement du côté de la maison. William n’y fit aucune attention; il écoutait le chant.
Quand les enfants eurent répété leur air plusieurs fois, sous la direction de Lafaine, celui-ci les quitta pour reprendre son ouvrage, et ils continuèrent à chanter, avec Mary Bell à leur tête. Elle les fit mettre en rond sur une petite place circulaire qui se trouvait devant le berceau. Un grand saule en occupait le centre; cet endroit était charmant pour danser une ronde; et le saule, tout pleureur qu’il était, fut bien obligé de s’égayer de la joie des enfants.
Après avoir chanté et dansé jusqu’à en être fatigués, ils quittèrent le jardin pour retourner à la cour, où ils jouèrent longtemps et s’amusèrent beaucoup. Là, Caroline fut l’âme de tous les divertissements, elle était pleine de vie et de gaieté. Elle imaginait des jeux, combinait des expéditions, chantait des chansons et racontait des histoires; elle était entourée d’une foule qui la suivait dans ses moindres mouvements. Mary Bell était plus silencieuse et se mettait moins en avant. De temps en temps, elle se mêlait comme les autres aux jeux de Caroline; mais, en général, elle préférait se promener doucement en com pagnie de deux ou trois amies, ou s’asseoir à côté d’elles à l’écart sur une pierre ou sur un banc rustique. Cependant, si une jeune fille s’approchait d’elles, Mary Bell l’accueillait avec un sourire qui indiquait assez que son goût pour la solitude ne provenait pas du désir de quitter le reste de la compagnie pour jouir égoïstement de la société de deux ou trois amies de cœur. Même, pour éviter qu’on la soupçonnât de faire une chose qui est à fort juste titre considérée comme impolie dans toute espèce de réunion, elle avait soin de toujours varier ses compagnes, de se promener tantôt avec l’une, tantôt avec l’autre, répartissant ainsi également ses attentions entre toutes. C’est là la seule conduite vraiment aimable à tenir dans des réunions intimes.
Il est vrai qu’il est souvent bien agréable de jouir exclusivement de la société d’un ou deux bons amis, mais ce n’est pas le genre d’agrément que nous devons rechercher dans des parties de plaisir, et si nous le faisons, nous courons grand risque d’exciter la jalousie et de nuire au plaisir général.
Mary Bell, bien que plus disposée que beaucoup d’autres jeunes filles à aimer les plaisirs calmes, était pourtant toujours prête à prendre part aux jeux que proposaient les autres. L’après-midi se passa d’une façon charmante, et enfin l’heure de la collation arriva. Tous les invités se dirigèrent vers le pavillon, dont la porte n’était plus fermée. Les fraises étaient dans les assiettes, et le lait et la crème dans les jattes. Tout était prêt. Les enfants restèrent un instant debout autour de la table, à admirer la belle ordonnance des préparatifs; mais bientôt chacun prit place sur les bancs qui faisaient le tour du pavillon.
«Je propose, dit Caroline, que nous ayons une reine; je crois que ce serait bien; elle pourra déléguer son autorité à quelqu’un qui servira les fraises et les gâteaux à la ronde.
— Oui, dit Mary Bell, c’est une bonne idée.»
Caroline ajouta:
«Que tous ceux à qui cela convient disent: «Accepté ! »
Tous les enfants crièrent: «Accepté !» Il y en eut même qui, fort inutilement, le répétèrent deux ou trois fois.
«Je propose que Caroline soit la reine, dit Mary Bell. Que tous ceux qui sont de cet avis disent: «Accepté !»
— Accepté ! accepté ! crièrent beaucoup de voix; il y en eut pourtant qui dirent: «Non, Mary Bell! que Mary Bell soit reine!»
— Il est décidé que Caroline est la reine, dit Mary Bell.
— Je trouve que c’est vous qui devriez être reine, dit bien timidement une petite fille qui était assise auprès de Mary Bell, et qui s’appelait Alice.
— Chut!» fit Mary en lui posant le doigt sur les lèvres; mais elle regarda Alice avec un sourire qui lui prouva bien que, si elle lui avait imposé silence, du moins elle ne lui en voulait pas d’avoir parlé.
Caroline prit place au haut bout de la table et commença à remplir ses royales fonctions; elle nomma des aides et leur fit servir le festin sous ses ordres. Je dois dire qu’elle s’acquitta de son métier de reine avec infiniment de goût et de tact, car elle était en beaucoup de points faite pour jouer ce rôle.
Quelques petites filles furent désappointées de ce que Mary Bell n’était pas la reine; elles se réunirent autour d’elle pendant que chacun était occupé avec les fraises et les gâteaux, et lui exposèrent leur mécontentement. Le bruit des voix qui riaient et causaient dans le pavillon était si continu qu’elles purent parler tout à leur aise sans être entendues par le reste de la compagnie. Quelques-unes même emportèrent leur assiette de fraises et de gâteaux et allèrent s’asseoir à l’extérieur de la maison, sur les marches.
«Je trouve que vous auriez dû être la reine, dit Alice, vous êtes la plus âgée.
— Oh! seulement de deux mois, dit Mary Bell. Non, Caroline doit être la reine, parce que c’est elle qui a été proposée d’abord.
— Mais c’est vous qui l’avez proposée, dit Madeleine.
— Non, dit Mary Bell, je préfère que ce soit Caroline. Je trouve...»
Ici Mary Bell s’arrêta. Elle allait dire que Caroline ferait une bien meilleure reine qu’elle, et elle le pensait vraiment; mais elle réfléchit aussi qu’il valait autant ne pas le dire. Elle avait raison; car s’il est malhonnête de faire son propre éloge, il est presque aussi malhonnête de se dénigrer soi-même. On a toujours l’air de demander une contradiction flatteuse.
«N’importe, dit Mary Bell, Caroline a été choisie, et elle fait une très bonne reine. Je propose que nous allions dans le jardin tresser une guirlande pour la couronner. N’en disons rien jusqu’à ce qu’elle soit prête.»
Les petites furent enchantées de ce projet, et surtout de l’idée de n’en rien dire. Mary Bell envoya Alice demander à la reine de permettre à Mary et à trois autres jeunes filles de s’absenter un peu de temps.
«Et si elle n’a pas l’air disposée à consentir, dit Mary Bell, dites-lui tout bas que c’est pour faire une couronne à la reine.»
Alice alla donc porter sa pétition, tandis que Mary et les autres petites filles l’attendaient en se promenant dans l’allée. La reine commença par déclarer qu’il lui était impossible de permettre à aucun de ses sujets de s’absenter; mais quand Alice lui eut dit à l’oreille le but de l’expédition, elle consentit aussitôt, et fit répondre à Mary Bell qu’elle la remerciait infiniment de sa bonne pensée.
Les petites, qui allèrent avec Mary, prirent le plus grand plaisir à cueillir les fleurs et à tresser la guirlande, et quand elle fut finie et posée sur la tête de la reine, les trois petites filles comptaient parmi les sujettes les plus dévouées de Sa Majesté Caroline. C’était dans ce but que Mary Bell avait fait sa proposition. A partir de cet instant, tout alla pour le mieux et le plus harmonieusement du monde: le règne de Caroline fut sans nuage. Il ne faudrait pourtant pas croire qu’elle occupât une position beaucoup plus élevée que Mary Bell, car celle qui fait une reine, qui la couronne, et qui la soutient moralement, n’est-elle pas en quelque sorte au-dessus d’elle?
Après le goûter, les enfants jouèrent quelque temps dans la cour; mais s’étant fatigués des jeux actifs, la reine leur proposa de rentrer au salon se divertir à quelque jeu plus tranquille. Ce projet reçut l’assentiment général. Biquet dit qu’il irait chez William le prier de venir leur conter une histoire. Il alla donc sous la fenêtre de William, fenêtre qui, comme on a pu le voir précédemment, donnait sur un petit balcon. Ce balcon était appuyé sur deux grands poteaux d’où sortaient, de distance en distance, des chevilles de bois qui servaient à soutenir les plantes grimpantes, mais qui étaient surtout utiles à Biquet, très habile dans la gymnastique, pour arriver à la chambre de son cousin sans avoir recours à l’escalier.
Quand Riquet fut en haut des poteaux, il se retourna et regarda les petites filles qui jouaient dans la cour; quelques-unes étaient rentrées, d’autres cueillaient des fleurs sous le balcon. Riquet était si habitué à grimper à ces supports, qu’il se tenait sur les dernières chevilles avec aussi peu de crainte que s’il eût été sur l’escalier.
Biquet adressa sa demande à son cousin, qui consentit immédiatement, tout en lui disant, comme l’on a l’habitude en pareil cas, qu’il ne se rappelait aucune histoire.
Riquet usa de l’escalier ordinaire pour redescendre, et vint. communiquer la réponse de William à Caroline et à toutes les petites filles assemblées dans le salon. Caroline et Mary Bell rapprochèrent deux canapés, et, à l’aide de quelques chaises, elles formèrent un cercle. Au centre, on mit des coussins et des tabourets de toutes sortes pour les plus petits enfants.
Il leur fallut bien du temps avant d’être complètement installées, car, à chaque instant, les petites changeaient de place, avec l’espoir d’en trouver une meilleure. On mit deux fauteuils en face l’un de l’autre; l’un fut pour Caroline, l’autre pour William.
L’entrée de ce dernier intimida un peu la société, car il était beaucoup plus âgé que la plus raisonnable des jeunes filles présentes. Madeleine. lui dit que Caroline était la reine. et qu’il fallait lui obéir en tous points. Là-dessus, William s’inclina respectueusement et dit à Sa Majesté qu’il était trop heureux de se ranger parmi ses sujets. Caroline déclara alors qu’elle ne voulait plus être reine, et que William devait être roi; William répondit que pour rien au monde il ne voudrait la déposséder, mais que, si Caroline y consentait, il serait son premier ministre. Cette proposition fut acceptée à l’unanimité, et William, en sa qualité de premier ministre de la reine Caroline, se mit à la tête de la petite assemblée.