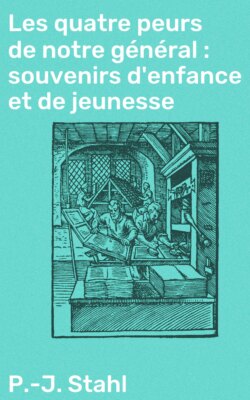Читать книгу Les quatre peurs de notre général : souvenirs d'enfance et de jeunesse - P.-J. Stahl - Страница 7
IV
Оглавление«Mon évanouissement dura, dit-on, près de deux heures; je revins à moi dans les bras de tante Marie, vers laquelle était monté mon cri de détresse. Ma mère était revenue. A genoux devant sa sœur et devant moi, elle me baignait le front et les tempes et m’imbibait les narines avec quelque chose qui me brûlait un peu, mais qui sentait très bon. Je fondis en larmes, et mon premier mot, quand je pus parler, fut pour demander et redemander pardon, et, quand, à bout de voix, j’avais dû m’arrêter, c’était pour crier de nouveau-: «Pardon! pardon!» de ce qui était pour moi une irrémissible faute.
«— Pardon de quoi, mon pauvre enfant? me dit ma mère quand j’eus repris tout à fait connaissance. Est-ce d’avoir été dans la grande salle? mais tante Marie t’a pardonné ; ne vois-tu pas comme elle t’embrasse?»
«Le baiser, oui, c’était le pardon, le pardon de tante Marie, mais ce n’était pas seulement de ce qu’elle croyait qu’il fallait que je fusse pardonné. On ne savait pas tout. Je tins à faire un aveu complet, et, dans un récit entrecoupé de frissons et de larmes, je le dis «ce tout» à tante Marie et à ma mère, je leur racontai ce qu’il m’en avait coûté, c’était mon idée fixe «de manquer de respect à un mort.»
«Ma confession ne fut pas seulement complète, elle fut publique: le chirurgien de l’hôpital et cinq ou six soldats étaient autour de nous.
«— Ah! dit un des militaires s’adressant au docteur, c’est le vieux maréchal des logis qui n’avait pas pu supporter l’amputation d’hier que l’enfant a vu...»
«Quand j’eus achevé mon récit, quand, à force de bonnes paroles, on eut rétabli un calme relatif dans ma conscience et dans mes esprits, quand on m’eut bien répété que le mort ne pouvait plus être fâché, puisque je lui avais demandé pardon, quand tante Marie m’eut fait entendre que, d’ailleurs, s’il faut respecter les morts, les honorer, il ne faut pas avoir peur d’eux, un jeune sergent qui était là et que j’avais taquiné plus qu’un autre, parce qu’il avait plus souvent que d’autres la drogue sur le nez, demanda à ma mère la permission d’embrasser «ce petit-là.»
«Lorsqu’il eut usé de la permission que ma mère lui avait donnée bien volontiers, il lui dit en me remettant sur ses genoux: «Madame, quand on vient à bout de soi à six ans comme cela, c’est pas pour avoir froid aux yeux plus tard. Ce mioche-là sera un lapin.»
«Si je suis devenu un lapin, dit le général en rallumant son cigare, je n’en sais rien, mais ce que je sais, c’est que, dans toute ma vie militaire, je n’ai jamais eu plus de mal que ce jour-là à n’être pas, jusqu’au dernier moment, devant cette première rencontre avec la mort, un fier poltron. — Après ça, nous le savons tous, le courage consiste aussi à surmonter la peur.»
Le général avait eu raison. Cette histoire d’un enfant était au fond l’histoire d’un homme; elle intéressa ses auditeurs, ainsi qu’il arrive aux récits où chacun peut trouver à se faire sa part à soi-même. Ce n’était pas d’ailleurs une mauvaise préparation à la besogne nocturne du lendemain, qui devait exiger de chacun de nous plus d’opiniâtreté, plus de volonté et de sang-froid que d’élan.