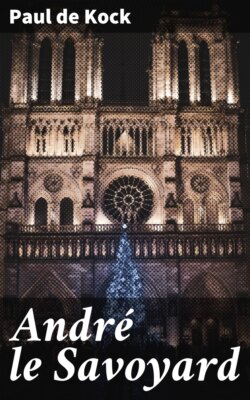Читать книгу André le Savoyard - Paul de Kock - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE PREMIER
TABLEAU DE NEIGE.—LA FAMILLE SAVOYARDE.
ОглавлениеTable des matières
La neige tombait par gros flocons; elle couvrait les routes, elle rendait encore plus difficiles les sentiers pratiqués dans les montagnes et les chemins, souvent bordés de précipices, qui entourent la petite ville de l’Hôpital située près du Mont-Blanc.
Notre chaumière s’élevait près d’une route que le mauvais temps rendait déserte depuis quelques jours. Déjà plus d’un pied de neige couvrait la terre; et cependant ni moi ni mes frères ne songions à rentrer pour nous mettre à l’abri.
J’étais couché près d’un bloc de rocher; et là je me trouvais aussi bien que sur un épais gazon: mes petites mains formaient des boules avec de la neige, et les lançaient à mes frères, qui, de leur côté, m’assaillaient également de boules glacées. Pierre accroupi dans un enfoncement que formait la route, ne se montrait que rarement, tâchant de viser adroitement, et se cachant aussitôt; Jacques courait de côté et d’autre, sans se fixer à aucune place, se baissant pour ramasser de quoi faire des boules, et s’esquivant lestement après nous les avoir lancées.
Quel plaisir nous éprouvions lorsque nous parvenions à nous attraper!... Quels cris de joie quand Jacques recevait, en fuyant, de la neige sur son dos; lorsque Pierre, au moment où sa petite tête blonde sortait de sa cachette, était atteint à la figure par la boule qui s’éparpillait sur son visage! Le vaincu mêlait ses ris à ceux du vainqueur; la victoire ne coûtait jamais une larme. Pouvions-nous sentir le froid? nous étions si heureux!... et dans un âge où le bonheur est pur, parce qu’il ne s’y mêle ni souvenirs du passé ni craintes pour l’avenir.
Déjà, plusieurs fois, la voix de notre mère s’était fait entendre pour nous engager à rentrer.—Nous voilà, répondions-nous tous trois. Mais au moment de regagner notre demeure, une nouvelle boule de neige, lancée par l’un de nous, faisait recommencer la guerre; chacun s’attaquait de nouveau; les cris de joie, les éclats de la gaieté faisaient encore retentir les échos de nos montagnes. Nos pieds étaient à demi morts de froid; nos petites mains rouges et engourdies pouvaient à peine saisir et presser cette neige, qui nous procurait de si doux passe-temps; et cependant nous ne pouvions nous résoudre à retourner près du foyer de notre chaumière.
Mais l’approche de la nuit nous force enfin à quitter notre jeu. Nous rentrons tous les trois, essoufflés, haletants, et encore rayonnants de plaisir; nous courons nous blottir contre l’immense foyer devant lequel notre père est assis sur une grande chaise, tandis que notre mère va et vient dans cette vaste pièce, l’unique du logis, et prépare la soupe pour notre repas du soir, tout en nous grondant d’avoir tant tardé à rentrer.
—Voyez comme ils sont couverts de neige!... Rester ainsi sur la route par le temps qu’il fait!... Hum! les mauvais sujets! quand ils sont en train de jouer, ils ne m’écoutent plus.
—Ne les gronde pas, Marie, dit notre père en nous attirant près de lui; ne les gronde pas; ils s’amusent, ils sont heureux!... Pourquoi déjà chercher à troubler leurs plaisirs? Chers enfants!... ce temps passera si vite!... Bientôt la raison amènera les soucis, les inquiétudes! Le travail du jour sera-t-il suffisant pour le lendemain? les espérances d’aujourd’hui feront-elles oublier les peines de la veille?... Toujours des tourments! rarement du plaisir!... et jamais de moments aussi doux que ceux qu’ils viennent de goûter! Moi aussi j’ai fait des boules de neige!... Il y a quarante ans que je jouais comme eux... Ce temps est loin, il a trop peu duré; je ne me rappelle pas depuis avoir éprouvé un plaisir aussi vrai.
—Quoi, même lorsque tu m’as épousée, Georget? dit notre mère d’un ton de reproche. Mon père la regarde en souriant, et se contente de murmurer:—Oh! ce n’est plus la même chose... Je n’avais qu’une chaumière à t’offrir!—En avais-je davantage? Cela nous a-t-il empêchés d’être heureux?...—Non, sans doute...—Notre maisonnette, notre travail nous suffisent; nous sommes pauvres, mais nous n’avons pas encore manqué, et nos enfants s’élèvent bien; ils grandiront, ils travailleront à leur tour...—Oui... Mais d’ici là!... Ah! Marie! depuis cette maudite chute que j’ai faite en guidant au glacier ce gros étranger... qui ne m’a pas même aidé à me ramasser, tiens, je sens que mes forces diminuent... je ne puis recouvrer la santé... Et s’il fallait te laisser ainsi avec ces enfants, dont l’aîné n’a que sept ans... hélas! que deviendriez-vous?
En disant ces mots, mon père nous entourait de ses deux bras, et nous pressait plus fortement contre lui. J’étais grimpé sur ses genoux; Jacques était assis à ses pieds, et Pierre, debout près de lui, appuyait sa tête sur son épaule. Notre mère s’était arrêtée au milieu de la chambre; les derniers mots de son mari venaient de lui serrer le cœur. Elle se détourna pour cacher une larme qui coulait le long de ses joues; et nous, sans trop comprendre ce dont il s’agissait, nous redoublions de caresses, pour dissiper la tristesse que nous lisions dans les yeux de notre père.
—Bon Dieu!... peut-on avoir de pareilles idées! dit enfin la bonne Marie en poussant un gros soupir qu’elle ne pouvait plus contenir. Ah! Georget! ne travaille plus, ne te fatigue plus... Reste auprès de notre foyer. Nos récoltes sont rentrées, nous avons du pain pour plus de six semaines encore; je ne veux pas que tu t’exposes pour gagner quelques pièces d’argent.
—Mon père, dis-je alors en levant la tête d’un air décidé, quand il passera des voyageurs, c’est moi qui les conduirai, c’est moi qui monterai avec eux sur les glaciers, qui leur ferai regarder dans ces beaux précipices si effrayants! Ils me donneront quelques pièces de monnaie, je vous les rapporterai, et vous n’aurez plus besoin de vous fatiguer. Vous le voulez bien, n’est-ce pas, mon père?
—Tu es encore trop jeune, mon petit André, dit mon père en me passant la main sur les joues et en me faisant sauter sur ses genoux.—Trop jeune!... Je suis l’aîné de mes frères... J’ai sept ans passés... Le fils de Michel, notre voisin, ne les avait pas quand il est parti pour la grande ville...—Mes chers enfants, puissiez-vous n’être point forcés d’y aller aussi!... Je voudrais vous garder toujours près de moi...
—Ça doit être bien joli, la grande ville! dit Pierre en ouvrant ses petits yeux de toute sa force. On dit qu’on y voit tous les jours la lanterne magique qui a passé une fois chez nous.—Voudrais-tu y aller, Pierre?—Dam’, je n’oserais pas y aller tout seul, comme le fils de Michel...—Et toi, mon petit Jacques? dit mon père à celui de mes frères qui n’avait encore que cinq ans, et se roulait à ses pieds en s’étendant pour se réchauffer devant la flamme du foyer.
—Dis donc, Jacques, que ferais-tu par là, mon garçon?...—Je mangerais tous les jours du fromage avec mon pain, répond Jacques en souriant, et en regardant du côté de notre mère pour voir si la soupe se faisait.
—Moi, dis-je à mon tour, je travaillerais, je gagnerais beaucoup d’argent... de quoi acheter un grand jardin... je reviendrais vous apporter tout cela... Ça fait que nous serions bien heureux. Vous, mon père, et vous, ma mère, vous pourriez vous chauffer toute la journée en hiver... Puis, mes frères et moi nous aurions le temps de faire encore des boules de neige...
—Tu es un bon garçon, André: tu songes à tes parents... Mais la grande ville... ah! mes enfants, on n’y fait pas toujours fortune; j’y suis allé, moi, étant jeune; je n’ai pu amasser que peu de chose!... et puis, en route, des coquins m’ont pris tout ce que j’avais!... le fruit de dix ans de travail que je rapportais à ma mère!... il a fallu rentrer sans rien...
—Qu’est-ce que c’est donc que des coquins? dit Pierre.—Mon ami, ce sont des méchants, des paresseux, des voleurs, qui n’ont pas voulu travailler, et ne vivent qu’en dépouillant les autres.—On peut les battre, n’est-ce pas, mon père? dis-je avec vivacité.—Pas toujours, mon cher André; quand on parvient à les prendre, la justice les punit; mais il est défendu de les battre soi-même!...
—Est-ce qu’on donne à manger à ceux qui sont méchants? dit le petit Jacques, en regardant alternativement le feu et la soupe qui cuisait.
—Il faut que tout le monde vive, mes enfants...—Mais les méchants n’ont pas de bonne soupe comme celle-là!... n’est-ce pas, mon père?...
Notre père sourit, et releva le petit Jacques qu’il embrassa tendrement... Nous nous penchâmes, Pierre et moi, vers le sein de notre père pour obtenir les mêmes caresses, qu’il s’empressa de nous prodiguer, car il nous aimait également tous trois: son cœur ne connaissait point ces injustes préférences qui font souvent naître entre frères et sœurs l’envie, la jalousie, les chagrins; il ne cherchait point sur nos traits quel était celui qui promettait d’être le plus avantagé par la nature; aux yeux d’un bon père, tous ses enfants sont aussi beaux.
Par les soins de ma mère, la soupe préparée est placée sur une table de bois; la fumée qui sortait d’une grande écuelle réjouissait notre vue, et faisait sourire le petit Jacques, qui respirait déjà avec délices le parfum du souper.
—A table! à table! dit notre mère. Jacques se laisse aussitôt couler des genoux de mon père, et va se placer sur un petit escabeau; Pierre approche de la table la chaise que mon père vient de quitter, et moi, je reste près de celui dont je voudrais déjà soutenir la marche mal assurée: car, dans sa dernière chute, mon père s’était blessé assez grièvement au genou, et il n’était pas encore bien guéri.
Mon père faisait semblant de s’appuyer sur moi, parce qu’il voyait que j’étais fier d’être déjà son soutien; mais sa main se reposait légèrement sur mon épaule. Nous fûmes bientôt assis autour de la table. La neige tombait avec une nouvelle violence; le vent soufflait avec force, il ébranlait souvent la porte de notre chétive demeure, et son bruit lugubre et monotone intimidait Pierre, qui se serrait contre moi toutes les fois que notre porte remuait avec plus de fracas.
Mais la flamme brillante qui sortait du foyer égayait notre chaumière, qu’une seule lampe éclairait; et l’odeur de la soupe faisait rire le petit Jacques, qui chantait toujours lorsqu’il était à table.
—Quel temps affreux! dit la bonne Marie en nous servant à souper. Je suis sûre que l’on ne peut plus marcher sans enfoncer de deux pieds dans la neige...—Je plains ceux qui sont en route dans nos montagnes, dit mon père.—Nous sommes heureux d’avoir un abri, un bon feu, et de quoi souper... Va, Georget, il y a bien des gens qui voudraient maintenant être dans notre chaumière.
Comme ma mère achevait ces mots, nous entendîmes des cris éloignés, puis le claquement d’un fouet et les jurements d’un postillon.
Nous prêtâmes tous l’oreille, excepté Jacques, qui s’emplissait la bouche d’une grande cuillerée de soupe.—Qu’est-ce que cela! dit Pierre en tremblant.
J’écoutais toujours ainsi que mes parents: les voix devinrent plus distinctes. On appelait au secours; on réclamait l’assistance de quelque habitant du village, mais le village le plus voisin était éloigné de la route, que notre chaumière seule touchait.
—Plus de doute, dit mon père en se levant de table, ce sont des voyageurs en peine; il faut aller à leur aide.
Rassemblant ses forces, il prend à la hâte son chapeau, son bâton, et sort de notre chaumière sans écouter les prières de sa femme, qui le supplie de ne point s’exposer et se fatiguer de nouveau. Mais mon père est déjà loin; il se dirige du côté d’où partaient les cris. Je m’étais levé, et j’aurais voulu le suivre; ma mère me retient en me disant:—Eh bien! André, veux-tu donc aller aussi t’exposer dans ces mauvais chemins!... Tu es trop jeune, mon ami; reste avec nous, et prions le ciel pour qu’il n’arrive rien à ton père.
Je me mets à genoux à côté de ma mère; Pierre en fait autant, ayant déjà les yeux pleins de larmes; Jacques reste seul à table continuant à manger.