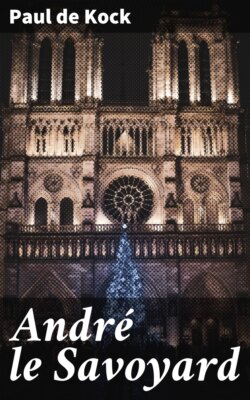Читать книгу André le Savoyard - Paul de Kock - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE V
LES PETITS SAVOYARDS.—FRAYEUR ET PLAISIR.
ОглавлениеTable des matières
Nous marchons depuis près d’une heure, Pierre et moi, et nous ne nous sommes encore rien dit. Je ne l’entends plus parler; mais il pousse de temps à autre de gros soupirs qu’il finit par ces mots: Jacques est bien heureux, lui!... il reste chez nous!...
J’ai aussi cessé de pleurer. Je commence à regarder autour de moi; ce ne sont encore que des montagnes et des sites semblables à ceux qui entouraient notre chaumière, et cependant tout cela me paraît différent; il me semble déjà que je suis loin... bien loin de mon pays!... J’aperçois un village; nous y demanderons si l’on a vu nos compatriotes; d’ailleurs, je me souviens du nom de la première ville où nous devons nous rendre: c’est à Pont-de-Beauvoisin, puis après à Lyon. Oh! j’ai de la mémoire, et je trouverai bien ma route.
—André, je suis las, me dit Pierre en s’arrêtant devant moi.—Asseyons-nous là-bas... au bord de la route, lui dis-je en le regardant avec tendresse; car je me souviens des dernières paroles de ma mère: elle m’a dit de veiller sur mon frère, de le protéger, de ne point l’abandonner. Je me sens fier de la confiance qu’elle a eue en moi, et de cette secrète supériorité qu’elle me reconnaît sur lui.
Nous nous sommes assis au pied d’une colline:—Marcherons-nous longtemps? me dit Pierre, qui a toujours l’air bien affligé.—Ah! dame! nous ne sommes pas près d’arriver!...—Jacques est bien heureux, lui!... il reste chez nous!...—Nous allons gagner de l’argent pour aider notre mère; est-ce que tu en es fâché?—Et comment ferons-nous pour gagner de l’argent?—Nous ramonerons les cheminées; nous ferons des commissions, nous danserons la savoyarde, nous chanterons la chanson que nous a apprise notre père...
Pierre, qui a fait la grimace quand j’ai parlé de ramoner, me dit alors:—Si tu veux, André, tu ramoneras les cheminées, et moi je danserai.
Je regarde mon frère; ses yeux bleus étaient encore gonflés d’avoir pleuré; sa figure, ordinairement riante, ronde et rouge comme une cerise, et que ses cheveux blonds qui tombaient en grosses boucles sur son front rendaient si gentille, était comme ses yeux changée par le chagrin. Je lui saute au cou, je l’embrasse tendrement; cela nous fait du bien, et Pierre retrouve l’appétit.
—J’ai faim, me dit-il.—Mangeons..., nous avons de quoi dans nos sacs.
Pierre fouille dans le sien... il pousse un cri de joie. Ma bonne mère nous a glissé des noisettes et des pommes avec notre pain.—André!... André!... des pommes! me dit-il. Et le voilà qui mange et chante en même temps; les pommes ont rendu à mon frère toute sa gaieté.
—Dis donc, André, qu’est-ce que nous verrons à Paris? me dit-il tout en se bourrant de pommes et de noix.—Oh! tout plein de choses!... Tu sais bien que mon père nous racontait ce qu’il y avait vu...—Ah! oui... des polichinelles, n’est-ce pas? et puis des hommes qui font des tours... qui mangent du fil et des aiguilles... qui marchent sur la tête, qui tournent sur une jambe.—Oh! bien d’autres choses encore!... des rues superbes, des maisons bien plus grandes que la nôtre, des voitures qui roulent toujours, des boutiques, comme quand c’est la foire à la ville de l’Hôpital, des lanternes magiques, des pièces curieuses, le soleil et la lune qu’un monsieur porte sur son dos, le diable qui danse, un chat qui lui tire la queue, et une bataille avec des chevaux dans une petite maison.
—Comment! nous verrons tout ça? dit Pierre en se levant et sautant de joie; ah! comme nous allons nous amuser... Tiens, moi, je ferai la roue... Vois-tu, André, comme je la fais bien!
Et voilà mon frère qui s’exerce à faire la roue sur le bord de la route; il ne pense déjà plus à notre chaumière. Ah! Pierre sera heureux à Paris!
Mais le temps se passe: il faut nous remettre en route; Pierre fait la grimace. Il n’était plus fatigué pour faire la roue, il l’est encore pour marcher. Il me suit cependant, tout en faisant la moue. Mon frère, lui dis-je, tu sais bien que notre mère nous a recommandé de ne point être paresseux; si nous nous arrêtons souvent aussi longtemps, nous ne rattraperons pas les autres...—Je suis las.—Tu dansais tout à l’heure.—J’ai mal au talon.—Ça ne t’empêchait pas de faire la roue; il faut bien que nous arrivions ce soir dans une ville pour trouver à coucher, sans cela il faudrait dormir sur la route.—Ah! oui, oui, dit Pierre. Et il retrouve ses jambes, parce qu’il a peur de passer la nuit en plein air. Je sais maintenant le moyen de le faire avancer.
—Dis donc, André, si nous allions nous perdre?...—Oh que non! nous demanderons toujours le chemin de Paris.—Si nous rencontrions des voleurs?—Tu sais bien que ma mère nous a dit que l’on ne volait pas les enfants.—Est-ce parce que les voleurs aiment les enfants?—Non, c’est parce que, quand on est petit, on n’a pas d’argent.—Ah! quand je serai grand, je n’aurai jamais d’argent, pour ne point avoir peur des voleurs.—Et avec quoi achèterons-nous du pain et des pommes?—Je ferai la roue et on me donnera de quoi dîner.—Et qu’est-ce que tu enverras à notre mère?
Pierre ouvre de grands yeux et ne répond rien.
Les pommes, la roue et les voleurs l’occupent entièrement.
Nous sommes arrivés au village que j’avais aperçu de loin; je demande si l’on a vu passer une bande de Savoyards se rendant à Paris ou à Lyon.
—Oui, mes enfants, me dit une bonne vieille, mais ils ont beaucoup d’avance sur vous. Ils sont passés au point du jour et voilà le soleil qui va bientôt se coucher.
—Allons, en route! dis-je à mon frère, qui s’est déjà assis sur un banc devant une maisonnette et mange ce qui lui reste de pommes et de noix.—Est-ce que nous n’allons pas dîner?—Nous dînerons en chemin... il faut rejoindre nos amis.
Pierre a beaucoup de peine à se décider à se lever, mais il me voit m’éloigner; il me suit enfin. Je me suis bien fait indiquer la route que nous devons tenir, car le jour commence à baisser; et si nous nous égarions dans les montagnes, nous pourrions tomber dans quelque précipice ou glisser dans quelque ravin.
—Ne va donc pas si vite! me crie Pierre. Est-ce que les autres ne nous attendront pas?—Non, car ils ne savent pas que nous les avons suivis.—Je suis déjà bien las.—Et quand nous courions toute la journée dans le village, quand nous descendions sur nos mains le mont du Corbeau, tu n’étais jamais las.—Ah! j’aime mieux grimper à quatre pattes que marcher comme ça.—Tu n’as donc pas envie d’arriver à Paris?—Oh! si; mais Jacques est chez nous, lui! il n’est pas fatigué, et il aura de la soupe ce soir.
Pierre pousse un gros soupir en songeant à la soupe. Nous avançons toujours, mais le jour finit, et je n’aperçois pas le village que l’on m’a dit qu’il fallait gagner pour trouver à coucher. Mon frère, qui était toujours en arrière, se rapproche de moi dès que la nuit paraît.
—Dis donc, André, voilà la nuit...—Eh bien! ça n’empêche pas de marcher quand il fait clair de lune; nous verrons bien devant nous.—Est-ce que nous ne sommes pas bientôt arrivés?—Je ne sais pas.—Veux-tu courir, mon frère?—Non, non; ma mère nous a défendu de courir; ça nous rendrait malades en route... D’ailleurs tu es las.—Non, je ne suis pas fatigué... Tiens, allons plus vite.
Pierre double le pas. Heureusement que la lune qui vient de paraître éclaire alors nos montagnes et nous permet de marcher sans danger. Cependant cette clarté a quelque chose qui inspire la tristesse. Les objets que nous voyons ne nous paraissent plus les mêmes; les ombres changent leurs formes. Souvent un bloc de rocher, une simple pierre, a de loin un aspect effrayant. Mon frère ne regarde plus qu’avec crainte autour de lui, il se serre contre moi, me tient le bras, qu’il presse avec force. Nous marchons ainsi sans parler pendant assez longtemps; le bruit de nos souliers ferrés trouble seul le silence de la nuit et le calme de nos montagnes, dont les habitants sont déjà livrés au repos.
L’ardeur de Pierre se ralentit; il commence à perdre courage, et nous n’allons plus aussi vite.—André, est-ce que nous ne sommes pas bientôt arrivés? me dit-il à demi-voix comme s’il craignait d’être entendu à droite ou à gauche. Je devine au son de sa voix qu’il a grande envie de pleurer, et je tâche de le consoler.
—Allons, Pierre, ne sois pas chagrin, nous souperons bien en arrivant...—Ah! je n’ai plus ni pommes ni noix.—On nous donnera quelque chose; tu sais bien que ma mère nous a dit qu’en chemin on donne aux enfants qui vont à Paris.—Nous aurons peut-être du lard?...—Si on nous en donne, nous danserons...—Oh! oui!... Comme c’est bon, du lard!... En mange-t-on à Paris?—Oui, puisqu’on gagne beaucoup d’argent. Il y a des gens qui donnent un sou pour une chanson...—Un sou!... C’est beaucoup d’argent, ça.—Tiens, chantons tous les deux pour voir comment nous ferons à Paris.—Non, je ne veux pas chanter... j’ai envie de dormir.—Nous dormirons quand nous serons arrivés...—Je ne vois pas de maisons!—Allons, Pierre, il faut que je te tire à présent: marche donc...—Si nous étions pris par des voleurs?...—Tu es un poltron, tu trembles toujours; quand tu seras à Paris tout le monde se moquera de toi!—André, est-ce qu’il n’y a pas des hommes qui mangent les enfants?—Eh non! c’est pour rire qu’on raconte ces choses-là, tu sais bien que mon père se moquait de Jacques quand il disait cela; d’ailleurs, si on voulait te faire du mal, je saurais bien te défendre! je donnerais des bons coups, va!...
—Pierre a beaucoup de peine à se rassurer; cependant nous continuons de marcher, lorsque tout à coup il s’arrête et me saisit le bras en me disant d’une voix tremblante:—Ah! mon frère! vois-tu là-bas?...
Il me désigne le côté droit de la route, à une trentaine de pas de nous, et j’aperçois une ombre de la grandeur d’un homme qui avance, puis recule sur le chemin que nous devons prendre; en même temps, j’entends comme un bruit sourd et uniforme qui se répète toutes les fois que l’ombre s’allonge et s’étend sur la route. Quoique je ne sois pas poltron je sens que mon cœur se serre, que ma respiration est gênée; je fais comme Pierre: je m’arrête, les yeux fixés sur cet objet, près duquel je crains d’approcher.
—Ah! mon frère, qu’est-ce que c’est que ça? me dit Pierre, qui n’a presque plus la force de parler.—Dame... je ne sais pas...—Vois-tu comme ça remue... comme c’est grand?... entends-tu le bruit que ça fait?...—Oui... mais il faut pourtant que nous passions là... Oh! non, André... non, je t’en prie... j’ai trop peur... sauvons-nous...—Allons, Pierre, ne tremble pas ainsi... Nous sauver!... Non, mon père m’a dit que c’était honteux de se sauver. Cet homme qui est là veut nous effrayer; mais moi je n’ai pas peur... viens...—Non, non, André, je n’ose pas...
Pierre se jette à genoux; il veut me retenir, il saisit ma veste, mais je ne l’écoute pas... Je me dégage, et il cache sa figure dans ses mains: j’avance fièrement vers l’objet qui nous cause tant d’alarmes, en criant bien haut pour me rassurer:—Non, non, je n’ai pas peur, moi!...
J’approche enfin; et dans ce moment l’ombre mouvante s’approchait aussi et semblait vouloir me barrer le passage. Je n’avais pas encore osé la regarder en face pour m’assurer de ce que c’était; mais quelle est ma surprise en arrivant contre cet objet, de me trouver devant une barrière fixée après un poteau, et placée là pour empêcher les voyageurs de tomber dans un trou très-profond qui touchait presque la route. Cette barrière, qui s’ouvrait par le milieu, devait être fermée par une chaîne ou un cadenas; mais depuis longtemps une moitié s’était cassée; on avait négligé de la raccommoder, et ce qui restait et tenait au poteau par des gonds de fer tournait et retournait au gré du vent en rendant un son uniforme causé par le frottement continuel des vis qui criaient dans les gonds.
Je n’ai pas plutôt reconnu ce que c’est, que, riant de ma frayeur, enchanté d’avoir eu le courage de la surmonter, je grimpe sur la barrière et me mets à cheval dessus, tournant avec elle au gré du vent.
Pierre, qui est resté à terre la tête cachée dans ses mains, m’entend pousser des cris de joie en répétant:—Hue donc! à cheval!... ah! que c’est gentil!... viens donc, Pierre... Ah! qu’on est bien là-dessus! ça va tout seul.
Pierre ne sait ce que cela veut dire, ni s’il doit se risquer à venir me trouver. Cependant je l’appelle toujours, il m’entend rire, cela dissipe sa frayeur. Il s’approche enfin, et ne m’a pas plutôt vu tournant sur la barrière, qu’il grimpe à califourchon et se met en croupe derrière moi. Puis nous donnons le mouvement, et nous voilà nous ébattant à qui mieux mieux sur le morceau de bois qui nous fait tourner autour du poteau. Nous ne remarquons pas que ce poteau est placé tout près d’un précipice, et qu’en nous faisant aller de toute notre force sur la barrière, nous pourrions, si nous perdions l’équilibre lorsqu’elle revient sur le bord, rouler à plus de trente pieds, et nous casser bras et jambes sur les rochers; mais nous ne voyons plus le danger, et ce qui un moment auparavant nous causait de si vives alarmes est devenu pour nous une source de plaisirs.
Comme il faut que tout ait une fin, après être restés près de trois quarts d’heure sur cette nouvelle balançoire, je descends et je dis à Pierre:—Il faut nous remettre en route, mon frère.—Ah! encore un peu... c’est si amusant!—Et coucher? et souper?...—Oh! je n’ai plus ni faim ni envie de dormir... André, fais-moi aller, je t’en prie!—Non, en voilà assez, il faut arriver au village.
J’ai bien de la peine à déterminer Pierre à descendre de dessus la barrière; il cède cependant en répétant:—Quel dommage!... comme c’était amusant!
Nous nous remettons en marche; mais cette fois c’est en riant, en chantant; la frayeur a disparu, le jeu nous a ôté de la tête toutes les visions causées par le clair de lune; et maintenant, quand nous apercevons de loin quelque chose qui semble remuer, Pierre s’écrie en sautant de joie:—Ah! si c’était encore une balançoire!... Qu’il faut peu de chose pour nous faire envisager les objets sous un aspect différent!.......
Nous sommes arrivés au bourg que l’on m’a indiqué, et cette fois le chemin ne nous a pas paru long. Mais il est sans doute tard, car je n’aperçois pas de lumière dans les maisons.—Vois-tu! dis-je à Pierre, nous sommes restés trop longtemps à cheval sur la barrière. Je ne sais pas où il faut frapper pour demander à coucher et à souper.—Il faut frapper à une maison...—Oui, mais dans toutes les maisons on ne donne pas à coucher!...—Bah!... nous leur chanterons quelque chose... ou ben tu ramoneras, toi.—Est-ce qu’on ramone la nuit?... Cette bonne dame où nous avons passé ce matin m’avait dit d’aller à l’auberge, qu’on y couchait les Savoyards pour deux sous dans une belle grange, avec un morceau de fromage.—Il faut y aller...—Mais je ne sais à qui demander... Viens, Pierre, on dit que c’est une grande maison; cherchons-en une belle.
Nous voilà parcourant le bourg, qui est assez considérable, et regardant toutes les maisons au clair de la lune. J’en aperçois une qui me semble bien plus belle que les autres, et je dis à Pierre:—C’est sans doute l’auberge... frappons.
Nous cognons avec nos pieds et nos poings contre la porte de la maison. Aussitôt nous entendons les aboiements d’un chien qui accourt tout contre la porte à laquelle nous avons frappé, et qui fait un bruit épouvantable. Pierre, effrayé, s’éloigne de la maison, dont il ne veut plus approcher; je cours après lui pour le rassurer, mais les aboiements du chien ont réveillé les autres. Tous les mâtins du bourg semblent se répondre: de quelque côté que nous nous sauvions, nous entendons près de nous japper avec fureur, et Pierre est tremblant, parce qu’il croit avoir après lui tous les dogues de l’endroit; il veut à toute force quitter le village.
—Viens, André, me dit-il, allons-nous-en... Il n’y a que des chiens dans cet endroit-ci... Oh! j’aime mieux coucher sur la route...—N’aie donc pas peur!... Tous ces chiens-là sont pour garder les maisons; mais ils ne nous feront pas de mal, nous ne sommes pas des voleurs!... Est-ce qu’il faut trembler comme ça? Attends, voilà encore une belle maison, je vais frapper plus doucement, pour que les chiens ne m’entendent pas.
Je cogne un petit coup contre la porte: on ne répond pas. Je continue de cogner; mais le bruit que font les chiens empêche qu’on ne m’entende. Cependant on ouvre une fenêtre à quelques pas de moi, puis une autre dans une maison à côté: j’entends des voix, et bientôt la conversation s’établit d’une croisée à l’autre.
—Dieu! queu tapage font tous ces mâtins!... queu qu’ils ont donc cette nuit pour être en l’air comme ça?...—Ah! c’est toi, Claudine! t’es donc réveillée aussi?—Est-ce qu’on peut dormir avec ce charivari?... Et toi, est-ce ton mari ou les chiens qui t’ont éveillée?—Mon mari!... Ah ben! on lui tirerait le canon dans l’oreille qu’il n’ bougerait pas plus qu’une bûche!... i’ n’est pus jamais gai la nuit. Tiens, Jeanne, si tu te remaries, ne prends pas un plâtrier!... I gnia rien de plus traître que ça... C’est un état trop fatigant, vois-tu: Michel est un bonhomme, mais i’ n’rit que le dimanche!...—Ah! c’est ben triste!... j’ tâcherai d’épouser un couvreur, ils sont ben plus aimables.
Pendant la conversation de ces dames, le bruit a cessé. Je veux m’approcher d’elles et leur parler; mais elles viennent de refermer leur croisée. Je retourne à la grande maison, je frappe encore... Enfin, on ouvre une fenêtre: une vieille figure presque cachée sous un grand bonnet de laine se montre et demande avec colère:
—Qui est-ce qui ose frapper chez M. le maire à l’heure qu’il est?
—C’est nous, madame...—Qui, vous?—André et Pierre...—Qu’est-ce qu’ils veulent, André et Pierre?—Nous sommes de petits Savoyards... Avez-vous une cheminée à faire nettoyer?... Voulez-vous nous ouvrir, nous chanterons la petite chanson, et nous danserons nous deux mon frère pour un peu de pain et de fromage...—Ah! les petits drôles!... Ah! les mauvais sujets, qui viennent réveiller des gens comme nous!... pour leur proposer de les voir danser! Si je vous retrouve demain, je vous ferai danser, moi. Du fromage!... du fromage!... à ces polissons!... Allez-vous-en bien vite, et que je ne vous entende plus. Venir la nuit!... ramoner... chez M. le maire!...
La vieille femme est rentrée en murmurant des menaces contre nous. Je retourne tristement près de mon frère.
—André, me dit-il, ces gens-là sont bien méchants, ils ne veulent pas nous ouvrir... Pourquoi donc ça? Et quand on frappait la nuit à notre chaumière, mon père ouvrait toujours; il partageait son souper, sans faire ramoner sa cheminée, et sans savoir si on lui chanterait quelque chose. Pourquoi ces gens-là ne sont-ils pas comme mon père?—Ah! dame! je ne sais pas!...—Ça sera-t-il comme ça à Paris?—Oh! non! à Paris on aime bien les Savoyards, parce qu’on a beaucoup de cheminées à faire ramoner.
Tout en causant avec mon frère, j’aperçois, à côté d’une petite maisonnette de bien chétive apparence, une espèce d’écurie dans laquelle sont plusieurs monceaux de paille et des instruments de jardinage. Il n’y a point de porte qui ferme cet endroit; j’entre tout doucement, en faisant signe à Pierre de me suivre. Il n’ose pas.—Il y a peut-être encore des chiens, me dit-il en restant à la porte. J’entre seul... je m’assieds sur la paille, et Pierre, voyant qu’il n’y a pas de danger, se décide enfin à entrer, et vient s’asseoir près de moi.
—Oh! qu’on est bien là, André!—Nous allons y passer la nuit.—Mais si on nous gronde demain?—Non, non, puisqu’il n’y a pas de porte, c’est qu’on veut bien permettre d’y entrer. N’aie pas peur, Pierre... Nous serons aussi bien là que dans leur maison, et on ne nous dira rien.
Pierre se rassure; d’ailleurs il est las, et il a sommeil. Comment quitter cette paille, sur laquelle nous sommes si douillettement!... Mon frère se couche à mon côté; je passe un de mes bras autour de lui, pour le sentir toujours près de moi; je mets mon autre main sur le médaillon, que je porte sous ma veste, afin qu’on ne puisse pas me l’enlever, car je suis fier de porter un objet si précieux. Plus tranquille de cette manière, je ne tarde pas à imiter Pierre, et nous nous endormons profondément.