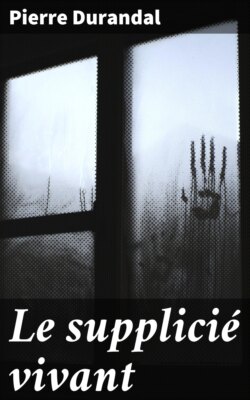Читать книгу Le supplicié vivant - Pierre Durandal - Страница 4
PROLOGUE
LA TERRE DES TITANS
ОглавлениеIl n’y a dans toute la nature aucun spectacle qui puisse être comparé au panorama des grands lacs de l’Amérique du Nord. Qu’on se figure, en effet, un cadre gigantesque dépassant, au delà de toute conception, les proportions étroites des horizons mesquins du vieux monde. Dans cette étendue incommensurable aux perspectives féeriques se dresse, plus majestueux que l’imagination la plus hardie ne saurait se le représenter, un amphithéâtre colossal dont les gradins étagés en arc-en-ciel forment autant de cascades tombant chacune d’un bassin supérieur et descendant de plateau en plateau en nappes grandioses, pour se dégorger finalement dans une mer d’eau douce, le golfe Saint-Laurent. Celui-ci se relie aux grands lacs par le fleuve du même nom qui règne sur une vallée où pourrait tenir à l’aise tout le continent européen.
C’est ici, tout l’indique, la terre mystérieuse entrevue par Platon dans ses rêves. Les anciens, commentant les passages célèbres du Critias et du Timée, en célébrèrent les merveilles. Ils la nommaient Atlantide et y plaçaient le séjour des Titans. Quels autres, en effet, que les géants mythiques pouvaient, à leurs yeux, habiter, aux àges les plus reculés, ces solitudes sans bornes, dont l’approche était, disait-on, défendue par des brumes épaisses et éternelles, et où n’avaient, suivant la tradition, abordé, dans la nuit des temps, que quelques malheureux naufragés jetés par la tempête sur ces côtes inconnues?
Région superbe entre toutes, dont aucun pinceau ne pourrait reproduire la splendeur, et où la pompe de la création éclate dans toute sa gloire. Au-dessus du fleuve Saint-Laurent, qui verse dans le golfe cinquante-sept millions et demi de mètres cubes d’eau par heure, le charmant petit lac des Mille-Iles, écrin de perles miroitant au soleil, reçoit les eaux tranquilles de l’Ontario, la première assise de l’amphithéâtre. Dans cette vasque prodigieuse dont l’orifice est de quatorze mille kilomètres carrés et la profondeur de cent quatre-vingt-dix mètres, se déversent par deux chutes les cascades du Niagara. Plus haut est le lac Érié, non moins imposant: il a cent soixante mètres de profondeur et seize mille cinq cents kilomètres de surface. Il sert, par le Détroit et le Saint-Clair, de déchargement au Michigan, qui a quarante-trois mille kilomètres carrés d’étendue. Au Michigan se rattache par une pente à peine sensible le lac Huron. Ce dernier a cinq cents lieues de long sur quatre-vingt-dix de large. Il communique par les sauts Sainte-Marie, c’est-à-dire par une succession de cascades superposées, avec le lac Supérieur, qui est le faîte de cet édifice fantastique. Ici les dimensions atteignent dans tous les sens à l’idéal, et l’esprit humain, quel que soit son orgueil, demeure confondu devant ce triomphe de la puissance divine. Le lac Supérieur est un véritable océan, suspendu à cent quatre-vingt-treize mètres d’altitude, et dont le reflux et les orages le disputent en violence aux mouvements les plus impétueux de la mer. Quarante rivières y portent leur tribut. Sa circonférence a cinq cents lieues, sa profondeur mesure trois cents mètres. Ses trois îles, Maurepas, Royale, Saint-Ignace, fertiles et plantureuses, séduisent le regard par leurs formes étranges et les couleurs chatoyantes de leur végétation. Telles des oasis dans l’immensité du désert. La chaîne des monts Alleghanys ou Apalaches, dont plusieurs sommets s’élèvent au delà de six cents mètres, projette dans ces bassins si admirablement disposés les larges ombres de son flanc énorme couvert de forêts.
Au XVIIe siècle et pendant toute la première moitié du XVIIIe, cette contrée si digne d’être appelée un présent de Dieu et qu’avaient découverte nos intrépides Argonautes malouins, nous appartenait tout entière. Jacques Cartier en1534, Roberval en1541y avaient planté notre drapeau et fait reconnaître, dans ce monde où nul Européen n’avait pénétré avant eux, l’autorité de la France. Quelques colons, la plupart originaires de Saint-Malo, s’y étaient plus tard établis sous la protection de nos armes. Le Canada devint ainsi en peu de temps un centre de ralliement. La pêche de la morue et le commerce des fourrures furent jusqu’au règne de Henri IV les principaux attraits de cette émigration vers la Nouvelle-France. Malheureusement les guerres civiles qui désolèrent notre pays sous les derniers Valois détournèrent l’attention de ce mouvement. Les Anglais et les Hollandais en profitèrent pour fonder les établissements de la Nouvelle-Bretagne et de la Nouvelle-Belgique sur le rivage de l’Atlantique.
Lorsque, en1602, Samuel de Champlain, reprenant la route ouverte par Cartier, remonta le Saint-Laurent jusqu’au saut Saint-Louis, les colonies britanniques et néerlandaises étaient déjà plus prospères et plus peuplées que les positions françaises. Cependant, tel était l’ascendant exercé par ce vaillant explorateur sur ses compagnons, qu’en peu d’années de vastes défrichements furent opérés par les Malouins dans toutes les directions. Québec, hameau conquis sur les naturels et situé favorablement sous le double rapport du commerce et de la défense, reçut, en1608, le nom de capitale de la Nouvelle-France. Dès ce moment l’impulsion était donnée. Des agglomérations d’habitations, devenues plus tard des villes, se succédèrent d’année en année; on s’adonna à la culture du sol déboisé; des routes protégées par des forts réunirent les différents postes et centres de commerce, et, grâce à cette féconde initiative, la domination du pays et la liberté des communications se trouvèrent rapidement assurées dans la région des cinq lacs, sur le cours des fleuves et au travers des bois.
A cette époque, trois grandes nations indiennes occupaient la contrée où les Français poursuivaient leurs conquêtes. Au nord du Saint-Laurent vivaient les Algonquins, tribus généralement nomades, qui parcouraient les forêts pour y suivre la piste des cerfs, des élans, des daims et des chevreuils, tout en étant forcées parfois de se défendre contre les ours et les loups. Souvent aussi ils pénétraient dans les plaines voisines des grands lacs qui étaient le domaine des bisons. Ou bien encore ils longeaient les rivières et s’engageaient dans les marais pour y surprendre le castor et la loutre, dont ils vendaient la fourrure aux Européens, et principalement aux colons du Canada. Deux de ces peuplades algonquines, plus sédentaires que les autres, se livraient plus exclusivement à l’agriculture. C’étaient les Miamis et les Illinois. Moins farouches que les autres naturels et conséquemment plus accessibles à la civilisation, ils furent, dès le commencement du mouvement colonial, les alliés des Français, et formèrent avec nous des relations étroites d’intérêt et d’amitié. Nos missionnaires, récollets et jésuites, trouvaient parmi eux un accueil bienveillant. Aussi les conversions y furent-elles rapides et nombreuses. D’autant plus qu’en vertu d’une charte octroyée par le cardinal de Richelieu aux cent associés fondateurs de la Nouvelle-France, tout Indien converti était de droit citoyen français.
Toutefois, autant les Miamis, les Illinois et la plupart des Algonquins témoignaient d’empressement à se rapprocher des établissements français, autant les deux autres nations indigènes étaient animées contre nous de sentiments d’hostilité ou de haine. Les Wyandots, que les premiers colons avaient, à cause de leurs coiffures bizarres, baptisés du nom caractéristique de Hurons, habitaient au nord des lacs Erié et Ontario. Intelligents et industrieux, ils avaient, sous l’énergie de leurs chefs, acquis une grande supériorité sur les autres tribus. C’étaient des hommes de haute taille, aux membres fortement musclés, au regard franc et ferme, et ne craignant ni le danger ni la mort. Ils étaient en lutte depuis des temps fort éloignés avec les Iroquois, non moins puissants qu’eux, et qui, établis au sud de l’Ontario et du Saint-Laurent, leur disputaient dans la région des lacs de vastes territoires de chasse. De là une guerre à outrance, où chaque rencontre était signalée par d’horribles carnages.
La bravoure des Hurons, leur fidélité inébranlable à la foi jurée, leurs mœurs relativement policées, la noblesse d’âme dont ils donnèrent en plusieurs circonstances la preuve, enfin l’établissement de leurs campements sur la rive du Saint-Laurent, où les Français eux-mêmes s’étaient fixés, avaient décidé Champlain à faire la paix avec eux et à les soutenir dans leurs sanglantes querelles avec les Cinq-Nations iroquoises. Celles-ci, de leur côté, trouvèrent un appui chez les Hollandais de la Nouvelle-Belgique et chez les Anglais de la Nouvelle-Bretagne, qui étaient, les uns et les autres, jaloux de voir le Canada reculer ses limites dans tous les sens, et ne laissaient échapper aucune occasion de traverser nos projets ou d’opposer des barrières à nos progrès.
Telle était la situation de la colonie lorsqu’en1649éclata un événement qui devait être pour les Hurons, en même temps que pour nous, le point de départ d’une nouvelle guerre de cent ans, non moins acharnée que la première, et dont l’issue nous fut, sous tous les rapports, plus funeste.
On était aux premiers jours de l’année. L’hiver, toujours rude au Canada, où le sol disparaît sous la neige pendant six mois consécutifs, avait redoublé de rigueur. Bien qu’ils fussent accoutumés aux intempéries, les Hurons, campés au saut Saint-Louis, se tenaient le plus souvent enfermés dans leurs huttes. A peine un petit nombre vaquaient au dehors aux travaux les plus urgents. Les autres, cantonnés dans le village, demeuraient assis jusqu’à la tombée de la nuit devant de grands feux sans cesse ravivés. Ils écoutaient avec la plus vive curiosité les enseignements de deux missionnaires récemment arrivés dans la contrée.
Le plus âgé de ces pionniers de l’Évangile semblait être le Mentor de son compagnon. C’était une de ces natures héroïques, préparées par de longues épreuves aux plus cruelles vicissitudes de la vie. Jeune encore, quoiqu’il fût entré dans l’Ordre de Jésus vingt ans auparavant, il était de ces élus de la grâce auxquels est ouverte la route des souffrances. Il y marchait avec assurance, soutenu par l’inébranlable fermeté de sa foi, et persuadé d’avance de trouver au bout la palme du martyre. Sur ces âmes de fer les tortures n’exercent point d’empire.
Le P. de Brébeuf avait été des premiers à répondre à l’appel de Champlain et des cent associés. Il s’était dit que sur cette terre vierge la moisson de Dieu ne pouvait manquer d’être abondante, et il avait béni les desseins de la Providence qui lui confiait la mission de répandre la bonne nouvelle parmi ces peuples ignorants et de les arracher à la barbarie et à la misère. Il allait devant lui, n’ayant d’autre moyen de défense que le bâton du pasteur dont il faisait à peine usage pour écarter les ronces du chemin et pour repousser les agressions des animaux sauvages. Aux sons de la clochette qu’il tenait à la main, les naturels accouraient sur son passage, saisis d’une admiration muette, et se groupaient à sa suite, attendant que cet homme extraordinaire, dont la stature athlétique commandait le respect, leur parlât en leur langue, qu’il avait apprise avec une étonnante facilité.
Plus jeune que le P. de Brébeuf, mais non moins courageux que lui, le P. Lallemant, fils du lieutenant-criminel de Paris, s’était attaché aux pas de son généreux guide, et tous deux frayaient de commun effort le sentier du Seigneur.
Les Hurons du saut Saint-Louis avaient une affection toute filiale pour ces deux hommes de bien qu’ils appelaient, dans leur langage imagé, les «Pères de la prière». Ils les trouvaient l’un et l’autre toujours prêts à secourir ceux qui étaient en danger, à conseiller les chefs dans leurs entreprises, à soutenir les combattants dans leurs légitimes expéditions, à donner les dernières consolations aux mourants et à rendre l’espérance à ceux qui perdaient un parent ou un ami. Aussi, tant était grande la reconnaissance de ces naturels pour leurs bienfaiteurs, que tous eussent volontiers fait le sacrifice de leur vie pour conserver celle des bons et infatigables missionnaires,
La nuit était venue, et le village était plongé dans le silence et le sommeil. Seuls quelques grands chiens de garde laissés en liberté veillaient à l’entrée du campement, l’oreille dressée au moindre bruit, et perçant de leurs regards la profonde obscurité qui les enveloppait. Tout à coup des rumeurs sourdes produites par un bruissement de feuilles mortes et un craquement étouffé de branches sèches éveillèrent l’attention des fidèles sentinelles. Un instant après, leurs aboiements répétés jetaient l’alarme parmi les Hurons. En moins de temps qu’il n’en faut pour décrire cette scène, tout le village fut debout. Il n’y avait point à s’y tromper. Le campement était attaqué et une lutte terrible allait s’engager.
Elle fut de courte durée. Les Hurons, inférieurs en nombre, succombèrent après une résistance héroïque. Presque tous restèrent sur le champ de bataille. Les autres furent pris. Pas un ne voulut chercher son salut dans la fuite. Accourus aux premiers cris, les PP. de Brébeuf et Lallemant s’étaient jetéss au milieu de la mêlée, non pour y prendre part, mais pour donner le baptême ou administrer les derniers sacrements à ceux qu’ils considéraient comme leurs enfants. Agenouillés auprès des moribonds et leur faisant baiser le crucifix, ils furent faits prisonniers dans cette attitude, et les Iroquois les entraînèrent avec les Hurons survivants pour les livrer en même temps qu’eux au supplice.
Cependant, à peine la troupe des vainqueurs, accablant de sarcasmes et d’imprécations les victimes destinées au sanglant sacrifice, eut-elle atteint le but de sa course, qu’elle sépara le P. de Brébeuf de ses compagnons de souffrance, tant était ferme le maintien de cet homme impassible, dont le calme même les exaspérait et leur semblait en quelque sorte contagieux.
Ils le firent monter sur un échafaud et épuisèrent sur lui tous les raffinements de la cruauté. Le serviteur de Dieu demeurait insensible à leurs menaces et à leurs tortures. Il ne voyait plus les Hurons, mais sa voix forte, dominant toutes les clameurs, ne cessait de les exhorter à la patience et à la résignation, en même temps qu’il parlait à ses bourreaux de la colère divine et des châtiments réservés aux persécuteurs des chrétiens.
Les Iroquois, ne voyant dans ces paroles que des bravades accoutumées à leurs prisonniers, voulurent lui imposer silence; n’en pouvant venir à bout, ils lui coupèrent la lèvre inférieure et l’extrémité du nez, lui appliquèrent par tout le corps des mèches allumées, lui brûlèrent les gencives, et enfin lui enfoncèrent dans le gosier un fer rouge.
L’invincible missionnaire ne poussa point un gémissement. Sa physionomie avait au contraire une expression d’angélique sérénité, et la miséricorde seule se lisait dans son regard fixé sur ses ennemis.
Toutefois les sauvages lui réservaient des tourments encore plus cruels. Ne pouvant briser son courage, ils résolurent de le frapper au cœur, en faisant souffrir le P. Lallemant sous ses yeux. Le jeune religieux fut amené en sa présence, les mains liées derrière le dos, dépouillé de tout vêtement, et le corps couvert des pieds à la tête d’écorces de sapin auxquelles on mit le feu.
Aux plaintes de cet infortuné dont les chairs crépitaient sous l’action de la flamme, les Iroquois, en proie au délire que cause le paroxysme de la rage, répondaient par des contorsions affreuses, en répétant la sinistre mélopée du scalp. Enveloppé d’une fumée épaisse, le P. Lallemant, presque étouffé, levait les mains au ciel pour implorer le secours de Dieu. On le frappa à grands coups de corde, et son corps, déjà mis en lambeaux par le feu, ne fut bientôt plus qu’une plaie.
Pendant ce temps, d’autres sauvages avaient fait rougir des haches de fer; ils en fabriquèrent un collier qu’ils mirent au cou du P. de Brébeuf; puis, obéissant aux instigations d’un Huron apostat, ils répandirent lentement de l’eau bouillante sur la tête des deux confesseurs de la foi, en dérision des cérémonies du baptême.
Ce ne fut pas tout. Quelques-uns, ajoutant la raillerie à la cruauté, dirent que la chair de ces visages pâles devait être bonne; ils en coupèrent sur le corps des deux martyrs de grands lambeaux qu’ils mangèrent. Reprenant ensuite le chant du scalp, ilsse ruèrent sur le P. de Brébeuf, lui tirèrent les cheveux, lui enlevèrent la peau de la tête, et comme il respirait encore, un des chefs lui ouvrit le côté d’où le sang jaillit en abondance, puis il lui fendit la poitrine, en arracha le cœur et le dévora.
Le supplice du P. de Brébeuf s’était prolongé pendant trois heures. Celui du P. Lallemant en dura dix-sept. Après la mort de son compagnon, on le ramena dans la cabane où ses souffrances avaient commencé. On lui porta au-dessus de l’oreille gauche un coup de hache qui lui ouvrit le crâne et en fit sortir la cervelle. On lui arracha ensuite un œil, à la place duquel on mit un charbon ardent. Enfin le ciel ne permit point que la ferveur de cette grande âme, triomphant de toutes les tortures infligées au corps, fût soumise à d’autres épreuves. Le P. Lallemant expira, comme le P. de Brébeuf, sans avoir un seul regard de haine pour ses bourreaux.
Cette victoire décisive des Iroquois sur les Hurons fut le signal d’une guerre d’extermination dans le Canada. Les vainqueurs ne se contentèrent point de détruire les villages indiens. Ils ravagèrent la colonie française elle-même, et sans le canon de Québec, qui les tint en respect, la ruine de notre établissement eût été infailliblement consommée dès cette époque. Quoi qu’il en soit, les tentatives de paix avec les Cinq-Nations échouèrent; nos postes les plus importants, même ceux de Québec et de Montréal, se trouvèrent constamment exposés à des coups de main, et l’incurie de la métropole, alors tout entière aux guerres de la Fronde et d’Espagne, ne fit qu’aggraver d’année en année cette situation déjà si périlleuse.
Aussi comprend-on l’empressement des Hollandais et des Anglais à tirer parti de cet état de choses. Le gouvernement britannique surtout montra en cette occasion une fois de plus les procédés auxquels il a recours pour agrandir son territoire colonial. Il s’attacha les sauvages en leur vendant de l’eau-de-vie. C’était en même temps le plus sûr moyen de faire disparaître la race. Colbert avait eu un moment la pensée d’agir de même. Mais Louis XIV s’était refusé à signer l’ordonnance sur la traite de l’eau-de-vie, et celle-ci fut interdite «sous les peines les plus grièves». Le sentiment de l’humanité fit place en cette circonstance à la raison d’Etat, et qui oserait en blâmer le grand roi?
Cependant, les gouverneurs français qui se succédèrent au Canada, MM. de la Barre, de Dénonville, de Frontenac, le chevalier de Callières, soutenaient tantôt avec mollesse, tantôt avec habileté, tantôt avec une grande énergie, l’intégrité de nos droits contre les prétentions et les empiétements de la Nouvelle-Angleterre. M. de Callières parvint en1700à réunir à Montréal tous les chefs des tribus indigènes de la Nouvelle-France, sans en excepter ceux des Cinq-Nations iroquoises. Il fut particulièrement aidé dans cette importante et laborieuse négociation par un chef de Hurons, dont le nom est resté légendaire parmi les populations des Grands-Lacs.
Kondiaronk ou le Rat était un sachem vénéré de tous les Indiens des Pays d’en haut. Sa bravoure était proverbiale. Sa supériorité d’intelligence dominait tous ceux qui l’entouraient ou l’abordaient. Non moins entraînant que sagace, il venait à bout des uns par l’éloquence et des autres par l’esprit. Il avait le jugement prompt et droit, la repartie vive et pleine de justesse, et son regard, où passaient parfois de redoutables éclairs, était si généralement empreint de douceur et de malice, qu’il séduisait et fascinait autant qu’il en imposait. Grâce à lui, les Indiens comprirent les avantages que leur offrait la paix avec les Français; ils la signèrent en1701, et la veille même du jour où cet acte solennel fut conclu, le Rat, accablé par les fatigues et le grand âge, mourut dans les bras du gouverneur, après avoir donné l’exemple d’une vie aussi utilement que chrétiennement employée.
La paix, faite de part et d’autre de bonne foi, eût duré à jamais sans la duplicité des Anglais, qui poussèrent les Iroquois à sortir de leur neutralité. Ajoutons que le traité d’Utrecht et celui d’Aix-la-Chapelle nous placèrent dans des conditions peu favorables pour pouvoir espérer d’arrêter l’ambition de la Grande-Bretagne.
La reprise des hostilités, déterminée par l’assassinat de M. de Jumonville, assassinat dont la responsabilité a longtemps pesé sur Washington, le remplacement au poste de gouverneur du marquis Duquesne par le marquis de Vaudreuil, la faiblesse de ce dernier, l’échec de Washington à la Nécessité en1754, la victoire de la Belle-Rivière, enfin l’arrivée à Québec du marquis de Montcalm et du chevalier de Levis furent successivement les épisodes marquants de cette campagne menée jusqu’en1756avec des alternatives de succès et de revers. Après bientôt cent ans de rivalité armée, les deux nations alors les plus puissantes de l’Europe étaient encore aux prises dans ce nouveau mondes, où chacune d’elles, celle-ci par droit de premier occupant, celle-là par droit de conquête, était avide de rester la maîtresse exclusive.
Nous n’avons point à retracer ici l’héroïque carrière de Montcalm. Sa mémoire et ses exploits figurent à la plus belle page de nos annales. Mais ce que l’on connaît moins, et ce qui fait l’objet même de ce récit, ce sont les causes qui, malgré l’intrépidité et l’irrésistible élan déployés à Chouegen, à Carillon, à Montmorency, firent en définitive, au moment suprême, échouer l’audace presque fabuleuse du Grand-Vaincu.
Quelle lutte plus épique, en effet, que celle où les deux généraux opposés l’un à l’autre tombèrent presque au même instant mortellement blessés!
Montcalm commandait à Québec, dont les formidables positions semblaient pouvoir défier tous les assauts. Malheureusement ses troupes n’étaient pas assez nombreuses pour les défendre. C’est dans ces conditions qu’il tint tète aux Anglais pendant quatre mois. L’ennemi épuisé voyait chaque jour ses rangs décimés par la faim et par le feu de nos forts. Mais la ville assiégée fut enfin à bout de ressources. Il fallait frapper un grand coup.
Persuadés que la pointe Levy et les hauteurs d’Abraham, protégées par leur escarpement naturel, étaient moins surveillées que les autres points de Québec, le général Wolf en tente hardiment l’escalade. Montcalm, presque aussitôt averti de cette manœuvre, court au-devant de lui par le versant opposé. Au premier choc, Wolf tombe frappé en pleine poitrine. Sa mort redouble le courage des assaillants. Les Français se sentent devancés sur le plateau et plient. Montcalm, qui n’a jamais reculé de sa vie, s’indigne à ce mouvement à peine apparent de défection, et d’un geste rétablit les chances du combat. Mais au même moment il s’affaisse, frappé à son tour. Il demande à son médecin s’il lui reste encore un jour à vivre.–Une heure, lui dit-on.–Tant mieux! s’écrie-t-il, le visage inondé de joie; je ne verrai pas Québec aux mains des Anglais!
Brave Montcalm! Il comptait sans le traité de Paris.