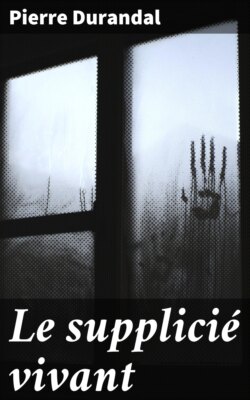Читать книгу Le supplicié vivant - Pierre Durandal - Страница 5
I
UN HORRIBLE SUPPLICE.
ОглавлениеOn était aux premiers jours de juin1759. La flotte anglaise venait de paraître devant Québec. Montcalm et Wolf allaient jouer leur va-tout. La guerre, qui durait sans interruption depuis l’année précédente, avait pris un caractère d’acharnement inouï. Quelques mois auparavant, le siège du fort de Carillon avait coûté à nos ennemis plus de quatre mille hommes. Des deux côtés on mettait en œuvre toutes les ressources pour s’assurer la victoire. L’intervention des sauvages était en cette circonstance d’un grand poids. Aussi toute Fattention des généraux se portait-elle sur les alliances à conclure soit avec les Algonquins ou les Hurons, soit avec les Iroquois.
A quelques milles de distance du saut du Niagara, situé sur le territoire des Cinq-Nations, un homme s’avançait à pas lents. Il portait le costume et les armes ordinaires du chasseur de fourrures: les vêtements de peau, le rifle, le couteau et la hache. Tout à coup il s’arrêta brusquement et pencha la tête en avant, pour sonder du regard la profondeur de la forêt qui se déroulait à sa gauche, dans la direction du fort Duquesne et des monts Apalaches. Un moment après, il se laissa couler doucement sur le sol, et la face collée contre terre, il prêta l’oreille.
Tout autre moins expérimenté n’aurait entendu que la plainte étouffée de la brise dans l’épais feuillage, le bourdonnement monotone des insectes se jouant dans un rayon de soleil, les coups secs du pic s’obstinant à percer un tronc de chêne ou les cris rauques et discordants du geai bleu.
Mais l’homme étendu sur le sol n’ignorait, lui, aucun des artifices de la vie des frontières. Aussi percevait-il distinctement en ce moment les sons de plusieurs voix, rudes et gutturales, qui étaient évidemment des voix d’Indiens. L’une d’elles pourtant trahissait, à des accents plus purs, la présence d’un homme blanc.
Les paroles qui venaient jusqu’au chasseur ne paraissaient point de nature à le rassurer. Une vive rougeur colorait son visage basané, les grosses veines de ses tempes se tendaient comme des cordes d’arc, ses dents claquaient, ses poings se crispaient, ses yeux pleins de flamme avaient un éclat sinistre. Chacun de ses gestes révélait les sentiments de rage qui dominaient dans son cœur.
Tout à coup il se redressa.
C’était un homme d’une haute stature, aux épaules puissantes, à la poitrine large et profonde, aux hanches saillantes, aux jarrets musculeux, aux attaches solides. Ses traits sans beauté avaient une expression de loyauté qui corrigeait leur dureté naturelle. Son teint sombre, sa barbe inculte, ses longs cheveux grisonnants et bouclés, ses sourcils épais et hérissés, ses yeux d’une mobilité extraordinaire donnaient à l’ensemble de sa physionomie un aspect sauvage, qui dénotait une âme vaillante, aguerrie au danger.
Une fois debout, il examina son rifle, dont il fit jouer la batterie, ensuite il dégagea le long couteau et la hache qui étaient passés dans sa ceinture.
Sûr ainsi de pouvoir résister à une attaque, il avança prudemment à pas de loup, posant à peine le pied par terre, de manière à ne laisser aucune empreinte sur le sol humide.
Il ne tarda point à atteindre un fourré d’où il pouvait tout surveiller sans être vu; ménageant ensuite une étroite ouverture dans les buissons, il s’accroupit pour épier ceux qui se tenaient à quelques pas de lui. Ils étaient cinq: un homme blanc et quatre Indiens.
A leur costume, aux figures bizarres peintes sur leur corps, le chasseur reconnut aussitôt que ces Peaux-Rouges appartenaient à la tribu des Onontagues, la plus farouche des Cinq-Nations iroquoises et la seule qui n’eût point encore fait cause commune avec les Anglais.
–L’Ours-Maigre a dû me comprendre, disait l’homme blanc en s’adressant à l’un des sauvages, qui était apparemment un chef, à en juger par les marques de respect que lui témoignaient ses compagnons. Il sait maintenant ce que je veux et ce que je m’engage à lui donner, s’il réussit dans son entreprise. Je ferai plus: à la récompense que j’ai promise j’ajouterai des rifles et de la poudre. Le service que je demande et le danger qu’il y aura à courir seront ainsi doublement payés.
–L’Ours-Maigre a parfaitement entendu, répondit l’Indien dans le jargon accoutumé aux Iroquois et aux Européens. Mais pourquoi Œil-de-Serpent ne frappe-t-il point son ennemi de sa propre main?
L’homme blanc rougit et baissa les yeux.
–Parce que, dit-il après un moment d’hésitation, les Français sauraient parfaitement que c’est une vengeance et qu’ils en découvriraient aussitôt l’auteur. Mon crédit auprès d’eux n’est déjà pas si grand, et ils seraient trop heureux de trouver un motif pour se débarrasser de moi. Or, tant que mon œuvre n’est pas accomplie, la prudence me commande de vivre avec eux en bons termes. Que mes frères rouges attendent avec patience l’heure décisive. Cette heure sonnera bientôt. Une fois que j’aurai donné le signal convenu, les Onontagues commenceront le massacre. Ils tueront jusqu’à ce que leurs bras soient fatigués. Les scalps qui rempliront leurs wigwams seront si nombreux que les pappouses auront des cheveux blancs avant de pouvoir achever de les compter. Le sang des visages pâles cou lera à flots, et ces flots seront si abondants, qu’un homme rouge pourra y promener son canot d’un soleil à l’autre sans toucher terre.
Ce discours emphatique fut accueilli par un grognement de satisfaction.
Le chasseur caché dans le buisson ne put réprimer un mouvement d’indignation. Le doigt sur la détente de son rifle, il se demandait s’il fallait faire feu sur le scélérat. Pourtant il maîtrisa sa colère et continua d’écouter sans bouger.
L’homme blanc avait repris la parole:
–Qu’aucun de vous, disait-il en attachant ses regards sur les sauvages, ne perde le souvenir de ce que je promets ici. Vous êtes quatre, chacun de vous aura droit à un rifle neuf avec autant de poudre et de balles qu’il en faut pour six lunes.. L’Ours-Maigre, votre chef, recevra en outre un baril d’eau de feu et une couverture. En échange de ces riches présents, qu’aurez-vous à me donner? Peu de chose. Je vous ai demandé, je vous demande encore de tuer un de mes ennemis. Or, cet ennemi est aussi le vôtre. L’homme dont je réclame la mort est celui qui a semé la désolation et la ruine dans votre tribu, celui qui se vante d’avoir orné sa cabane des scalps des Iroquois, Agniers, Annegouts, Tsonnontouans, Goyagouins et Onontagues. Cet homme, que vous haïssez autant qu’il vous hait, je veux qu’il périsse sous vos coups. Quand vous m’aurez apporté sa chevelure, je vous paierai. Plus tard je vous enseignerai le secret de la supériorité des visages pâles sur les hommes rouges dans les combats. Est-ce convenu? Vous savez de qui je veux parler?
–Ogh! dit l’Ours-Maigre avec un ricanement diabolique, Œil-de-Serpent demande la chevelure du Buffle-Gris.
–En effet. Je veux que vous tuiez le Buffle-Gris ou le comte de Rochetonnerre, comme l’appellent les Français.
L’Indien allait répondre, quand un bruit sourd suivi d’un craquement et de la chute d’un corps lourd partit du fourré.
Le chasseur, en entendant prononcer son nom, s’était incliné pour mieux saisir les projets de ceux qui complotaient sa mort. Cette imprudence devait lui être funeste. La branche qu’il repoussait de la main s’était cassée et l’avait entraîné.
L’Ours-Maigre poussa un cri féroce. Il brandit son tomahawk et se jeta dans le fourré, que les trois autres sauvages se mirent en devoir de cerner. Quant à l’homme blanc que les Indiens surnommaient Œil-de-Serpent, il se prépara à faire usage de son rifle.
Tandis que le chef des Indiens tombait sur lui comme un forcené, Rochetonnerre se baissait pour ramasser son fusil échappé de ses mains. Surpris dans une position extrêmement désavantageuse, il eut néanmoins le temps de se dérober. Avec la promptitude de l’éclair il saisit l’Ours-Maigre par le milieu du corps, le souleva de terre et le jeta si violemment contre un tronc d’arbre, que le sauvage s’abattit sans proférer une parole.
Prenant ensuite d’une main sa hache et de l’autre son énorme couteau, le comte s’élança au-devant de ses ennemis, sans prendre le temps de les compter. L’un d’eux était à sa portée et voulut parer le coup qui le menaçait en levant le bras pour protéger sa tête. L’arme terrible du Buffle-Gris lui pénétra dans le crâne avec un son strident, et fit jaillir sa cervelle à plusieurs pas. L’Indien tomba foudroyé.
Malheureusement le chasseur ne put se retourner assez vite pour faire face aux deux autres qui le prenaient par derrière. Atteint aux deux jambes, il s’affaissa.
Ce mouvement lui sauva la vie. Comme il tombait, la balle partie du rifle de l’homme blanc lui effleura le sommet de la tête. Sa blessure lui fit perdre connaissance. Lorsqu’il reprit ses sens, il reconnut qu’il était solidement attaché et au pouvoir de ceux-là mêmes qui, un moment auparavant, avaient juré sa mort.
Pendant ce temps, l’Ours-Maigre s’était relevé.
Honteux d’avoir été vaincu et encore tout meurtri, le sauvage promena autour de lui son regard farouche.
Quand il vit le chasseur étendu sur le sol, fortement garrotté et hors d’état de faire un mouvement, il eut une exclamation de joie.
En même temps il se précipita sur son ennemi sans défense.
L’homme blanc l’arrêta d’un geste impérieux, et se plaçant entre lui et le comte:
–Pas encore, dit-il, le prisonnier m’appartient.
–Il a frappé l’Ours-Maigre, hurla l’Indien, l’Ours-Maigre le tuera!
Un éclair de férocité passa dans les yeux de l’Onontague. Il fit un pas en avant, tandis que sa main serrait son couteau.
L’homme blanc étendit le bras pour le repousser.
–Je ne veux point, dit-il avec calme et fermeté, empêcher mon frère rouge de tuer ce visage pâle. N’ai-je point, il y a quelques instants à peine, offert de payer richement la chevelure du Buffle-Gris? Pourquoi donc aurais-je changé d’avis, maintenant qu’il est venu de lui-même se livrer à nous? Que l’Ours-Maigre lui donne la mort, il en a le droit, et mon cœur en sera réjoui. Mais qu’avant d’accomplir sa juste vengeance, il m’accorde un moment d’entretien avec le prisonnier. Quand j’aurai cessé de parler, l’Ours-Maigre agira comme il lui plaira: je lui laisserai toute liberté, pourvu qu’il me délivre du Buflle-Gris.
–L’Ours-Maigre attendra, répliqua sèchement le sauvage. Il espère qu’Œil-de-Serpent ne le trompera point, sinon.
Une menace significative acheva sa pensée.
–Trêve de bravades, répondit l’homme blanc avec dédain. Tes craintes n’ont aucun fondement. Cet homme me gêne autant qu’il te gêne toi-même. Nous avons juré sa mort l’un et l’autre. Il n’échappera point à nos coups.
En disant ces paroles, il poussa brutalement du pied le prisonnier qui gisait immobile et muet, attendant le sort qui le menaçait.
L’homme blanc était à peu près du même âge que le comte de Rochetonnerre. D’une taille élancée et bien proportionné, il avait les traits réguliers, la physionomie fine et expressive. Ses cheveux châtains et soyeux encadraient un visage du plus pur ovale. Ses yeux grands et bleus avaient une étrange fixité. Son regard prenait, sous l’empire de la passion, un éclat métallique qui reflétait la basse cruauté d’une nature perfide.
Un frisson avait parcouru tout le corps du chasseur.
Il essaya de briser ses liens. Ses yeux étaient injectés de sang, sa bouche écumait. Vains efforts! Il était parvenu à se dresser sur son séant, mais ses muscles étaient désormais impuissants. Il retomba lourdement sur le dos en exhalant sa rage.
A ce moment, ses yeux tombèrent sur le cadavre de l’Onontague qui baignait dans son sang, le crâne ouvert, la face horriblement convulsée.
Rochetonnerre n’eut plus aucun doute sur le supplice qui lui était réservé, mais il ne craignait pas la mort, et un sourire de mépris erra sur ses lèvres.
Ce sourire fit place à une expression de stupeur, quand son regard rencontra celui de l’homme blanc.
–François Brissot! s’écria-t-il avec un accent dont rien ne saurait peindre la frénésie.
–Lui-même, comme vous voyez, mon cher comte, railla l’homme blanc. N’êtes-vous pas heureux de me trouver ici?
–Lâche! hurla le chasseur en faisant un appel désespéré à toutes ses forces pour faire éclater ses liens. Que l’on coupe ces cordes qui m’empêchent de me mouvoir! Qu’on me donne mon rifle, mon couteau ou ma hache, et je vous tiendrai tête à tous tant que vous êtes! Ou plutôt qu’on ne me laisse rien que mes deux mains avec un bâton pour châtier, comme on châtie un chien, ce misérable que j’ai eu la faiblesse d’épargner!
–A quoi bon vous emporter ainsi, mon cher comte? continua Brissot flegmatiquement. Vous êtes fou, ma parole. Vous avez tort de me provoquer. Si je ne devais compte de ma vie qu’à moi-même, je me mesurerais volontiers avec vous. Mais j’ai d’abord une tâche plus sérieuse à remplir, et chaque chose à son tour. Vous paraissez surpris de me rencontrer ici. Mon Dieu! je ne veux pas vous cacher ce que je viens y faire. J’ai d’ailleurs la conviction que vous n’abuserez pas de ma confiance. Je cherche à gagner aux Anglais l’alliance des Onontagues. Vous avez cru que je servais sincèrement les intérêts de la France. Vous n’avez point l’œil fin, mon cher comte, et vous auriez dû comprendre que si j’ai hanté votre camp, si je me suis insinué dans les bonnes grâces de vos officiers, ce ne pouvait être que pour mieux surprendre leurs secrets et les vôtres. Un jour, vous vous êtes douté de la vérité. Vous m’avez fait espionner comme je vous espionnais moi-même. Trahi par ma propre imprudence, j’ai été l’objet de toute votre sévérité. Vous m’avez condamné à être passé par les armes. Je me suis alors jeté à vos genoux et j’ai imploré votre pitié. Vous demeuriez inflexible. Il fallait, disiez-vous, un exemple. Cependant mes larmes et mon repentir admirablement joué ont triomphé de votre obstination. Vous avez commué ma peine en trente coups de verge. Je n’ai point oublié votre clémence, mais je n’ai pas non plus perdu la mémoire de l’affront que j’ai subi devant votre armée. Ce jour-là, j’ai juré de me venger, et j’ai patiemment attendu mon heure. Elle vient de sonner.
Le comte de Rochetonnerre jeta sans dire une parole un regard de profond mépris sur le misérable,
–Vous m’écoutiez il y a un instant, poursuivit François Brissot avec un sourire victorieux. Mais, caché dans ce buisson, vous n’avez peut-être pas entendu toute ma conversation avec l’Ours-Maigre. Je vais vous la répéter. J’ai mis votre tête à prix, non seulement parce que vous êtes mon ennemi, mais parce que les Anglais me rendront au centuple ce que vous allez me coûter. Vous êtes pour eux, mon cher comte, un adversaire trop dangereux, et le plus sûr moyen de n’avoir plus à redouter des hommes comme vous, c’est de les supprimer, dès qu’on en trouve l’occasion.
Le comte eut un nouveau geste de dégoût. Brissot ne parut pas s’en apercevoir.
–J’ai donc offert, dit-il sans s’arrêter, de payer votre chevelure au chef onontague que voici et que vous connaissez, si je ne me trompe, de vieille date. Il vous traitera comme vous le méritez, et n’eùt-il point de raisons personnelles pour le faire, la récompense que je lui ai promise suffirait pour l’y décider. Ce n’est pas tout. Le chef est chargé aussi de me rapporter la chevelure de votre femme et celles de vos enfants. Chacun sa manie en ce monde. La mienne est de collectionner. Il n’y a pas, vous le voyez, mon cher comte, de quoi faire tant de bile. On s’occupe de votre femme, de vos enfants, de vous-même. Avez-vous quelque chose à faire dire à votre famille, quelques arrangements à faire prendre? Je me chargerai de ce soin, si vous le voulez bien. Mais dépêchez-vous, je vois que le chef s’impatiente.
En achevant ces paroles prononcées avec lenteur, de manière à rendre le sarcasme plus amer, Brissot bourra complaisamment sa pipe et l’alluma.
–Ogh! gronda l’Ours-Maigre en frappant la terre du pied. Mon frère blanc a une langue de squaw. Il ne cesse de parler. Son nom est mal choisi, il devrait s’appeler le Geai-Moqueur.
–Encore un mot, repartit Brissot qui conservait son attitude railleuse. Le prisonnier ne peut t’échapper. Il ne tardera point à mourir de ta main. Mais la torture que je lui fais subir est cent fois plus cruelle,
En parlant ainsi, il s’était tourné vers le comte:
–Donc, fit-il en redoublant d’ironie, vous n’avez rien à me répondre, rien à faire dire à vos enfants, à votre femme, à vos amis, à ces bons et crédules Français qui tomberont demain dans le piège que je leur ai préparé?
–Jamais! exclama Rochetonnerre, tandis qu’un tressaillement s’emparait de tout son être.
–Mon Dieu, ricana Brissot avec un accent satanique, vous perdez vraiment votre temps en colères inutiles. Jetez un regard autour de vous. Contemplez pour la dernière fois ces merveilles de la nature qui se déroulent à vos yeux. Voyez le soleil qui vous inonde de ses feux, écoutez les chants de ces oiseaux qui célèbrent les joies de la vie. Toutes ces beautés, toutes ces jouissances seront perdues pour vous dans quelques instants. Comte de Rochetonnerre, vous allez mourir et mourir d’une mort terrible et ignominieuse, mourir en emportant la conviction que votre femme sera massacrée, que vos enfants seront écrasés sous les pieds de vos ennemis, et que les chevelures de ces pauvres petits êtres tant chéris par vous seront pendues avec celle de leur mère et la vôtre à la ceinture de l’Ours-Maigre.
Le comte de Rochetonnerre eut un frémissement. Sa puissante poitrine haletait. Il voulut répondre. Les paroles s’étouffèrent dans sa gorge.
–Dieu ne permettra point tant de scélératesse, dit-il après un long silence.
–Si vous n’avez pas d’autre espoir, répliqua Brissot en haussant les épaules, je vous plains.
Il se tut et regarda l’Ours-Maigre qui attendait.
–Le prisonnier t’appartient maintenant, dit-il enfin avec gravité. Fais de lui ce que tu voudras. Je te recommande une chose. Aie la certitude absolue de sa mort. Une fois que nous nous serons débarrassés de lui, achève ta mission. Quand tu m’apporteras avec la chevelure du Buffle-Gris celle de sa squaw et de ses pappouses, je te paierai comme je te l’ai promis.
Après avoir ainsi parlé, il jeta son rifle sur l’épaule, fit un signe d’adieu à l’Indien, lança un dernier regard de haine au comte et disparut dans la forêt.
Cependant le prisonnier avait fait une tentative suprême pour recouvrer la liberté. Hélas! cette dernière tentative était restée sans succès comme toutes les précédentes. Plus il essayait de briser ses liens, plus ils se tendaient et s’enfonçaient dans ses chairs.
Convaincu de son impuissance, l’infortuné promena un regard désespéré sur ses bourreaux dont il eût été inutile pour lui d’implorer la merci. Que pouvait-il attendre en effet de ceux qu’il avait tant de fois poursuivis à outrance comme on traque des bêtes fauves dans leur repaire? C’en était fait de lui, il le comprenait, et toutes les espérances qu’il avait eues pour sa famille lui apparaissaient maintenant comme perdues à jamais. Il sentit sa robuste charpente s’ébranler sous l’immense douleur à laquelle il était en proie. Une larme brilla sous sa paupière et roula sur ses joues.
Tout son passé se retraçait à ce moment devant ses yeux. Il se rappelait le dévouement de sa femme, cette compagne bienaimée de sa vie d’aventures et de périls. Il voyait se jouer autour de leur mère les deux charmantes créatures roses et souriantes qui formaient les doux gages de son union. Tous ces trésors, il les perdait du même coup. Quelques minutes plus tard, il allait expirer misérablement loin de ceux qui l’attendaient.
Mais le comte de Rochetonnerre était une âme stoïque. Maintenant que sa perte était inévitable, il était décidé à ne point donner à ses vainqueurs le spectacle d’une défaillance qui n’aurait fait qu’exciter leurs railleries. La mort allait se dresser devant lui affreuse et sanglante: il voulut la regarder en face.
Pendant ce temps, l’Ours-Maigre délibérait avec ses compagnons.
Tout à coup l’Indien marcha vers le prisonnier, et lui parlant dans le dialecte iroquois familier à tous les chasseurs de fourrures:
–Buffle-Gris, dit-il solennellement, avant d’envoyer ton esprit dans les prairies où chassent les guerriers morts, je veux t’adresser quelques paroles. Rassure-toi: l’Ours-Maigre n’est pas une squaw, sa langue est sobre de discours. Buffle-Gris, tu es un homme, tu l’as prouvé aux Onontagues en plus d’une rencontre. A quoi bon dès lors cacher ma pensée sous un nuage? Ecoute: tu es brave, tes pas ont foulé le sentier de la guerre pendant plusieurs lunes, ton rifle est sûr, ton bras est fort, tes pieds ont la légèreté de la plume, ils ne laissent derrière eux aucune piste. Tu as orné ton wigwam des scalps de mes frères rouges. Tu as fait périr sous tes coups plus d’Iroquois que je n’en puis compter sur mes doigts. Ce qui est fait est fait. Le Grand-Esprit l’a voulu. Maintenant tu es mon prisonnier, ta chevelure m’appartient; tu vas mourir, et j’ai juré par le grand Manitou de t’empêcher de continuer à combattre les Onontagues après ta mort. Si je me contentais de te tuer, il en serait dans les grandes prairies de l’autre vie comme dans celles-ci: tu serais là comme ici un grand chef et un guerrier redoutable. Écoute donc, et qu’aucune de mes paroles ne t’échappe! Toutes les fois qu’un guerrier meurt, il revit dans le monde des esprits et y conserve sa première vaillance. Mais si, avant de mourir, il est privé de sa chevelure, le cœur d’un chien entre sous sa poitrine, et il devient l’esclave des guerriers qui ont péri sans avoir été scalpés. Mon frère blanc a-t-il entendu? A-t-il compris?
L’Indien avait pour ainsi dire scandé chacune de ses phrases. Son attitude était froide, mais ses yeux gris qui dansaient dans leurs orbites et la contraction de ses lèvres grimaçant un hideux sourire laissaient clairement entrevoir la férocité de son dessein.
Chacune de ses paroles était tombée dans le cœur du prisonnier et s’y était enfoncée comme eût fait le trait le plus acéré. Le sang du malheureux comte s’était glacé dans ses veines. Pourtant il n’eut pas un geste, pas un cri. Il leva lentement les yeux sur le sauvage, et d’une voix claire et ferme:
–L’Ours-Maigre sait parfaitement, dit-il, que j’ai toute ma raison. Il ne doute pas un instant que j’aie compris sa pensée, quoi qu’il ait suivi pour la faire venir jusqu’à moi une piste détournée. L’Ours-Maigre a le droit de chercher à me torturer avant de me donner la mort; mais la peine qu’il prend est inutile. L’homme rouge est ignorant, et le plus inepte rirait de ses pauvres idées. La mort est un sommeil dont nul ne se réveillera que pour être jugé devant tous à la fin du monde. L’homme rouge est insensé lorsqu’il parle de grandes prairies où les esprits, altérés de sang, chassent leurs ennemis, le rifle et le tomahawk à la main. L’Indien eut un geste d’incrédulité.
–Libre à mon frère blanc, dit-il, de parler comme il pense et de répéter ce que lui ont appris les chefs de sa tribu, mais l’Ours-Maigre a fait une promesse, il veut la tenir. Le Buffle-Gris est-il prêt?
Tandis qu’il prononçait ces paroles, l’Indien avait passé son couteau sur son pouce pour en essayer le fil.
Le chasseur répondit à son apostrophe par un regard plein de fierté.
–Tes frères rouges verront, dit-il, comment un homme blanc sait mourir!
En même temps il se prépara à subir l’horrible supplice.
Les muscles tendus, les dents serrées, il attendait.
L’Ours-Maigre se pencha sur lui.
Il saisit d’une main la longue chevelure du prisonnier, tandis que de l’autre il faisait passer sous les yeux de sa victime le couteau qu’il allait lui enfoncer dans la tête.
Le comte de Rochetonnerre ne fit pas un mouvement. Ses yeux ne se fermèrent point et demeurèrent immobiles. Seule, la pâleur de ses traits indiquait les sentiments qui l’agitaient.
Un murmure d’étonnement et d’admiration circula parmi les Peaux-Rouges. Tant de courage les frappait de stupeur. L’Ours-Maigre lui-même, quelle que fût sa haine pour le chasseur, semblait indécis:
–Le Buffle-Gris est brave, dit-il. Un chef ne saurait prendre plaisir à torturer un ennemi tel que lui. L’Ours-Maigre regrette d’avoir donné sa parole, mais il ne peut la retirer.
L’instant fatal était arrivé.
L’Indien fit entrer la pointe de son couteau dans le crâne du prisonnier et décrivit avec rapidité un cercle d’une irréprochable régularité.
L’instrument du supplice produisit, en touchant la boîte osseuse, un affreux grincement.
Le comte n’avait pas desserré les dents.
Ses yeux fixes demeuraient cloués sur son bourreau.
L’air qui oppressait sa poitrine s’échappait par intervalles de ses lèvres avec un sifflement lugubre.
Le sauvage était resté courbé sur lui.
Il avait saisi entre ses dents la peau détachée.
Il l’arracha brusquement.
Une dernière secousse acheva l’œuvre sanglante.
Le chasseur était scalpé vivant.
Sa bouche s’ouvrit, livrant passage à l’air emprisonné dans ses poumons.
Il eut un faible râle.
Ses membres se détendirent.
Son visage prit tout à coup une pâleur cadavérique.
Les Indiens entonnèrent le chant du scalp.
Un instant après ils entourèrent le corps inerte du supplicié.
L’Ours-Maigre se rappela soudain la recommandation de Brissot.
Pour être plus sûr de la mort du comte, il lui enfonça son couteau jusqu’à la garde dans la poitrine.
Ensuite les quatre sauvages dépouillèrent leur victime de ses vêtements et se les partagèrent.
Le cœur du chasseur avait cessé de battre.
Les Indiens jetèrent un dernier regard mêlé d’épouvante et de joie sur le corps rigide du plus terrible de leurs ennemis, et se glissèrent l’un après l’autre silencieusement dans l’épaisseur de la forêt.
Les heures s’écoulèrent. Le soleil descendit lentement sous l’horizon. La lune se leva, jetant sa pâle lueur sur le site sauvage où venait de se passer l’épouvantable tragédie.
Un linceul de brume enveloppa peu à peu le corps nu et froid du comte de Rochetonnerre. Vers le milieu de la nuit, une pluie fine commença de tomber. Elle pénétra les membres du pauvre chasseur en lavant le sang qui coulait de sa blessure.
Illusion ou réalité, sous l’action persistante de cette pluie, l’infortunée victime parut tout à coup faire un mouvement. Un soupir étouffé et presque imperceptible rompit le silence profond qui planait sur la forêt.
Était-ce la plainte de la brise dans le feuillage?
Était-ce le râle suprême du malheureux supplicié?
Cependant la lune continuait de monter dans le ciel. Quand elle eut atteint son point culminant, elle sembla s’arrêter. Sa face blême regarda mélancoliquement le douloureux tableau. Un large faisceau de lumière blanche tomba sur le corps du Buffle-Gris.
Horreur! il s’était dressé sur son séant! Ses yeux ouverts et hagards avaient une expression d’indicible souffrance. Ses mains déliées s’appuyaient faiblement sur son crâne sanglant et dénudé. Ses membres pantelaient. Sa poitrine avait par intervalles des soubresauts violents. Le couteau de l’Indien demeurait fixé dans la plaie. Un sourd gémissement s’échappait des lèvres hideusement contractées.
Soudain un tressaillement convulsif agita, comme sous l’effet d’une commotion électrique, les bras, les jambes et la tête. Le corps retomba lourdement en arrière. Une immobilité complète succéda à cette dernière et poignante manifestation de la vie.
La lune disparut sous les nuages. Les ténèbres descendirent sur la forêt, couvrant de leur large manteau l’horrible spectacle. Les heures se succédèrent, lentes et lugubres.
Quand les premiers rayons de l’aurore éclairèrent cette scène déchirante, le comte de Rochetonnerre était debout, la bouche ouverte, adossé à un arbre qu’il enlaçait de ses bras rejetés derrière lui. Le couteau sanglant gisait à ses pieds; sa tête était couverte de feuilles légèrement appliquées, d’autres feuilles cachaient la plaie de la poitrine.
Le supplicié vivait!
Il resta longtemps dans cette attitude.
Peu à peu l’air pur qui pénétrait dans ses poumons le ranima.
Il essaya de marcher. Mais il sentit presque aussitôt ses jambes se dérober sous lui. Toutefois son courage ne l’abandonna point. S’aidant des pieds et des mains, il rampa lentement, péniblement, à travers les ronces et les broussailles, pendant plus d’une heure.
A l’endroit même où l’Alleghany, un des affluents de l’Ohio, prend sa source, se trouvait, sur une hauteur en pente douce, une assez vaste habitation. Tout autour de grands arbres, étendant leurs branches puissantes, donnaient à ce site un aspect calme et riant. Des terrains cultivés et des prairies bornées par des forêts se déroulaient aux environs. Çà et là paissaient des troupeaux et des chevaux en liberté. Quelques hommes vêtus à l’européenne allaient et venaient dans toutes les directions, s’occupant des travaux du labour.
Tout à coup l’un d’eux poussa un cri d’alarme. Il venait d’apercevoir à l’horizon, et à quelques pas de la clairière qui masquait l’entrée de la forêt, le corps entièrement nu d’un être humain, immobile et en apparence endormi.
Au même instant, une vingtaine de pionniers armés s’élancèrent de l’habitation dans la direction indiquée. Quelle ne fut point leur stupéfaction en reconnaissant le comte de Rochetonnerre, dépouillé de tout vêtement et évanoui!
On s’empressa de le transporter dans la demeure.
Revenu à lui, il rapporta en quelques mots les desseins de l’Ours-Maigre.
Le péril était imminent. Aussi mit-on tout en œuvre pour assurer la défense.
Les Onontagues ne manquèrent point à la promesse qu’ils avaient faite à Brissot. A la tombée de la nuit, ils cernèrent l’habitation, ne s’attendant d’ailleurs à aucune résistance.
Ils furent défaits et presque tous massacrés.
L’Ours-Maigre seul parvint à s’échapper.
Quant à François Brissot, les recherches qu’on fit pour le retrouver furent inutiles. Soit qu’il eût appris indirectement l’échec des Indiens, soit qu’il eût été par d’autres circonstances appelé loin du théâtre de ces tragiques événements, les investigations que l’on poursuivit en vue de s’assurer de sa personne demeurèrent sans résultat.
La guérison du comte de Rochetonnerre fut lente. Pendant plusieurs mois, son existence resta suspendue entre la vie et la mort.
La nouvelle de la prise de Québec, apportée par deux des compagnons de Montcalm, fut pour le Supplicié Vivant un coup terrible.
Horace de Rochetonnerre était l’un des officiers les plus brillants de l’armée française du Canada. Il avait assisté à toutes les expéditions contre les Anglais et s’était couvert de gloire à l’affaire de Carillon. Comme bien d’autres, il avait déploré la jalousie mesquine et le mauvais vouloir de M. de Vaudreuil. Aussi le découragement s’était-il emparé de lui en voyant que, malgré les victoires et l’héroïsme de l’armée, le gouvernement ne faisait rien pour assurer la sauvegarde de la colonie. La destruction du fort de Frontenac, qui servait d’arsenal à notre marine sur le lac Ontario et d’entrepôt aux vivres et aux munitions destinés aux postes des Pays d’en haut, avait donné la mesure de ce que l’on pouvait attendre des hommes auxquels on avait confié l’administration de la Nouvelle-France.
En fait, les avantages de la campagne demeuraient aux Anglais. Le succès de Carillon ne faisait que retarder leur marche sur Québec, mais ne devait point l’empêcher. Les sauvages, jusqu’alors alliés fidèles de la France, voyant notre puissance chanceler, commençaient à faire défection en grand nombre.
Tant de causes étaient bien de nature à faire naître l’inquiétude et le chagrin dans l’âme droite du comte de Rochetonnerre. Irrité des basses intrigues dont il était fréquemment le témoin, des désordres et des abus qui se passaient autour de lui au grand jour, sans qu’il eût qualité pour les réprimer, voyant clairement où devaient mener les dilapidations impudentes de l’intendant Bigot, il se sentait pris d’un immense dégoût et n’attendait qu’une occasion pour demander son rappel en France.
L’accueil fait à M. de Bougainville par le ministre de la marine, M. Berryer, mit le comble à l’exaspération du brave officier. Il était manifeste qu’à Paris on ne tenait aucun compte de la situation du Canada, et que l’abandon de la colonie paraissait tout naturel au milieu des difficultés avec lesquelles la métropole elle-même était aux prises. M. Berryer n’avait-il point dit: «Quand le feu est à la maison, on ne s’occupe pas des écuries»; et cet aveu n’équivalait-il point à un refus exprès de rien tenter de décisif pour conserver notre autorité dans l’Amérique septentrionale?
Horace de Rochetonnerre, naguère encore si enthousiaste, ne pouvait plus se dissimuler que l’armée du Canada, réduite à cinq ou six mille hommes, quelque courageuse qu’elle pût être dans la guerre des bois, ne tiendrait point en bataille rangée contre les Anglais, car elle était au fond abattue et démoralisée. Il ne voulut point être plus longtemps le complice d’une situation contre laquelle protestaient tous ses sentiments. Il demanda son congé définitif, et l’obtint sans difficulté, tant l’armée du Canada était peu de chose pour le ministre de la guerre.
Il s’était marié peu de temps auparavant à Québec. Sur les instances de la comtesse, qui ne voulait point quitter le pays où elle était née, il acheta la propriété située à la source de l’Alleghany. Pour donner un aliment à son activité, il se livra non seulement au défrichement des bois, mais à la chasse des animaux sauvages, dont les fourrures lui rapportaient un assez grand profit.
Ennemi juré des Iroquois, auxquels il ne pardonnait point les actes de cruauté qu’ils exerçaient contre les Français tombés dans leurs mains, il réunit autour de lui quelques hardis pionniers et fit à ces sauvages une guerre sans pitié. Son nom était devenu la terreur de la contrée. L’audace avec laquelle il se précipitait sur les campements indiens, la promptitude de ses mouvements, la couleur de son costume généralement sombre, lui avaient fait donner le surnom de Buffle-Gris. Ce surnom, seule désignation sous laquelle il fût connu parmi les Cinq-Nations, répandait l’effroi dans toutes les tribus de Peaux-Rouges. Les Onontagues, surtout, tremblaient en l’entendant prononcer, car il leur rappelait leurs wigwams détruits, leurs guerriers massacrés. De là leur haine invétérée.
L’échec éprouvé à l’habitation de l’Alleghany ne pouvait avoir d’autre résultat que de rendre cette haine encore plus profonde. Désormais il n’y avait plus qu’une issue possible à la lutte entre le Buffle-Gris et l’Ours-Maigre: l’un ou l’autre devait succomber sous les coups de son adversaire. Lequel des deux?