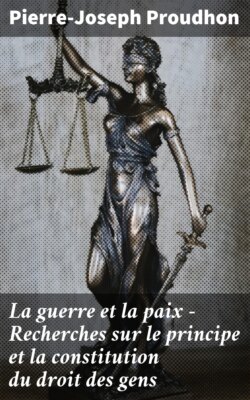Читать книгу La guerre et la paix - Recherches sur le principe et la constitution du droit des gens - Pierre Joseph Proudhon - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CRITIQUE DES OPERATIONS MILITAIRES: LA BATAILLE.
ОглавлениеLa bataille, où les armées se présentent en ligne, front contre front, et cherchent mutuellement à se terrasser, est l’acte suprême, héroïque, de la guerre. Tout se fait en vue de la bataille. C’est le choc qui décide de la destinée des empires, et qui, enveloppant vainqueurs et vaincus dans un manteau de gloire, doit les emporter, mêlés, confondus, vers un avenir meilleur. Voyons si le dénoûment de la tragédie répond à l’exposition.
Rappelons encore une fois les principes.
Une pensée de justice, ou, pour mieux dire, de judicature, est inhérente à la guerre. Elle consiste en ce qu’à certains moments du développement humanitaire, des nations jusqu’alors paisibles tendent, par la nécessité de leur situation, et pour une fin supérieure, à s’absorber; qu’en conséquence elles entrent en conflit; et que, l’incorporation devenue inévitable et l’heure ayant sonné, la suprématie appartient de droit à la puissance la plus forte. C’est le renversement de ce qui se passe dans l’ordre civil. Tandis que dans la justice ordinaire distribuée aux citoyens par l’État, la force appartient à la raison et doit rester à la loi, ici l’on peut dire, au rebours, que la raison, la loi, le droit, appartiennent et doivent rester à la force.
Il suit de là que la lutte des puissances engagées, autrement dire la guerre, n’a pas directement pour fin leur destruction mutuelle, bien qu’elle ne puisse avoir lieu sans effusion de sang et sans consommation de richesse; elle a pour fin la subordination des forces, ou leur fusion, ou leur équilibre.
D’où il suit encore que, dans cette espèce de duel judiciaire, le mode d’action doit être réglé de telle sorte que non-seulement les forces matérielles, mais aussi les forces morales de chaque puissance belligérante y interviennent, et qu’enfin la victoire reste à la plus forte, c’est-à-dire à celle qui l’emporte dans le plus grand nombre de parties, importance des armées, force physique, courage, génie, vertu, industrie, etc., et cela avec le moins de dommage possible des deux parts.
Hors de ces principes, il n’y a plus guerre, au sens humain et juridique du mot: c’est un combat de bêtes féroces, pis que cela, un massacre de brigands. Je dirais presque, comme de Maistre, eu égard à l’horreur et à la profonde absurdité du fait, que c’est un mystère de la Providence qui s’accomplit.
Examinant donc la tactique qui préside aux batailles modernes, pour ne parler que de celles-ci, j’observe qu’on n’y découvre pas ce caractère de haute moralité, de conservation, partant de certitude, qui seul rend la guerre loyale et la victoire légitime. Je trouve même que, sous ce rapport, nous avons fait depuis deux siècles des pas rétrogrades. On n’est pas moins brave sans doute, mais, par des causes que. j’expliquerai tout à l’heure, on se bat moins bravement; on fait plus de mal à l’ennemi, grâce à la violence des chocs et à la supériorité des armes, mais on s’en fait proportionnellement davantage à soi-même, ce qui rend la victoire louche. On tue plus de monde sans obtenir plus de succès. L’esprit démocratique, qui a pénétré les armées depuis la Révolution, semblait devoir être tout à l’avantage du soldat, et jamais on ne vit pareil mépris de la vie des hommes. En un mot, le matérialisme de la bataille s’est accru avec la civilisation, le contraire de ce qui aurait dû arriver.
Ges reproches, que l’on est en droit d’adresser à la tactique moderne, constituent autant de violations du droit de la guerre. Peu de mots suffiront à me faire comprendre.
D’abord, en ce qui concerne le choc des masses. Je ne veux pas discuter sur l’ordre profond et l’ordre mince, bien moins encore irai-je jusqu’à prétendre que la vraie manière de combattre serait que les soldats des deux armées s’attaquassent simultanément, corps à corps, homme à homme, virum vir; puis de compter de quel côté il y aurait le plus de morts et de blessés, dans ces cent ou deux cent mille duels. Je n’ignore pas que de toutes les batailles les plus sanglantes sont celles où chaque soldat choisit son ennemi. J’accorde donc que le groupement des forces, qui est une de nos puissances économiques, doit être compté aussi parmi les moyens légitimes de vaincre. Il y a d’ailleurs dans ce groupement, dans cette confraternité du champ de bataille, un élément moral qui rappelle la solidarité civique, l’unité de la patrie, et qui est certainement une force. Si le soldat français, par son instinct de concentration et d’unité, est plus disposé que tout autre à ce genre de tactique, si on le voit se rallier spontanément au milieu de la mêlée; se former en peloton, sans même attendre l’ordre de ses chefs, il faut le prendre tel que l’a fait la nature, qui a diversement constitué les animaux et les hommes, qui a donné le sabot au cheval, la corne au taureau, l’ongle et la dent au lion, la force musculaire et l’individualité à l’Anglo-Saxon, l’union dans le combat au Français.
Cette concession faite, je dis qu’il y a pour toute nation, en cas de guerre, une manière de se servir de ses facultés et moyens, suivant que l’action guerrière est dirigée par une pensée de droit ou par une rage de destruction; de même qu’il y a des règles pour le combat singulier, selon qu’il s’agit d’une affaire d’honneur ou d’un cas de légitime défense contre un assassin. Comment donc se fait-il que dans les batailles ce principe de bon sens, de loyauté, d’humanité, soit presque entièrement méconnu? A force de prendre la destruction pour le but même de la guerre, on n’a plus vu dans les groupes armés, depuis le peloton jusqu’à la division, que des machines à broyer les hommes, des engins d’écrasement. M. Thiers, dans son Histoire du Consulat et de l’Empire, avoue, malgré son admiration pour l’empereur, que l’abus des masses et de l’artillerie avait en moins de quinze ans changé les batailles en d’épouvantables boucheries, où la vertu militaire ne comptait plus, et. sans que les résultats en fussent plus grands, ni surtout plus durables.
L’art de ménager les soldats, tout en les faisant mouvoir par groupes, cet art dans lequel excellait Tu-renne, paraît se perdre. Jeter des masses, infanterie, cavalerie, artillerie, les unes sur les autres, faire des pâtées de chair humaine, arracher la victoire par l’épouvantement des hécatombes, ce fut dans les dernières années tout l’art de Napoléon. A faire mouvoir les armées, à les conduire à l’ennemi par le plus court. et le plus sûr chemin, et dans le moins de temps possible, à prendre position, son habileté reste hors ligne; elle semble croître avec l’âge et l’expérience. Arrivé sur le champ de bataille, il dédaigne la tactique, saisit ses masses et les lance sur l’ennemi, comme les géants de la fable lançaient sur les dieux des montagnes. Il a calculé la marche: s’il ne s’est pas trompé, l’ennemi doit être pris en flagrant délit et infailliblement broyé. A Waterloo il n’employa pas d’autre méthode, et fut vaincu: lorsque les Prussiens arrivèrent, le marteau s’était brisé sur l’enclume. Et voilà pourquoi sans doute, dans l’opinion de plusieurs critiques, Napoléon, incomparable comme stratège, ne figure plus comme tacticien qu’au second rang.
C’est par le même procédé que fut enfin enlevé Séhastopol. Le général Canrobert n’ayant pas, dit-on, les nerfs assez fortement trempés, on avait fait venir pour cette grosse besogne le général Pélissier. A Magenta et à Solferino les choses se seraient passées, s’il faut en croire les relations, un peu autrement: l’initiative du soldat et la baïonnette auraient décidé la victoire. Dieu veuille que ce soit un retour à des combats plus héroïques! L’effet de ces chocs monstrueux, dont le secret se réduit à une formule de mécanique, la masse multipliée par la vitesse, est horrible. Là, le génie et la valeur n’ont rien à voir; celui qui joue le plus gros jeu a le plus de chances de vaincre. L’art de la guerre, qui, si tant est qu’un pareil art existe, de-. vrait consister surtout à déployer les courages, à conserver les forces tout en les engageant, à obtenir le plus en dépensant le moins, à contraindre l’ennemi sans l’anéantir, n’est plus qu’un abatis réciproque, où la matière joue seule un rôle, où l’esprit n’intervient que pour donner le signal, et dont l’horreur n’est égalée que par le mépris affecté des chefs pour la vie du soldat.
Qu’on ne me demande pas quelle nouvelle, plus humaine, et surtout plus convaincante tactique, je voudrais introduire dans les batailles. Je ne suis pas plus obligé d’apprendre à nos maréchaux à faire la guerre, qu’à nos gens de lettres à faire de meilleure poésie ou de meilleurs drames. J’use de mon droit quand je soutiens contre les uns que leurs manœuvres sont opposées au droit de la guerre, contre les autres que leurs productions sont en dépit de l’art. Et je suis d’autant mieux fondé dans ma critique, que si le respect de la vie humaine a été dans tous les temps le moindre souci des gens de guerre, la manière de combattre a maintes fois changé, ce qui permet de supposer qu’il doit y en avoir une qui réponde mieux que les autres au but de la guerre et à ses conditions essentielles .
C’est surtout de l’invention de la poudre à canon et de la prépondérance de plus en plus décisive de l’arme à feu sur L’arme blanche que date ce que j’appellerai la dépravation des batailles. Mais, chose à noter, l’emploi de l’artillerie, après avoir suggéré l’idée de ces chocs écrasants, paraît tendre aujourd’hui, par le perfectionnement des armes, à rendre la rencontre des masses impossible. Un peu plus de portée, de rapidité et de précision dans le tir, il n’en faut pas davantage pour amener dans la tactique une nouvelle révolution, qui certes ne sera pas à l’honneur du soldat.
Un autre inconvénient de l’artillerie est d’avoir, comme l’a remarqué Ancillon, rendu les guerres plus dispendieuses sans les rendre plus rares. La dépense de matériel à la guerre a été toujours en croissant depuis l’invention des armes à feu, par suite la dépense de courage toujours en diminuant: tel est le résultat auquel aboutit l’influence de l’industrie moderne sur l’art des tacticiens et les jugements de la force. Tout boulet de canon tiré coûte quinze francs; tout canon de bronze mis en place, six mille francs; un canon rayé, vingt-cinq mille francs. Un soldat d’infanterie, de quatre ans de service, équipé et armé, représente, en avances faites par la famille et par l’État, intérêts de ces avances, perte de travail, un capital moyen de vingt-cinq mille francs. Bientôt l’on ne dira plus: La victoire est aux gros bataillons; on dira: La victoire est aux grosses machines, aux gros capitaux.
Le soldat romain ne coûtait quelque chose à l’État et ne devenait une cause de déficit pour sa famille que du jour où il entrait en campagne; la vie de caserne n’altérait pas ses mœurs laborieuses et ses vertus civiques. Son éducation militaire se faisait au sein même des travaux rustiques: c’était une tradition de famille autant qu’un enseignement de la cité. Quant à l’armement, Jes épées et les piques, passant des pères aux enfants, n’avaient besoin, à chaque génération comme à chaque campagne, que d’un repassage. En revanche, tandis qu’avec nos armes de jet la victoire et la vie du soldat dépendent surtout de l’avantage des positions, du nombre des pièces, du pointage des canonniers, de la précision des feux de bataillon, de la druesse des feux de file, elles dépendaient alors bien davantage de la bravoure des légionnaires. Le Romain, à chaque combat, joignait l’ennemi, combattait corps à corps, et, s’il avait affaire à des troupes aguerries, comptait ses triomphes par ses blessures.
Le progrès des armes modernes, il faut l’avouer, est en sens contraire de la valeur antique. Un des résultats obtenus dans la dernière campagne par l’emploi des canons rayés a été, dit-on, de rendre la cavalerie et les réserves complétement inutiles. Les nouveaux projectiles allaient les chercher à des distances telles, qu’elles étaient paralysées ou détruites sur place avant d’avoir pu entrer en ligne et fournir une charge. Encore un progrès dans ce genre, et les masses d’infanterie se deviendront mutuellement inabordables. Une colonne d’attaque, lancée au pas de course, pouvant être détruite par une poignée d’hommes en moins de temps qu’il n’en faut pour franchir un intervalle de cent à cent cinquante pas, les soldats de la haute civilisation seraient réduits à s’exterminer de loin sans pouvoir jamais en venir aux mains. De quart d’heure en quart d’heure, on verrait un parlementaire, circulant entre les deux armées, porter un bulletin du général en chef au général en chef: «Ma perte est de tant d’hommes; quelle est la vôtre? Comptons... A vous, monsieur, l’avantage.» Quelle civilisation! Quel progrès! Comment croire encore à une justice de la guerre, à un droit de la force?
Un autre genre de reproches est relatif à l’enrôlement, à l’organisation militaire, aux garanties du soldat, à la responsabilité des officiers, à la moralité du commandement,
D’après les principes développés au livre II, la guerre étant une lutte de nation à nation dans un in térêt d’État, il s’ensuit, à priori, que tous les sujets de l’État, tous les membres de la cité, sans exception, doivent y prendre part. La jeunesse et tous les hommes qui n’ont pas atteint l’âge caduc forment l’armée, les vieillards, les enfants et les femmes sont employés aux ateliers, magasins, ambulances, travaillent aux fortifications et aux retranchements. La perte d’un œil, d’une jambe, d’un bras; la surdité, la myopie, le défaut de taille, les faiblesses de complexion, les fonctions d’un certain ordre, ne sont pas des causes suffisantes de libération du service. La Convention était dans le vrai sens de la loi de la guerre, lorsqu’elle décréta la levée en masse et déclara la patrie en danger. Aussi la République fut victorieuse. On ne triomphe pas d’une nation armée comme était alors la France. Maintenant il y a le tirage au sort, les conseils de révision, traînant à leur suite les exemptions de toute espèce et les remplacements. Comme image de la nation armée, on a conservé la garde nationale, tantôt organisée au grand complet, tantôt réduite à son minimum d’expression, selon l’esprit et les tendances des gouvernements, dans tous les cas ridicule par sa lourdeur et son inutilité.
Les résultats de ce système sont connus. La guerre, abandonnée aux soins du gouvernement, n’intéressant la nation que d’une manière indirecte et à titre d’impôt, est devenue, pour les militaires gradés, fils de bourgeois la plupart, une carrière; pour les autres, ouvriers et paysans, une perte d’état. Sous prétexte d’assurer la défense nationale par la force de l’armée, on choisit dans la jeunesse travailleuse ce qu’il y a de plus beau, de plus fort et de meilleur pour en faire la matière première d’une armée, qu’on s’étudie ensuite à séparer du peuple; la race, continuellement écrémée, perd de sa taille et de sa vigueur, et la nation est atteinte dans sa souverainté même.
Cette première infraction au droit de la guerre, identique sous ce rapport au droit politique, en amène une autre relative au choix des officiers et généraux.
Dans la guerre, encore plus que dans la paix, l’homme revêtu d’un commandement doit être à la nomination des citoyens. C’est le moins que l’homme qui s’arme pour la défense de son pays choisisse son capitaine: ainsi firent les fédérés de 92, et personne n’a prétendu que leurs officiers, produit de l’élection, fussent moins braves, moins capables, et surtout moins amis de la liberté, que ceux qui plus tard formèrent la menue monnaie de l’empereur.
On observe à ce propos que l’élection, appliquée à l’armée,- serait destructive de la subordination, sans laquelle une armée ne peut subsister; qu’ainsi le droit du citoyen-soldat allant contre le but même de la guerre qui est le déploiement de la force, il y a lieu de faire plier le droit politique devant la discipline militaire.
Cette objection pourrait être vraie dans une monarchie où, l’armée étant distincte de la nation, la guerre laissée à la direction du prince, on voudrait conserver pour la nomination des officiers la forme républicaine. Il y aurait évidemment contradiction. La question alors serait de savoir si l’intérêt dynastique doit passer avant l’intérêt national, avant l’intérêt de la guerre elle-même, qui exige, comme l’industrie, pour le déploiement de la plus grande force, la plus grande liberté possible. Mais dans une république, dans un empire fondé sur le suffrage universel, où la nation garde le plein et entier exercice de sa souveraineté, où la guerre et la paix restent en définitive soumises à la décision du pays, l’exception n’est plus de mise. L’élection des officiers par les soldats, outre qu’elle découle du droit public de la nation, est le gage de la moralité du commandement, du civisme de l’armée, et par conséquent de sa force.
Mais sortons des considérations politiques, qui ont bien ici leur importance, et occupons-nous seulement de la chose militaire.
Par la solidarité du péril et la communauté de l’effort, une armée est une véritable association. La présence de l’ennemi met de niveau officiers et soldats; ceux qui ont fait la guerre en savent quelque chose. Là, si la discipline est respectée, c’est à la condition que le dévouement soit réciproque, la confiance du soldat dans ses chefs absolue. Là, plus de bon plaisir, plus de passe-droit, personne de sacrifié. Le bon plaisir, devant l’ennemi, le passe-droit, est trahison; le sacrifice d’un homme, d’un corps, hors des nécessités absolues de la bataille, assassinat. Croit-on que cette fraternité d’armes, qui dans une armée de citoyens libres s’étend du général au soldat, soit aussi bien garantie dans la constitution actuelle des armées?
Indépendant de ses subordonnés devenus ses subalternes. l’officier, à plus forte raison le général, n’éprouve plus pour le soldat cette sollicitude dévouée qu’entretiennent l’élection et l’égalité civiques. Le grade devenu l’insigne de l’inégalité, la justice, âme de la guerre, remplacée par le commandement, un autre esprit tend à s’emparer de l’armée. C’est le monde de l’impératif, dans lequel le supérieur n’étant responsable que devant le supérieur, c’est-à-dire en réalité devant personne, l’inférieur se trouve inévitablement et indignement sacrifié. Le soldat, dans la main du général, n’est plus en effet, comme le paysan dans son village, une âme; c’est une arme de jet, une machine à tuer, de la matière, enfin, comme les canons et les munitions, un produit de l’industrie militaire, que l’on ménage parce qu’il coûte, du reste aussi vil que ses cartouches et son fusil.
De là ces maximes judaïques, sujettes à de si monstrueuses applications, qu’à la guerre il est permis de sacrifier la partie pour sauver le tout, comme disait Caïphe: expedit unum hominem pro populo mori; d’exposer à une destruction certaine des régiments, des corps entiers, pour faire réussir une combinaison, pour étonner l’ennemi, quelquefois par crânerie; d’abandonner, dans les retraites, blessés, malades, traînards et arrière-garde. De là ce principe atroce, préconisé par certains écrivains et diamétralement opposé à la loi de la guerre, que le soldat, dans une situation désespérée, doit se faire massacrer plutôt que de se rendre, parce que, si faible que soit sa défense, sa mort coûtera toujours quelque chose à l’ennemi. De là, enfin, ce système d’entraînement qui, à défaut de patriotisme, entretient le courage du soldat, et fait de lui, non plus le défenseur de son pays, mais le séide d’un ambitieux.
Tel est l’esprit dans lequel les républicains ont accusé, non sans amertume, Napoléon Ier d’avoir formé ses officiers et façonné ses armées. Ainsi, disent-ils, on le vit à Austerlitz, afin de déterminer le mouvement des alliés sur sa droite et de les faire tomber dans le piège, laisser écraser toute une aile de son armée, tandis qu’il avait sous la main 40,000 hommes qui ne prirent aucune part à l’action; à la Moskowa, refuser sa garde, malgré les cris des soldats, ce qui rendit la victoire et plus sanglante et moins fructueuse; au passage de la Bérésina, forcé de quitter tout et de sauver sa personne, parce que de la con servation de sa personne dépendait le salut de l’empire. Déjà on l’avait vu, dans la campagne de Marengo, plus empressé d’assurer sa propre gloire que de voler au secours de Masséna, dont les soldats sacrifiés en conservèrent un long ressentiment. Ainsi encore, usant du pouvoir souverain qui de la nation avait passé au premier magistrat, il choisit pour l’inutile et impolitique expédition de Saint-Domingue 35,000 soldats républicains dont l’esprit n’était plus en harmonie avec les principes qui avaient prévalu depuis le 18 brumaire, et pouvait exercer une influence fâcheuse sur l’armée.
J’admets cette critiqué : j’observe seulement, à la décharge de Napoléon, que le reproche tombe bien moins sur lui que sur ses idées qui étaient celles de son temps.
Si, dans ces diverses circonstances, Napoléon avait agi, comme aucuns le supposent, par un machiavélisme calculé, je ne relèverais pas des actes justiciables seulement de la conscience de l’historien. Je considérerais le fondateur de la dynastie des Bonaparte comme un grand coupable et m’abstiendrais d’en parler. Mais ce n’est pas ainsi que les abus s’introduisent dans les gouvernements, et par suite dans les opérations de la guerre et la discipline des armées. Remontez la chaîne des causes, et, quand vous vous imaginez n’avoir devant vous que les fautes d’un homme, vous arrivez à un courant d’opinion, à un essor des énergies nationales qui, selon l’idée qui le dirige, tantôt porte aux nues le chef de l’État, chef en même temps de l’armée, tantôt fait de lui sa première victime. Or, qui ne voit ici que le premier consul, plus tard l’empereur, obéissait à une double influence dont il n’était pas le maître: d’un côté, la réaction du principe d’autorité après la longue agitation révolutionnaire; de l’autre l’idée fausse qu’on se faisait de la guerre, et qui faisait supposer que la victoire était d’autant plus glorieuse, qu’elle avait été remportée avec moins de monde sur une puissante coalition?
En vain la routine prétendrait-elle que la nécessité le veut ainsi; qu’il n’y a pas d’autre manière de faire la guerre; que cette courtoisie chevaleresque que nous réclamons au nom du droit même de la guerre est bonne pour les romans; que le premier devoir du soldat est le sacrifice; qu’après tout on ne se bat pas pour la gloire, mais pour des intérêts, et qu’il est de la nature des intérêts, lorsqu’ils entrent en lutte, de fouler aux pieds toute moralité et tout idéal.
Je répondrai toujours que cette prétendue nécessité n’est pas réelle; que les lois de la guerre ne sont pas plus difficiles à suivre que celles du duel; quant aux intérêts, que la raison et la justice nous ont été données précisément afin d’établir entre eux l’équilibre, et que la première condition de cet équilibre est le droit de la force. Ah! de grâce, gardons-nous d’introduire l’utilitarisme dans la guerre, pas plus que dans la morale. La guerre n’a pour elle que sa conscience, son droit, sa bonne renommée; et vous voyez ce que déjà ; par l’effet de fausses notions, elle tend à devenir. Que sera-ce si, dans le cœur des soldats et des généraux, à la place de ce sentiment exalté d’honneur qui les anime, vous mettez l’intérêt?
Que si, malgré ces considérations irréfutables, on prétendait persister, par paresse d’esprit, manque de cœur ou perversité d’intention, dans un honteux système, alors je dirais qu’il ne faut plus parler ni de droit de la guerre, ni de droit international, ni de droit politique. Plus de liberté, plus de patrie: l’empire du monde est aux plus scélérats. Quant aux honnêtes gens, mieux vaut pour eux accepter tout ce qui se présente, au dedans l’usurpation, de quelque part qu’elle vienne, au dehors l’insulte et l’amoindrissement, que d’engager des luttes auxquelles il serait impossible de prendre part sans cesser d’être homme. L’ennemi approché : Aux armes, citoyens; formez vos bataillons contre l’étranger! — Eh! Sire, défendez-vous tout seul. Quant à nous, que vous daignez appeler en ce moment citoyens, qu’avons-nous à perdre à changer de maître? Et que pourrait-il nous arriver de pis que d’être soldats?