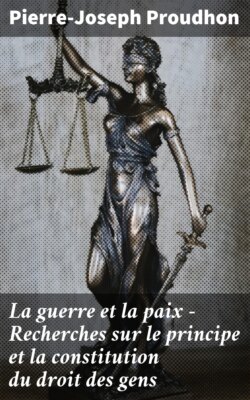Читать книгу La guerre et la paix - Recherches sur le principe et la constitution du droit des gens - Pierre Joseph Proudhon - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
QUESTIONS DIVERSES:
Оглавление1. Le droit des gens est-il dépourvu de sanction? — 2. Déclarations de guerre. — 3. Jusqu’où il est permis de pousser la résistance. — 4. De l’interruption du commerce. — 5. Si les sujets des puissances ennemies sont ennemis. — 6. Des alliances.
La critique des opérations militaires n’épuise pas tout ce que nous aurions à dire à propos des formes de la guerre. 11 est encore une foule de questions, résultant du fait de guerre, que la jurisprudence des auteurs a, si j’ose ainsi dire, sabrées, et qui toutes doivent se résoudre d’après les mêmes principes et de la même manière. Nous y consacrerons quelques pages.
«Le droit des gens, dit un écrivain contemporain,
«est de création toute moderne.»
Ce que nous avons dit de la guerre, tant dans ce livre que dans le précédent, montre dans quelle mesure et en quel sens cette proposition avantageuse doit être prise. En fait, les anciens eurent l’intelligence du droit des gens, nous voulons dire ici du droit de la guerre, à un degré fort supérieur aux modernes; et la raison, nous l’avons dite, c’est que les anciens prenaient au sérieux le droit de la force. Mais, bien que les anciens eussent du droit des gens une idée plus juste que la nôtre, ils ne paraissent pas en avoir laissé de théorie, et c’est seulement depuis environ deux siècles que les modernes ont essayé de suppléer à ce silence.
Les dates et monuments principaux de cette constitution théorique du droit des gens sont les suivants:
Publication du livre de Grotius, De Jure belli ac pacis, 1625;
Publication du livre de Hobbes, De Cive, 1647;
Traité de Westphalie, 1648;
Jus naturœ et gentium, de Pufendorf, 1672;
Codex juris gentium diplomaticus, de Leibnitz, 1693;
Traité d’Utrecht, 1713;
Jus gentium, de Wolf, 1749;
Le Droit des gens, de Vattel, 1758;
Tableau des révolutions du système politique en Europe, par Ancillon, 1803-1805;
Traités de Vienne, 1814-1815;
Traité de Paris, 1856.
Je passe sous silence la multitude d’écrits dont l’éditeur français de Martels donne la liste, et qu’il est parfaitement inutile de consulter, puisqu’ils ne font tous que répéter les maîtres, que par conséquent il n’y a rien à en apprendre.
Quelle vérité positive résulte de cette tradition savante de 235 ans?
Aucune. Depuis que la violation ou l’abrogation des traités de Vienne, qui avaient posé en dernier lieu les bases de la paix en Europe, a été, pour ainsi dire, mise à l’ordre du jour des gouvernements et des peuples, les incertitudes qui planent sur le droit des gens, auparavant renfermées dans les livres, se sont divulguées, et les nations apprennent aujourd’hui à leurs dépens que toute idée fausse dans l’ordre moral et politique finit par se traduire en calamité dans la vie sociale.
Or, l’erreur radicale des publicistes, celle qui engendre toutes les autres, et qui fait de leur théorie du droit de la guerre et du droit des gens un tissu de non-sens et de contradictions, c’est que, ne reconnaissant pas l’existence et la légitimité d’un droit de la force, ils sont forcés de regarder le droit de la guerre comme le produit d’une fiction, par suite de nier à son tour le droit des gens qui, par la négation du droit de la guerre, se trouve dépourvu de sanction. C’est ce qui résulte du témoignage formel de tous les écrivains, et sur quoi il est utile que nous revenions une dernière fois.
1. Le droit des gens est-il dépourvu de sanction? — Que le lecteur veuille bien ici nous faire grâce de quelques redites.
En principe la justice, comme la vérité, n’a et ne peut avoir d’autre sanction qu’elle-même: c’est le bien qui résulte de son accomplissement, le mal qui suit sa violation. Au point de vue politique et gouvernemental, dans le sens administratif et pratique du mot, la sanction de la justice est dans l’omnipotence du souverain, c’est-à-dire dans la force.
Ainsi, dans le droit civil, les circonstances sont nombreuses où la force publique se manifeste à l’appui de la justice: les sommations et assignations, la saisie, l’expropriation forcée, l’apposition des scellés, la plantation des bornes, la contrainte par corps, la garnison, la vente à l’encan, etc. — Dans le droit pénal, jl y a les mandats de comparution, d’arrêt, d’amener, de dépôt; la prison, la chaîne, l’exposition, le travail forcé, lé bannissement, la transportation, la guillotine.
D’après cette analogie, on demande quelle est la sanction pratique du droit des gens; et comme les nations ne reconnaissent pas de souverain, qu’elles ne relèvent d’aucune autorité ni d’aucune force, on est conduit à dire que le droit qui régit leurs rapports, valable au for intérieur, est dépourvue, au for extérieur, de sanction. — Il y a la guerre, direz-vous. — Mais, répliquent les juristes, la force par elle-même ne prouve rien; il faut qu’elle soit autorisée, commandée par une puissance supérieure, organe elle-même et représentant- de la justice. Cette autorité n’existant pas, le droit des gens n’a de garantie que la raison et la moralité des gouvernements, c’est-à-. dire qu’en réalité le droit des gens repose sur le vide.
Qu’est-ce donc que la guerre, si elle n’est pas la sanction du droit des gens?
La guerre, répondent les auteurs, est la contrainte exercée par une nation qui se prétend lésée vis-à-vis d’une autre nation que celle-là accuse de faire grief à son droit et à ses intérêts. Mais il est évident que, par le fait de la déclaration de guerre, l’agresseur se pose à la fois comme juge et partie, ce qui, en bonne procédure, ne se peut admettre, alors surtout qu’il s’agit de recourir à la force. Il suit de là que la guerre par elle-même ne prouve absolument rien; que la victoire ne fait pas le droit; mais, comme il faut que les guerres finissent, que les litiges internationaux reçoivent une solution bonne ou mauvaise, on est tacitement convenu, afin d’arrêter l’effusion du sang et pour éviter de plus grands malheurs, de reconnaître le droit du vainqueur, de quelque côté que se porte la victoire: c’est ce que l’on appelle droit des gens volontaire. Pour que la guerre fût tout à fait morale et légitime, il faudrait qu’elle eût lieu en vertu d’un jugement émané d’une autorité supérieure, devant laquelle seraient portés les litiges internationaux, avec pouvoir de les juger et de donner exécution à ses arrêts. Mais c’est ce qui ne saurait avoir lieu, et c’est pourquoi, disent les auteurs, le droit des gens, comme le droit de la guerre, se réduit à une. fiction.
En deux mots, la théorie des publicistes modernes, fondée sur une analogie, aboutit à l’hypothèse d’une monarchie, république ou confédération universelle, précisément ce contre quoi les nations protestent avec le plus d’énergie, et dont la seule prétention a causé dans tous les temps les guerres les plus terribles. Hors de cette omniarchie, le droit des gens, selon eux, reste un desideratum de la science, un vain mot. Les nations, les unes à l’égard des autres, sont à l’état de nature.
«S’il est vrai que les souverains et les États, en
«leur qualité de personnes morales, soient justiciables
«de la même loi qui sert à déterminer les rapports
«des individus, chacun d’eux a sa sphère d’activité
«qui est limitée par celle des autres; là où la
«liberté de l’un finit, celle de l’autre commence, et
«leurs propriétés respectives sont également sacrées;
«il n’y a pas deux règles de justice différentes, l’une
«pour les particuliers, l’autre pour les États... Ce
«droit existe, mais il manque d’une contrainte extérieure;
«il n’y a point de pouvoir coactif qui puisse
«forcer les différents États à ne pas dévier, dans leurs
«relations, de la ligne du juste... Les souverains
«sont encore dans l’état de nature, puisqu’ils n’ont pas
«pas encore créé cette garantie commune de leur
«existence et de leurs droits, et que chacun d’eux
«est seul juge et seul défenseur de ce qui lui appartient
«exclusivement, et que les autres doivent respecter.»
J’ai cité précédemment M. Oudot, concluant de cet état de nature des souverains, dénoncé par Ancillon, et de cette absence de sanction du droit des gens, à une centralisation de toutes les puissances de la terre. Je renvoie le lecteur à cette citation, t. 1er, p. 168.
Mais une semblable exagération du principe d’autorité serait la plus impraticable des utopies, et il est surprenant qu’elle n’ait pas suffi pour avertir les honorables légistes qu’ils faisaient fausse route. L’idée d’une souveraineté universelle, rêvée au moyen âge et formulée dans le pacte de Charlemagne, est la négation de l’indépendance et de l’autonomie des États, la négation de toute liberté humaine, chose à laquelle États et nations seront éternellement d’accord de se refuser. De plus, ce serait l’immobilisme de l’humanité, absolument comme le despotisme dans un État, ou le communisme dans une tribu, est l’immobilisation de cet État et de cette tribu. La civilisation ne marche que par l’influence que les groupes politiques exercent les uns sur les autres, dans la plénitude de leur souveraineté et de leur indépendance; établissez sur eux tous une puissance supérieure, qui les juge et qui les contraigne, le grand organisme s’arrête; il n’y a plus ni vie ni idée.
Non, il n’est pas possible que le droit des gens soit dépourvu de sanction, comme le disent ses prétendus inventeurs les modernes jurisconsultes. Le droit des gens a pour sanction naturelle, légitime, efficace, la guerre, faite selon les règles qui se déduisent logiquement du droit de la force. — Non, il n’est pas vrai que la guerre, ou l’emploi de la force comme instrument de justice entre les nations, doive être assimilée, ainsi que le font les mêmes jurisconsultes, aux moyens de contrainte usités dans la procédure civile et criminelle, et que par conséquent elle requière, pour sa propre légitimation, l’exequatur d’une autre souveraineté. C’est méconnaître la nature et l’objet de la guerre que de la ramener à de pareils termes; c’est ne rien comprendre à la marche de l’esprit humain, aux lois de la civilisation et de l’histoire. La guerre, ainsi que nous l’avons démontré par la théorie du droit de la force et de son application, est précisément le cas, et c’est l’unique, dans lequel le droit se démontre par l’exhibition de la force. La guerre est, pour cette raison même, de tous les tribunaux le moins sujet à errer et le plus prompt à revenir de ses erreurs; et c’est ce qui fait que, comme le droit des gens domine toute espèce de droit, la guerre, qui l’affirme et le garantit, est la plus puissante de toutes les sanctions.
De cette erreur des publicistes sur la nature de la guerre et la sanction du droit des gens, dérivent toutes les absurdités qui pullulent dans leurs écrits, et par suite toutes les calamités et les crimes que la guerre traîne à sa suite; c’est ce dont sera convaincu tout homme de bon sens qui voudra se rendre compte de la pensée qui dirige les armées et leurs opérations.
Les questions suivantes, prises au hasard dans les livres des docteurs, compléteront notre critique.
2. Déclarations de guerre. — La justice, selon Vattel, exige que la guerre soit déclarée avant que les hostilités commencent. — Pourquoi cela? demande Pinheïro-Ferreira, si la guerre n’est que la revendication par la force de ce qui est dû ; si, d’autre part, les moyens de contrainte doivent avoir pour but de détruire ou de paralyser les forces de l’ennemi? Il suffit que la nation lésée ait notifié sa réclamation: le refus exprimé, elle est libre d’agir. Avertir l’ennemi, par une déclaration de guerre, qu’il ait à se tenir sur ses gardes, est absurde.
Il n’y a rien à répondre à cette observation de Pinheïro, et Vattel lui-même, après avoir posé le principe de la déclaration de guerre, le retire en ces termes:
«Le droit des gens n’impose point l’obligation de
«déclarer la guerre pour laisser à l’ennemi le temps
«de se préparer à une juste défensive. Il est donc
«permis de faire sa déclaration seulement lorsqu’on
«est arrivé sur la frontière avec une armée, et même
«après que l’on est entré sur les terres de
«l’ennemi...»
C’est le guet-apens que Vattel autorise, en vertu de sa fiction du droit des gens volontaire. Aussi qu’arrive-t-il? Autrefois, les peuples s’envoyaient des hérauts chargés de faire longtemps d’avance ces déclarations; du temps de Vattel, on se bornait à les afficher dans les capitales; maintenant on renvoie les ambassadeurs, la veille et quelquefois le lendemain du jour où les hostilités commencent. Et il n’y a rien à redire, si la guerre est telle que les jurisconsultes modernes la définissent.
C’est autre chose si la guerre est, comme nous le soutenons, la revendication légale du droit de la force, si de plus, comme nous venons de l’établir, elle est la sanction du droit des gens. Alors il est de toute évidence qu’elle doit procéder exactement comme si elle était ordonnée par une autorité supérieure, c’est-à-dire être déclarée à l’avance, et cela précisément afin que la nation attaquée se mette en défense: sans quoi la victoire de l’agresseur serait de mauvais aloi; il y aurait surprise, non pas démonstration de la force. Ainsi le veut le sentiment commun des nations, et jusqu’à ces derniers temps leur pratique y a été conforme.
3. Jusqu’où il est permis de pousser la résistance. — Vattel avoue que la résistance devient punissable quand elle est manifestement inutile. «Alors, dit-il, c’est opiniâtreté,
«non valeur.»
Mais, dans le système de Vattel, qui n’admet la guerre juste des deux côtés qu’au moyen de la fiction du droit des gens volontaire, et qui refuse toute qualité juridique à la force, cette proposition est de sa part une inconséquence. Il se peut que le plus fort soit un agresseur injuste; comment blâmer un homme qui, assailli par quatre brigands, se défend jusqu’au dernier soupir plutôt que de livrer ou sa fille, ou sa femme, ou sa fortune, le pain de ses enfants? Dans le cas même le plus favorable, celui d’une guerre de conquête ou de simple prééminence, comment blâmer un peuple qui préfère la mort à la domination? De ce prétexte d’inutilité de la défense résultera la vengeance du vainqueur, je le sais bien; c’est ainsi que, dans un siège, les habitants qui résistent à l’assaut s’exposent à être passés au fil de l’épée. Mais la vengeance de l’ennemi ne fait pas que la résistance soit injuste: Vattel devait d’autant mieux le comprendre qu’il nie le droit de la force.
Pour moi, qui affirme la réalité du droit de la guerre. et qui fais de ce droit la sanction du droit des gens, mais qui en même temps ne puis oublier que la guerre peut avoir pour but l’extinction d’une nationalité, je ne me prononce qu’avec réserve. Si la guerre est, comme je le dis, la sanction du droit des gens, nous devons tous en reconnaître la loi, qui est celle de la force, d’autant mieux que céder à la force n’implique pas de honte. Mais s’il s’agit d’incorporation ou d’émancipation politique, alors il me semble que les deux puissances belligérantes sont seules juges du prix qu’elles attachent respectivement à leur extension ou à leur liberté, et conséquemment du degré de leur résistance. Car se défendre à outrance peut devenir en certains cas un acte d’héroïsme, respectable au vainqueur lui-même. Les circonstances seules me paraissent devoir décider de la résolution à prendre, dont chacun au surplus reste maître.
4. De l’interruption du commerce. — Suivant Pinheïro-Ferreira, l’état de guerre n’est pas une raison suffisante d’interrompre les relations commerciales entre deux pays. C’est sans doute le blocus continental qui a suggéré à Pinheïro-Ferreira cette opinion d’une haute philanthrophie, et il faut avouer qu’avec un tel principe Napoléon 1er eût été réduit de bonne heure. Bien plus, il faut reconnaître que les opérations commerciales, si elles devaient être respectées et maintenues, rendraient le plus souvent les opérations militaires inexécutables. Profondément convaincu de l’absurdité du droit de la force et de l’immoralité de la guerre, Pinheïro-Ferreira ne marchande point, comme les autres, avec le préjugé. Il s’attache à entourer la guerre de toutes les conditions qui peuvent l’abréger, la restreindre, la rendre impraticable et impossible. Tel est le caractère général des écrits de ce philosophe.
Malheureusement les choses ne se prêtent point ainsi à l’arbitraire de l’opinion, et, parce qu’il nous plaît de les définir à notre guise, elles n’en suivent pas moins leur indomptable nature. La guerre est, entre deux nations, la lutte des forces. Et qu’est-ce que le commerce? un échange de forces. Que la guerre soit aussi courte que possible, je le veux; mais, au moment du combat, c’est-à-dire tant que durent les hostilités; toute relation de commerce, c’est-à-dire tout échange de forces entre les puissances belligérantes, doit cesser. Sans cela la guerre deviendrait un jeu; ce serait une partie d’escrime, non un jugement ni une sanction.
5. Si les sujets des puissances ennemies sont ennemis. — Question grosse de contradictions et à peu près insoluble, dans le système généralement suivi. Grotius et Vattel décident que, en vertu de la solidarité qui existe entre la nation et son gouvernement, les sujets de deux puissances en guerre sont ennemis. En conséquence, dit Vattel, les enfants, les femmes, les vieillards, sont au nombre des ennemis; ils appartiennent au vainqueur, ce qui n’est du reste pas une raison pour celui-ci de les massacrer. Pinheïro-Ferreira se récrie contre cette doctrine, et il faut avouer que son opinion, quoique faiblement motivée en principe, dans la pratique plaît davantage.
Sans doute, peut-on dire avec lui, en bonne logique, il n’est pas possible de séparer ici la cause de l’État de celle des particuliers. Mais quoi! Si la guerre n’est, comme on le prétend, qu’une substitution, arbitraire ou fatale, de la force à la justice; si la victoire par elle-même ne prouve absolument rien; si l’on ne peut admettre qu’en toute guerre le droit soit positivement égal des deux côtés; si cette égalité n’est qu’une fiction de légiste; si par conséquent la guerre se réduit le plus souvent à un fait de l’ambition, du machiavélisme ou de l’imbécillité des princes, faut-il rendre responsables de toutes ces folies tant d’innocents qui n’en peuvent mais? Et ne serait-il pas d’une pratique plus humaine, n’aurait-on pas fait un grand pas vers la pacification définitive, de déclarer, d’un commun accord, les populations insolidaires, en temps de guerre, de la politique de leurs gouvernements?
Je laisse au lecteur le soin de pousser cette controverse, qui peut donner lieu à de magnifiques développements oratoires, mais sans aboutir à aucune conclusion.
Pour moi, qui considère le mouvement des États comme une nécessité de l’histoire et la guerre comme un acte juridique, je dis simplement que, dans la guerre, il serait dangereux, impolitique, immoral, de séparer les gouvernements des sujets, que la cause leur est commune, et que par conséquent leur responsabilité est la même. Mais j’ajoute, en vertu des mêmes principes, et ici je vais plus loin que Pinheïro, que l’antagonisme n’existe véritablement qu’entre les groupes, c’est-à-dire entre les deux personnes morales qu’on appelle États; en sorte que, même dans une guerre à outrance ayant pour but l’absorption intégrale de l’une des puissances par l’autre, les sujets de ces puissances, PAS PLUS QUE LES SOLDATS EUX-MÊMES, ne doivent se considérer comme personnellement ennemis. La guerre de Crimée, dans laquelle Français et Russes, dans l’intervalle des luttes les plus acharnées, se rapprochaient en amis, en hôtes, échangeaient une pipe de tabac, une gorgée d’eau-de-vie, est le plus beau commentaire que je puisse donner de ma pensée et de la manière d’exercer le droit de la force.
6. Des alliances. — Sur cette matière, tout ce que j’ai rencontré dans les auteurs est politique d’antichambre, indigne de la plus légère mention. Sortons de ces vulgarités.
Les lois de la force régissent seules l’existence extérieure des États.
En vertu de ces lois, toute puissance est par nature hostile aux autres et en état de guerre avec elles. Elle répugne à l’association, comme à la sujétion. Son organisation intérieure la pousse à l’envahissement; à plus forte raison elle tend à une absolue indépendance, et se montre d’autant plus jalouse de son autonomie, qu’elle soutient avec ses voisines des rapports plus nombreux et plus fréquents.
Tant qu’un État conserve sa force d’action intérieure et extérieure, il est respecté ; dès qu’il vient à la perdre, il se disloque; tantôt une province, tantôt une autre se révolte contre le pouvoir central et se sépare du tronc; d’autres fois il est partagé par les États voisins qui se l’incorporent.
Il suit de là que les alliances entre États sont naturellement difficiles, de peu de vertu, de plus courte durée, et n’ont trait qu’à un objet spécial. Ainsi l’alliance de la Russie, de la Prusse et de l’Autriche, pour le partage de la Pologne, ne dura que le temps nécessaire au partage; elle n’eut pas d’autre objet, et ce qui en fit le succès, ce fut la décrépitude même de l’État polonais. Ainsi la fameuse Sainte-Alliance, imaginée par le czar Alexandre 1er pour prévenir le retour des conquérants, et signée par toutes les puissances de l’Europe, n’eut jamais d’existence que sur le papier. Napoléon Ier abattu, cloué sur son rocher de Sainte-Hélène, chacun des États signataires se remit à vivre de sa vie propre, c’est-à-dire à s’étendre et à conquérir dans la mesure de ses forces et de ses moyens. Ainsi encore l’alliance entre le même Alexandre et l’empereur Napoléon pour le partage de l’Europe ne fut qu’un rêve; les augustes contractants s’aperçurent bientôt qu’il est plus aisé de faire vivre ensemble cinquante États plus ou moins équilibrés que deux grands empires qui, après s’être partagé le globe, se fussent trouvés tous deux à l’étroit.
L’alliance entre deux ou plusieurs États, quand elle a lieu, a donc pour but, soit de poursuivre le démembrement et le partage d’un autre État, en conséquence de former des débris de celui-ci un nouvel État ou d’augmenter d’autant leur propre puissance; soit de résister à l’envahissement ou à la prépondérance d’un État qui, en raison de sa force, revendique sur les autres la suprématie.
Ainsi le cours des événements conduit une puissance A à s’emparer de tout ou partie d’une puissance B: c’est ce qui est arrivé pour l’empire germanique, actuellement l’Autriche, vis-à-vis de l’Italie, à la fois impériale, pontificale et fédérale, et pour cela non viable. Cette conquête du germanisme a même reçu, pendant un temps, la double sanction et de la majorité des Italiens et du droit public de l’Europe. Mais, avec le temps et sous l’influence même des traités qui avaient confirmé cette incorporation, les idées changent; la population incorporée se ravise; bien plus, il importe à une puissance C que la puissance B recouvre son intégrité et son indépendance, les autres puissances, D, E, F, etc., signataires des traités, demeurant indifférentes. En conséquence; il y a alliance entre B et C contre A. Que signifie cette alliance? Que le droit de vivre, ou, ce qui est la même chose, le droit de la force, est revenu à B, et qu’il s’est réduit d’autant du côté de A, ce qui se démontrera, par la guerre.
Les alliances politiques sont le champ de la défection et de l’ingratitude. Il ne faut pas s’en étonner. La promesse est subordonnée à la raison, qui n’est autre que la raison même de la force. Il se peut que l’Autriche, en se séparant de la Russie dans la guerre de Crimée, ait manqué de prudence; c’est cette imprudence qui a fait tout son crime. Mais elle avait le droit de se. tromper: mieux eût valu pour elle perdre la Hongrie que de devenir vassale du czar.
Au contraire, il se peut que l’Italie, en garde contre l’Autriche, reste fidèle à la France, et nous nous en réjouirons. Mais l’Italie a le droit de répudier notre alliance, et c’est ce qu’elle ne manquera pas de faire le jour où l’Autriche la reconnaîtra.