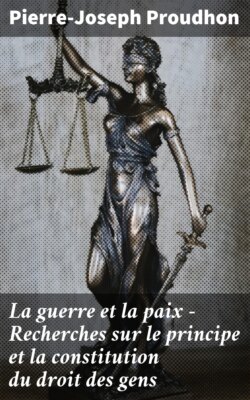Читать книгу La guerre et la paix - Recherches sur le principe et la constitution du droit des gens - Pierre Joseph Proudhon - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CRITIQUE DES OPÉRATIONS MILITAIRES: ACTES DE VANDALISME, SIÉGES, BLOCUS, MASSACRES, VIOLS, PILLAGE, ASSASSINATS, COMBATS SINGULIERS, PRISONNIERS DE GUERRE.
ОглавлениеEn cherchant la définition de ce qui est licite à la guerre et de ce qui est illicite, il est impossible que nous ne nous répétions pas quelquefois. Toute la conduite de l’homme de guerre peut se ramener à deux chefs: les personnes et les choses. On me pardonnera donc quelques redites, si elles ont pour but de faire ressortir davantage les anomalies de la pratique et les difficultés de la théorie.
Puisque la guerre est le jugement de la force, que la force se démontre par la lutte et par la victoire; et puisque la force, pour lutter et vaincre, a besoin de se livrer à des manœuvres souvent compliquées, difficiles, qui exigent, avec beaucoup d’hommes, beaucoup de temps et d’argent, nous pouvons, à ce point de vue tout économique, considérer la guerre comme une sorte d’industrie, ce que les militaires ont fait d’ailleurs-de tout temps. On dit le métièr de la guerre, l’art de la guerre, la profession des armes.
Ainsi la guerre a ses frais de main-d’œuvre; elle a sa matière première, qui sont ses munitions, des produits souvent très-perfectionnés de l’industrie; elle a ses travailleurs, qui sont les soldats; elle a son produit, qui est la conquête, l’incorporation d’une ville, d’une province, d’une nation, ou leur affranchissement. La guerre implique donc, avec l’effusion du sang, le sacrifice d’une certaine quantité de capitaux et de produits. En un mot elle a, comme toute industrie, son compte de recettes et de dépenses.
Les expositions industrielles, qu’on pourrait définir des joutes pacifiques, coûtent fort cher: on se les permet cependant, dans l’intérêt de l’industrie elle-même et du progrès des nations. La guerre, qui est la lutte armée des nations, combattant soit pour leur indépendance, soit pour leur prépondérance, coûte bien davantage. On s’y résigne néanmoins, et, une fois l’héroïque résolution arrêtée, on ne songe plus qu’à la mener avec vigueur et rapidité, les pires des guerres étant les guerres prolongées avec des résultats indécis.
Il suit de là que la guerre, ne se faisant pas pour elle-même, ne sacrifiant pas les hommes et les choses pour le plaisir de la destruction, mais pour la victoire, c’est-à-dire pour la conquête, ou, ce qui revient au même, pour la suprématie, la guerre, dis-je, a aussi son économie; elle est conservatrice, productrice même, de la même manière que le travail, qui, tout en consommant, conserve et reproduit. Toute destruction en dehors de ces règles est abusive, viole le droit. C’est barbarie pure, guerre de bête féroce.
Une conséquence de ce principe, c’est que l’État qui entreprend la guerre, la nation qui la consent, le général qui la conduit, doivent avoir constamment en vue de proportionner leurs sacrifices à l’intérêt qu’ils veulent sauvegarder, à l’avantage qu’ils prétendent obtenir. Il serait contre le droit de la guerre, autant que contre le vulgaire bon sens, de dépenser à la guerre, en hommes et en argent, plus que ne vaut l’objet même de la guerre. Une telle opiniâtreté serait blâmable, et dégénérerait en férocité.
Ceci posé, venons aux faits.
On raconte que la police papale, ne sachant comment venir à bout des brigands qui infestaient les États de l’Église, prit le parti de détruire les forêts qui leur servaient de repaire. Le déboisement produisit un fléau pire que le brigandage, la malaria. Ne voilà-t-il pas une police bien faite? Et ceci ne montre-t-il pas toute l’incapacité du gouvernement ecclésiastique, d’un gouvernement à qui il n’est pas permis de tirer l’épée, même contre des brigands, sans doute par crainte de perdre leurs âmes?
Mais voici qui est plus grave. Napoléon a accusé de vandalisme le gouverneur Rostopchin, qui, à l’approche des Français, mit le feu à la ville de Moscou; il l’a cité au ban des nations civilisées. On demande ce qu’il faut penser de cet acte, que les uns traitent, avec Napoléon, de barbare; que les autres qualifient d’héroïque.
Détruire son propre pays, brûler ses magasins, afin de laisser son ennemi dans le vide, c’est d’abord ne faire tort qu’à soi-même. Nul ne peut être tenu de nourrir son ennemi, et chacun est juge du prix qu’il attache à son indépendance et à sa liberté.
Mais, d’autre part, ce ne fut pas l’incendie de Moscou qui amena le désastre de l’armée française: les marches et les combats, depuis le Niémen, l’avaient réduite de plus des trois quarts, et, même après l’incendie de la ville, les vivres et munitions ne lui manquèrent pas. Le sacrifice accompli par Rostopchin fut donc en pure perte. D’autre part, il y avait à considérer si la Russie, même après avoir perdu sa capitale, pouvait se croire en péril; et Napoléon avait le droit de dire, en citant ses propres campagnes, que la prise de Vienne et celle de Berlin avaient certainement fait moins de mal à l’Autriche et à la Prusse que ne leur aurait coûté la destruction de ces deux villes.
Voilà le pour et le contre. Que décidons-nous?
Une infraction au droit de la guerre en amène une autre: abyssus abyssum invocat. La conduite de Rostopchin fut une réponse à celle de Napoléon. Laissant de côté la cause même de la guerre de Russie, que je ne discute point, j’observe que Napoléon, en franchissant le Niémen, avait compté sur deux choses:.la première, que le pays lui fournirait des ressources; la seconde, que les Russes accepteraient le duel en une ou deux batailles rangées, après lesquelles il ne leur resterait, vaincus, qu’à recevoir la loi du vainqueur. Or, ce calcul impliquait une double violation du droit de la guerre, non pas tel que Napoléon et ses adversaires le pratiquaient, mais tel que nous le révèle la notion de la guerre, et que nous cherchons à le déterminer.
Pour vaincre la Russie en l’attaquant chez elle, c’est-à-dire, au besoin, pour la conquérir, il y avait à remplir deux conditions. La première était de pouvoir l’occuper militairement tout entière, en tenant compte, par conséquent, de l’immensité de son étendue, sa principale et naturelle défense. Ce n’était donc pas avec 400,000 hommes que Napoléon devait franchir le Niémen, c’était avec 1,200,000, faute de quoi il contrevenait à ses propres maximes, en prétendant subjuguer la Russie avec une force réellement trop faible.
La seconde condition, c’est que, à part la ressource que l’armée envahissante pouvait trouver dans les magasins militaires dont elle parviendrait à s’emparer, elle devait être en mesure de subsister de ses propres moyens, sans rien extorquer à la population; puisque, d’après la critique que nous avons faite, la maraude est une infraction au droit de guerre, qui dans certains cas rend nulle la victoire.
L’événement a confirmé cette théorie. L’armée française n’était pas à cent lieues de l’autre côté du Niémen que la campagne pouvait être considérée comme perdue. Les victoires de Smolensk et de la Moscowa ne rétablirent point les affaires; le froid, qui plus tard assaillit l’armée française, ne fut qu’un sinistre de plus dans un désastre aux trois quarts accompli.
La conduite de Napoléon, dans cette injustifiable campagne, servit de provocation et jusqu’à certain point d’excuse à celle de Rostopchin. Il était évident, d’un côté, que Napoléon ne pouvait porter le guerre en Russie, à six cents lieues de sa capitale, sans exercer une immense maraude; le service dé transport qu’il essaya d’organiser de Dantzig au Niémen et qui ne lui fut presque d’aucune utilité le prouve. D’autre part, il n’est pas moins clair qu’un pays de cinquante millions d’âmes ne pouvait jouer son indépendance sur le sort d’une bataille contre une armée de 400,000 hommes. C’était laisser trop d’avantage à Napoléon. La loi des forces n’était plus observée. Napoléon ne pouvait plus dès lors être considéré comme un vrai conquérant, le représentant de la civilisation et du progrès, puisque, si l’on pouvait accorder qu’il eût pour lui l’idée, il n’avait pas le nombre, il n’avait pas la force. C’était un usurpateur de souverainetés, un perturbateur de l’Europe, un aventurier qu’il fallait détruire à tout prix, en l’affamant. A cet égard, Rostopchin dut se croire d’autant plus autorisé que Napoléon lui donnait l’exemple. En vertu du principe que le salut de l’armée est pour un général la loi suprême, Napoléon avait donné l’ordre, afin de ralentir l’ennemi, de brûler tout ce qu’on ne pouvait emporter, et jamais ordre ne fut plus consciencieusement exécuté, dit M. Thiers, que celui-là ne le fut par Davoust.
Tout se tient dans les choses humaines: une faute contre le droit. de la force en devient une contre le droit des gens, et de faute en faute la puissance la mieux établie finit par se perdre. Quels que fussent les griefs de Napoléon contre Alexandre, dès lors qu’il ne pouvait absorber la Russie, ni même l’occuper militairement, il devait s’abstenir de toute invasion. La manière dont a été faite la guerre de Crimée servirait au besoin à justifier cette proposition; cette guerre, où fut déployée une puissance bien autrement formidable que celle dirigée par Napoléon 1er en 1812, et qui n’avait cependant d’autre but que de contraindre la Russie à la paix en détruisant sa forteresse de Sébastopol, est la critique la plus péremptoire qu’on puisse faire de l’expédition de 1812.
Changeons de sujet. Tout le monde connaît l’histoire; ou le roman, de Judith et du siège de Béthulie. Les Juifs, selon le récit biblique, menacés par une armée d’invasion, se réfugient dans leurs places fortes. Arrivé devant Béthulie, bâtie sur un rocher, et ne pouvant s’en emparer par un coup de main, le général ennemi coupe le canal qui fournissait de l’eau à la ville. Bientôt les assiégés, mourant de soif, sont dans la nécessité de se rendre. Dans cette légende, devenue populaire, on peut voir, au point de vue du droit, l’histoire de tous les blocus. Je n’examine pas s’il y avait raison suffisante de guerre entre les Assyriens et les Hébreux; j’admets le cas. Je demande seulement si la conduite d’Holopherne était bien selon le droit de la guerre, laquelle, comme dit Cicéron, est une manière de vider les différends par les voies de la force.
— Sans nul doute, répondent les militaires, Holopherne était ici dans son droit. Si les Juifs voulaient éviter les inconvénients du blocus, ils n’avaient qu’à descendre et accepter la bataille. Tout siège de place a pour but de forcer un ennemi, qui par le fait de sa retraite s’avoue impuissant, mais qui, par l’art de la fortification, entreprend de suppléer à l’infériorité du nombre par la supériorité de la position. Se défendre chez soi, au moyen de remparts, de fossés pleins d’eau, etc., est de plein droit à la guerre, attendu que c’est à l’agresseur à forcer le défendeur et à le forcer chez lui; attendu, en outre, que la fortification d’une place est déjà par elle-même un acte considérable de force, qui doit compter dans la balance de la justice guerrière; attendu enfin que, si une nation se trouvait, par la nature du sol, tout à fait hors d’atteinte, elle échapperait à la loi d’incorporation et devrait être neutralisée. C’est ce motif qui a fait admettre par le droit européen l’indépendance de la confédération helvétique, placée, pour ainsi dire, en l’air, à l’abri des conquêtes, et hors d’état elle-même de nuire aux puissances qui l’enveloppent. Mais ce droit de la défense dans une place fortifiée implique que l’ingénieur aura pourvu à tout, à l’eau et aux vivres aussi bien qu’à l’armement. Sinon, le blocus et ce qui s’ensuit deviennent un moyen de contrainte d’autant plus légitime que l’assiégeant est exposé aux mêmes inconvénients que l’assiégé, et que, lorsqu’une armée est forcée de lever un siège, c’est d’ordinaire par l’effet des maladies ou le manque de vivres.
Je n’ai rien à opposer à cette argumentation. Se défendre dans une place fortifiée et inaccessible, bien que ce soit un moyen de se soustraire à la loi de la force, qui est celle de la guerre, est légitime. Mais attaquer une place par la soif et la famine, bien que ces moyens ne soient pas de vive force, est légitime aussi, puisque cette attaque a pour but de forcer l’ennemi au combat. Double exception, qui au fond rentre dans la règle. Je ne reviendrai pas sur les raisons données. Je m’empare de ces raisons au contraire, et je dis à mes interlocuteurs:
Donc, gens de guerre, vous regardez la guerre comme l’exercice du droit de la force, droit positif, auquel, sauf certaines exceptions prévues, il n’est pas permis, dans une guerre régulière, de se soustraire. C’est pour cela que les places assiégées n’attendent pas d’ordinaire l’assaut avant de se soumettre: elles savent que, pendant tout le temps qui a précédé l’assaut, leurs forces se sont dépensées tandis que l’ardeur de l’ennemi s’est accrue; qu’une défense plus longtemps prolongée ne serait pas plus honorable, et que l’ennemi pourrait s’irriter d’une défense trop opiniâtre, et s’en venger comme d’un crime. C’est pour cela aussi que dans les capitulations il est dit souvent que, si dans un délai déterminé il ne se présente pas d’armée pour combattre, la ville sera remise à l’assiégeant. Tout cela implique évidemment un droit positif de la force, base du droit de la guerre, dont les militaires ont le sentiment profond, mais dont ils ne savent pas déduire les formules, parce qu’ils ne sont pas juristes, et que les juristes à leur tour expliquent on ne peut plus mal, parce qu’ils ne sont pas militaires.
Tout cela marche on ne peut mieux. Mais alors il faut suivre la loi dans toutes ses déductions: s’en tenir, sauf les exceptions et modifications prévues, aux moyens de force, lesquels excluent la perfidie, le sac, le massacre, le pillage; ne rien faire en dehors du but légitime de la guerre, lequel se réduit généralement à une question de suprématie, d’incorporation ou d’affranchissement; s’abstenir, enfin, hors du champ de bataille, de toute atteinte aux personnes et aux propriétés, sauf la répression des crimes commis et les indemnités à exiger. Or, est-ce ainsi que les choses sa passent à la guerre? Non, la guerre est, ou peu s’en faut, aussi brutale chez les civilisés que chez les barbares. On dirait que les conditions qu’impose le droit de la force répugnent aux soldats; que s’il y fallait tant de façons, tant de vertu, personne ne voudrait du métier.
Les combats finiraient faute de combattants.
De l’égorgement, du pillage, du viol, il semble qu’on ait besoin de tout cela pour satisfaire je ne sais quel instinct de destruction, entretenir la main au soldat, l’animer, lui relever le moral. Dans toute bataille, comme dans toute ville prise d’assaut, une part plus ou moins large est faite au carnage, en dehors de l’utilité comme du péril. On dirait que, sans colère et sans haine, le civilisé serait incapable de se battre. A la bataille de Ligny, les soldats français, emportés par la. haine, excités par les paroles du général Roguet, ne faisaient pas de prisonniers. Le surlendemain, à Mont-Saint-Jean, les Prussiens prenaient leur revanche; il ne tint pas à Blücher que Napoléon n’expiât de sa personne ces infractions au droit de la guerre. Mais passons sur ces tueries, que les relations dissimulent le plus qu’elles peuvent. Aussi bien, est-ce qu’on a le temps, sur le champ de bataille, de faire des prisonniers? Est-ce qu’on le peut? Ne faudrait-il pas les garder? Tue! tue! les morts ne reviendront pas... Parlons de choses moins atroces.
Le viol n’est plus aussi fréquent, à ce qu’on assure, dans les armées qu’il l’était autrefois. C’est un progrès dont nos modernes guerriers aiment à se glorifier, et dont je les félicite de bon cœur, si le compliment les touche. Mais point d’escobarderie. Il y a viol et viol. La galanterie soldatesque a de nos jours des façons beaucoup moins inhospitalières que jadis. Dans son Histoire de la Révolution, M. Thiers, parlant des belles Italiennes, dont les heureux soldats de Bonaparte recueillaient les faveurs, exclut, naturellement l’idée de viol: la chose en valait-elle mieux? C’est ce dont les historiens étrangers, italiens et autres, ne sont pas avec nous d’accord.
Quoi qu’il en soit de la réserve de MM. les militaires, reste la question de droit: à cet égard, il ne faut pas qu’on se fasse d’illusion. D’après les notions reçues, le viol est licite, en principe, de par la loi de la guerre: de même que le pillage, il rentre dans la prérogative de la victoire. Grotius ne trouve à combattre le viol qu’au moyen du précepte de morale chrétienne qui interdit au chrétien la fornication. Mais dans les mœurs antiques, où la fornication n’était pas même réputée péché véniel, le viol à la guerre était de plein droit; pour mieux dire, il n’existait pas. De même que celui qui achète une esclave pour en faire sa concubine ne peut être accusé de viol, attendu que, suivant le langage de la Bible, la femme achetée, payée, est devenue sa propriété, pecunia ejus est; de même le soldat qui, en pays ennemi, saisit une femme, ne peut être accusé de crime, à moins que sa consigne ne le lui ait, pour des motifs particuliers, défendu, et cela, parce que la femme ennemie est la conquête du soldat. Le mot a passé, chez nous, dans le style de la galanterie.
Après la défaite des Teutons, les femmes de ces barbares ayant demandé au consul Marius la vie et la pudeur sauves, Marius, en vertu du droit de la guerre, refusa de souscrire à la seconde de ces conditions. Il ne pouvait, général et magistrat, priver ses soldats d’un droit qu’ils avaient conquis au risque de leur vie. Pourquoi la continence, de Scipion le Jeune fut-elle tant admirée des Romains? C’est que la victoire lui donnait le droit de posséder la jeune princesse qu’il rendit à son fiancé, et qu’en faisant à la politique, au respect de la dignité humaine, le sacrifice de sa propre volupté, il faisait un acte de vertu véritablement hors ligne. On sait le conseil donné à Absalon, révolté contre David, par Achitophel, de violer aux yeux du peuple les femmes de son père. La victoire lui en donnait le droit, la politique lui en faisait un devoir. Dans les idées des anciens, la possession de la femme du prince, en mettant le sceau à sa honte, consacrait la transmission de la couronne. Le meurtrier de Candaule, roi de Lydie, devient son successeur en épousant sa femme. Quelque chose de semblable avait lieu de nation à nation: Moïse, en ordonnant d’exterminer tous les mâles des nations condamnées, réservait les filles. On sait que le peuple romain naquit d’un rapt. Chose singulière! de tous les faits de guerre le plus révoltant par sa nature, et que l’honneur et l’honnêteté pardonnent le moins au soldat, est peut-être celui qui, eu égard à l’état de son âme, mérite le plus d’indulgence. Il y a là un instinct tout à la fois de fusion et de suprématie qui rappelle clairement le but de la guerre et le droit de la force.
Actuellement le viol semble sortir de plus en plus des habitudes du soldat. Mais ce n’est qu’une apparence, qui résulte plutôt de notre manière de faire la guerre que d’une véritable modification des mœurs militaires. Si l’opinion, plus respectueuse de nos jours envers le sexe que dans les temps antiques, semble avoir-devancé sur ce point la théorie, le droit de la guerre, tel qu’il a été de tout temps pratiqué et qu’on l’enseigne encore, ne s’y oppose pas d’une manière formelle. Et le fait est que soldats et officiers, à l’occasion, ne se contraignent guère. Est-il donc nécessaire que la femme ait le pistolet sur la gorge pour qu’il y ait viol? Il y a mille manières d’en venir à bout. Ceci entendu, je ne crois pas faire peine aux militaires mes compatriotes en disant que jamais armées ne firent preuve de plus d’incontinence que les armées françaises. Au droit que le soldat s’est attribué de tout temps sur la femme de l’ennemi, le Français joint des façons engageantes qui achèvent d’étourdir la malheureuse, diminuent pour elle l’horreur de l’outrage, et pour lui l’ennoblissent.
Le droit de violer n’est, du reste, qu’une conséquence de celui qu’on s’arrogeait de rendre les vaincus tributaires ou esclaves. Bossuet trouve la chose juste en principe, et il le déclare sans embarras,-d’accord en cela avec la Bible et toute l’antiquité. «En
«principe, dit-il, la personne du vaincu devient la
«propriété du vainqueur qui obtient sur elle droit
«de vie et de mort.» Le christianisme, il est vrai, nous a rendus moins sanguinaires; il a de plus aboli l’esclavage. Mais qu’on ne s’abuse pas: le principe invoqué par Bossuet subsiste toujours. Toujours le vainqueur peut s’y référer, et s’il y déroge, s’il s’abstient de verser le sang ou de réduire le vaincu en servitude, ce n’est qu’à la faveur d’une sorte de fiction de morale chrétienne, qui engage sa dévotion ou son amour-propre.
Il en est du prisonnier comme de la prisonnière. En principe, je parle d’après Bossuet, le prisonnier, s’il n’est mis à mort, est voué au service du vainqueur, la prisonnière à ses plaisirs. Ce n’est que par des considérations d’un autre ordre qu’ils y échappent. De même que nous avons vu le droit moderne de la guerre arriver, par la fiction d’un péché d’incontinence, à la réprobation du viol; c’est par la fiction d’une fraternité religieuse attachée au baptême que l’esclavage est aboli, et par une autre fiction encore, celle de la courtoisie chevaleresque, que l’on s’abstient généralement de massacrer les prisonniers. Sauf ces adoucissements, on agit comme du passé. Si l’on ne réduit pas les prisonniers en esclavage, on les met à rançon, ce qui est exactement la même chose, ou bien on les emploie aux travaux publics. Le cas échéant on en fait un échange; au besoin, pour peu que la sécurité le commande, on les massacre. La philanthropie gémit ensuite de ces extrémités, mais elle n’ose les flétrir. Que répondre à des gens qui ont pour eux les principes, et qui invoquent le salut public?
Il faut en finir, par une réfutation en règle, avec ces monstruosités qui ont coûté la vie à des centaines de millions d’hommes.
Le droit de vie et de mort, attribué au vainqueur .sur la personne du vaincu, me semble provenir théoriquement de deux sources, abstraction faite de la barbarie primitive qui y a aussi sa part. La première de ces sources est que la guerre, amenée fatalement par la rivalité de deux États et la nécessité d’une incorporation, implique la mort morale de l’un de ces États. En raison même de l’attachement du citoyen à sa patrie, attachement qui lui faisait préférer la mort à la déchéance de son pays, on a étendu à l’homme l’arrêt de mort prononcé par la guerre contre l’État. Je n’ai pas besoin de montrer le vice de ce raisonnement; je l’ai réfuté d’avance, parla distinction que j’ai faite du droit public et du droit des gens.
L’autre source est que la guerre est la revendication du droit de la force, droit reconnu par toute l’antiquité ; qu’une nation vaincue pouvait, en conséquence, être accusée d’avoir combattu contre le droit, ce qui, dans la rigueur, est un crime de mort. Ici, le faux du raisonnement provient de ce que la guerre étant nécessaire, non-seulement pour revendiquer, mais pour démontrer de quel côté est le droit de la force, on ne peut pas arguer de la défaite que le vaincu était coupable.
Voilà par quelle confusion s’est introduit ce prétendu droit de vie et de mort, dont tant de savants hommes parlent à tort et à travers, et que les gens de guerre pratiquent encore, bien qu’ils ne s’en vantent point; et voilà par quels torrents de sang l’humanité paye l’oubli de ses principes les plus essentiels. Rétablissez le vrai sens du droit de la guerre, et, en supposant la continuation des hostilités, le carnage diminue partout des trois quarts. Vous pouvez vous en rapporter sur ce point à la conscience des militaires.
J’ai parlé plus haut de la maraude: le pillage n’est pas la même chose. La première a pour objet la subsistance du soldat; on l’exerce en vertu du principe que la guerre doit nourrir la guerre. Le second est bien autrement ignoble et immoral; il a pour but l’enrichissement du soldat. Ce n’est plus dans ce cas la nécessité qui parle, c’est la cupidité. Ici, l’on peut dire que la science du juriste et l’honneur militaire ont subi une éclipse complète.
S’il est permis, disent nos casuistes, de frapper l’ennemi, même désarmé et dans son sommeil, et de lui ôter la vie, à plus forte raison le sera-t-il de lui prendre son bien. A cet égard, les auteurs même les plus récents n’éprouvent pas le moindre scrupule. Ils se sentent à l’aise. Neque est contra naturam spoliare cum, si possis, quem honestum est necare, dit Cicéron, après Aristote, Platon, et toute la sagesse antique. Grotius, Vattel, et la masse des juristes, opinent à leur tour du bonnet et de la voix, des mains et des pieds, en faveur du droit de butiner. Il n’y a pas même d’exception pour les choses sacrées, rien de ce qui appartient à l’ennemi ne pouvant être sacré pour le vainqueur, ajoute le Digeste: Quum loca capta sunt ab hostibus, omnia desinunt vel religiosa vel sacra esse.
Ce qui donne envie de rire est de voir le pieux et honnête Grotius faire une petite réserve pour le cas où vainqueurs et vaincus professeraient le même culte. Alors, dit-il, il y a conscience. Toutefois, comme ces objets font partie du domaine public, et que rien n’est plus aisé que de les déconsacrer, il est permis, avec tout le respect dû aux choses saintes, de les prendre. L’Église suit la condition des paroissiens! N’est-ce pas joli? En Italie et en Espagne, certains de nos généraux n’attendaient pas la déconsécration; il est vrai que par la révolution ils étaient devenus mé créants. Que dire de plus? Il est permis, en vue du pillage, de violer jusqu’aux tombeaux. Pourvu qu’on ne s’écarte pas du respect dû aux cadavres, observe le grave auteur du traité De Jure belli ac pacis, une pareille violation n’a rien que de licite, les tombeaux après tout étant la propriété des vivants, non celle des morts.
Je reviendrai, au livre suivant, sur la question des dépouilles, considérées, non plus comme conséquence, mais comme cause et objet de la guerre. Pour le moment, je me contente d’une simple remarque. Un honnête homme est attaqué au coin d’un bois par un malfaiteur et le tue. Que fera-t-il après? Il préviendra la justice, afin qu’on relève le cadavre et qu’on informe. Il se gardera de le dépouiller; il croirait, avec raison, se déshonorer. Je ne parle pas du duel, où la plus extrême décence est imposée au vainqueur à l’égard du mort. Or, il s’agit ici, non de la destruction d’une bande de brigands, avec lesquels on ne garde pas de mesure; non pas même d’une satisfaction d’honneur, sans aucune conséquence intéressée; mais d’un débat pour la souveraineté politique à vider entre deux nations par les voies de la force. Et le résultat d’un tel débat, la conclusion adjugée à la victoire, serait le pillage!...
Plus on agite cette matière, à peine effleurée, de la guerre, plus on est étonné de l’énormité des sophismes, des contradictions et des couardises de raisonnement qui y pullulent. Il est permis, ce nous dit-on, de surprendre l’ennemi, de se glisser dans un poste, dans un fort, et de massacrer la garnison sans lui laisser le temps de se mettre en garde; d’aller, en rampant, jusque dans sa tente, frapper le général ennemi. A ce propos, Grotius cite les exemples de Mucius Scévola, d’Aod et d’une foule d’autres. D’après ce principe, le jeune homme qui à Schœnbrünn tenta d’assassiner Napoléon était dans le droit, tandis que Napoléon, qui le fit passer devant un conseil de guerre et fusiller, violait le droit. Donc, faudrait-il conclure, il sera permis de mettre à prix la tête de celui qu’on regarde comme l’auteur ou le conducteur de la guerre, comme fit le roi d’Espagne Philippe II à l’égard de Guillaume le Taciturne, et de le faire assassiner? Ici Grotius recule: «Non, dit-il, l’intérêt commun «des princes ne le veut pas.» La belle raison! Et l’intérêt commun des peuples?
Disons plutôt, en revenant aux vrais principes, que la guerre étant le jugement de la force, tout assassinat, surtout à l’égard des généraux, est une félonie. C’est pourquoi nous réprouvons les entreprises des Aod, des Balthazar Gérard, des Poltrot de Méré, des Ornano, de tous ceux qui à la guerre font usage de la trahison et de l’assassinat. Napoléon, quels que fussent ses torts vis-à-vis de l’Allemagne, hors du champ de bataille devenait inviolable. Dans le gâchis européen, surtout dans l’incertitude des principes et attendu la réciprocité des torts, la guerre qu’il faisait, même avec ses vices de forme, était censée toujours le jugement de la force.
Une question fort agitée est celle de savoir si, pour mettre fin à la guerre et épargner le sang, on pourrait convenir de s’en rapporter au résultat d’un combat singulier, ou d’un combat entre un certain nombre d’hommes choisis de part et d’autre, par exemple de trois contre trois, de trente contre trente, de cent contre cent.. Grotius se prononce pour la négative: a Il faut, dit-il, y aller de toutes ses forces.» Je suis de l’avis de Grotius; mais je ne puis admettre ses raisons. De semblables combats, où quelques-uns se dévouent pour tous, où le succès est pris pour une démonstration dé la bonne cause et une marque de la protection divine, offensent, selon lui, la charité et la religion. Il semble, au contraire, qu’un pareil dévouement serait le sublime de la charité ; quant à la religion, elle n’y est pas plus intéressée qu’au tirage au sort des conscrits.
Pour moi, prenant toujours pour point de départ et base de mes raisonnements la définition de la guerre, savoir qu’elle est, qu’elle veut et doit être la revendication du droit du plus fort, et conséquemment la démonstration en fait de la force, je réponds: Oui, il faut que les parties militantes agissent de tous leurs moyens, qu’elles déploient toutes leurs forces, précisément parce que la victoire est due au plus fort, ce qui pourrait n’avoir pas lieu, si la bataille était limitée à deux fractions égales de puissances en conflit. Il est évident, en effet, qu’une pareille manière de guerroyer serait tout à l’avantage de la puissance la plus faible, les champions étant supposés de part et d’autre d’une valeur individuelle égale.
Terminons ce chapitre. A mesure que nous avançons dans cette critique, une chose doit apparaître de plus en plus à l’esprit du lecteur, résultant des contradictions mêmes qui obscurcissent toute cette matière:
C’est que le droit de la guerre est un droit positif, la raison de la force une raison positive, applicables à un certain ordre de faits et d’idées avec la même certitude que le droit du travail est applicable aux choses de la production et de l’échange, le droit du talent aux choses de l’art, le droit d’amour aux choses du mariage, etc.; — c’est que le droit de la guerre, cette raison de la force, si profondément méconnue par les juristes, la multitude la sent, les armées l’affirment, la civilisation en relève, le progrès en réclame la codification; — c’est que, s’il est incontestable qu’il y ait eu depuis trois mille ans une amélioration dans les us et coutumes de la guerre, on ne peut nier que le droit même de la force se soit obscurci, en raison du développement des droits dont il ouvre la série; — c’est enfin que le meilleur moyen de parer aux calamités de la guerre, en supposant sa continuation, consiste précisément dans la reconnaissance du droit de la force.