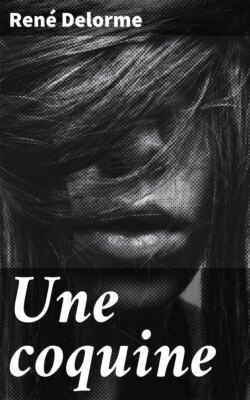Читать книгу Une coquine - René Delorme - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
ОглавлениеTable des matières
Il y a des natures qui sont faites pour être toujours annihilées, comme il y en a d’autres qui sont organisées pour dominer toujours. Si Mme de Lanchaire appartenait à la seconde espèce, son frère, M. Grimod, était l’un des plus curieux spécimens de la première.
Ces contrastes ne sont pas rares dans les familles. Deux enfants du même père et de la même mère naissent avec des caractères, des passions, des sentiments absolument contraires. L’un est avare et l’autre prodigue. L’un a le cœur sec, l’autre est aimant. L’un est vaniteux, l’autre modeste. Pourquoi ces dissemblances? De quel fait d’atavisme découlent-elles? A quel moment du passé, auquel des aïeux faut-il attribuer ces influences disparates?
Explicable ou non, le fait existe, et Mme de Lanchaire et son frère en fournissaient un exemple frappant. De même qu’il avait accepté paisiblement de porter le nom de Barbentry–et c’était lourd,–quand sa sœur l’en avait affublé; de même M. Grimod acceptait tout ce que voulaient bien lui imposer non-seulement sa sœur, mais les premiers venus. N’importe quelle personne parlant avec autorité le pouvait asservir à sa volonté. C’était un faible, désarmé pour les luttes de la vie, incapable de résister à une obsession, livré, par conséquent, au hasard des courants, bon ou mauvais suivant la rencontre, honnête, si l’on peut mériter ce titre quand on n’a pas d’énergie. Jamais cœur de cire ne fut mieux fait pour être pétri par toutes les mains.
Très doux, il avait cependant quelquefois–comment expliquer ce phénomène?–des réveils de colère. Ces éclairs de virilité étaient rares d’ailleurs. Ils se manifestaient par des rages accentuées, qui n’éclataient jamais qu’en dedans et qui ne faisaient de mal qu’à lui-même. Il était incapable d’avoir de ces bonnes colères rouges qui débordent, qui font vacarme, qui brisent les meubles et qui, dix minutes après, ne laissent plus de trace. Chez lui, la colère était blanche. Il pâlissait. Il devenait tout à fait muet, il serrait les dents. Cela durait des heures, et il se trouvait, après chacun de ces accès, brisé, anéanti, bilieux. Pendant la semaine qui suivait la crise, il ressemblait à un convalescent qui vient d’avoir la jaunisse.
Dans le monde bien élevé, on a pitié de ces natures sans défense; on se ferait un scrupule d’en abuser et de les malmener. Il y aurait, en quelque sorte, de la lâcheté à tyranniser ces faibles; on les protège plutôt. Ces malheureux n’échappent point pour cela à leur destinée. Ils deviennent les souffre-douleurs des inférieurs, des gens de service, qui se rattrapent sur eux des griefs qu’ils croient généralement avoir contre les maîtres. Il n’est point de taquineries, de petites méchancetés mesquines qui ne soient exercées contre eux. C’est l’une de ces victimes qui a dû formuler le proverbe: «On n’est jamais si bien servi que par soi-même.» En effet, ils ignorent les soins dont sont entourées les autres personnes et les plus grincheuses surtout, les prévenances des serviteurs qui craignent d’être grondés, la douceur de voir la maison en ordre, les habits brossés à l’heure dite. Quelques-uns d’entre eux, dans les mains de valets de génie, sont arrivés à devenir les domestiques de leurs domestiques.
Notez que les «gens de maison», puisque c’est ainsi qu’on a traduit le vieux terme latin, ont un flair admirable pour reconnaître leurs victimes à première vue. Entre mille, ils trouvent leur proie d’instinct.
M. Grimod ne pouvait leur échapper. Dans le petit hôtel de la rue du Paradis-Poissonnière où il était descendu, il avait de suite été toisé par le garçon. C’était le type du monsieur «qui ne dit rien». On ne lui cire pas ses bottes, il ne dit rien; on ne fait pas son lit, il ne dit rien; on ne renouvelle pas l’eau de sa toilette, il ne dit rien. On le sert toujours le dernier, on ne lui apporte que les restes de la cuisine, on ne met pas de bougie dans ses chandeliers, on ne lui donne pas ses lettres, on augmente les prix en sa faveur, il ne dit rien, jamais rien, et il ne lui vient pas à l’idée de changer d’hôtel, parce que la fatalité le suivrait ailleurs, parce que tous les garçons de service sont les mêmes et que tous agiraient de la même façon avec lui.
Le surlendemain du jour où s’était passée la scène que nous avons contée précédemment, M. Grimod se réveilla à huit heures précises dans sa petite chambre garnie,–la plus petite et la moins garnie de la maison. Elle lui revenait de droit.
Il devait être sous le coup d’une préoccupation qui l’avait agité pendant la soirée précédente et qui l’avait poursuivi pendant son sommeil, car il se laissa aller à dire tout haut:
–J’ai peut-être eu tort.
Quel tort pouvait bien avoir à se reprocher ce pauvre inoffensif? Un tort envers les autres? Non. Un tort envers lui-même? Peut-être.
Quoi qu’il en soit, il n’était pas tranquille; il se leva plus vite que d’habitude; il fit rapidement son ménage –il fallait bien qu’il le fit, sous peine de tomber sous l’application du proverbe: «Comme on fait son lit, on se couche.» Puis il s’habilla, choisissant dans sa garde-robe ce qu’il avait de mieux. Toujours pressé, il prit son chapeau et son parapluie, et descendit dans la salle à manger de l’hôtel.
–Je désirerais prendre mon café au lait tout de suite; j’ai une affaire urgente qui m’appelle au dehors.
–Les fourneaux ne sont pas allumés, répondit du fond de la cuisine une grosse voix normande, empâtée dans son accent.
–Cependant.
–Il faudrait peut-être les allumer à huit heures du matin! (neuf heures sonnaient au même moment) c’est cela! On changera toutes les habitudes pour monsieur. C’est une maison rangée, ici; on a des heures. Ceux qui ne s’y conforment point n’ont qu’à s’en prendre à eux-mêmes.
M. Grimod n’entendit pas la suite de cette réprimande. Détestant par dessus tout les disputes, il avait pris la fuite aux premiers mots. Déjà il trottinait par les rues pleines de monde, dans ce quartier commerçant, bousculé, heurté à chaque instant, et demandant doucement pardon à ceux qui lui marchaient sur les pieds ou qui le renfonçaient. Entre temps il se replongeait dans la pensée qui l’absorbait, la même qu’il avait eue à son réveil.
A force de marcher, M. Grimod se trouva enfin dans le quartier de l’Europe, et, peu après, dans la rue de Naples.
Arrivé à quelque distance du no 84, il s’arrêta comme frappé de stupeur. Un fourgon des pompes funèbres était arrêté devant la porte et des ouvriers achevaient d’attacher au mur les draps frangés d’argent des chapelles ardentes. M. Grimod sentit ses jambes flageoller sous lui.
Il savait que la maison n’avait que deux habitants: sa sœur et M. Raimbert.
Lequel avait été frappé?
Il se remit cependant, et pénétrant brusquement, pour la première fois de sa vie, chez le concierge:
–M. Raimbert? demanda-t-il d’une voix effarée.
La concierge, habillée de laine noire, lui répondit en lui montrant les apprêts funèbres:
–C’est pour lui.
M. Grimod défaillit cette fois pour tout de bon. Il pâlit affreusement et fut forcé de s’adosser à un meuble pour ne pas tomber.
–J’en avais le pressentiment, murmura-t-il. Et quand le malheur est-il arrivé?
–Avant-hier soir.
–Avant-hier! répéta-t-il machinalement, comme un homme qui commence à n’avoir plus conscience de ses paroles.
Cependant, le voyant si pâle, si défait, la concierge s’empressa auprès de lui.
–Prenez la peine de vous asseoir, monsieur. Remettez-vous; c’est le saisissement. Ça se comprend. Un homme si bon, si aimé!Je vais vous faire un peu d’eau sucrée… Et généreux! Sa nièce a passé toute la nuit dernière à prier près de lui, et toute la journée… Buvez, cela vous remettra.
–Merci, merci, fit M. Grimod; pardonnez-moi, je… je monte bien vite chez ma sœur.
Il se leva, en effet, et se dirigea vers l’escalier. Il avait hâte d’arriver; mais, comme il mettait le pied sur la première marche pour monter, quatre hommes vigoureux s’apprêtaient à descendre le corps de M. Raimbert pour le poser sur le catafalque de la porte cochère.
M. Grimod se rangea pour le laisser passer.
C’est toujours un spectacle pénible que le passage d’un cercueil. Les plus indifférents ne peuvent y assister sans se sentir émus ou attristés. Cette boite de chêne, lourdement promenée par les grossiers portefaix de la mort, a quelque chose d’horriblement triste, qui vous serre le cœur et qui vous indigne en même temps. Est-ce donc là le dernier acte de la vie? L’homme est-il donc si peu de chose qu’il puisse tenir là-dedans, si grand qu’il ait été, si brillante qu’ait été sa carrière, si grandioses qu’aient été ses actes, ses pensées et ses rêves? Le berceau, le cercueil! Voilà donc nos deux termes, notre point de départ et notre point d’arrivée.
En même temps, une idée plus haute s’empare de nous. L’esprit s’élève au-dessus du détail banal de la boîte plus ou moins bien rabotée. A travers les planches du cercueil il devine la silhouette raidie de celui qui n’est plus sur la terre, de celui dont l’âme plane dans des régions meilleures.
Des horizons plus vastes s’ouvrent, et la pensée s’y perd dans l’admiration d’un avenir mystérieux et rayonnant. Un respect pieux s’empare alors des vivants, qui ne savent point encore, devant les restes mortels de celui qui doit déjà tout savoir. Les fronts se découvrent, et l’hommage du salut accueille le défilé funèbre.
M. Grimod se découvrit, lui aussi, mais ce fut presque machinalement, parce que c’est l’usage à Paris, parce que le bras a pris cette habitude, parce que, dans cette ville de folie et de gaieté, il y a un énergique sentiment des contrastes qui fait que la mort est respectée plus que partout ailleurs.
M. Grimod ôta son chapeau, mais il darda sur le cercueil un regard étrange, plein de rancune et de fiel, un regard presque haineux.
Le triste défilé dura quelques minutes.
Enfin l’escalier fut libre, et M. Grimod se hâta de l’escalader.
De quelle main fébrile il sonna à la porte de Mme de Lanchaire!
Dès qu’on eut ouvert:
–Ma sœur?
–Elle repose.
–Il faut que je lui parle.
–Je vous dis qu’elle dort.
–Ça ne fait rien.
Et, laissant Fanny stupéfaite d’une audace à laquelle il ne l’avait pas habituée, il se précipita dans la chambre de la veuve.
–Qu’y a-t-il? fit-elle en se réveillant en sursaut.
–Il y a… il y a que je suis ruiné! lui cria-t-il d’un air égaré, en levant au ciel ses deux mains, dont l’une agitait son parapluie et l’autre son chapeau, je suis ruiné, entends-tu? ruiné!
Et, tombant sur un fauteuil, il se mit à fondre en larmes.
A ce mot, Mme de Lanchaire se releva à moitié par un mouvement brusque.
Cette fois son intérêt était en jeu.
Allait-elle avoir son frère à sa charge? Très inquiète, elle lui dit:
–Explique-toi… parle; mais parle donc!
–Je suis perdu. Toutes mes économies, ma vie assurée, la paix, j’ai tout perdu, tout!
–Voilà assez de jérémiades. Je demande des explications et non des plaintes.
–J’avais cent mille francs…
–En Rente française, je le sais.
–Oui… mais, comme la rente avait atteint un cours très-élevé, on m’avait conseillé de vendre et d’acheter des obligations de chemin de fer à l’émission. J’ai donc fait vendre.
–Sans me consulter! Du moment que tu agis seul, on doit s’attendre, en effet, à de belles choses.
–J’ai eu tort; mais, que veux-tu? il est trop tard pour revenir sur ce qui est fait. Avant-hier, j’ai été toucher le montant de mes titres: cent huit mille francs, chez l’agent de change. Huit mille francs de bénéfice. C’était joli.
–Eh bien après? Tu me fais mourir avec tes lenteurs.
–On m’avait payé cette somme en billets de banque; cent huit beaux billets. Cela faisait un petit paquet que je portais avec orgueil. Je m’en allais tout fier à la Compagnie d’Orléans lorsque j’ai rencontré au bas de la rue de Londres.
–Qui?
–M. Raimbert. Il ne m’avait pas vu depuis six mois. Il était dans sa voiture; il l’a fait arrêter, puis il m’a demandé comment j’allais et ce que je devenais. Je lui ai dit que, grâce à lui, je vivais de mes rentes, que j’avais réalisé tous mes désirs, que j’avais mes cent mille francs et que précisément je me rendais à deux pas de là pour les placer. «Êtes-vous bien pressé de déposer votre argent? m’a-t-il dit, et seriez-vous fâché, en retardant votre placement de huit jours, de gagner un billet de mille francs?» Mille francs de bénéfice et huit mille francs que je venais de réaliser, cela me faisait un bien beau compte. La fortune semblait décidément me sourire. Naturellement, j’ai répondu que je serais enchanté de la combinaison, d’autant plus que, conseillé par lui, j’étais bien sûr de ne pas aventurer mon capital.–«Je crois, a-t-il ajouté en souriant, que vous pouvez avoir confiance; car c’est moi-même qui serai votre débiteur. Vous m’obligerez. J’ai acheté une nouvelle mine, et je la paye à raison de100,000francs par mois. L’échéance du sixième payement est arrivée et les fonds que j’attendais sont en retard.» J’étais très-fier et très-heureux d’obliger un millionnaire. Je lui ai remis l’argent séance tenante.
–Sans reçu?
–Sans reçu. Comment aurait-il pu me faire un reçu, puisque cela se passait en pleine rue?
–Tu n’as pas songé à lui en demander un?
–Je n’aurais pas osé. Demander un reçu à M. Raimbert! Cela l’eût peut-être froissé. N’est-ce pas à lui que je dois tout, que nous devons tout, car enfin, sans lui, ma chère Léonie, que serions-nous maintenant? Des pauvres diables, crevant de faim, des gens de peu, des gens de rien. Sans lui je serais encore le petit cafetier de la place d’Armes à Thionville, faisant toute la besogne, balayant la maison, servant les bocks et rinçant les verres. Et toi, qui es si belle et si brave aujourd’hui, tu serais encore derrière le petit comptoir.
–Il s’agit bien de cela. De quoi vas-tu parler maintenant? Tu sais bien que je t’ai défendu, sous aucun prétexte, de rappeler ces souvenirs.
–C’est vrai; mais ce sont ces souvenirs qui m’ont fait agir comme je l’ai fait. Sans M. Raimbert, aurai-je jamais pu amasser tant d’argent? Cent mille francs! songe donc! Pouvais-je refuser de l’obliger à mon tour quand il me le demandait?
–Enfin, qu’est-ce qu’il a dit quand il a pris ton argent?
–Il m’a dit: «Venez demain; je vous donnerai un reçu… ou plutôt je passerai aujourd’hui chez mon banquier et je ferai inscrire cette somme à votre compte. Vous serez encore un peu mon associé.» Tu penses si j’ai accepté avec joie cette combinaison. Car enfin c’est en plaçant ainsi en mon nom les cinq mille francs produits parla vente du café… pardon!… qu’il a constitué mon capital de cent mille francs.
–T’a-t-il dit chez quel banquier il comptait aller? Il en a plusieurs.
–Il me l’a nommé: mais j’ai oublié le nom.
–Cherche-le.
–Attends. Je crois que cela finissait en and… non! je me rappelle. C’est un nom en oy.
–Albert Colroy?
–Oui, c’est celac… Albert Colroy! c’est bien cela!
–Et tu te désoles! et tu pleures comme une femme!
Attends donc au moins pour te lamenter d’avoir la certitude de ta ruine. Rien n’est encore perdu peut-être.
–Tu crois vraiment que…?
Le pauvre homme se transfigurait en disant ces mots. Il renaissait à l’espoir.
–Si M. Raimbert a fait ce qu’il a dit.
–Il l’aura fait. Un si honnête homme!
–Alors il doit y avoir une trace de l’argent que tu lui as prêté sur les livres du banquier. Cet argent aura été inscrit à ton nom. Il n’est point perdu.
–M. Raimbert avait trop d’ordre, c’était un homme trop consciencieux pour négliger une affaire comme celle-là.
–Il faut s’assurer au plus vite de la vérité. Cours chez M. Colroy et informe-toi adroitement…
–Adroitement?
–Tu ne comprends donc rien. Tu n’as aucun titre en mains pour faire ta réclamation, M. Colroy a la réputation d’être un honnête homme; il l’est, je veux le croire; mais enfin il pourrait très bien ne pas l’être, et nier une créance qui ne serait pas suffisamment établie. Il faut toujours se méfier quand il s’agit d’une question d’intérêts.
–Tu as raison, tu as toujours raison. Ma chère Léonie, je n’agirai plus jamais sans te consulter.
–Tu feras bien.
–Donne-moi des indications sur la conduite que je dois tenir.
–Avant cela, mets-moi plus au courant. M’as-tu bien rapporté toute ta conversation? M. Raimbert ne t’a-t-il pas dit autre chose?
–Si; en me quittant, il a ajouté: «Venez toujours me voir.»
–Et tu n’es pas venu hier?
–Je ne voulais pas avoir l’air trop pressé. Je craignais…
–Tu craignais!… Tu ne seras jamais pratique… Tu es bien fait pour être dupe toute ta vie.
–Mais puisqu’il était mort avant-hier soir, je serais venu hier matin que…
–Tu serais venu hier matin que tu aurais pu aller trouver M. Colroy avant qu’il fût prévenu de la mort de son client. Tu as perdu toute une journée pour des motifs de sensibilité ridicule, de délicatesse absurde. Hier matin, le plus malhonnête des banquiers n’aurait pas eu l’idée de te tromper, puisqu’il devait croire que M. Raimbert vivait encore. Aujourd’hui, le plus honnête pourra émettre des doutes sur la légitimité de tes réclamations, chicaner, distinguer, te tourmenter enfin. Que fera-t-il si l’honnêteté n’est pas sa qualité dominante? Voilà la situation où tu t’es jeté par ta faute. Tu as fait une première sottise en prêtant de l’argent sans reçu. On ne sait ni qui vit, ni qui meurt. Tu as fait une seconde sottise en ne te hâtant pas de venir.
–Je vais me dépêcher d’aller trouver M. Colroy.
–Il est temps de te dépêcher.
–Où demeure-t-il?
La veuve hésita un peu avant de répondre; puis:
–Je ne sais pas, dit-elle; entre chez le premier négociant venu et demande à consulter le Bottin.
–Que je te remercie de tous tes bons conseils! Sans toi…
–C’est bon; c’est bon. Tu me remercieras plus tard.
M. Grimod descendit l’escalier, ayant le cœur plus léger qu’il ne l’avait à son arrivée. En passant sous la porte, près du catafalque, il n’adressa plus au mort ce regard qu’il lui avait jeté précédemment, regard soupçonneux et défiant. A sa première rencontre avec le cercueil, il n’avait vu là que la dépouille de l’homme qui l’avait ruiné. Alors il aurait volontiers crié à ce cadavre: «Rends-moi mon bien!» Maintenant, il était plein d’espérance. Le cadavre de M. Raimbert était redevenu la dépouille sacrée d’un honnête homme, les restes mortels d’un bienfaiteur généreux. C’est toujours notre pensée qui colore les choses et les êtres.
M. Grimod se découvrit donc avec le plus grand respect. Il prit même le goupillon, le trempa dans l’eau bénite et aspergea, en faisant un signe de croix, le drap noir semé de larmes blanches.
Quant à la veuve, à peine son frère eut-il quitté sa chambre, qu’elle se leva, passa un peignoir et alla s’arrêter devant la glace.
L’examen de sa personne lui parut satisfaisant. Elle était vraiment en beauté ce jour-là. Ses yeux avaient de l’éclat, son teint de la fraîcheur. Complaisamment, elle se sourit à elle-même; puis répondant à une pensée intime:
–Je suis libre maintenant, pensa-t-elle. Je ne relève ni ne dépends de personne… Je puis agir à ma guise. Je puis faire ce que je veux. Je ne suis plus sous la surveillance d’un vieillard soupçonneux… J’ai encore de beaux jours devant moi… je ne suis ni fanée ni flétrie. Ma réputation est excellente et je sais ce dont je suis capable… Avec tout cela, je dois pouvoir réaliser mon rêve. Ma vie va commencer, une vie nouvelle qui me fera oublier l’ancienne, faite d’obscurité et de servitude.
Toujours souriante, elle alla vers le secrétaire où elle avait caché des papiers lorsque M. Raimbert était venu la surprendre l’autre soir.
Elle s’assit devant le petit meuble, l’ouvrit et en tira la lettre qu’elle avait précédemment écrite, celle-là même qui se terminait par ces deux mots: «où et quand?»
Elle la relut et la trouva bien sans doute, car elle n’y changea rien. Qu’aurait-elle pu dire de plus clair ?
Elle prit donc une enveloppe et, de la même écriture soignée et galante, elle écrivit l’adresse.
Sonnant alors Fanny:
–Cette lettre à la poste… de suite.
Fanny prit la lettre et sortit. A peine arrivée sur l’escalier, elle s’arrêta pour lire la suscription.
Elle était ainsi conçue:
Monsieur
Monsieur Albert Colroy,
102, rue de la Chaussée-d’Antin,
E.V.
–Tiens! tiens! fit Fanny, sur la figure de laquelle se dessina un étrange sourire.