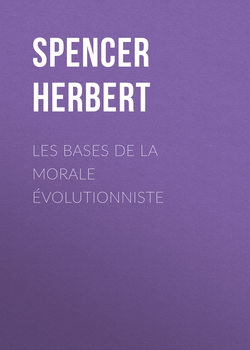Читать книгу Les bases de la morale évolutionniste - Spencer Herbert - Страница 3
CHAPITRE II
L'ÉVOLUTION DE LA CONDUITE
Оглавление3. Nous sommes très familiarisés aujourd'hui avec l'idée d'une évolution de structures à travers les types ascendants de l'animalité. Nous nous sommes aussi familiarisés à un haut degré avec cette pensée qu'une évolution de fonctions s'est produite pari passu en même temps que l'évolution des structures. Faisant un pas de plus, il nous reste à concevoir que l'évolution de la conduite est corrélative à cette évolution de structures et de fonctions.
Il faut distinguer avec précision ces trois cas. Il est clair que les faits établis par la morphologie comparée forment un tout essentiellement indépendant, bien qu'on ne puisse l'étudier en général ou en détail sans tenir compte des faits qui appartiennent à la physiologie comparée. Il n'est pas moins clair que nous pouvons appliquer exclusivement notre attention à cette différenciation progressive de fonctions et à cette combinaison de fonctions, qui accompagnent le développement des structures, – que nous pouvons dire des caractères et des connexions des organes seulement ce qu'il faut pour parler de leurs actions séparées ou combinées. La conduite forme elle-même un sujet distinct du sujet des fonctions, moins que celui-ci ne l'est du sujet des structures, mais assez cependant pour constituer un sujet essentiellement séparé. Ces fonctions en effet, qui se combinent déjà de diverses manières pour former ce que nous regardons comme des actes corporels particuliers, sont recombinées encore d'un nombre indéfini de façons pour former cette coordination d'actes corporels désignée sous le nom de conduite.
Nous avons affaire aux fonctions dans le vrai sens du mot, quand nous les considérons comme des processus qui se développent dans le corps; et, sans dépasser les limites de la physiologie, nous pouvons traiter de leurs combinaisons, tant que nous les regardons comme des éléments du consensus vital. Si nous observons comment les poumons aèrent le sang que le coeur leur envoie, comment le coeur et les poumons ensemble fournissent du sang aéré à l'estomac et le rendent ainsi capable de remplir sa tâche; comment ces organes collaborent avec diverses glandes de sécrétion ou d'excrétion pour achever la digestion et pour éliminer la matière qui a déjà servi; comment enfin tout ce travail a pour effet de maintenir le cerveau en état de diriger ces actes qui contribuent indirectement à la conservation de la vie, nous ne traitons ainsi que des fonctions. Alors même que nous étudions la manière dont les parties qui agissent directement autour du tronc, – les jambes, les bras, les ailes, – font ce qu'elles doivent faire, nous nous occupons encore des fonctions, en tant qu'elles sont physiologiques, aussi longtemps que nous limitons notre examen à leurs processus internes, à leurs combinaisons internes.
Mais nous abordons le sujet de la conduite dès que nous étudions les combinaisons d'actions des organes sensoriels ou moteurs en tant qu'elles se manifestent au dehors. Supposons qu'au lieu d'observer les contractions musculaires par lesquelles convergent les axes optiques et s'adaptent les foyers oculaires (ce qui est du domaine de la physiologie), qu'au lieu d'observer la coopération des nerfs, des muscles, des os, qui permet de porter la main à telle place et de fermer les doigts (c'est encore du domaine de la physiologie), nous observions ce fait qu'une arme est saisie par une main que les yeux ont guidée. Nous passons alors de la pensée d'une combinaison de fonctions internes à la pensée d'une combinaison de mouvements externes. Sans doute, si nous pouvions suivre les processus cérébraux qui accompagnent ces mouvements, nous trouverions une coordination physiologique interne correspondante à cette coordination extérieure d'actions. Mais cette hypothèse s'accorde avec cette affirmation que, lorsque nous ignorons la combinaison interne et faisons attention seulement à la combinaison externe, nous passons d'une partie de la physiologie à une partie de la conduite. On pourrait objecter, il est vrai, que la combinaison externe donnée comme exemple est trop simple pour être légitimement désignée par le nom de conduite; mais il suffit de réfléchir un moment pour voir qu'elle se lie par d'insensibles gradations à ce que nous appelons la conduite. Supposons que cette arme soit prise pour parer un coup, qu'elle serve à faire une blessure, que l'agresseur soit mis en fuite, que l'affaire fasse du bruit, arrive à la police, et qu'il s'ensuive tous ces actes variés qui constituent une poursuite judiciaire. Evidemment l'adaptation initiale d'un acte à une fin, inséparable de tout le reste, doit être comprise avec ce reste sous un même nom général, et nous passons évidemment par degrés de cette simple adaptation initiale, qui n'a pas encore de caractère moral intrinsèque, aux adaptations les plus complexes et à celles qui donnent lieu à des jugements moraux.
Négligeant toute coordination interne, nous avons donc ici pour sujet l'agrégat de toutes les coordinations externes, et cet agrégat embrasse non seulement toutes les coordinations formées par des hommes, les plus simples comme les plus complexes, mais encore toutes celles que produisent tous les êtres inférieurs plus ou moins développés.
4. Nous avons déjà implicitement résolu cette question: en quoi consiste le progrès dans l'évolution de la conduite, et comment pourrons-nous le suivre depuis les types les plus humbles des créatures vivantes jusqu'aux plus élevés? Quelques exemples suffiront pour mettre la réponse dans tout son jour.
Nous avons vu que la conduite se distingue de la totalité des actions en ce qu'elle exclut les actions qui ne tendent pas à une fin: mais dans le cours de l'évolution cette distinction se manifeste par degrés. Chez les créatures les plus humbles, la plupart des mouvements accomplis à chaque instant ne paraissent pas plus dirigés vers un but déterminé que les mouvements désordonnés d'un épileptique. Un infusoire nage au hasard çà et là, sans que sa course soit déterminée par la vue d'aucun objet à poursuivre ou à éviter, et seulement, selon toute apparence, sous l'impulsion de diverses actions du milieu où il est plongé; ses actes, qui ne paraissent à aucun degré adaptés à des fins, le conduisent tantôt au contact de quelque substance nutritive qu'il absorbe, tantôt au contraire dans le voisinage de quelque animal par lequel il est lui-même absorbé et digéré. Privés des sens développés et de la puissance motrice qui appartiennent aux animaux supérieurs, quatre-vingt-dix-neuf pour cent de ces animalcules, qui vivent isolément quelques heures, disparaissent en servant à la nutrition d'autres êtres ou sont détruits par quelque autre cause. Leur conduite se compose d'actions si peu adaptées à des fins que leur vie continue seulement tant que les accidents du milieu leur sont favorables.
Mais si, parmi les créatures aquatiques, nous en observons une d'un type encore peu élevé, supérieure cependant à l'infusoire, un rotifère par exemple, nous voyons en même temps que la taille s'accroît, que la structure se développe et que le pouvoir de combiner des fonctions s'augmente, comment il se fait aussi un progrès dans la conduite. Nous voyons le rotifère agiter circulairement ses cils, et attirer pour s'en nourrir les petits animaux qui se meuvent autour de lui; avec sa queue préhensive, il se fixe à quelque objet approprié; en repliant ses organes extérieurs et en contractant son corps, il se soustrait aux dangers qui peuvent de temps à autre le menacer. En adaptant mieux ses actions à des fins, il se rend ainsi plus indépendant des faits extérieurs et assure sa conservation pour une plus longue période.
Un type supérieur, comme celui des mollusques, permet de marquer encore mieux ce contraste. Lorsque nous comparons un mollusque inférieur, comme l'ascidie flottante, avec un mollusque d'une espèce élevée, comme un céphalopode, nous trouvons encore qu'un plus haut degré de l'évolution organique est accompagné d'une conduite plus développée. A la merci de tout animal marin assez gros pour l'avaler, entraînée par les courants qui peuvent au hasard la retenir en pleine mer ou la laisser à sec sur le rivage, l'ascidie n'adapte que fort peu d'actes à des fins déterminées, en comparaison du céphalopode. Celui-ci, au contraire, tantôt rampe sur le rivage, tantôt explore les crevasses des rochers, tantôt nage dans la mer, tantôt attaque un poisson, tantôt se dérobe lui-même dans un nuage de liqueur noire à la poursuite d'un animal plus gros et se sert de ses tentacules soit pour se fixer au sol, soit pour tenir sa proie plus serrée; il choisit, il combine, il proportionne ses mouvements de minute en minute, aussi bien pour échapper aux dangers qui le menacent que pour tirer parti des hasards heureux; il nous montre enfin toute une variété d'actions qui, en servant à des fins particulières, servent à cette fin générale: assurer la continuité de l'activité.
Chez les animaux vertébrés, nous suivons également ce progrès de la conduite parallèlement au progrès des structures et des fonctions. Un poisson errant çà et là à la recherche de quelque chose à manger, capable de découvrir sa proie par l'odorat ou la vue, mais seulement à une faible distance, et à chaque instant forcé de fuir à l'approche redoutable de quelque poisson plus gros, ce poisson adapte à des fins des actes relativement peu nombreux et très simples; par une conséquence naturelle, la durée de sa vie est fort courte. Il y en a si peu qui survivent à la maturité, que, pour compenser la destruction des petits non encore éclos, du menu fretin et des individus à demi développés, une morue doit frayer un million d'oeufs, et, sur ce grand nombre d'oeufs, deux autres morues peuvent parvenir à l'âge de frayer à leur tour. Au contraire, un mammifère d'un degré élevé dans l'échelle de l'évolution, comme un éléphant, adapte beaucoup mieux à leurs fins même ces actes généraux qui lui sont communs avec ce poisson. Par la vue, aussi bien, probablement, que par l'odorat, il découvre sa nourriture à une distance relativement fort grande; et si, de temps à autre, il lui faut fuir, il le fait avec beaucoup plus de rapidité que le poisson. Mais la principale différence consiste en ce qu'il y a encore ici d'autres groupes d'adaptations. Ainsi certains actes se combinent pour faciliter la nutrition: par exemple, il brise des branches chargées de fruits pour s'en nourrir, il fait un choix de tiges comestibles parmi le grand nombre de celles qui s'offrent à lui; en cas de danger, il peut non seulement fuir, mais encore, s'il le faut, se défendre ou même attaquer le premier, et il se sert alors simultanément de ses défenses, de sa trompe et de ses pieds pesants. En outre, nous voyons des actes secondaires et variés s'adapter à des fins secondaires; ainsi il va chercher la fraîcheur dans une rivière et se sert de sa trompe pour s'arroser, ou bien il emploie une baguette pour chasser les mouches qui s'attachent à son dos, ou encore il sait faire entendre des sortes de cris d'alarme pour avertir le troupeau, et conformer lui-même ses actes à ces cris s'ils sont poussés par d'autres éléphants. Evidemment, l'effet d'une conduite si développée est d'assurer l'équilibre des actions organiques pendant des périodes beaucoup plus longues.
Si nous étudions maintenant la manière d'agir du plus élevé parmi les mammifères, de l'homme, nous ne trouvons pas seulement des adaptations de moyens à fins plus nombreuses et plus exactes que chez les mammifères ordinaires, nous faisons encore la même remarque en comparant les races humaines supérieures aux races humaines inférieures. Prenons une des fins les plus importantes, nous la verrons bien plus complètement atteinte par l'homme civilisé que par le sauvage, et nous y verrons concourir un nombre relativement plus grand d'actes secondaires. S'agit-il de la nutrition? La nourriture est obtenue plus régulièrement par rapport à l'appétit; elle est de meilleure qualité, plus propre, plus variée, mieux préparée. S'agit-il du vêtement? Les caractères de la fabrication et de la forme des articles qui servent à l'habillement, et leur adaptation aux besoins sont de jour en jour, d'heure en heure, améliorés. S'agit-il des habitations? Entre les huttes de terre et de branchages habitées par les sauvages les plus arriérés et la maison de l'homme civilisé, il y a autant de différence extérieure que dans le nombre et la valeur des adaptations de moyens à fins que supposent respectivement ces deux genres de constructions. Si nous comparons les occupations ordinaires du sauvage avec les occupations ordinaires de l'homme civilisé, – par exemple les affaires du commerçant qui supposent des transactions multiples et complexes s'étendant à de longues périodes, les professions libérales, préparées par des études laborieuses et chaque jour assujetties aux soucis les plus variés, ou les discussions, les agitations politiques employées tantôt à soutenir telle mesure et tantôt à combattre telle autre, – nous rencontrons non seulement des séries d'adaptations de moyens à fins qui dépassent infiniment en variété et en complexité celles des races inférieures, mais des séries qui n'ont pas d'analogues dans ces races. La durée de la vie, qui constitue la fin suprême, s'accroît parallèlement à cette plus grande élaboration de la vie produite par la poursuite de fins plus nombreuses.
Mais il est nécessaire de compléter cette conception d'une évolution de la conduite. Nous avons montré qu'elle consiste en une adaptation des actes aux fins, telle que la vie se trouve prolongée. Cette adaptation augmente encore le total de la vie. En repassant en effet les exemples donnés plus haut, on verra que la longueur de la vie n'est point, par elle-même, la mesure de l'évolution de la conduite: il faut encore tenir compte de la quantité de vie. Par sa constitution, une huître peut se contenter de la nourriture diffuse contenue dans l'eau de mer qu'elle absorbe; protégée par son écaille à peu près contre tous les dangers, elle est capable de vivre plus longtemps qu'une sèche, exposée malgré ses facultés supérieures à de nombreux hasards; mais aussi la somme d'activités vitales dans un intervalle donné est bien moindre pour l'huître que pour la sèche. De même un ver, ordinairement caché à la plupart de ses ennemis par la terre sous laquelle il se fait un chemin et qui lui fournit assez pour sa pauvre subsistance, peut arriver à vivre plus longtemps que ses parents annelés, les insectes; mais l'un de ceux-ci, durant son existence de larve ou d'insecte parfait, expérimente un plus grand nombre de ces changements qui constituent la vie. Il n'en est pas autrement quand nous comparons dans le genre humain les races les plus développées aux moins développées. La différence entre les années que peuvent vivre un sauvage et un homme civilisé ne permet pas d'apprécier exactement combien la vie diffère chez l'un et chez l'autre, si l'on considère le total de la vie comme un agrégat de pensées, de sensations et d'actes. Aussi, pour estimer la vie, nous en multiplierons la longueur par la largeur, et nous dirons que l'augmentation vitale qui accompagne l'évolution de la conduite résulte de l'accroissement de ces deux facteurs. Les adaptations plus multiples et plus variées de moyens à fins, par lesquelles les créatures plus développées satisfont des besoins plus nombreux, ajoutent toutes quelque chose aux activités exercées dans le même temps, et contribuent chacune à rendre plus longue la période pendant laquelle se continuent ces activités simultanées. Toute évolution ultérieure de la conduite augmente l'agrégat des actions, en même temps qu'elle contribue à l'étendre dans la durée.
5. Passons maintenant à un autre aspect des phénomènes, à un aspect distinct de celui que nous avons étudié, mais nécessairement associé avec lui. Nous n'avons considéré jusqu'à présent que les adaptations de moyens à fins qui ont pour dernier résultat de compléter la vie individuelle. Considérons les adaptations qui ont pour fin la vie de l'espèce. Si chaque génération subsiste, c'est parce que des générations antérieures ont veillé à la conservation des jeunes. Plus l'évolution de la conduite qui sert à la défense de la vie individuelle est développée et suppose une haute organisation, plus la conduite relative à l'élevage des petits doit être elle-même développée. A travers les degrés ascendants du règne animal, ce second genre de conduite présente des progrès successifs égaux à ceux que nous avons observés dans le premier. En bas, où les structures et les fonctions sont peu développées et le pouvoir d'adapter des actes à des fins encore faible, il n'y a pas, à proprement parler, de conduite pour assurer la conservation de l'espèce. La conduite pour le maintien de la race, comme la conduite pour le maintien de l'individu, sort par degrés de ce qui ne peut être appelé une conduite. Les actions adaptées à une fin sont précédées d'actions qui ne tendent à aucune fin.
Les protozoaires se divisent et se subdivisent, par suite de changements physiques sur lesquels ils n'ont aucun contrôle, ou, d'autres fois, après un intervalle de repos, se brisent en petites parties qui se développent séparément pour former autant d'individus nouveaux. Dans ce cas, pas plus que dans le précédent, il n'y a pas de conduite. Un peu plus haut, le progrès consiste en ce qu'il se forme, à certains moments, dans le corps de l'animal, des cellules germes et des cellules de sperme qui sont projetées à l'occasion dans l'eau environnante et abandonnées à leur sort: une sur cent mille peut-être arrive à maturité. Ici encore, nous voyons le développement et la dispersion des nouveaux êtres se faire sans que les parents s'en occupent. Les espèces immédiatement supérieures, comme les poissons, qui choisissent les endroits favorables pour y déposer leurs oeufs, les crustacés d'un genre élevé, qui charrient des masses d'oeufs jusqu'à ce qu'ils soient éclos, font voir des adaptations de moyens à fins que nous pouvons désigner du nom de conduite; mais c'est encore une conduite du genre le plus simple. Lorsque, comme dans une certaine espèce de poissons, le mâle veille sur les oeufs et en éloigne les intrus, c'est une nouvelle adaptation de moyens à fins, et l'on peut employer plus résolument dans ce cas le mot de conduite.
Si nous passons à des créatures bien supérieures, comme les oiseaux, qui bâtissent des nids, couvent leurs oeufs, nourrissent leurs petits pendant de longues périodes et les assistent encore quand ils sont capables de voler; ou comme les mammifères, qui allaitent un certain temps leurs petits, et continuent ensuite à leur apporter de la nourriture ou à les protéger pendant qu'ils prennent eux-mêmes leur nourriture, jusqu'à ce qu'ils soient capables de se suffire à eux-mêmes, nous voyons comment la conduite qui a pour but la conservation de l'espèce se développe pas à pas avec celle qui sert à la conservation de l'individu. Cette organisation supérieure qui rend celle-ci possible rend également possible celle-là.
L'humanité marque dans ce genre un grand progrès. Comparé avec les animaux, le sauvage, supérieur déjà dans la conduite qui se rapporte à sa propre conservation, est supérieur aussi dans la conduite qui a pour fin la conservation de sa race. Il pourvoit en effet à un plus grand nombre de besoins de l'enfant; les soins des parents durent plus longtemps et s'étendent à apprendre aux enfants les arts, à leur donner les habitudes qui les préparent à l'existence qu'ils doivent mener. La conduite de cet ordre, aussi bien que celle de l'autre, se développe encore davantage sous nos yeux, quand nous nous élevons du sauvage à l'homme civilisé. L'adaptation des moyens à des fins dans l'éducation des enfants est plus complète; les fins à atteindre sont plus nombreuses, les moyens plus variés, et l'emploi en est plus efficace; la protection, la surveillance se continuent aussi pendant une bien plus grande partie de la vie.
En suivant l'évolution de la conduite, de manière à nous faire une idée exacte de la conduite en général, nous devons donc reconnaître la dépendance mutuelle de ces deux genres. A parler généralement, l'un ne peut se développer sans que l'autre se développe, et ils doivent parvenir simultanément l'un et l'autre au plus haut degré de leur évolution.
6. Cependant, on se tromperait en affirmant que l'évolution de la conduite devient complète, lorsqu'elle atteint une adaptation parfaite de moyens à fins pour conserver la vie individuelle et élever les enfants, ou plutôt je dirais que ces deux premiers genres de conduite ne peuvent pas arriver à leur forme la plus haute, sans qu'un troisième genre de conduite, qu'il nous reste à nommer, atteigne lui-même sa forme la plus élevée.
Les créatures innombrables et de toute espèce qui remplissent la terre ne peuvent vivre entièrement étrangères les unes aux autres; elles sont plus ou moins en présence les unes des autres, se heurtent les unes contre les autres. Dans une grande proportion, les adaptations de moyens à fins dont nous avons parlé sont les composantes de cette «lutte pour l'existence» engagée à la fois entre les membres d'une même espèce et les membres d'espèces différentes; et, le plus souvent, une heureuse adaptation faite par une créature implique une adaptation manquée par un être de la même espèce ou d'une espèce différente. Pour que le carnivore vive, il faut que des herbivores meurent, et, pour élever ses petits, il doit priver de leurs parents les petits d'animaux plus faibles. Le faucon et sa couvée ne subsistent que par le meurtre de beaucoup de petits oiseaux; ces petits oiseaux à leur tour ne peuvent multiplier, et leur progéniture ne peut se nourrir que par le sacrifice de vers et de larves innombrables. La compétition entre membres de la même espèce a des résultats analogues, bien que moins frappants. Le plus fort s'empare souvent par la violence de la proie qu'un plus faible a attrapée. Usurpant à leur profit exclusif certains territoires de chasse, les plus féroces relèguent les autres animaux de leur espèce en des lieux moins favorables. Chez les herbivores, les choses se passent de la même manière; les plus forts s'assurent la meilleure nourriture, tandis que les plus faibles, moins bien nourris, succombent directement d'inanition ou indirectement par l'inhabileté à fuir leurs ennemis qui résulte de ce défaut même d'alimentation. Cela revient à dire que, chez ceux dont la vie se passe à lutter, aucun des deux genres de conduite déterminés plus haut ne peut arriver à un complet développement. Même chez les animaux qui ont peu à craindre de la part d'ennemis ou de compétiteurs, comme les lions ou les tigres, il y a fatalement encore quelques défauts d'adaptation des moyens aux fins dans la dernière partie de leur vie. La mort par la faim qui résulte de l'impuissance à saisir sa proie est une preuve que la conduite n'atteint pas son idéal.
De cette conduite imparfaitement développée, nous passons par antithèse à la conduite parvenue à la perfection. En considérant ces adaptations d'actes à des fins, qui restent toujours incomplètes, parce qu'elles ne peuvent être faites par une créature sans qu'une autre créature soit empêchée de les faire, nous nous élevons à la pensée d'adaptations telles que toutes les créatures pourraient les faire sans empêcher les autres créatures de les faire également. Voilà nécessairement le caractère distinctif de la conduite la plus développée. Aussi longtemps en effet que la conduite se composera d'adaptations d'actes à fins, possibles pour les uns à la condition seulement que les autres ne puissent faire les mêmes adaptations, il y aura toujours place pour des modifications par lesquelles la conduite atteindrait une phase où cette nécessité serait évitée et qui augmenterait la somme de la vie.
De l'abstrait passons au concret. Nous reconnaissons que l'homme est l'être dont la conduite est le plus développée; recherchons à quelles conditions sa conduite, sous les trois aspects de son évolution, atteint sa limite. D'abord, tant que la vie n'est entretenue que par le pillage, comme celle de certains sauvages, les adaptations de moyens à fins ne peuvent atteindre en aucun genre le plus haut degré de la conduite. La vie individuelle, mal défendue d'heure en heure, est prématurément interrompue; l'éducation des enfants fait souvent tout à fait défaut, ou elle est incomplète si elle ne manque pas entièrement; de plus, la conservation de l'individu et celle de la race ne sont assurées, dans la mesure où elles le sont, que par la destruction d'autres êtres, d'une autre espèce ou de la même. Dans les sociétés formées par la composition et la recomposition des hordes primitives, la conduite reste imparfaitement développée dans la mesure où se perpétuent les luttes entre les groupes et les luttes entre les membres des mêmes groupes; or ces deux traits sont nécessairement associés, car la nature, qui pousse aux guerres internationales, porte également aux attaques d'individu à individu. La limite de l'évolution ne peut donc être atteinte par la conduite que dans les sociétés tout à fait paisibles. Cette adaptation parfaite de moyens à fins pour la conservation de la vie individuelle et l'éducation de nouveaux individus, à laquelle chacun peut atteindre sans empêcher les autres d'en faire autant, constitue, dans sa véritable définition, un genre de conduite dont on ne peut approcher que si les guerres diminuent ou cessent tout à fait.
Mais nous avons encore une lacune à combler, car il y a un dernier progrès dont nous n'avons pas encore parlé. Outre que chacun peut agir de telle sorte qu'il parvienne à ses fins sans empêcher les autres de parvenir aux leurs, les membres d'une société peuvent s'entr'aider à atteindre leur but. Si des citoyens unis se rendent plus facile les uns aux autres l'adaptation des moyens aux fins, – soit indirectement par une coopération industrielle, soit directement par une assistance volontaire, – leur conduite s'élève à un degré plus haut encore d'évolution, puisque tout ce qui facilite pour chacun l'adaptation des actes aux fins augmente la somme des adaptations faites et sert à rendre plus complète la vie de tous.
7. Le lecteur qui se rappellera certains passages des Premiers principes, des Principes de biologie et des Principes de psychologie reconnaîtra dans les passages qui précèdent, sous une autre forme, le mode de généralisation déjà adopté dans ces ouvrages. On se souviendra particulièrement de cette proposition que la vie est «la combinaison définie de changements hétérogènes, à la fois simultanés et successifs, en correspondance avec des coexistences et des séquences extérieures;» et surtout de cette formule abrégée et plus nette d'après laquelle la vie est «l'adaptation continuelle de relations internes à des relations externes».
La différence dans la manière de présenter ici les faits par rapport à la manière dont nous les présentions autrefois consiste surtout en ceci que nous ignorons la partie intérieure de la correspondance pour nous attacher exclusivement à cette partie extérieure constituée par les actions visibles. Mais l'une et l'autre partie sont en harmonie, et le lecteur qui désirerait se préparer lui-même à bien comprendre le sujet de ce livre au point de vue de l'évolution ferait bien d'ajouter, à l'aspect plus spécial que nous allons considérer, les aspects que nous avons déjà décrits.
Cette remarque faite en passant, je reviens à l'importante proposition établie dans les deux chapitres précédents et qui a été, je pense, pleinement justifiée. Guidés par cette vérité que la conduite dont traite la morale est une partie de la conduite en général, et qu'il faut bien comprendre ce que c'est que la conduite en général pour comprendre spécialement ce que c'est que cette partie; guidés aussi par cette autre vérité que, pour comprendre la conduite en général, nous devions comprendre l'évolution de la conduite, nous avons été amenés à reconnaître que la morale a pour sujet propre la forme que revêt la conduite universelle dans les dernières étapes de son évolution. Nous avons aussi conclu que ces dernières étapes dans l'évolution de la conduite sont celles que parcourt le type le plus élevé de l'être, lorsqu'il est forcé, par l'accroissement du nombre, à vivre de plus en plus en présence de ses semblables. Nous sommes ainsi arrivés à ce corollaire que la conduite obtient une sanction morale à mesure que les activités, devenant de moins en moins militantes et de plus en plus industrielles, sont telles qu'elles ne nécessitent plus ni injustice ni opposition mutuelles, mais consistent en coopérations, en aides réciproques, et se développent par cela même.
Ces conséquences de l'hypothèse de l'évolution, il nous reste à voir qu'elles s'accordent avec les idées morales directrices auxquelles les hommes se sont élevés par d'autres voies.