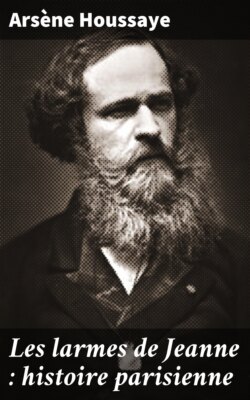Читать книгу Les larmes de Jeanne : histoire parisienne - Arsène Houssaye - Страница 11
VI
LE DUO A TABLE
ОглавлениеE soir, la mère et la fille dînaient rue de Morny, chez Mme de Tramont, cette femme à la mode qui ne s’offensait pas trop d’être surnommée forte-en-gueule, parce qu’elle avait la plus belle bouche du monde et qu’elle débitait de l’esprit à tort et à travers.
Mme de Tramont avait toutes les semaines de l’hiver douze personnes à dîner, qu’elle choisis sait çà et là dans le monde de l’aristocratie et dans le monde littéraire; c’était la confusion des races et des esprits.
Elle était encore belle, quoiqu’elle fût à son regain, voilà pourquoi elle n’était pas jalouse, voilà pourquoi Mme et Mlle d’Armaillac étaient de ses invitées parmi les femmes. La fille était fort belle, et la mère n’était pas encore trop en ruines; d’ailleurs la mère était comme Mme de Tramont, une jolie forte-en-gueule.
Quoique Jeanne mît en retard Mme d’Armaillac, elles n’arrivèrent pas les dernières chez Mme de Tramont; on avait invité, ce jour-là, une grande dame italienne, renommée pour sa belle voix, qui ne vint qu’à sept heures et demie, appuyée au bras de M. de Briançon.
–Cinq minutes de plus, dit Mme de Tramont, j’aurais dit: «Mieux vaut jamais que tard.»
–Remarquez, madame, dit Martial, que c’est l’illustrissime chanteuse en i, avec un beau point sur l’i, qui m’a mis en retard.
–Mais monsieur, dit la chanteuse, je n’ai pas l’honneur de vous connaître.
Ils étaient arrivés en même temps à la porte de l’appartement; dans l’antichambre, M. de Briançon avait offert son bras pour entrer dans le salon.
–Oui, dit Martial en s’inclinant vers la dame, mais moi je vous connais bien, or mes chevaux ont suivi les vôtres, qui n’allaient pas vite du tout. Je ne voulais pas les dépasser pour avoir l’honneur de vous offrir mon bras dans l’antichambre de Mme de Tramont.
Martial avait salué tout le monde, il s’approcha de Mlle d’Armaillac comme s’il se la fût réservée pour la bonne bouche.
–Eh bien, dit Mme de Tramont, puisque vous en êtes à Mlle Jeanne, donnez-lui votre bras pour la conduire à la salle à manger.
Ce qui fut dit fut fait:
–Mademoiselle, dit Martial, j’avais tout justement gardé un regret hier au bal; comment ai-je pu oublier de vous offrir après la valse une coupe de café glacé, au buffet? Je vais aujourd’hui réparer tous mes torts.
–Ce sera d’autant mieux, dit Jeanne, que j’ai soif depuis hier.
En effet, Jeanne avait la fièvre. Chez Mme de Tramont on se plaçait à la diable: elle ne voulait pas qu’on lui reprochât d’avoir mis le froid avec le chaud, le pacifique à côté de l’emporte-pièce. Naturellement M. de Briançon ne céda pas sa place à côté de Mlle d’Armaillac.
Quand on est douze à table, la conversation est presque toujours une, surtout dans les maisons comme celle de Mme de Tramont, où on rédige en dînant la gazette politique, littéraire, mondaine et scandaleuse de Paris.
Martial, qui connaissait les habitudes de la table, commença à parler haut de ceci et de cela pour payer sa contribution, se réservant de causer bien-, tôt à mi-voix avec sa voisine, pendant que les «fortes-en-gueule» auraient la parole.
Au bout de cinq minutes, il avait entamé la causerie la plus intime avec Jeanne.
Que se dirent-ils? que ne se dirent-ils pas? Jeanne, qui avait beaucoup de cœur, trouvait beaucoup d’esprit à Martial. Il se montrait tour à tour passionné et amusant, ne prenant ni lui ni les autres au sérieux. Il tentait de prouver à Jeanne qu’elle était la plus belle entre toutes et qu’il l’aimait éperdument.
–Je n’en crois pas un mot, lui dit-elle tout à coup.
–Parce que je ne vous dis pas cela avec la figure du jeune Werther, reprit-il en allumant ses yeux; mais la figure ne fait rien à l’affaire; croyez-vous que par cela que nous ne sommes plus au temps du pâle sentimentalisme, nous n’ayons pas autant de cœur que tous ces pleureurs de l’ancien régime? Nous sommes comme le gladiateur, nous allons à l’amour avec un sourire.
–Vous avez raison, dit tristement Mlle d’Armaillac, aller à l’amour, c’est aller à la mort.
—Oui, mais par le chemin le plus long et le plus joli.
–Le chemin des larmes!
Martial regarda Jeanne.
–Mademoiselle vous avez marché ce matin sur un pli de rose.
Jeanne essaya de sourire.
–C’est en valsant hier, monsieur, que j’ai marché sur un pli de rose.
Un silence. Martial hasarda quelques paradoxes sur les passions. Un second silence.
Jeanne reprit la parole sans lever les yeux.
–Vous parlez, monsieur, des passions, comme si vous ne viviez que là dedans. Est-ce que vous en faites la grammaire à l’usage des jeunes personnes?
–Dieu m’en garde! d’ailleurs, je ne parle de l’amour que par ouï-dire, car je n’ai jamais aimé que vous!
–Je n’en doute pas, car après la valse vous vous êtes enfui en toute vapeur.
–Mademoiselle, je fuyais le danger.
–Vous êtes allé vous mettre à l’abri dans une petite fête du café Anglais. Vous ne fuyez pas le danger avec ces demoiselles.
–Oh non, ces demoiselles ne me font pas peur! on rie craint pas avec elles de s’enchevêtrer dans une passion sans fin; tandis qu’avec une fille du monde comme vous, on se jette tout entier dans la fosse aux lions; on y met son cœur, son âme, sa vie; on est prêt à tous les sacrifices, à toutes les folies, à tous les héroïsmes.
Quoique Mlle d’Armaillac fût très-émue, elle trouva assez de présence d’esprit pour interrompre Martial en lui disant:
–On croirait que vous jouez un rôle d’amoureux au Gymnase.
Et lui, dépassant le diapason:
–Mademoiselle, vous n’aimerez jamais!
Jeanne répéta comme un écho:
–Jamais!
–Mais M. de Briançon, qui voyait bien l’émotion à travers le masque, ne se tint pas pour battu; il sentait que son magnétisme amoureux frappait fortement la jeune fille, il pensait qu’un jour ou l’autre, s’il le voulait bien, elle lui tomberait dans les bras comme une fraise vous tombe dans la main en agitant le fraisier.
Il y a une fable italienne qui peint à merveille ces premiers enlacements. Ce sont des amoureux rustiques qui veulent se fuir, mais qui se retrouvent toujours dans le même chemin; le fil de la Vierge flotte autour d’eux; peu à peu ils sont enchaînés par ces liens fragiles; ils pourraient les briser, mais ils croient que c’est la volonté du ciel qui les emprisonne dans les bras l’un de l’autre. Ils n’ont plus que la force de s’aimer.
Tous les amoureux sont ainsi, ils s’emprisonnent dans des chaînes idéales, tout en s’imaginant que c’est écrit là-haut. Pas une femme qui ne se dise le jour de sa chute: c’était ma destinée!
Il faut bien se donner raison, quand on a tort.
Après le dîner, Mme de Tramont dit tout haut à M. de Briançon:
–Eh bien, mon cher ami, vous avez perdu votre temps: cela m’amusait bien de vous voir filer le parfait amour avec cette belle statue. Voyez-vous, mon cher, Mlle d’Armaillac est une déesse, il faut l’adorer, mais il ne faut pas l’aimer.
–Omon Dieu oui, vous avez. raison, répondit l’amoureux en prenant un air de bonne bête, oui, j’ai perdu mon temps, mais le meilleur de son temps, voyez-vous, c’est encore le temps perdu.
Mme de Tramont se tourna vers Mme d’Armaillac:
–Quand vous aviez vingt ans, est-ce que vous étiez comme Jeanne? Est-ce que vous aviez un cœur de Paros et de Carrare?
–Oui, dit Mme d’Armaillac.
Et se penchant à l’oreille de Mme de Tramont:
–Mais je me suis joliment rattrapée depuis.
–Oh! vous êtes comme moi, vous vous parez des plumes du paon, vous avez eu la bêtise de la sagesse. Ce que c’est que d’être bien née!
–Puisque je vous tiens un instant, reprit Mme d’Armaillac, il faut que je vous dise une bonne nouvelle. Je vais marier Jeanne.
–Marier Jeanne! à qui? à quoi?
–On ne vous a jamais parlé d’un jeune magistrat qui s’appelle M. Delamare?
–La mare, de la mare, à la mare, non jamais.
–Eh bien! si je ne me trompe, ma fille s’appellera, avant six semaines, Mme Delamare.
– Comment est-il? Beau ramage et beau plumage?
–Vingt-cinq mille livres de rente et tout autant plus tard.
–Elle l’aime?
–L’amour dans le mariage, nous avons bien vécu sans cela nous autres.
–Et qui a décidé ce dénoûment?
–Mon frère. Que voulez–vous, ma chère amie, quand on n’a plus que son nom et ses diamants.
Mme de Tramont, qui avait été fort malheureuse avec son mari, ne put s’empêcher de dire:
–Quel malheur de donner une si belle fille à un mari!
Pour Mme de Tramont, un mari était une espèce à part, indigne en tout point de vivre avec les femmes.
Elle n’avait pas trahi la foi conjugale, elle s’était hasardée dans quelques aventures sentimentales tout à fait platoniques, mais elle avait toujours eu en horreur les hommes mariés; pour elle, son mari et les autres maris, c’était tout un.
Mlle d’Armaillac, qui écoutait aux portes, fut désespérée d’apprendre par un mot de sa mère que c’était son oncle qui avait eu l’idée de la marier au jeune magistrat. Son oncle l’adorait; il était son refuge contre sa mère, dont elle subissait trop souvent les caprices; elle espérait que le jour venu il lui donnerait une petite dot; elle vivait donc très-soumise à son oncle jusque-là: comment lui résister quand il allait la supplier d’épouser M. Delamare? c’était un mariage de raison s’il en fut.
La figure de Jeanne venait de se rembrunir singulièrement.
Quand Mme et Mlle d’Armaillac rentrèrent chez elles vers minuit, il y eut entre elles une terrible explication, quoique Jeanne se fût efforcée de garder le silence devant les remontrances de sa mère.
–Mme d’Armaillac reprocha à Jeanne d’avoir trop flirté avec M. de Briançon.
A la fin, Jeanne, ne se dominant plus, dit à sa mère qu’elle ne comprenait pas ce mot-là qui n’était pas dans sa grammaire, ni au couvent, ni dans le monde.
–Malheureusement, dit Mme d’Armaillac, c’est maintenant un mot français. Les jeunes filles ont si bien imité les Américaines que nous sommes forcés de prendre des expressions au Nouveau-Monde.
–J’avoue, murmura Jeanne, que c’est de l’hébreu pour moi.
–Je te dis encore une fois que c’en était scandaleux: tu avais l’air de boire les paroles de ce jeune homme, si bien que M. Delamare en sera averti, je n’en doute pas.
Jeanne bondit.
–M. Delamare! Ne dirait-on pas que je suis sa femme!
–Plût à Dieu que tu fusses sa femme! je n’aurais plus à m’inquiéter de toi.
–Je ne sais pas pourquoi tu t’inquiètes de moi, on dirait vraiment que je ne peux pas marcher toute seule.
Je ne veux pas redire mot à mot toute la conversation; ce que j’ai rapporté n’était que le début. Les paroles amères succédèrent aux paroles froides, les paroles violentes aux paroles amères. Ce fut au point que Mme d’Armaillac prit sa fille par le bras et la jeta hors de sa chambre en lui disant:
–C’en est trop, tu me feras mourir de chagrin.
Comme toutes les femmes emportées, Mme d’Armaillac avait ses bons et ses mauvais quarts d’heure. Elle ne se connaissait plus dans la colère; elle était variable à ce point que son frère ne manquait pas de faire cette plaisanterie quand il la voyait rire ou pleurer: «Le baromètre est au beau temps, ou à la pluie; ou bien il est à la brise, ou à la tempête.» Il la menaçait de ne plus venir chez elle qu’avec un parapluie, quand elle lui montrait ses larmes stériles. Aucune femme n’avait autant pleuré pour rien; aussi disait-elle souvent:
–Omes nerfs! mes nerfs!
Jeanne était presque toujours impassible devant les variations de sa mère; elle la plaignait de ne se point contenir, elle l’embrassait dans ses larmes, mais sans vouloir se mettre à son diapason, ce qui désespérait Mme d’Armaillac, car elle aurait voulu que sa fille eût toutes ses joies et toutes ses douleurs.
Quand Mlle d’Armaillac fut ainsi jetée à la porte de sa mère, elle se demanda si vraiment elle était coupable. Coupable de quoi? Coupable d’aimer Martial. Mais l’entraînement avait été si rapide, en vérité, qu’elle ne pouvait dire:
–C’est ma faute.
Elle entra dans sa chambre, elle alluma son bougeoir et se regarda dans la glace de la cheminée. Elle était si pâle qu’elle fut presque effrayée de sa pâleur. Depuis la veille c’était une métamorphose: ses yeux étaient plus grands et plus enflammés, sa figure s’était pour ainsi dire imprégnée du sentiment profond qui agitait son cœur.
–Non, ce n’est plus moi, dit-elle.
Il y avait dans son regard je ne sais quelle vague tristesse qui lui fit peur.
–L’amour, c’est donc si triste que cela, reprit-elle.
Elle pensa à sa mère et à M. de Briançon elle se sentit malheureuse.
–Elle me repousse, murmura-t-elle, et lui ne m’appelle pas.
Jeanne se mit à pleurer et tomba agenouillée devant son lit.
–O mon Dieu! dit-elle, sauvez-moi.
Mais elle ne sentit pas que Dieu fût là pour écouter ses prières.
Elle pria pourtant, mais elle s’aperçut bientôt qu’elle ne pensait qu’à Martial.
Elle se releva et se déshabilla lentement sans bien savoir ce qu’elle faisait. Elle pensa qu’il lui serait impossible de dormir, tant elle avait de flammes dans la tête. Elle prit un roman pour se coucher, mais elle lut comme elle avait prié, sans pouvoir effacer l’image de M. de Briançon. Quand la passion prend fortement le cœur, il n’y a plus d’autre roman que la passion elle-même.
Vers le jour, Jeanne s’endormit pourtant, mais d’un sommeil clairvoyant qui agite plutôt qu’il ne repose. Aussi, vers neuf heures, quand elle descendit de son lit, elle avait la fièvre et ne pouvait dominer ses battements de cœur.
Une bonne pensée la conduisit vers la chambre de sa mère; elle voulait l’embrasser et la ramener à sa douceur des bons jours, décidée à s’humilier, quoiqu’il en coûtât fort à son orgueil indomptable, mais non décidée pourtant à épouser M. Delamare.
Mme d’Armaillac ne fermait jamais le verrou de sa chambre, mais cette fois Jeanne ne put ouvrir la porte; aussi elle frappa doucement. Mme d’Armaillac ne répondit pas, quoique Jeanne fût sûre qu’elle était éveillée, puisqu’on venait de lui porter un tasse de chocolat.
L’orgueil remonta vite dans cette jeune tête. Jeanne retourna dans sa chambre en disant:
–C’en est fait! tant pis pour moi, tant pis pour elle!
Elle acheva de s’habiller en toute hâte; elle mit une robe noire, elle se coiffa d’un chapeau noir, elle jeta sur ses épaules son manteau de fourrures et descendit quatre à quatre l’escalier.
–Mademoiselle va à la messe? lui cria la femme de chambre.
Jeanne ne répondit pas.
Quand elle eut descendu deux étages, elle faillit rebrousser chemin.
–Non, dit-elle, c’est impossible que j’aille jusque-là.
Après quelques secondes d’hésitation, elle descendit plus vite encore et ne se retourna plus.
Dans la rue, elle fit signe. à un cocher et s’enferma dans une citadine, comme si elle se cachait.
–Où faut-il conduire madame? demanda le cocher.
Mme d’Armaillac demeurait rue Malesherbes. Jeanne répondit au cocher:
–Tout près d’ici, rue du Cirque, mais par l’avenue Gabriel.
–Quel numéro?
La jeune fille n’osa pas dire le numéro.
–Vous vous arrêterez avenue Gabriel.
Et fouette cocher!
Vous voyez tout de suite où elle allait, si vous ne l’avez pas deviné.
Dans les rêves qui l’avaient tourmentée pendant son demi-sommeil, elle s’était déjà hasardée à cette maison qui était le paradis et l’enfer. Elle se rappelait qu’elle n’avait pas eu la force de monter, mais Martial était descendu et l’avait emportée chez lui comme par enchantement. Mais ce rêve se réaliserait-il? Qui sait d’ailleurs si M. de Briançon était là? Aurait-elle le terrible courage de franchir le seuil? Si elle allait rencontrer quelqu’un qui la connût? Et puis, elle ne savait pas à quel étage il demeurait. Comment oserait-elle le demander au portier?
Pendant que toutes ces idées la préoccupaient, la citadine allait bon train.
–Cette voiture va trop vite, dit-elle comme si elle sentît l’abîme sous ses pas.
La citadine arriva avenue Gabriel, au coin de la rue du Cirque.
Jeanne fut une demi-minute sans descendre; le cocher la regardait et semblait ne pas comprendre.
–Oui, c’est bien ici, lui dit-elle.
Elle descendit enfin et marcha d’un pas rapide.
–Connu, connu, murmura le cocher qui n’était pas payé, elle ne veut pas que je sache le bon numéro. Il paraît qu’elle m’avait pris à l’heure.
Et l’automédon avança sa montre de cinq minutes avant de lire son journal. Il faut bien que l’instruction soit gratuite.