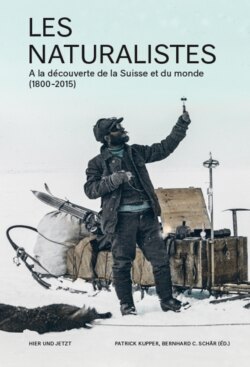Читать книгу Les naturalistes - Группа авторов - Страница 13
LA SUISSE, JARDIN DE L’EUROPE
ОглавлениеDans le contexte du romantisme et de l’essor de la philosophie de la nature, la Suisse allait devenir, au XVIIIe siècle, l’une des destinations les plus appréciées des amoureux de la nature de toute l’Europe. Ses montagnes difficilement accessibles et leurs glaciers n’étaient plus considérés comme un sujet d’épouvante ou comme des contrées inhospitalières. Le paysage de la Suisse, avec ses vallées profondes, ses collines couvertes de forêts et ses innombrables rivières, ruisseaux et lacs, ainsi que ses plaines alluviales et leurs rives, était peu à peu considéré comme une sorte de paradis sur terre. Vers la fin du siècle, le médecin et géographe allemand Johann Gottfried Ebel note dans son journal de voyage: «Il n’est certainement aucune contrée, aucune partie de notre Globe, qui soit, à tant de divers égards, aussi remarquable et aussi intéressante que la Suisse. […]. Tout ce qu’il y a de grand, de majestueux et d’étonnant, tout ce qu’il y a de plus propre à inspirer l’effroi et même l’horreur, tout ce qu’il y a de beau, de suave, d’attrayant, de douceurs pures et revivifiantes, qui se trouve épars dans la Nature entière, semble ici s’être réuni dans un petit espace, et avoir composé de ce pays le jardin de l’Europe, où tous les adorateurs de la Nature devroient se rendre en pélérinage, sûrs d’y recueillir, pour prix de leur dévotion, une ample moisson de satisfactions et de récompenses.»3
Ill. 1: La nature suisse, sauvage et romantique. Gravure d’un livre du voyageur allemand Christian Hirschfeld en 1776.
La réputation de la Suisse comme paradis naturel se renforcera surtout dans les grandes métropoles européennes. A Paris, par exemple, en 1794, un parc arboré et paysagé récemment ouvert, comprenant des enclos où l’on pouvait voir des animaux, et donc l’un des premiers jardins zoologiques publics du monde, est tout simplement baptisé «la vallée suisse».4 Toutefois, en Suisse également, même les bourgeois aisés apprennent à voir leur pays avec d’autres yeux. Les cabinets des curiosités joueront là un rôle particulier, ainsi que l’explique l’humaniste allemand Christian Cajus Lorenz Hirschfeld en 1777:
«On ne peut pas ne pas louer les Suisses de s’être intéressés non seulement aux curiosités de leur pays, mais de les avoir aussi présentées avec plaisir aux étrangers. Dans des régions montagneuses reculées, de nombreux prédicateurs commencent même à faire de la collection et de l’étude de curiosités naturelles de leur pays une occupation aussi utile qu’agréable.»5
Les voyageurs érudits découvrent des cabinets de curiosités dans les grandes villes comme Bâle, Berne, Zurich, Genève, Lausanne, Neuchâtel ou Lucerne, mais aussi dans des localités plus modestes telles que Schaffhouse, Soleure, Yverdon, Altdorf, Glaris ou La Ferrière. Leurs propriétaires étaient des professeurs, des médecins, des pharmaciens ou des pasteurs, des maîtres d’école ou des artistes. Des banquiers ou industriels fortunés de la région possédaient une petite collection de naturalia.6 Certains se spécialisèrent même dans le commerce de ces objets naturels ainsi que des curiosités. La collection, le commerce et l’échange de naturalia n’était pas simplement un passe-temps agréable. Ces collections constituaient une base indispensable pour l’étude de la nature. C’est ce qu’il ressort de l’entrée sur les cabinets d’histoire naturelle figurant dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert en 1752:
«La science de l’Histoire naturelle fait des progrès à proportion que les cabinets se complètent; l’édifice ne s’élève que par les matériaux que l’on y employe, & l’on ne peut avoir un tout que lorsqu’on a mis ensemble toutes les parties dont il doit être composé. […] Ce n’a guère été que dans ce siècle que l’on s’est appliqué à l’étude de l’Histoire naturelle avec assez d’ardeur & de succès pour marcher à grands pas dans cette carrière. C’est aussi à notre siècle que l’on rapportera le commencement des établissements les plus dignes du nom de cabinet d’Histoire naturelle.»7
Les innombrables cabinets de naturalia qui furent créés au XVIIIe siècle en Suisse, la plupart du temps dans les régions urbanisées, appartenaient à des particuliers. Généralement, ils étaient réservés à l’usage de leurs propriétaires.8 Néanmoins, rendre les collections accessibles à un vaste public était une mesure nécessaire, ainsi que la femme de lettres et poétesse Helen Maria Williams (1761-1827) le fait observer lors de son séjour de six mois en Suisse en 1794:
«Parmi les curiosités de la Suisse qui méritent l’attention des voyageurs, les cabinets d’histoire naturelle sont, de l’avis des autochtones, d’un rang particulier. […] ces collections pourraient conduire un jour à un musée d’une importance considérable et très précieux, si elles étaient rassemblées et mises au service du public.»9