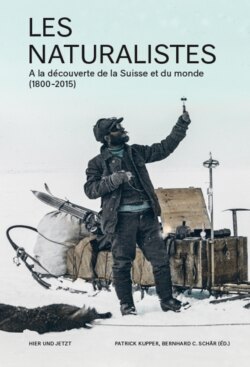Читать книгу Les naturalistes - Группа авторов - Страница 9
UNE RENCONTRE LOURDE DE CONSÉQUENCES
ОглавлениеEn 1836, l’assemblée générale de la SHSN à Soleure en 1836 lui fournit l’occasion de discuter de ses réflexions. Il y rencontre alors le naturaliste allemand Karl Friedrich Schimper (1803-1867) et son ami d’études, le spécialiste des fossiles et titulaire de la chaire d’histoire naturelle de l’Académie de Neuchâtel, Louis Agassiz (1801-1872). Charpentier entretenait une correspondance avec ce dernier depuis 1833.32 Comme il avait coutume de le faire avec d’autres naturalistes, il l’invite à passer ses vacances avec sa famille à Bex. Agassiz accepte. Au cours de l’été, Charpentier réussira à le convaincre du bien-fondé de sa théorie des glaciations, bien que Louis Agassiz se soit montré réticent au départ.33 Finalement, Agassiz demandera à Schimper de venir les rejoindre à Bex. En 1833, ce dernier avait déjà supposé un passage d’une phase chaude à une phase froide durant l’histoire de la Terre.34 Durant l’hiver 1836/37, Schimper et Agassiz élaboreront leur propre théorie des glaciations à Neuchâtel. C’est à Karl Friedrich Schimper que l’on doit la métaphore de l’«âge glaciaire» qui résume cette nouvelle théorie.35
En juillet 1837, l’Assemblée générale de la SHSN se tient à Neuchâtel. Elle est présidée par Louis Agassiz, qui profite de l’occasion pour exposer dans son discours d’ouverture la nouvelle théorie développée avec Schimper. Après s’être référé aux enseignements de Venetz et de Charpentier, expliquant que les glaciers suisses étaient jadis beaucoup plus étendus, il fait part de ses propres observations concernant les énormes blocs erratiques, aux arêtes aiguës, que l’on rencontre dans le Jura. Il en conclut que ce massif devait, lui aussi, avoir été jadis recouvert par les glaces. Au contraire de Charpentier, il rejette toutefois l’idée que ces blocs aient pu y être transportés par un gigantesque glacier alpin. Agassiz avance plutôt la thèse selon laquelle l’Europe aurait été couverte d’une couche de glace du pôle Nord jusqu’à la Méditerranée. Lorsque les Alpes se soulevèrent, elles auraient percé cette couche et des débris de roches auraient glissé jusqu’au Jura. Contrairement à Charpentier, Agassiz ne considérait pas que l’augmentation momentanée de l’altitude des Alpes avait joué un rôle décisif dans le refroidissement du climat, 36 mais qu’à la fin de chaque ère géologique, une chute soudaine de la température du globe avait entraîné «un froid glacial», éteignant toute vie sur la planète.37 Celle-ci se serait réchauffée ultérieurement, grâce à des réactions chimiques au niveau du noyau terrestre, et aurait été repeuplée à la suite d’une nouvelle création. Ainsi, des formes de vie primitives, plus anciennes, auraient disparu, laissant la place, selon Agassiz et Schimper, à de nouvelles formes de vie plus développées. Le spécialiste des fossiles Agassiz et le botaniste Schimper rejetaient l’idée d’une transformation des espèces, et donc, il ne leur restait qu’une solution: supposer des catastrophes planétaires pour expliquer la succession toujours plus complexe de formes de vie, selon eux plus développées, au cours de l’histoire de la Terre. Avec la découverte des glaciations, ces catastrophes semblaient identifiées.38 Vingt-trois ans avant la parution de l’ouvrage de Charles Darwin, On the Origin of Species, qui ouvrait de nouvelles perspectives, Agassiz et Schimper croyaient avoir trouvé dans les glaciations une explication à la succession des espèces dans l’histoire de notre planète. Cette explication, influencée par la philosophie de la nature romantique, était, certes, hautement spéculative, mais, aux yeux des deux hommes, elle aurait mérité qu’on s’y intéresse de plus près. Agassiz devait être frustré que le thème de la succession des espèces soit relégué au second plan et que l’on mette plutôt l’accent sur la question d’une glaciation durant la Préhistoire, déjà traitée par Charpentier et Venetz. Peut-être est-ce la raison pour laquelle il n’a pas particulièrement mis en exergue la contribution de Charpentier à sa théorie et à celle de Schimper, et qu’il s’abstiendra, dans les publications suivantes parues dans la Bibliothèque universelle de Genève, de remercier le directeur des salines de l’avoir instruit à ce sujet. Au contraire, Agassiz se démarquera de la théorie de Venetz et de Charpentier. Il se fondait, certes, sur l’observation précise des moraines et des blocs erratiques, mais affirmait néanmoins qu’il n’avait pas l’intention de défendre les réflexions théoriques de Venetz et de Charpentier.39
Ill. 5: Reconstitution de l’extension du glacier du Rhône à l’ère glaciaire proposée par Charpentier en 1841. La surface en bleu représente la région couverte par le glacier.