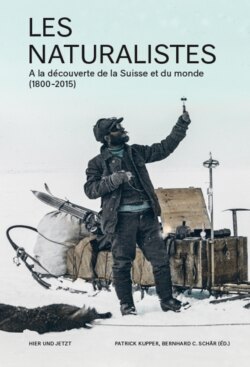Читать книгу Les naturalistes - Группа авторов - Страница 8
JEAN DE CHARPENTIER SÉDUIT PAR L’IDÉE DES GLACIATIONS
ОглавлениеAujourd’hui, cet éminent naturaliste est surtout connu comme pionnier de la recherche sur les glaciations. Ce n’est pas sans ironie d’un point de vue historique. Certes, depuis de nombreuses années (avant même qu’il ne commence ses propres recherches), il était confronté à des questions qui allaient préoccuper les futurs glaciologues. Toutefois, dans un premier temps, il refusera l’idée d’un climat qui aurait été jadis plus froid et de glaciers alpins plus étendus, car il partait du principe que le climat avait été plus chaud au cours des premières ères géologiques.
C’est sans doute à l’été 1815 que Jean de Charpentier entendit parler pour la première fois de la croissance des glaciers. A l’époque, il entreprend une excursion au val de Bagnes en Valais. Quelqu’un lui suggère alors que les énormes blocs de pierre éparpillés dans la nature pourraient y avoir été transportés par des glaciers. Bien des années plus tard, en février 1840, il évoquera cette rencontre dans une lettre privée au géologue bernois Bernhard Studer: «La personne qui m’a parlé pour la première fois des glaciers comme étant la cause du transport des débris erratiques [sic] était un paysan de Lourtier dans le val de Bagne, du nom de Perotin, qui est sans doute mort aujourd’hui. C’est en juillet 1815, lorsque j’ai fait un voyage dans cette vallée, que j’ai passé la nuit chez lui. Il prétendait dur comme fer qu’autrefois, le val de Bagne et le val d’Entremont étaient complètement remplis par un glacier qui s’étendait jusqu’à Martigny et y avait déposé les gros blocs de granit. Il va de soi que je rejetai complètement cette idée.»12 Le «Perotin» mentionné ici n’était autre que le charpentier et chasseur de chamois Jean-Pierre Perraudin (1767-1858). Contrairement à ce que suppose Jean de Charpentier lorsqu’il écrit cette lettre, ce dernier n’était pas encore décédé; l’alerte vieillard siégeait même au Grand Conseil valaisan! Sans doute considéra-t-il les réflexions du montagnard dignes d’être publiées, car ce dernier s’appuyait sur des observations vérifiables et faisait valoir que les blocs erratiques étaient trop gros et trop lourds pour avoir été charriés par les eaux. Ainsi Perraudin appliquait-il intuitivement le principe de l’actualisme, déjà répandu parmi les géologues du XIXe siècle, selon lequel des phénomènes observés dans le passé s’expliquent à partir de faits encore observables à l’époque présente. Des hypothèses comme celle de Perraudin étaient effectivement fort répandues parmi les habitants des régions alpines, et des savants en avaient fait état à différentes reprises.13 Quelques mois plus tard, Charpentier se retrouvera à nouveau confronté au mystère de l’origine des blocs erratiques, alors qu’il assiste à la conférence d’Henri-Albert Gosse sur ce thème à l’occasion de la création de la SHSN à Genève, en octobre 1815.14
Ill. 2: Photographie présumée de Jean-Pierre Perraudin (1767-1858), qui a sans doute été prise après 1850.
L’année suivante, une autre question qui intéressera les futurs glaciologues préoccupera Jean de Charpentier. Lors de la deuxième assemblée annuelle de la SHSN à Berne, il présente les résultats des recherches effectuées par l’ingénieur cantonal valaisan Ignaz Venetz (1788-1859), assurant ainsi à ce dernier son admission au sein de la Société. Venetz se demandait notamment comment des objets prisonniers des glaciers pouvaient être transportés.15 Nous ne savons pas quand et comment Charpentier et Venetz firent connaissance, mais ce qui est sûr, c’est qu’ils eurent des contacts professionnels à partir de 1818. Cette annéelà, le glacier du Giétroz s’effondre. La chute des séracs provoquera la constitution d’un nouveau glacier en contrebas, créant un lac de retenue. Le 16 juin, le barrage de glace cède et l’eau accumulée déferle dans la vallée. Pour vérifier les mesures de protection prises par Venetz, le gouvernement cantonal du Valais avait mandaté, entre autres, Charpentier à titre d’expert.16 Plus tard, les deux hommes se rencontreront de temps à autre, participant notamment à la correction et à l’endiguement du Rhône. 17
En 1821, Venetz soumet à la SHSN un mémoire dans lequel il cherche à répondre à la question mise au concours en 1817, à savoir si le climat se refroidissait. Se fondant sur l’état des anciens glaciers, des blocs erratiques et des moraines, l’ingénieur cantonal vaudois soutient que le climat s’est dégradé à l’aube de l’époque moderne. Il lui est toutefois plus difficile d’expliquer les traces d’anciennes moraines qui se trouvent à une distance considérable de la langue glaciaire – parfois même jusqu’à cinq kilomètres et demi!
Par l’intermédiaire de Jean de Charpentier, Venetz demandera, probablement à la fin août 1822, qu’on lui renvoie son manuscrit afin qu’il le révise en vue de la mise sous presse.18
Jusque-là, le monde scientifique de Charpentier était en ordre. Tout allait changer au printemps 1829, lorsque Ignace Venetz rendit visite au directeur des Mines de sel de Bex. Selon Charpentier, Venetz lui expliqua «que ses observations le portaient à croire que, non seulement la vallée d’Entremonts, mais que tout le Valais avait été jadis occupé par un glacier, qui s’était étendu jusques au Jura et qui avait été la cause du transport des débris erratiques».19 Charpentier n’était pas vraiment convaincu de ces thèses audacieuses. L’idée d’une glaciation aussi formidable lui semblait, comme il le reconnut ultérieurement, «réellement folle et extravagante».20 Lors de la prochaine assemblée générale de la SHSN, qui eut lieu au Grand Saint-Bernard en juillet 1829, Venetz présenta ses réflexions dans une conférence. Il y expliquait que les amas de roches alpines répandus dans les Alpes et au Jura, mais aussi les blocs erratiques du nord de l’Europe étaient dus à «l’existence d’immenses glaciers qui ont disparu depuis lors».21 Les réactions à cette conférence furent très critiques. L’origine des blocs erratiques semblait en effet déjà suffisamment expliquée par les théories, alors fort répandues, des éboulis et des flots de boue. Les savants de l’époque voyaient dans les plantes tropicales fossilisées la preuve éclatante d’un climat autrefois nettement plus chaud en Europe. La plupart des géologues du XIXe siècle supposaient donc qu’au cours de son histoire, la Terre s’était lentement refroidie. Pour la plupart des chercheurs présents, Venetz était un autodidacte provincial mal informé, d’autant plus que ses observations se limitaient aux zones à proximité des glaciers valaisans.22 Jean-de Charpentier faisait aussi partie des détracteurs de Venetz. Pour dissuader son ami de persister dans cette prétendue erreur, il entreprit de vérifier ses thèses et de les réfuter.23 Ses études sur le terrain durèrent tout juste quatre années. Elles le conduiront toutefois à un résultat bien différent de celui auquel il s’attendait. Il arriva en effet à la conclusion que ce n’était pas Venetz, mais lui et les autres naturalistes qui étaient dans l’erreur. Aussi, le directeur vaudois des salines se ralliera-t-il peu à peu aux vues de l’ingénieur cantonal valaisan. Charpentier évoque ce revirement au cours d’une conversation qu’il a avec le futur médecin Hermann Lebert (1813-1878) lors de sa visite, en automne 1833.24 L’année suivante, Charpentier présente pour la première fois son nouveau point de vue à un public scientifique lors de l’assemblée générale de la SHSN à Lucerne. Sa conférence s’intitule Annonce d’un des principaux résultats des recherches de Mr. Venetz, ingénieur des ponts et chaussées du Canton du Vallais, sur l’état actuel et passé des glaciers du Vallais.25 Dans son exposé, Charpentier essaie de prouver que le glacier du Rhône s’étendait jadis jusqu’au Plateau suisse. Il est possible qu’il se soit senti conforté dans ses thèses audacieuses par une expérience faite quelques jours plus tôt, en se rendant à Lucerne. Le directeur des salines relate dans la lettre à Bernhard Studer mentionnée plus haut comment, marchant avec le manuscrit de sa conférence dans sa poche, il rattrapa un bûcheron de Meiringen en haut du col de Brüning et fit un bout de chemin avec lui: «Celui-ci prétendait, sans que je le lui aie demandé, que les blocs de granit que nous voyions sur notre route avaient été transportés du Grimsel jusqu’ici par le glacier qui s’étendait encore un peu plus loin que Berne. Comme à cet instant, j’avais mon mémoire dans ma poche[,] pour le lire à Lucerne, cette remarque me réjouit tellement que je donnai un bon pourboire à cet homme.»26
Ill. 3: Ignaz Venetz à l’âge de 38 ans. Ce portrait qu’il fit faire en 1826 le montre sous les traits d’un ingénieur plein d’assurance. Par la fenêtre, sur la gauche, on aperçoit à l’arrière-plan le glacier du Giétroz. Grâce aux mesures qu’il avait prises, Venetz réussit à empêcher une catastrophe plus grande lorsqu’il s’effondra. Peinture à l’huile de Lorenz Justin Ritz (1796-1870).
Conformément aux théories sur la formation de la Terre propagées à cette époque, Jean de Charpentier partait du principe que la planète s’était continuellement refroidie au cours de son histoire. S’appuyant sur les théories du soulèvement des montagnes, il supposait que, des forces dites plutoniennes, agissant dans les profondeurs de la Terre, avaient soulevé les Alpes et le territoire environnant. De la vapeur d’eau s’était alors échappée des fentes et des abîmes du nouveau massif. Les Alpes étant, peu après leur formation, nettement plus élevées qu’aujourd’hui, des chutes de neige persistantes entraînèrent une croissance exceptionnelle des glaciers. C’est ainsi qu’un gigantesque glacier alpin s’étendra bientôt jusqu’au Jura, traversant le Plateau suisse. Une fois le nouveau massif montagneux stabilisé, les Alpes étaient tombées à leur niveau actuel, provoquant un réchauffement des régions alpines et la fin de la glaciation. Dans son interprétation, Charpentier considérait la vaste expansion des glaciers des Alpes comme un phénomène régional provisoire. Il croyait ainsi pouvoir concilier ses observations et celles de Venetz avec les théories de l’histoire de la Terre qui prévalaient alors. Globalement, l’approche de Charpentier ressemblait à celle du botaniste suédois Göran Wahlenberg (1780-1851) qui, s’étant intéressé à l’origine des blocs erratiques en Scandinavie en 1818, supposait un refroidissement régional temporaire et une glaciation des montagnes scandinaves.27 Jean de Charpentier fera paraître son article en 1835 dans les Annales des Mines, une revue scientifique française prestigieuse.28 Le public germanophone prendra connaissance de son contenu un an plus tard, notamment grâce à une notice de Karl Büchner (1806-1837) parue dans la Literarische Zeitung.29 La même année, une revue allemande et une revue anglaise publient une traduction du texte légèrement remanié.30 Un deuxième article, dans lequel Charpentier place sa théorie glaciaire dans un cadre historique plus vaste, paraît en français et en anglais en 1836. Enfin, en 1837, la principale revue géologique allemande, Neue Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie und Geologie, publiera en même temps ses deux articles.31 Jean de Charpentier était manifestement convaincu de sa théorie et soucieux de la diffuser et de l’introduire dans le débat scientifique.
Ill. 4: Portrait de Louis Agassiz réalisé de son vivant, en 1844, sur lequel le scientifique, alors âgé de 37 ans, est mis en scène en tant que spécialiste des glaciers et des glaciations. Les rochers figurant sur sa droite représentent sans doute les surfaces polies des blocs charriés par les glaciers. A l’arrière-plan à droite, on peut voir un paysage de montagnes comportant un glacier et une moraine médiane, nettement reconnaissable. Peinture à l’huile de Frédéric Zuberbühler (1822-1896).