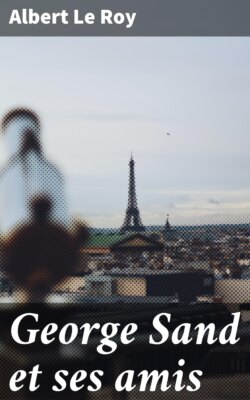Читать книгу George Sand et ses amis - Albert Le Roy - Страница 4
LES ORIGINES
ОглавлениеGeorge Sand a voulu résumer sa personne littéraire et morale dans l'épigraphe qu'elle inscrivit en tête de l'Histoire de ma Vie: «Charité envers les autres, dignité envers soi-même, sincérité devant Dieu.» Fut-elle toujours fidèle, et dans ses livres et dans ses actes, à cette noble devise? C'est l'étude qu'il sera loisible d'entreprendre, en retraçant les vicissitudes de sa destinée, en analysant son oeuvre, en instituant une enquête sur les hommes de son temps et les événements auxquels elle fut mêlée.
A l'image de Jean-Jacques Rousseau, son maître, elle nous a légué un ouvrage autobiographique, composé non pas au déclin, mais au milieu même d'une existence diverse et contradictoire. La première partie de l'Histoire de ma Vie a été rédigée en 1847, alors que George Sand était dans tout l'éclat de sa renommée. Elle explique nettement l'objet qu'elle se propose et le plan qu'elle a conçu: «Je ne pense pas qu'il y ait de l'orgueil et de l'impertinence à écrire l'histoire de sa propre vie, encore moins à choisir, dans les souvenirs que cette vie a laissés en nous, ceux qui nous paraissent valoir la peine d'être conservés. Pour ma part, je crois accomplir un devoir, assez pénible même, car je ne connais rien de plus malaisé que de se définir… Une insurmontable paresse (c'est la maladie des esprits trop occupés et celle de la jeunesse par conséquent) m'a fait différer jusqu'à ce jour d'accomplir cette tâche; et, coupable peut-être envers moi-même, j'ai laissé publier sur mon compte un assez grand nombre de biographies pleines d'erreurs, dans la louange comme dans le blâme.» Ce sont, à dire vrai, ces erreurs de détail que George Sand s'est surtout complu à redresser en racontant les années de sa jeunesse, voire même les origines de sa maison, avec une singulière prolixité. Sur les quatre gros volumes de l'Histoire de ma Vie, le premier est consacré presque entièrement à nous décrire «l'Histoire d'une famille de Fontenoy à Marengo.» Elle remonte à Fontenoy pour rappeler que Maurice de Saxe fut son bisaïeul. Quelque démocrate qu'elle soit devenue, elle tire vanité d'être par le sang arrière-petite-fille de l'illustre maréchal, de même qu'elle est par l'esprit de la lignée de Jean-Jacques; puis elle formule ainsi son état civil: «Je suis née l'année du couronnement de Napoléon, l'an XII de la République française (1804). Mon nom n'est pas Marie-Aurore de Saxe, marquise de Dudevant, comme plusieurs de mes biographes l'ont découvert, mais Amantine-Lucile-Aurore Dupin.»
Aussi bien, en se défendant de la manie aristocratique, n'est-elle pas indifférente et veut-elle nous intéresser à tous les souvenirs généalogiques de sa famille. Elle s'étend longuement sur le maréchal de Saxe et sur cette noblesse de race qu'elle ramènera théoriquement à sa juste valeur dans le Piccinino. Sa grand'mère, Aurore Dupin de Francueil, avait vu Jean-Jacques une seule fois, mais en des conditions qu'elle n'eut garde d'oublier. Voici comment elle relatait l'anecdote dans les papiers dont George Sand hérita: «Il vivait déjà sauvage et retiré, atteint de cette misanthropie qui fut trop cruellement raillée par ses amis paresseux ou frivoles. Depuis mon mariage, je ne cessais de tourmenter M. de Francueil pour qu'il me le fît voir; et ce n'était pas bien aisé. Il y alla plusieurs fois sans pouvoir être reçu. Enfin, un jour, il le trouva jetant du pain sur sa fenêtre à des moineaux. Sa tristesse était si grande qu'il lui dit en les voyant s'envoler: «Les voilà repus. Savez-vous ce qu'ils vont faire? Ils s'en vont au plus haut des toits pour dire du mal de moi et que mon pain ne vaut rien.» En digne aïeule de George Sand, madame Dupin de Francueil avait le culte de Jean-Jacques. Lorsqu'il accepta de dîner chez elle, sans doute pour faire honneur à son hôte elle lut tout d'une haleine la Nouvelle Héloïse. Aux dernières pages elle sanglotait, et ce jour-là, du matin jusqu'au soir, elle ne fit que pleurer. «J'en étais malade, dit-elle, j'en étais laide.» Rousseau arrive sur ces entrefaites, et M. de Francueil se garde de la prévenir. «Je ne finissais pas de m'accommoder, ne me doutant point qu'il était là, l'ours sublime, dans mon salon. Il y était entré d'un air demi-niais, demi-bourru, et s'était assis dans un coin, sans marquer d'autre impatience que celle de dîner, afin de s'en aller bien vite. Enfin, ma toilette finie, et mes yeux toujours rouges et gonflés, je vais au salon; j'aperçois un petit homme assez mal vêtu et comme renfrogné, qui se levait lourdement, qui mâchonnait des mots confus. Je le regarde et je devine; je crie, je veux parler, je fonds en larmes. Jean-Jacques, étourdi de cet accueil, veut me remercier et fond en larmes. Francueil veut nous remettre l'esprit par une plaisanterie et fond en larmes. Nous ne pûmes nous rien dire. Rousseau me serra la main et ne m'adressa pas une parole. On essaya de dîner pour couper court à tous ces sanglots. Mais je ne pus rien manger, M. de Francueil ne put avoir de l'esprit, et Rousseau s'esquiva en sortant de table, sans avoir dit un mot.» Quant à George Sand, quatre-vingts ans plus tard, elle est radieuse d'avoir eu une grand'mère qui a pleuré avec Jean-Jacques.
La Révolution jeta en prison, pour quelques semaines, madame Dupin, très attachée aux hommes et aux choses de l'ancien régime. Son fils, Maurice, le père de George Sand, avait l'humeur plus libérale, et les lettres qu'il écrivit durant la Terreur, reproduites dans l'Histoire de ma Vie, sont d'un style assez alerte. Il gardait, d'ailleurs, certains préjugés du monde où il avait grandi, celui par exemple d'imputer à Robespierre la responsabilité de toutes les violences auxquelles la République fut condamnée, pour se défendre contre ses adversaires du dehors et du dedans. Plus équitable et mieux informée, George Sand s'applique à détruire cette légende. «Voilà, dit-elle, l'effet des calomnies de la réaction. De tous les terroristes, Robespierre fut le plus humain, le plus ennemi par nature et par conviction des apparentes nécessités de la Terreur et du fatal système de la peine de mort. Cela est assez prouvé aujourd'hui, et l'on ne peut pas récuser à cet égard le témoignage de M. de Lamartine. La réaction thermidorienne est une des plus lâches que l'histoire ait produites. Cela est encore suffisamment prouvé. A quelques exceptions près, les thermidoriens n'obéirent à aucune conviction, à aucun cri de la conscience en immolant Robespierre. La plupart d'entre eux le trouvaient trop faible et trop miséricordieux la veille de sa mort, et le lendemain ils lui attribuèrent leurs propres forfaits pour se rendre populaires. Soyons justes enfin, et ne craignons plus de le dire: Robespierre est le plus grand homme de la Révolution et un des plus grands hommes de l'histoire.»
L'esprit révolutionnaire animera George Sand, dirigera sa pensée et inspirera son oeuvre, encore qu'elle ait reçu des traditions de famille et une éducation qui devaient lui inculquer des sentiments contraires. Sa grand'mère, madame Dupin, au sortir des prisons de la Terreur, eut des procès qui entamèrent sa fortune: c'était double raison pour détester le régime nouveau. On vivait, au fond du Berry, dans cette terre de Nohant que George Sand a tant aimée. Elle y passa presque toute sa vie et elle souhaitait de pouvoir y mourir: son voeu s'est réalisé. Voici la peinture qu'elle a tracée de ce modeste domaine qu'il nous importe de connaître. C'est le cadre même de son existence:
«L'habitation est simple et commode. Le pays est sans beauté, bien que situé au centre de la Vallée Noire, qui est un vaste et admirable site… Nous avons pourtant de grands horizons bleus et quelque mouvement de terrain autour de nous, et, en comparaison de la Beauce ou de la Brie, c'est une vue magnifique; mais, en comparaison des ravissants détails que nous trouvons en descendant jusqu'au lit caché de la rivière, à un quart de lieue de notre porte, et des riantes perspectives que nous embrassons en montant sur les coteaux qui nous dominent, c'est un paysage nu et borné… Ces sillons de terres brunes et grasses, ces gros noyers tout ronds, ces petits chemins ombragés, ces buissons en désordre, ce cimetière plein d'herbe, ce petit clocher couvert en tuiles, ce porche de bois brut, ces grands ormeaux délabrés, ces maisonnettes de paysan entourées de leurs jolis enclos, de leurs berceaux de vigne et de leurs vertes chenevières, tout cela devient doux à la vue et cher à la pensée, quand on a vécu si longtemps dans ce milieu calme, humble et silencieux.»
C'est là que madame Dupin traversera des années de gêne extrême, au lendemain de la Terreur. Les revenus de Nohant ne s'élevaient pas à 4.000 francs, payables en assignats, et il fallait rembourser des emprunts onéreux contractés en 1793. Durant plus d'un an, on vécut, paraît-il, des médiocres revenus du jardin, de la vente des légumes et des fruits qui produisait au marché de 12 à 15 francs par semaine. Puis l'horizon s'éclaircit, sans que jamais la fortune patrimoniale, après la Révolution, ait dépassé 15.000 livres de rente.
Le père de George Sand, Maurice Dupin nous laisse l'impression d'un assez mauvais sujet. Est-ce la faute de l'éducation qu'il reçut ou des commotions politiques et sociales? Du moins il manquait d'équilibre, peut-être même de bon sens, et l'Histoire de ma Vie essaie en vain de colorer avantageusement ses défauts: «Ce père que j'ai à peine connu, et qui est resté dans ma mémoire comme une brillante apparition, ce jeune homme artiste et guerrier est resté tout entier vivant dans les élans de mon âme, dans les fatalités de mon organisation, dans les traits de mon visage.» Il y a là quelque hyperbole et un excès d'adoration filiale. La destinée de Maurice Dupin fut surtout hasardeuse, comme l'était sa pensée. A dix-neuf ans, il voulait être musicien et jouait la comédie dans les salons de La Châtre. L'année suivante, la loi du 2 vendémiaire an VII ayant institué le service militaire obligatoire, il lui fallut servir sous les drapeaux de la République. Sa mère, toute royaliste qu'elle fût, avait aliéné ses diamants pour l'équiper. Il est protégé par le citoyen La Tour d'Auvergne Corret, capitaine d'infanterie, et rejoint son régiment à Cologne; ensuite il passe en Italie. Entre temps, un incident était survenu à Nohant, que George Sand relate sans s'émouvoir, mais qui dut troubler la quiétude de madame Dupin: «Une jeune femme, attachée au service de la maison, venait de donner le jour à un beau garçon, qui a été plus tard le compagnon de mon enfance et l'ami de ma jeunesse. Cette jolie personne n'avait pas été victime de la séduction. Elle avait cédé, comme mon père, à l'entraînement de son âge. Ma grand'mère l'éloigna sans reproche, pourvut à son existence, garda l'enfant et l'éleva.» George Sand ajoute: «Elle avait lu et chéri Jean-Jacques; elle avait profité de ses vérités et de ses erreurs.» Maurice Dupin, lui aussi, avait-il lu Rousseau? En tous cas, il avait trouvé une Thérèse dans le personnel domestique de Nohant.
La guerre lui réserve d'autres aventures. Il traverse le Saint-Bernard en prairial an VIII et nous raconte comment il fut accueilli à Aoste par le Premier Consul, qui venait de l'attacher à son état-major: «Je fus à lui pour le remercier de ma nomination. Il interrompit brusquement mon compliment pour me demander qui j'étais.—Le petit-fils du maréchal de Saxe.—Ah oui! ah bon! Dans quel régiment êtes-vous?—1er de chasseurs.—Ah bien! mais il n'est pas ici. Vous êtes donc adjoint à l'état-major?—Oui, général.—C'est bien, tant mieux, je suis bien aise de vous voir.—Et il tourna le dos.»
Après avoir pris part à la bataille de Marengo, voici en quels termes
Maurice Dupin relate ses impressions, dans une lettre à son oncle de
Beaumont, ou, comme dit la suscription, au citoyen Beaumont, à l'hôtel de
Bouillon, quai Malaquais, Paris:
«Pim, pan, pouf, patatra! en avant! sonne la charge! en retraite, en batterie! nous sommes perdus! victoire! sauve qui peut! Courez à droite, à gauche, au milieu! revenez, restez, partez, dépêchons-nous! Gare l'obus! au galop! Baisse la tête, voilà un boulet qui ricoche!… Des morts, des blessés, des jambes de moins, des bras emportés, des prisonniers, des bagages, des chevaux, des mulets; des cris de rage, des cris de victoire, des cris de douleur, une poussière du diable, une chaleur d'enfer; un charivari, une confusion, une bagarre magnifique; voilà, mon bon et aimable oncle, en deux mots, l'aperçu clair et net de la bataille de Marengo, dont votre neveu est revenu très bien portant, après avoir été culbuté, lui et son cheval, par le passage d'un boulet, et avoir été régalé pendant quinze heures par les Autrichiens du feu de trente pièces de canon, de vingt obusiers et de trente mille fusils.»
Ce qui vaut mieux que tout ce verbiage, c'est qu'il fut nommé par Bonaparte lieutenant sur le champ de bataille. Mais il appréhende la fin de la guerre et il s'écrie avec une pointe de gasconnade: «Encore trois ou quatre culbutes sur la poussière, et j'étais général.» Le séjour enchanteur de Milan va tourner d'autre côté ses préoccupations. Il est amoureux, non pas à la légère comme il lui est advenu sur les bords du Rhin ou à Nohant, mais avec tout l'emportement d'une passion qui veut être durable. Et il s'en ouvre à sa mère, dans une lettre écrite d'Asola, le 29 frimaire an IX: «Qu'il est doux d'être aimé, d'avoir une bonne mère, de bons amis, une belle maîtresse, un peu de gloire, de beaux chevaux et des ennemis à combattre!» La femme qui soulève tout cet enthousiasme—et qui sera la mère de George Sand—s'appelait Sophie-Victoire-Antoinette Delaborde. Elle avait été en prison au couvent des Anglaises en même temps que madame Dupin, et pour lors elle usait de moyens d'existence assez fâcheux. L'Histoire de ma Vie recourt à des circonlocutions, à des euphémismes, et finit par convenir que «sa jeunesse avait été livrée par la force des choses à des hasards effrayants.» Ces explications très embarrassées ont pour objet de ne pas confesser crûment que Victoire Delaborde accompagnait un général de l'armée d'Italie et avait trouvé des ressources dans les dépouilles du pays conquis. George Sand ne s'arrête pas à ces misères. Elle veut excuser, sinon innocenter sa mère: «Un fait subsiste devant Dieu, c'est qu'elle fut aimée de mon père, et qu'elle le mérita apparemment, puisque son deuil, à elle, ne finit qu'avec sa vie.» Haussant encore le ton, elle s'écrie sur le mode déclamatoire: «Le grand révolutionnaire Jésus nous a dit un jour une parole sublime: c'est qu'il y avait plus de joie au ciel pour la recouvrance d'un pécheur que pour la persévérance de cent justes.» Redescendons des sommets de la morale évangélique dans la réalité: Maurice Dupin recevait de madame Delaborde des prêts d'argent, sans s'inquiéter d'abord d'où elle tirait ces subsides. Ce n'est qu'à la réflexion qu'il doute de la délicatesse du procédé et discute avec ses scrupules: «Qu'as-tu fait? qu'ai-je fait moi-même en acceptant ce secours?… Si j'avais su que tu n'étais pas mariée, que tout ce luxe ne t'appartenait pas!… Je me trompe, je ne sais ce que je dis, il t'appartient, puisque l'amour te l'a donné: mais quand je songe aux idées qui pourraient lui venir, à lui… Il ne les aurait pas longtemps, je le tuerais! Enfin je suis fou, je t'aime et je suis au désespoir. Tu es libre, tu peux le quitter quand tu voudras, tu n'es pas heureuse avec lui, c'est moi que tu aimes, et tu veux me suivre, tu veux perdre une position assurée et fortunée pour partager les hasards de ma mince fortune.»
Maurice Dupin réussit à détacher madame Delaborde de son général, mais il rencontra mille obstacles avant d'aboutir au mariage. Quatre années s'écoulèrent entre la rencontre d'Asola et la naissance de George Sand. Elles furent singulièrement agitées: maintes fois le jeune homme essaya de sacrifier son amour à sa mère, qui avait l'humeur ombrageuse et jalouse. Fait prisonnier par les Autrichiens en nivôse an IX, il ne recouvra la liberté, au bout de deux mois, que pour accourir à Nohant en floréal de la même année. Victoire Delaborde vint le rejoindre à La Châtre, «ayant tout quitté, tout sacrifié à un amour libre et désintéressé.» On sut sa présence dans la petite ville, et Maurice en parla à madame Dupin. Son précepteur, un certain Deschartres, ci-devant abbé, voulut intervenir et le fit très maladroitement. Un beau matin, il se rend à La Châtre, à l'auberge de la Tête-Noire, réveille la voyageuse, lui adresse des reproches et des menaces, la somme de repartir le jour même pour Paris. Elle riposte, lui ferme la porte au nez. Il va quérir le maire et les gendarmes, qui pénètrent dans la chambre de Victoire et trouvent «une toute petite femme, jolie comme un ange, qui pleurait, assise sur le bord de son lit, les bras nus et les cheveux épars.»
Les autorités constituées s'adoucissent. Elle leur raconte «qu'elle avait rencontré Maurice en Italie, qu'elle l'avait aimé, qu'elle avait quitté pour lui une riche protection et qu'elle ne connaissait aucune loi qui pût lui faire un crime de sacrifier un général à un lieutenant et sa fortune à son amour.» A ce récit, les magistrats municipaux sont émus. Ils prennent parti contre le pédagogue. Mais le coup était porté, le scandale produit, et madame Dupin, avertie par Deschartres, ne devait jamais oublier cet esclandre. Maurice s'efforça de consoler sa mère par de mensongères promesses. Il lui écrivit: «Enfin que crains-tu et qu'imagines-tu? Que je vais épouser une femme qui me ferait rougir un jour?… Ta crainte n'a pas le moindre fondement, Jamais l'idée du mariage ne s'est encore présentée à moi; je suis beaucoup trop jeune pour y songer, et la vie que je mène ne me permet guère d'avoir femme et enfants. Victoire n'y pense pas plus que moi» Puis il entre dans des détails pour rassurer madame Dupin, et il va sans nul doute à l'encontre de ses visées. Victoire est veuve, elle a une petite fille. Elle travaillera pour vivre. Elle a déjà été modiste; elle tiendra de nouveau un magasin de modes. Et il conclut: «Est-ce que je peux, est-ce que je pourrai jamais prendre un parti qui serait contraire à ta volonté et à tes désirs? Songe que c'est impossible, et dors donc tranquille.»
L'orgueil de la châtelaine de Nohant devait être exaspéré, à la seule pensée que cette modiste pourrait devenir sa bru et porter le nom presque seigneurial des Dupin. Mais il y avait plus. Victoire, éloignée de La Châtre, continuait d'écrire à Maurice, et quelles lettres! En ce point, elle était la digne émule de Thérèse Levasseur. Et George Sand, qui nous donne sur sa mère des renseignements qu'elle aurait pu et dû taire, souligne son manque d'instruction: «C'est tout au plus si à cette époque elle savait écrire assez pour se faire comprendre. Pour toute éducation, elle avait reçu en 1788 les leçons élémentaires d'un vieux capucin qui apprenait gratis à lire et à réciter le catéchisme à de pauvres enfants… Il fallait les yeux d'un amant pour déchiffrer ce petit grimoire et comprendre ces élans d'un sentiment passionné qui ne pouvait trouver de forme pour s'exprimer.» Cependant Maurice était conquis et subissait l'ascendant de cette nature inférieure. Il y a une histoire assez louche et assez répugnante au sujet de l'argent qu'elle lui avait prêté et qui venait du général. La restitution fut effectuée, mais péniblement, et Maurice est obligé de s'en expliquer avec sa mère: «Tous les dons, dit-il, qu'elle lui avait emportés pour en manger le profit avec moi se réduisaient à un diamant de peu de valeur qu'elle avait conservé par mégarde, et qui lui avait été renvoyé avant même qu'elle connût ses plaintes et ses calomnies.» N'importe, il devait être infiniment douloureux pour madame Dupin que son fils fût réduit à lui écrire: «Je ne sais pas si je suis un des Grieux, mais il n'y a point ici de Manon Lescaut.» Devant la perspective d'une telle union, on ne peut que comprendre et approuver les résistances de la mère. Il faudra pourtant qu'elle finisse par céder, par consentir à un mariage que George Sand tâche de justifier en recourant à de véritables paradoxes: «Il va épouser une fille du peuple, c'est-à-dire qu'il va continuer et appliquer les idées égalitaires de la Révolution dans le secret de sa propre vie. Il va être en lutte dans le sein de sa propre famille contre les principes d'aristocratie, contre le monde du passé. Il brisera son propre coeur, mais il aura accompli son rêve.» En vérité, c'est employer de trop grands mots pour expliquer des misères. Et, dans ce conflit d'ordre sentimental, nos sympathies iront plutôt vers madame Dupin que vers Victoire Delaborde.
Durant bien des mois les tiraillements se prolongèrent. Maurice écrivait à sa mère, le 3 pluviôse an X (février 1802): «Je te jure par tout ce qu'il y a de plus sacré que V*** travaille et ne me coûte rien… Ne parlons pas d'elle, je t'en prie, ma bonne mère, nous ne nous entendrions pas; sois sûre seulement que j'aimerais mieux me brûler la cervelle que de mériter de toi un reproche.» Aussi bien toutes les mercuriales de madame Dupin demeuraient impuissantes, et le pauvre Deschartres, chargé du rôle de Mentor, était berné sans vergogne, alors qu'il s'appliquait à tenir son ancien écolier sous sa férule. «Un matin, raconte George Sand, mon père s'esquive de leur commun logement, et va rejoindre Victoire dans le jardin du Palais-Royal, où ils s'étaient donné rendez-vous pour déjeuner ensemble chez un restaurateur. A peine se sont-ils retrouvés, à peine Victoire a-t-elle pris le bras de mon père, que Deschartres, jouantle rôle de Méduse, se présente au devant d'eux. Maurice paye d'audace, fait bonne mine à son argus et lui propose de venir déjeuner en tiers. Deschartres accepte. Il n'était pas épicurien, pourtant il aimait les vins fins, et on ne les lui épargna pas. Victoire prit le parti de le railler avec esprit et douceur, et il parut s'humaniser un peu au dessert; mais quand il s'agit de se séparer, mon père voulant reconduire son amie chez elle, Deschartres retomba dans ses idées noires et reprit tristement le chemin de son hôtel.»
Au printemps de 1802, Maurice va rejoindre son régiment à Charleville, et Victoire l'accompagne. Auprès des camarades de la garnison et des gens de la petite ville, ils passaient pour être secrètement mariés. Il n'en était rien. Mais la naissance de plusieurs enfants vint resserrer étroitement leurs liens. Ils ne poussèrent pas l'imitation de Jean-Jacques jusqu'à les livrer à la charité publique. Un seul survécut: ce devait être George Sand, qui ignore ou néglige de nous indiquer le nombre et le sexe des autres enfants issus de cette union et emportés en bas âge.
On était alors dans une période d'accalmie politique et militaire. Le gouvernement personnel s'établissait sur les ruines de la République. L'oeuvre de réaction débutait par une entente avec la Cour de Rome, aux fins de briser l'Eglise constitutionnelle et nationale de 1789. L'armée, en sa grande majorité, accueillait assez mal cette première étape sur la route de Canossa. «Le Concordat, écrit Maurice Dupin à sa mère, ne fait pas ici le moindre effet. Le peuple y est indifférent. Les gens riches, même ceux qui se piquent de religion, ont grand'peur qu'on n'augmente les impôts pour payer les évêques. Les militaires, qui ne peuvent pas obtenir un sou dans les bureaux de la guerre, jurent de voir le palais épiscopal meublé aux frais du gouvernement.» Et le jeune homme, fervent voltairien, raille la bulle du Pape, «écrite dans le style de l'Apocalypse, et qui menace les contrevenants de la colère de saint Pierre et de saint Paul.» Bref, conclut-il, «nous nous couvrons de ridicule.» A la cérémonie de Notre-Dame en l'honneur du Concordat, les généraux se rendirent à peu près comme des chiens qu'on fouette. Le légat était en voiture, et sa croix devant lui, dans une autre voiture. Ce fut là l'occasion de négociations Pour lui, soldat de la Révolution, ayant grandi auprès d'une mère royaliste mais philosophe, il voyait avec inquiétude «des changements dans les affaires publiques qui ne promettent rien de bon», et même «un retour complet à l'ancien régime». Démocrate, il devait s'affilier à la franc-maçonnerie qui était déjà le foyer des idées libérales. Il nous a malicieusement conté son initiation: «On m'a enfermé dans tous les trous possibles, nez à nez avec des squelettes; on m'a fait monter dans un clocher au bas duquel on a fait mine de me précipiter… On m'a fait descendre dans des puits, et, après douze heures passées à subir toutes ces gentillesses, on m'a cherché une mauvaise querelle sur ma bonne humeur et mon ton goguenard, et on a décidé que je devais subir le dernier supplice. En conséquence, on m'a cloué dans une bière, porté au milieu des chants funèbres dans une église, pendant la nuit, et, à la clarté des flambeaux, descendu dans un caveau, mis dans une fosse et recouvert de terre, au son des cloches et du De profundis. Après quoi chacun s'est retiré. Au bout de quelques instants, j'ai senti une main qui venait me tirer mes souliers, et, tout en l'invitant à respecter les morts, je lui ai détaché le plus beau coup de pied qui se puisse donner. Le voleur de souliers a été rendre compte de mon état et constater que j'étais encore en vie. Alors on est venu me chercher pour m'admettre aux grands secrets. Comme avant l'enterrement on m'avait permis de faire mon testament, j'avais légué le caveau dans lequel j'avais été enfermé au colonel de la 14e, afin qu'il en fît une salle de police; la corde avec laquelle on m'y avait descendu, au colonel du 4e de cavalerie, pour qu'il s'en servît pour se pendre, et les os dont j'étais entouré, à ronger à un certain frère terrible, qui m'avait trimbalé toute la journée dans les caves et greniers.»
C'étaient là les menues distractions de la vie de garnison à Charleville. Toutes les journées ne devaient pas y être aussi plaisantes pour Maurice, partagé entre sa maîtresse et sa mère. Celle-ci, exempte de préjugés religieux, et qui n'acceptait guère que les doctrines du Vicaire savoyard ou cette foi à l'Etre suprême que George Sand appelle le culte épuré de Robespierre et de Saint-Just, admettait fort bien que jeunesse se passe, mais ne pouvait tolérer une mésalliance. C'est donc à son insu que le mariage fut conclu, le 16 prairial an XII (1804), par devant le maire du deuxième arrondissement de Paris, entre Maurice Dupin et Victoire Delaborde, qui désormais prendra le prénom de Sophie. Un mois plus tard, le 12 messidor (1er juillet), George Sand vit le jour, dans la maison portant le numéro 15 de la rue Meslay. Ces deux événements furent cachés à madame Dupin, qui, ultérieurement informée, courra à Paris et essayera vainement de faire casser le mariage. Celui-ci avait été célébré presque clandestinement. Sophie était allée à la mairie en modeste robe de basin, n'ayant au doigt qu'un mince filet d'or; car la gêne du ménage ne permit d'acheter que quelques jours plus tard une véritable alliance de six francs. En dépit de ces circonstances mystérieuses, George Sand, enfant de l'amour, naquit au milieu de la joie. La soeur de Sophie Delaborde allait épouser un officier, ami intime de Maurice, et l'on avait organisé une petite sauterie. «Ma mère, lisons-nous dans l'Histoire de ma Vie, avait une jolie robe couleur de rose, et mon père jouait sur son fidèle violon de Crémone une contredanse de sa façon». Tout à coup souffrante, Sophie passa dans la chambre voisine. Au milieu d'un chassez-huit, la tante Lucie accourut en s'écriant: «Venez, venez, Maurice, vous avez une fille.» Et elle ajouta: «Elle est née en musique et dans le rose, elle aura du bonheur.» On l'appela Aurore, en souvenir de la grand'mère absente et que l'on se garda bien d'informer. George Sand entrait dans le monde, l'an dernier de la République, l'an premier de l'Empire. Sa vie devait être agitée, comme la Révolution politique, philosophique, religieuse et sociale dont elle est issue et que reflètera son oeuvre.