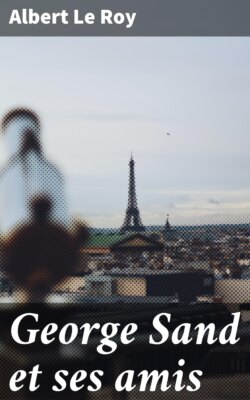Читать книгу George Sand et ses amis - Albert Le Roy - Страница 9
AU COUVENT
ОглавлениеL'éducation d'Aurore par les soins de sa grand'mère avait donné de médiocres résultats: l'enfant souffrait d'être séparée de sa mère. Deschartres, ci-devant précepteur de Maurice Dupin, n'était pas beaucoup plus heureux dans son enseignement. Il avait des bourrasques, des rages de vieux pédagogue, et la main leste. Un jour, comme la fillette était distraite au cours de la leçon, il lui jeta à la tête un gros dictionnaire latin. «Je crois, écrit-elle, qu'il m'aurait tuée si je n'eusse lestement évité le boulet en me baissant à propos. Je ne dis rien du tout, je rassemblai mes cahiers et mes livres, je les mis dans l'armoire, et j'allai me promener. Le lendemain, il me demanda si j'avais fini ma version: «Non, lui dis-je, je sais assez de latin comme cela, je n'en veux plus.» Deschartres ne revint jamais sur ce sujet, et le latin fut abandonné. On ne s'avisa que plus tard qu'il fallait compléter cette instruction faite à bâtons rompus. En attendant, Aurore tout enfant avait déjà ce culte de la nature qui hantera l'imagination de George Sand et inspirera exquisement la meilleure part de ses oeuvres. Elle nous vante, dans l'Histoire de ma Vie, l'automne et l'hiver, qui étaient ses saisons les plus gaies, et proteste contre l'habitude mondaine qui «fait de Paris le séjour des fêtes dans la saison de l'année la plus ennemie des bals, des toilettes et de la dissipation.» Elle loue les riches Anglais de passer l'hiver dans leurs châteaux, en goûtant les délices du coin du feu et de la vie de famille. Cette passion pour la campagne s'épanche en une jolie page de poésie descriptive:
«On s'imagine à Paris que la nature est morte pendant six mois, et pourtant les blés poussent dès l'automne, et le pâle soleil des hivers, on est convenu de l'appeler comme cela, est le plus vif et le plus brillant de l'année. Quand il dissipe les brumes, quand il se couche dans la pourpre étincelante des soirs de grande gelée, on a peine à soutenir l'éclat de ses rayons. Même dans nos contrées froides, et fort mal nommées tempérées, la création ne se dépouille jamais d'un air de vie et de parure. Les grandes plaines fromentales se couvrent de ces tapis courts et frais, sur lesquels le soleil, bas à l'horizon, jette de grandes flammes d'émeraude. Les prés se revêtent de mousses magnifiques, luxe tout gratuit de l'hiver. Le lierre, ce pampre inutile mais somptueux, se marbre de tons d'écarlate et d'or. Les jardins mêmes ne sont pas sans richesse. La primevère, la violette et la rose de Bengale rient sous la neige. Certaines autres fleurs, grâce à un accident de terrain, à une disposition fortuite, survivent à la gelée et vous causent à chaque instant une agréable surprise. Si le rossignol est absent, combien d'oiseaux de passage, hôtes bruyants et superbes, viennent s'abattre ou se reposer sur le faîte des grands arbres ou sur le bord des eaux! Et qu'y a-t-il de plus beau que la neige, lorsque le soleil en fait une nappe de diamants, ou lorsque la gelée se suspend aux arbres en fantastiques arcades, en indescriptibles festons de givre et de cristal? Et quel plaisir n'est-ce pas de se sentir en famille, auprès d'un bon feu, dans ces longues soirées de campagne où l'on s'appartient si bien les uns aux autres, où le temps même semble nous appartenir, où la vie devient toute morale et toute intellectuelle en se retirant en nous-mêmes?»
Voilà bien l'aimable tour de style qui fera le charme et le succès de George Sand, en donnant à la peinture d'un paysage certain reflet de psychologie! Elle écrira, par malheur, des pages moins soignées, sous le coup de l'improvisation hasardeuse; ainsi cette phrase d'Isidora: «Lorsqu'une main plus hardie cherche à soulever un coin du voile, elle aperçoit, non pas seulement l'ignorance, la corruption de la société, mais encore l'impuissance et l'imperfection de la nature humaine.» Cette main qui, en soulevant un voile, aperçoit…, évoque le souvenir d'une métaphore fameuse de roman-feuilleton: «Sa main était froide comme celle d'un serpent.»
A douze ans, Aurore fait sa première communion, non à la paroisse de Saint-Chartier comme son demi-frère Hippolyte, mais à La Châtre, sous la direction d'un vieux curé qui avait du tact et lui épargna les questions inutiles et messéantes de la confession. Cette cérémonie accomplie—et la voltairienne madame Dupin disait volontiers: cette affaire bâclée—l'enfant était en règle avec l'Eglise. Sa grand'mère, qui n'entrait jamais dans un lieu de culte, tremblait qu'elle ne devînt dévote. «Il n'en fut rien, raconte George Sand. On me fit faire une seconde communion huit jours après, et puis on ne me reparla plus de religion.»
Pourtant la crise mystique allait atteindre cette jeune imagination, éclose et développée dans une atmosphère d'incrédulité philosophique. Elevée un peu à l'aventure, entre sa grand'mère, Deschartres et des domestiques, Aurore devenait fantasque et presque révoltée. Elle refusait de travailler et demandait obstinément à rejoindre sa mère. Madame Dupin essaya des moyens de rigueur; l'enfant dut prendre ses repas seule, sans que personne lui adressât la parole. Enfin la grand'mère, pour briser cette résistance, usa d'un moyen détestable. Comme Aurore venait s'agenouiller et implorer son pardon, elle lui dit avec sécheresse: «Restez à genoux et m'écoutez avec attention; car ce que je vais vous dire, vous ne l'avez jamais entendu et jamais plus vous ne l'entendrez de ma bouche. Ce sont des choses qui ne se disent qu'une fois dans la vie, parce qu'elles ne s'oublient pas; mais, faute de les connaître, quand par malheur elles existent, on perd sa vie, on se perd soi-même.» Et la cruelle, l'impitoyable aïeule étala sous les yeux de cette fillette de treize ans les secrets de la famille; elle lui raconta le passé de son père, de sa mère, leur mariage tardif, sa naissance hâtive. Elle laissa même planer des doutes sur la conduite actuelle de sa bru. Et George Sand, qui a gardé de cette épouvantable confession un odieux souvenir, résume ainsi, quarante ans après, ses impressions ineffaçables:
«Ma pauvre bonne maman, épuisée par ce long récit, hors d'elle-même, la voix étouffée, les yeux humides et irrités, lâcha le grand mot, l'affreux mot: ma mère était une femme perdue, et moi un enfant aveugle qui voulait s'élancer dans un abîme.»
Une telle révélation produisit sur Aurore une secousse dont elle nous a transmis la description précise: «Ce fut pour moi comme un cauchemar; j'avais la gorge serrée; chaque parole me faisait mourir, je sentais la sueur me couler du front, je voulais interrompre, je voulais me lever, m'en aller, repousser avec horreur cette effroyable confidence; je ne pouvais pas, j'étais clouée sur mes genoux, la tête brisée et courbée par cette voix qui planait sur moi et me desséchait comme un vent d'orage. Mes mains glacées ne tenaient plus les mains brûlantes de ma grand'mère, je crois que machinalement je les avais repoussées de mes lèvres avec terreur.»
Dès lors, le séjour de Nohant devint odieux à Aurore. Il y avait un lien d'affection, ou brisé ou détendu, entre elle et sa grand'mère. Elle se comporta en enfant terrible, rebelle au travail, s'évadant de la maison pour courir les chemins, les buissons, les pacages, et ne revenir qu'à nuit close avec des vêtements déchirés. Madame Dupin décida de la mettre au couvent à Paris. Aurore accueillit avec joie cette nouvelle; du moins elle verrait sa mère.
Au début de l'hiver 1817-1818, madame Dupin conduisit sa petite-fille, alors dans sa quatorzième année, au couvent des Anglaises, institué par la veuve de Charles Ier pour les religieuses catholiques émigrées sous le protectorat de Cromwell. George Sand devait y passer trois ans, jusqu'au printemps de 1820. Elle a raconté avec d'amples détails son séjour dans cette communauté, où les élèves, assez indisciplinées, semble-t-il, se divisaient en trois catégories: les diables, les sages et les bêtes. Ces dernières, il va sans dire, étaient les plus nombreuses, et l'Histoire de ma Vie relate avec une complaisante prolixité maintes anecdotes de couvent qui ne sauraient nous inspirer le même intérêt qu'à madame Sand, lorsqu'elle se retournait vers les années de pension où son esprit reçut la profonde commotion du mysticisme.
La communauté des Anglaises consistait en «un assemblage de constructions, de cours et de jardins qui en faisait une sorte de village plutôt qu'une maison particulière.» C'était un dédale de couloirs, d'escaliers, de galeries, d'ouvertures, de paliers; des chambres qui ouvraient à la file sur des corridors interminables, et puis, ajoute George Sand, «de ces recoins sans nom où les vieilles filles, et les nonnes surtout, entassent mystérieusement une foule d'objets fort étonnés de se trouver ensemble, des débris d'ornements d'église avec des oignons, des chaises brisées avec des bouteilles vides, des cloches fêlées avec des guenilles, etc., etc.» Des salles d'étude, et particulièrement de la petite classe où étaient entassées une trentaine de fillettes, George Sand a gardé un déplaisant souvenir. Elle revoit et nous montre «les murs revêtus d'un vilain papier jaune d'oeuf, le plafond sale et dégradé, des bancs, des tables et des tabourets malpropres, un vilain poêle qui fumait, une odeur de poulailler mêlée à celle du charbon, un vilain crucifix de plâtre, un plancher tout brisé; c'était là que nous devions passer les deux tiers de la journée, les trois quarts en hiver.» Et de cette laideur des locaux scolaires de son temps, elle tire argument pour expliquer la médiocrité ou l'absence des aspirations esthétiques, alors qu'un simple paysan vit dans une atmosphère et a sous les yeux des spectacles de beauté. A très bon droit, elle demande qu'on élargisse et qu'on embellisse l'horizon intellectuel des prolétaires français. Elle veut qu'on leur révèle les trésors et les splendeurs de l'art.
Des religieuses et des maîtresses de la communauté George Sand a esquissé des portraits qui nous offrent, sous les aspects les plus divers, le personnel d'une congrégation enseignante. C'était, d'abord, la maîtresse de la petite classe, mademoiselle D…, «grasse, sale, voûtée, bigote, bornée, irascible, dure jusqu'à la cruauté, sournoise, vindicative; elle avait de la joie à punir, de la volupté à gronder, et, dans sa bouche, gronder c'était insulter et outrager.» Il paraît qu'elle écoutait aux portes, qu'elle obligeait les élèves, en manière de punition, à baiser la terre. Et si, d'aventure, elles faisaient le simulacre et baisaient leur main en se baissant vers le carreau, la farouche mademoiselle D… leur poussait la figure dans la poussière. C'est qu'elle appartenait à l'espèce des maîtresses séculières, des pions femelles—selon l'expression de George Sand—qui sont la plaie des couvents.
Tout au rebours, il y avait la mère Alippe, «une petite nonne ronde et rosée comme une pomme d'api trop mûre qui commence à se rider.» Chargée de l'instruction religieuse, elle demanda à Aurore, le jour de son arrivée, où languissaient les âmes des enfants morts sans baptême. La petite-fille de madame Dupin était peu ferrée sur le catéchisme. Une de ses compagnes, qui avait un fort accent anglais, lui souffla: «Dans les limbes.» Aurore entendit et répéta: «Dans l'Olympe» Toute la classe éclata de rire, d'autant que la nouvelle venue ne savait pas faire le signe de la croix. Rose, la femme de chambre, lui avait appris à porter la main à l'épaule droite avant l'épaule gauche. C'était une hérésie, et le brave curé jovial de Saint-Chartier ne s'en était pas aperçu. On crut qu'une païenne était entrée dans la communauté. Elle mettait l'Olympe dans le catéchisme, se signait de travers, et disait «mon Dieu»—presque un juron—hors de ses prières, dans la conversation courante.
Ses camarades essayèrent de la tourner en dérision. Mary G…, qui était le grand chef des diables et la terreur des bêtes, l'aborda en ces termes: «Mademoiselle s'appelle Du pain? some bread? elle s'appelle Aurore? rising-sun? lever du soleil? les jolis noms! et la belle figure! Elle a la tête d'un cheval sur le dos d'une poule. Lever du soleil, je me prosterne devant vous; je veux être le tournesol qui saluera vos premiers rayons. Il paraît que nous prenons les limbes pour l'Olympe; jolie éducation, ma foi, et qui nous promet de l'amusement.»
Aurore eut vite désarmé la malveillance et conquis les sympathies de ses compagnes. Elle s'associa aux excursions de la diablerie qui, imitant le miaulement des chats, courait par les corridors et grimpait sur les toits, au risque de briser des vitres avec un fracas épouvantable. La punition, quand on était surprise, consistait à revêtir le bonnet de nuit; au début, ce fut pour Aurore la coiffure habituelle. On composait aussi, pour se distraire, et l'on se passait de main en main des modèles de confession ou d'examen de conscience, destinés aux petites et adressés à l'abbé de Villèle, confesseur d'une partie de la communauté. Voici l'un de ces scénarios assez irrespectueux:
«Hélas! mon petit père Villèle, il m'est arrivé bien souvent de me barbouiller d'encre, de moucher la chandelle avec mes doigts, de me donner des indigestions d'haricots, comme on dit dans le grand monde où j'ai été z'élevée; j'ai scandalisé les jeunes ladies de la classe par ma malpropreté; j'ai eu l'air bête, et j'ai oublié de penser à quoi que ce soit, plus de deux cents fois par jour. J'ai dormi au catéchisme et j'ai ronflé à la messe; j'ai dit que vous n'étiez pas beau; j'ai fait égoutter mon rat sur le voile de la mère Alippe, et je l'ai fait exprès. J'ai fait cette semaine au moins quinze pataquès en français et trente en anglais, j'ai brûlé mes souliers au poêle et j'ai infecté la classe. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, etc.»
Le samedi soir particulièrement, ou la veille des fêtes, on s'évertuait à mettre en colère la D…, qui donnait des gifles à tour de bras et tout à coup s'écriait lamentablement: «J'ai perdu mon absolution.» Ou bien on racontait gravement aux nouvelles arrivées que l'une des doyennes de la communauté, madame Anne-Augustine, ne digérait qu'au moyen d'un ventre d'argent et que, lorsqu'elle marchait, on entendait le cliquetis de ce ventre de métal. Les pires escapades de ces fillettes étaient de rassembler des victuailles, des fruits, des gâteaux, des pâtés, et de se concerter pour aller les dévorer de nuit, dans un coin de la maison. «Mettre en commun nos friandises et les manger en cachette aux heures où l'on ne devait pas manger, c'était une fête, une partie fine et des rires inextinguibles, et des saletés de l'autre monde, comme de lancer au plafond la croûte d'une tarte aux confitures et de la voir s'y coller avec grâce, de cacher des os de poulet au fond d'un piano, de semer des pelures de fruits dans les escaliers sombres pour faire tomber les personnes graves. Tout cela paraissait énormément spirituel, et l'on se grisait à force de rire; car en fait de boisson nous n'avions que de l'eau ou de la limonade.»
Soudain la plus invraisemblable des révolutions se produisit chez cette espiègle d'Aurore, adonnée à la diablerie. Elle devint dévote. Elle avait quinze ans. L'éveil de son coeur fut une crise de mysticisme. Elle avait besoin d'aimer hors d'elle-même. Elle aima Dieu. Voici comment la métamorphose s'opéra. L'ordinaire religieux des pensionnaires était la messe tous les matins, à sept heures, puis dans l'après-midi une méditation d'une demi-heure à la chapelle. Celles qui méditaient péniblement avaient le droit de faire une lecture pieuse. Plusieurs bâillaient, chuchotaient ou sommeillaient: Aurore était du nombre. Un jour, par ennui, elle ouvrit un abrégé de la Vie des Saints, lut la légende de Siméon le Stylite, y prit intérêt, rouvrit le volume le lendemain et les jours suivants. Un tableau du Titien, placé au fond du choeur, et qui représentait Jésus au Jardin des Olives, lui sembla s'illuminer et révéler le sens profond de l'agonie du Christ. Elle eut la vague curiosité de poursuivre ses lectures, d'aborder la vie de saint Augustin, celle de saint Paul, d'évoquer le peu de latin qu'elle avait su pour comprendre et admirer les psaumes. Elle ouvrit l'Evangile, s'en pénétra, s'y complut, et elle retourna au pied de l'autel, non seulement aux heures obligatoires, mais pendant les récréations. A la pâle clarté de la lampe du sanctuaire, elle priait, suivait son rêve mystique. Et le spectacle de cette chapelle, où son âme se renouvelle et s'épure, est demeuré gravé en sa mémoire: «La flamme blanche se répétait dans les marbres polis du pavé, comme une étoile dans une eau immobile. Son reflet détachait quelques pâles étincelles sur les angles des cadres dorés, sur les flambeaux ciselés et sur les lames d'or du tabernacle. La porte placée au fond de l'arrière-choeur était ouverte à cause de la chaleur, ainsi qu'une des grandes croisées qui donnaient sur le cimetière. Les parfums du chèvrefeuille et du jasmin couraient sur les ailes d'une fraîche brise. Une étoile perdue dans l'immensité était comme encadrée par le vitrage et semblait me regarder attentivement. Les oiseaux chantaient; c'était un calme, un charme, un recueillement, un mystère, dont je n'avais jamais eu l'idée.»
Peu à peu la chapelle se vida, la dernière religieuse, après avoir, selon la coutume de la communauté, non seulement plié le genou, mais baisé le sol devant l'autel, alluma sa bougie à la lampe symbolique. Aurore resta seule, et le grand ébranlement nerveux des conversions et des extases se produisit en elle. La grâce opérait avec la soudaineté de son efficace.
«L'heure s'avançait, la prière était sonnée, on allait fermer l'église. J'avais tout oublié. Je ne sais ce qui se passait en moi. Je respirais une atmosphère d'une suavité indicible, et je la respirais par l'âme plus encore que par les sens. Tout à coup un vertige passe devant mes yeux, comme une lueur blanche dont je me sens enveloppée. Je crois entendre une voix murmurer à mon oreille: Tolle, lege.»
C'en était fait. Elle aimait Dieu. Tout son être lui appartenait. Un voile venait de se déchirer devant ses regards. Elle entrevoyait une Terre promise et voulait y pénétrer. Ses appels, ses prières allaient à la divinité inconnue qu'elle adorait. Et les sanglots qui secouaient sa gorge, les larmes qui inondaient ses joues, attestaient la ferveur de son exaltation. De sens rassis, longtemps après, elle nous en donne une preuve décisive: «J'étais tombée derrière mon banc. J'arrosais littéralement le pavé de mes pleurs.»
Dès lors sa dévotion prit une forme passionnée et fougueuse. Les résistances de sa raison, les fantaisies de son humeur, les singularités de son caractère eurent tôt fait de capituler devant l'explosion victorieuse et triomphante de la foi. Ce zèle fut contenu par le tact d'un confesseur habile homme, l'abbé de Prémord, jésuite, ou, comme on disait alors, Père de la foi. Il écouta avec bienveillance la confession générale d'Aurore, c'est-à-dire le récit de sa vie passée qui dura trois heures. Quand elle eut terminé, il refusa d'entendre sa confession—elle s'était confessée en se racontant—et il lui donna sur-le-champ l'absolution: «Allez en paix, vous pouvez communier demain. Soyez calme et joyeuse, ne vous embarrassez pas l'esprit de vains remords, remerciez Dieu d'avoir touché votre coeur; soyez toute à l'ivresse d'une sainte union de votre âme avec le Sauveur.» Elle communia le lendemain, fête de l'Assomption. Elle avait quinze ans. Ce fut, à l'en croire, 1e véritable jour de sa première communion. Dans l'intervalle, elle ne s'était pas approchée du sacrement. Pour réparer cette négligence, durant plusieurs mois, elle communia tous les dimanches, et même deux jours de suite. «J'en suis revenue, dit-elle dans l'Histoire de ma Vie, à trouver fabuleuse et inouïe l'idée matérialisée de manger la chair et de boire le sang d'un Dieu; mais que m'importait alors?… Je brûlais littéralement comme sainte Thérèse; je ne dormais plus, je ne mangeais plus, je marchais sans m'apercevoir du mouvement de mon corps; je me condamnais à des austérités qui étaient sans mérite, puisque je n'avais plus rien à immoler, à changer ou à détruire en moi. Je ne sentais pas la langueur du jeûne. Je portais autour du cou un chapelet de filigrane qui m'écorchait, en guise de cilice. Je sentais la fraîcheur des gouttes de mon sang, et au lieu d'une douleur c'était une sensation agréable. Enfin je vivais dans l'extase, mon corps était insensible, il n'existait plus.» Bref, le mysticisme s'était emparé d'elle, annihilait son corps et emportait sa pensée vers des songes paradisiaques.
Par esprit sans doute de mortification, elle se plaisait au commerce des soeurs converses chargées des basses besognes de la communauté, et spécialement de la soeur Hélène, une pauvre écossaise vouée à la phtisie, qui s'arrêtait au milieu d'un couloir ou au bas d'un escalier, incapable de porter les seaux d'eau sale qu'elle devait descendre du dortoir. Cette malheureuse créature était laide, vulgaire, marquée de taches de rousseur; mais elle avait des dents merveilleuses et sur le visage une expression de souffrance d'une infinie mélancolie. Aurore voulut la seconder dans son gros travail, l'aida à enlever ses seaux, à balayer, à frotter le parquet de la chapelle, à épousseter et brosser les stalles des nonnes, voire même à faire les lits au dortoir. Qu'eût pensé madame Dupin si elle avait su que sa petite-fille se livrait à d'aussi viles occupations? En retour, Aurore apprenait à soeur Hélène les éléments de la langue française, et c'était là un touchant échange de services. A l'image de son élève, la future châtelaine de Nohant voulait entrer en religion, et non pas comme dame du choeur, mais comme simple converse, servante volontaire, par pur amour de Dieu, dans quelque communauté.
La supérieure des Anglaises et l'abbé de Prémord se garderont d'encourager une vocation qui leur semblait factice et sans avenir. Ce fut, de leur part, très avisé. Ils exigèrent même qu'Aurore renonçât aux exagérations de son mysticisme, qu'elle jouât et courût avec ses compagnes, au lieu de passer à la chapelle les heures de récréation. L'ordre était formel: «Vous sauterez à la corde, vous jouerez aux barres.» Elle dut se soumettre à la proscription, tout en continuant à communier le dimanche, et vite elle recouvra son équilibre physique et moral. De la sorte elle eut plusieurs mois de béatitude. «Ils sont, dit-elle, restés dans ma mémoire comme un rêve, et je ne demande qu'à les retrouver dans l'éternité pour ma part de paradis. Mon esprit était tranquille. Toutes mes idées étaient riantes. Il ne poussait que des fleurs dans mon cerveau, naguère hérissé de rochers et d'épines. Je voyais à toute heure le ciel ouvert devant moi, la Vierge et les anges me souriaient en m'appelant; vivre ou mourir m'était indifférent. L'empyrée m'attendait avec toutes ses splendeurs, et je ne sentais plus en moi un grain de poussière qui pût ralentir le vol de mes ailes. La terre était un lieu d'attente où tout m'aidait et m'invitait à faire mon salut. Les anges me portaient sur leurs mains, comme le prophète, pour empêcher que, dans la nuit, mon pied ne heurtât la pierre du chemin.»
Ce retour à la gaieté—une gaieté pieuse et pratiquante—fut marqué par un goût très vif pour les charades d'abord, puis pour de petites comédies qu'Aurore organisait avec cinq ou six de la grande classe. On élaborait des scénarios sur lesquels on dialoguait d'abondance, à l'improvisade. Les travestissements étaient un peu bien primitifs, ceux surtout des rôles masculins. C'était une manière de costume Louis XIII, où les hauts-de-chausses consistaient en un retroussis des jupes froncées jusqu'à mi-jambe. Avec des tabliers cousus on faisait des manteaux; avec du papier frisé on simulait des plumes. Il y eut même des bottes, des épées et des feutres fournis par les parents. Madame la supérieure daigna assister à l'une des représentations avec toute la communauté, et l'on eut ce soir-là permission de minuit. Aurore, qui était l'impresario de la troupe, retrouva dans sa mémoire quelques scènes du Malade imaginaire qu'elle ajusta, et les religieuses, sans s'en douter, applaudirent une vague paraphrase de Molière proscrit au couvent. Elles prirent plaisir aux pratiques de monsieur Purgon, avec des intermèdes renouvelés de Monsieur de Pourceaugnac. On avait découvert, dans le matériel de l'infirmerie, les instruments classiques. Le latin de Molière fut apprécié par les Anglaises qui avaient l'habitude de lire ou de psalmodier les offices en latin.
Cette représentation marqua l'apothéose d'Aurore. Peu de temps après, au lendemain de l'assassinat du duc de Berry qui interrompit les réjouissances théâtrales préparées au couvent pour le carnaval, avec un programme de violons, de bal et de souper, madame Dupin s'avisa de ramener sa petite-fille à Nohant. Elle avait appris ses projets d'entrer en religion, qui d'ailleurs subsistaient à travers les distractions dramatiques, et elle ne se souciait pas qu'Aurore devînt nonne ou béguine. Il fallut quitter le couvent. O désespoir! C'était le paradis sur la terre. L'idée de revoir le monde, la perspective d'être mariée, épouvantaient cette imagination de seize ans. Par bonheur la mère et la grand'mère ne devaient pas s'entendre pour choisir un prétendant. On accorda quelque répit à Aurore. Elle espérait du moins qu'un rapprochement pourrait survenir entre les deux influences qui s'étaient disputé son affection. Mais, lorsqu'elle aborda ce sujet, sa mère lui répliqua violemment: «Non certes! Je ne retournerai à Nohant que quand ma belle-mère sera morte.» Et elle ajoutait avec son humeur emportée et aigrie: «Va-t'en sans te désoler, nous nous retrouverons, et peut-être plus tôt que l'on ne croit!» Au début du printemps de 1820, Aurore rentra à Nohant avec sa grand'mère dans la grosse calèche bleue, et le lendemain matin, quand elle s'éveilla, ce fut une sensation neuve et troublante: «Les arbres étaient en fleur, les rossignols chantaient, et j'entendais au loin la classique et solennelle cantilène des laboureurs.» Le couvent allait bientôt s'effacer et disparaître dans les brumes du passé.