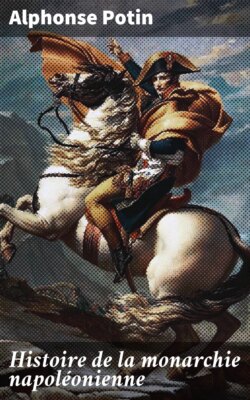Читать книгу Histoire de la monarchie napoléonienne - Alphonse Potin - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
ОглавлениеTable des matières
Naissance de Napoléon Bonaparte. — Son enfance. — Son entrée à l’école de Brienne. — Son goût pour les mathématiques. — Ses progrès. — Prédiction de l’archidiacre Lucien. — Son admission à l’École Militaire de Paris. — Ses habitudes de travail. — Sa première communion. — Sa nomination comme sous-lieutenant et capitaine d’artillerie.
La Corse était réunie depuis quelques mois seulement à la France, lorsque Napoléon Bonaparte naquit à Ajaccio, le 15 août 1769; sa famille, d’une origine noble de la Toscane , avait quitté l’Italie pour se fixer dans cette île dont les habitants devaient s’illustrer par leur héroïque résistance contre l’autorité tyrannique des Génois. Son père, Charles Bonaparte, homme d’une remarquable énergie, avait combattu à côté de Pascal Paoli, qui fut regardé par l’Europe comme le législateur et le vengeur de sa patrie; sa mère, madame Lætitia Bonaparte, femme aussi distinguée par sa beauté que par la fermeté de son âme, partagea dans cette guerre de montagnes, glorieusement soutenue par les Corses, toutes les fatigues, toutes les privations, tous les périls de son époux.
Si la fortune se montra avare de ses dons envers les père et mère de Napoléon, la providence réservait les plus hautes destinées à leurs enfants. Le jour de la naissance de l’homme qui devait symboliser dans l’esprit de la nation française, dans celui du monde, une époque d’ordre, de religion, de gloire au dehors et de satisfaction au dedans, fut marqué par un de ces incidents qui révèlent parfois les secrets de l’avenir; sa pieuse et bonne mère avait voulu assister à la solennité de l’Assomption et fut prise à l’église des premières douleurs, symptômes de l’enfantement; on fut obligé de la ramener chez elle en toute hâte. A peine arrivée, étendue sur une tapisserie représentant les combats de l’Iliade, elle mit au monde l’enfant que Dieu destinait à être l’apôtre et l’Achille de la rénovation sociale, mais dont la mémoire attend encore les chants d’un Homère.
Les premières années de Napoléon s’écoulèrent au sein de sa famille, qui résidait tantôt à Ajaccio, tantôt dans une habitation, non loin de la ville, que possédait un frère de madame Lætitia Romalino, appelé à devenir depuis le cardinal Fesch. Une tradition religieusement conservée a donné à un rocher d’une forme originale, dérobé aux regards par une épaisse ceinture d’oliviers sauvages, de cactus, de clématites et d’amandiers, qui faisait partie des dépendances de la propriété, le nom de Grotte de Napoléon. La précocité d’intelligence, la pénétration surprenante du jeune Bonaparte, trouva dans la sollicitude maternelle le mobile le plus puissant; il professait pour sa mère une profonde vénération; on aime à l’entendre lui-même exprimer sa respectueuse reconnaissance dans ce langage vif, précis, qui sait peindre en peu de mots: «Mon excellente mère, disait-il à monsieur O’Méara, est une excellente femme d’âme et de beaucoup d’énergie; elle a un caractère mâle, fier et plein d’honneur; je dois ma fortune à la manière dont elle a élevé ma jeunesse; je suis d’avis que la bonne ou la mauvaise conduite à venir d’un enfant dépendent entièrement de sa mère;» empereur, il consacrait ce jugement en créant pour sa mère le titre le plus en harmonie avec les principes de la loi de charité, celui de Protectrice des établissements de bienfaisance; il aimait tant le peuple qu’il ne croyait pouvoir mieux faire que de confier ses souffrances au cœur, à la religion de celle qui avait guidé ses premiers pas dans la carrière de la vie.
A l’âge de dix ans, le jeune Napoléon suivit à Versailles son père, député de la noblesse des États de Corse, et fut placé à l’école de Brienne, grâce à l’influence de M. de Marbeuf, gouverneur de la Corse. Il a depuis retracé les impressions qu’il éprouvait à cette époque; nous devons à l’histoire de sa vie de les reproduire fidèlement. «Quand j’entrai à Brienne, disait-il , j’étais heureux, ma tète commençait à fermenter, j’avais besoin d’apprendre, de savoir, de parvenir, je dévorais les livres; bientôt il ne fut bruit que de moi dans l’École. J’étais admiré, envié, j’avais la conscience de mes forces; je jouissais de ma suprématie. Ce n’est pas que je manquasse d’âmes charitables qui cherchaient à troubler ma satisfaction; j’avais, en arrivant, été reçu dans une salle où se trouvait le portrait du duc de Choiseul: la vue de cet homme odieux, qui avait trafiqué de mon pays, m’avait arraché une expression flétrissante: c’était un blasphème, un crime qui devait effacer mes succès. Je laissai la malveillance se donner ses larges Je devins plus appliqué, plus studieux; j’aperçus ce que sont les hommes, et je me le tins pour dit.»
Son esprit droit, positif, prompt à embrasser tous les calculs, à en déduire toutes les conséquences, à en résoudre tous les problèmes, se porta vers l’étude des mathématiques. «C’est mon premier mathématicien, » disait en parlant de lui le révérend père Patrault, chargé de cet enseignement, «Bezout était son auteur de prédilection. Son goût naturel pour les sciences exactes, ainsi que l’écrivait son neveu, Louis Napoléon, à M. Arago , est du reste naturel à expliquer. Ce qui distingue les grands hommes, ce qui enflamme leur ambition, ce qui les rend absolus dans leurs volontés, c’est l’amour de la vérité qu’eux seuls croient connaître: aussi l’empereur devait-il, dans son jeune âge, préférer aux autres sciences celle qui donne toujours des résultats incontestables et inaccessibles à la chicane et à la mauvaise foi.
» L’empereur avait une mémoire étonnante pour les chiffres, et il n’oubliait jamais les nombres exprimant les rapports des divers éléments de notre organisation civile et militaire. Ma mère m’a souvent raconté avoir vu l’empereur calculer devant elle les mouvements les plus compliqués de ses troupes, se souvenant de la position de chaque corps, du rapport des différentes armes entre elles, du numéro des régiments, et du temps que chacun d’eux employait pour parvenir à la distance voulue. Vous savez peut-être qu’un jour, vérifiant les comptes du Trésor, où était inscrit le passage des troupes à Paris, il affirma, contre le dire de l’administration, que le 32e n’était jamais passé à Paris. On fit une enquête, et on trouva en effet qu’il n’avait traversé que Saint-Denis, mais que la ville n’ayant pas de payeur militaire, la somme avait été mise sous le dossier de Paris. A ne juger que superficiellement, on pourrait croire que cette faculté de calculs et cette mémoire surprenante viennent d’un esprit plutôt arithmétique que mathématique, mais, en analysant, on voit que ce qui nous apparaît comme une simple proportion est déjà le résultat de hautes considérations,»
La puissance inouïe de travail qu’a toujours eue Bonaparte, lui fit faire des progrès si rapides, qu’on eût été porté à croire qu’il inventait la science plutôt qu’il ne l’apprenait. S’il avait un penchant prononcé pour les sciences exactes, parce que chacune d’elles était à ses yeux une application partielle de l’esprit humain, il était loin de négliger les lettres, car elles sont, disait-il, l’esprit humain lui-même. Aussi pendant les récréations, lorsque ses compagnons d’études se livraient aux plaisirs de leur âge, il se renfermait seul dans la bibliothèque: il y lisait Polybe, Arrien, César; sa lecture favorite était Plutarque. Il en conservait toujours un volume sur lui. Il méditait les œuvres de ce profond moraliste, si riche de saines doctrines, de judicieux aperçus, de ce peintre des grands hommes de l’antiquité, dont la morale usuelle, accommodée à toutes les conditions et à toutes les circonstances, nous apprend que c’est dans l’enfance que l’on jette les fondements d’une bonne vieillesse.
Un penchant irrésistible entraînait Bonaparte vers la carrière des armes. Dans le cours de l’hiver, il s’amusait à former des remparts de neige, à creuser des fossés, à élever des bastions, à figurer tout l’appareil d’un siége. Fier de commander ses camarades, qui reconnaissaient sa supériorité, il préludait, dans ces jeux de l’enfance, à ces combats de géants qui devaient un jour étonner le monde. Ainsi les moments de distractions tournaient au profit de l’étude. Organisation d’élite, il disait un jour: «J’ai connu les limites de mes jambes, j’ai connu les limites de mes yeux, je n’ai jamais pu connaître les limites de mon travail. Je suis bâti, corroyé, maçonné pour le travail.»
Le jeune Napoléon passait ordinairement le temps des vacances dans son pays natal. Il assista aux derniers moments d’un de ses parents révéré de toute la famille, l’archidiacre Lucien, dont la sagacité avait deviné les brillantes destinées de l’enfant qui plus tard traçait de sa propre main son propre portrait, si vrai, si fidèle. «Je suis d’un caractère singulier, sans doute; mais on ne serait point extraordinaire, si l’on n’était d’une trempe à part, et je suis une parcelle de rocher lancé dans l’espace.»
Autour du lit du mourant se pressaient respectueusement les membres de la famille, lorsque, prêt à quitter la terre, l’archidiacre, en leur donnant sa bénédiction, prononça ces paroles prophétiques: «Quant à la fortune de Napoléon, il est inutile d’y songer, il la fera lui-même. Joseph, tu es l’aîné de la famille, mais souviens-toi que Napoléon en est le chef.» Il faut l’avouer, la prédiction n’a pas été démentie. Dans ce temps, Charles Bonaparte, âgé de trente-huit ans seulement, succomba à une maladie cruelle. «C’était, a dit son illustre fils, un homme plein de courage et de pénétration Il aurait marqué s’il eût vécu.»
Napoléon resta à l’École de Brienne jusqu’à l’âge de quatorze ans. En 1783, M. le chevalier de Keralio, inspecteur des douze écoles militaires du royaume, vint visiter l’École. Il fut si frappé de la haute intelligence du jeune Bonaparte, de la solidité de son instruction, qu’il lui accorda une dispense d’âge et la faveur d’un examen pour être admis à l’École-Militaire de Paris. Un recueil manuscrit, qui a appartenu à M. le maréchal de Ségur , alors ministre de la guerre, renferme la note suivante:
«École des élèves de Brienne. État des élèves du roi, susceptibles, par leur âge, d’entrer au service ou de passer à l’École de Paris, savoir: M. de Bonaparte (Napoléon), né le 15 août 1769, taille de quatre pieds dix pouces dix lignes, a fait sa quatrième: de bonne constitution, santé excellente, caractère soumis, honnète et reconnaissant, conduite très-régulière, s’est toujours distingué par son application aux mathématiques; il sait très-passablement son histoire et sa géographie; il est assez faible dans les exercices d’agrément et pour le latin, où il n’a fait que sa quatrième; ce sera un excellent marin.: il mérite de passer à l’École de Paris.»
Le 22 octobre 1784, Napoléon était admis à l’École-Militaire. Parmi les élèves il fut le premier mathématicien. Laplace a dit de lui: «Il n’y a qu’avec lui que j’aie plaisir de causer mathématique et physique; il comprend tout; il va au delà de tout.»
M. de l’Éguille, son professeur d’histoire, le notait ainsi dans ses rapports sur l’École: «Corse de nation et de caractère, il ira loin, si les circonstances le favorisent. » On le trouvait même si avancé, qu’on voulait le faire passer sous-lieutenant d’emblée.
Au sein de ses études, de ses succès qui tenaient du prodige, les pensées de Napoléon s’inspiraient de la parole de Dieu; il reflétait le rayon providentiel qui illuminait son âme. Le cardinal Fesch disait à M. Olivier Fulgence : Il est bien fâcheux que je n’aie pas ici les Mémoires que j’ai écrits sur sa conduite privée et publique; j’en ai plus de dix volumes enterrés en France avec mes papiers..... si j’avais seulement une lettre qu’il m’écrivit de l’École-Militaire. «Mon oncle, m’écrivait-il le jour de sa première communion, rien n’est comparable aux joies que j’éprouve; je voudrais pouvoir consacrer à Dieu ma force tout entière et combattre pour lui au moins de la parole: les occupations de l’École ne me permettent pas de me livrer, comme il conviendrait, à la vie. contemplative; mais au moins je sens avec un bonheur réel qu’à travers mes travaux et la carrière où je m’engage, je marche catholique et dans la foi de mon père.»
La carrière militaire de Napoléon commença à seize ans; à la suite d’examens brillants, il fut nommé, le 1er septembre 1785, lieutenant en second au régiment d’artillerie de la Fère alors en garnison à Grenoble, et il passa bientôt dans un autre régiment en garnison à Valence; il était capitaine le 6 février 1792.